|
|
« Bénin aller-retour – Regards sur le
Dahomey de 1930 »
exposition musée Albert Kahn Boulogne
Billancourt
jusqu’au 14 juin 2026 |
|
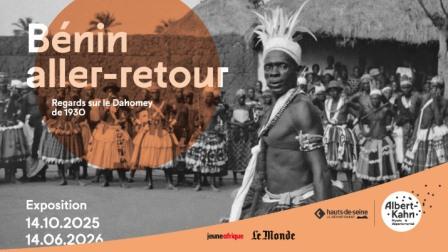
Une
expo découverte entre transmission et émotions…
Visiter l’exposition « Bénin aller-retour » au musée Albert Kahn tient
plus du voyage à la fois géographique et dans l’espace-temps que de la
pure enquête ethnographique, aussi précise et soignée soit-elle ! Car, il
faut l’avouer, toute la « magie » Albert Kahn – tant celle de la
personnalité de ce philanthrope et visionnaire que fut Albert Kahn que
celle envoûtante du lieux même, opère encore délicieusement en ce XXIe
siècle pourtant blasé d’images et d’effets dits spéciaux…
Le temps d’une exposition, en effet, une ancienne caméra, des photogrammes
et quelques autochromes font à eux seuls revivre un pan entier d’une
société qui dans les années d’avant-guerre connut une transition
culturelle et politique radicale. La fascination exercée par ces films
venant d’être numérisés en haute définition (4K) gagnera même le plus
distrait des visiteurs qui découvrira alors par ces bribes le vivant
témoignage d’une société encore ancrée sur ses croyances traditionnelles
bousculées par celles du nouvel arrivant colonisateur. Si le Dahomey de
l’époque, l’actuel Bénin, eut la « chance » de profiter de l’ouverture
d’esprit du prêtre missionnaire Francis Aupiais, la pellicule put quant à
elle graver pour l’éternité ces cérémonies secrètes, jamais filmées alors.
Ce fut l’occasion de nourrir un certain dialogue entre le regardant et le
regardé, conduisant à de multiples entrecroisements et transferts
culturels analysés, naguère, par le couple d’ethnologues Melville et
Frances Herskovits, quelques années après Aupiais.
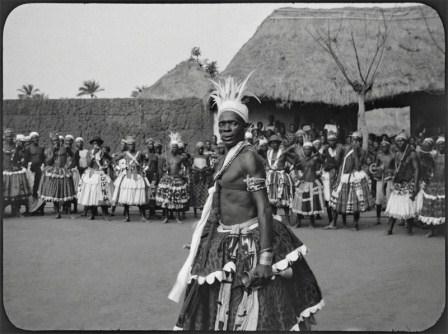
Vodúnon exécutant la danse d’Héviosso, Oumbégamé (près d’Abomey), Dahomey
(Bénin), 1930 (F. Gadmer, photogramme extrait de la bobine « Fétichisme 1,
110153) © Musée Albert-Kahn/CD92
Julien Faure-Conorton et David-Sean Thomas, commissaires de l’exposition,
ont conçu un parcours à la fois ambitieux, et parfaitement réussi,
présentant les différentes facettes de la culture du Dahomey de l’époque,
en n’écartant pas les limites critiques quant à l’action colonisatrice,
sans pour autant se limiter à ce seul aspect. L’évangélisation « éveillée
» du père Aupiais, soucieux d’associer et d’intégrer au christianisme la
puissante religiosité du culte vodun estompera ainsi les visions,
souvent caricaturales, du « méchant » missionnaire blanc… Parallèlement,
cet homme de foi et de culture n’épargna pas sa peine pour donner toute sa
grandeur à cette culture africaine auprès du public français dès son
retour, une campagne qui avait fort à faire avec les nombreux préjugés qui
dominaient dans l’opinion publique.
Le visiteur pourra ainsi déambuler au fil des salles au cœur même de la
société dahoméenne avec ses scènes villageoises, ses nombreuses cérémonies
suggérant le complexe rapport entretenu entre les vivants et les morts,
les hommes et les divinités. Même si quelques tournages furent l’occasion
d’être quelque peu « encadrés » par Aupiais et son collaborateur Frédéric
Gadmer, opérateur technique des Archives de la Planète d’Albert Kahn, la
magie gagne le visiteur qui aura la surprise de constater que ce dialogue
entre le Nord et le Sud se trouve encore aujourd’hui prolongé par de
passionnantes installations et œuvres d’art d’artistes béninois
contemporains ! |
A noter, également, toujours au musée Albert Kahn, une très belle et
émouvante installation de l’artiste 1011 intitulée « Fleurs de guerre »
réunissant des dessins de fleurs dites obsidionales disséminées lors des
guerres et des déplacements de population. Associant le nom d’un soldat
mort lors de la Grande Guerre au dessin d’une de ces plantes, l’artiste a
souhaité ainsi posé un autre regard sur ces témoins souvent silencieux et
chahutés – à l’image de ces jeunes soldats – par le vent de l’Histoire…
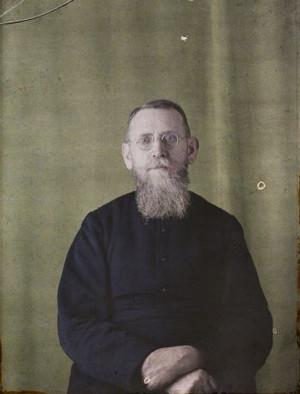
Portrait du révérend père Aupiais, Boulogne-sur-Seine, 9 août 1927
(A. Léon, autochrome A51431) © Musée Albert-Kahn/CD92
« Bénin aller-retour. Regards sur le Dahomey de 1930 » ; Catalogue
d’exposition sous la direction de Julien Faure-Conorton et David-Sean
Thomas, Editions RMN-Grand Palais / Musée départemental Albert-Kahn, 2025.
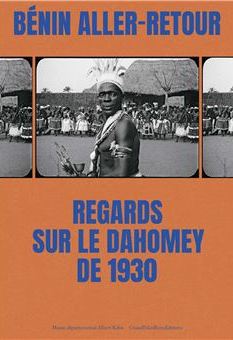
Le catalogue de l’exposition « Bénin Aller-retour – Regards sur le Dahomey
de 1930 » complètera idéalement la visite de l’exposition éponyme au musée
Albert Kahn. Sous la direction de Julien Faure-Conorton et David-Sean
Thomas, cette somme publiée aux éditions Grand Palais Rmn offrira une
masse documentaire et une sélection d’articles des plus éclairants pour
comprendre cette Mission, réalisée il y a près d’un siècle, au sud de
l’actuel Bénin. Présentant, en effet, tout d’abord la Mission « Dahomey »
de 1930 à partir des Archives de la Planète réunies par Albert Kahn, le
catalogue rappelle les conditions de mise en œuvre des prises de vue,
entre mise en scène et images prises sur le vif, posant là toute la
question de la place de l’ethnologue et de sa prétendue neutralité.
Au-delà de ces questionnements, cette Mission permit de dresser un
portrait du Dahomay à cette époque et d’en conserver ainsi la mémoire,
qu’il s’agisse de la vie quotidienne, culturelle ou spirituelle. Sans
écarter le contexte colonialiste dans lequel la Mission s’inscrivit, la
documentation accumulée permit de capter de nombreuses cérémonies
disparues depuis. A l’image de l’exposition, le catalogue réunit une
impressionnante documentation, ainsi que des liens QR code permettant
d’avoir accès à un grand nombre de films d’archives captés entre janvier
et mai 1930. Dressant, enfin, un état des lieux de la recherche
contemporaine, l’ouvrage invite le lecteur à un questionnement approfondi
sur le rapport entretenu entre ces archives et nos contemporains.
Une mémoire du Bénin préservée et partagée que cet ouvrage encourage à
redécouvrir. |
|
Delícias Caffe
Musée Albert-Kahn |
|

Le Delícias Caffe, installé au cœur du Musée Albert-Kahn, constitue une
belle porte d’entrée à l’universalisme prôné par le célèbre philanthrope.
Ouverte aux influences du monde, que ces dernières viennent de la
Méditerranée, de l’océan Atlantique ou de ses anciennes colonies, la
cuisine portugaise proposée par le Delícias Caffe invite aux évasions, et
Sameiro, sa directrice, aura à cœur de faire partager à ses hôtes des
plats fait maison et de beaux produits rigoureusement sélectionnés.
Qu’il s’agisse d’une petite pause gourmande au fil de sa visite au musée
Albert Kahn ou d’un déjeuner à part entière, seul ou entre amis, le
Delícias Caffe offre, en effet, de nombreux plats gourmands portugais
telle cette incontournable brandade de bacalhau réalisée dans les règles
de l’art agrémentée d’une habile touche personnelle, et accompagnée de ses
crudités et pain maison. Générosité encore pour ces mets traditionnels
rissois de carne, Tosta Mista ou encore Francesinha. |
Pour chaque recette, Sameiro ne ménage pas sa peine afin de partager sa
passion de la restauration portugaise traditionnelle héritée notamment de
sa grand-mère et d’une expérience de trente ans dans la restauration.
Les desserts de Sameiro réjouiront également les plus gourmands amateurs
de délices sucrées : les incontournables Pastéis de Nata mais aussi de
généreux gâteaux faits maison ouverts aux saveurs du monde, en écho aux
univers d’Albert Kahn...
Le Delícias Caffe propose ainsi, chaque jour et à chaque heure, des mets
toujours réinterprétés habilement, saveurs venues de la mer ou de la terre
qui rappellent avec délices les ruelles de Lisbonne ou les rives du Douro
à Porto, et ce, avec cette prévenance à chaque instant digne de
l’hospitalité portugaise.
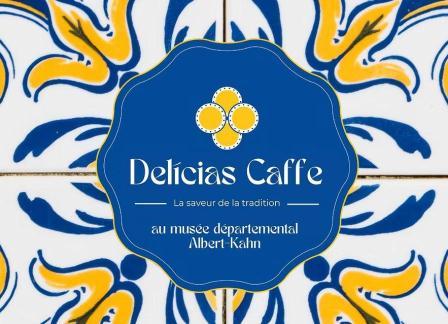
A noter qu’au printemps 2026, un nouveau restaurant ouvrira en plus et
au-dessus du Delícias Caffe, une adresse avec terrasse toujours dirigée
par Sameiro et qui proposera une carte résolument ouverte aux cuisines du
monde à l’image de ces lieux enchanteurs que sont les jardins et le musée
d’Albert Kahn… une adresse à suivre, donc ! |
|
|
|
« Le Grand Dauphin (1661-1711)
Fils de roi, père de roi et jamais roi »
Exposition Château de Versailles
jusqu'au 15 février 2026 |
|
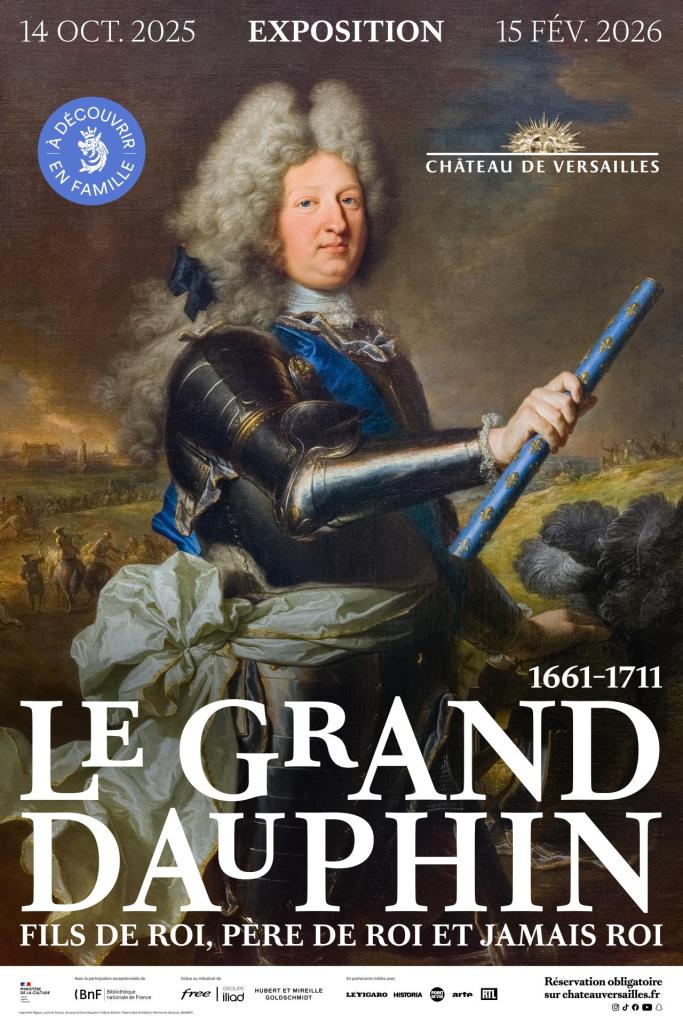
C’est à une figure étrangement négligée, et pourtant si proche du pouvoir
absolu du Grand Siècle, à laquelle s’attache une riche exposition au
château de Versailles : celui que l’on nommait le Grand Dauphin ou
Monseigneur, fils de Louis XIV et qui aurait dû régner à sa mort.
Reprenant la sentence lapidaire et quelque peu irrespectueuse de
Saint-Simon - « Fils de roi, père de roi, et jamais roi », le commissaire
de l’exposition Lionel Arsac a retenu cette formule sans concession, mais
historique pour diviser le parcours de l’exposition en trois sections
selon une scénographie particulièrement inspirée de Philippe Pumain.
Evitant les chronologies et autres généalogies quelque peu absconses,
l’exposition retrace ainsi le destin de Louis de France, un homme que tout
devait conduire au pouvoir dès son plus jeune âge avec une éducation digne
d’un Dauphin et présentée dans le détail avec, notamment, des précepteurs
prestigieux tels que notamment le grand Bossuet…Mais le destin en décida
autrement. |
A défaut d’être roi, le Grand Dauphin connaîtra cependant au moins le
plaisir de voir l’un de ses trois fils, le duc d’Anjou, devenir roi
d’Espagne en 1700, sous le nom de Philippe V, avant de décéder à l’âge de
49 ans en 1711, quatre ans avant son père Louis XIV… Les deux frères du
Duc d’Anjou, et fils du Grand Dauphin, étant morts en 1715 à la mort de
Louis XIX, ce sera donc, ainsi, l’un de ses arrière-petits-fils qui
deviendra à la mort du Roi Soleil, à cinq ans, Louis de France avant de
devenir en 1710, Louis XV dit aussi « Le bien aimé ».

Pierre Mignard
La famille du Grand Dauphin, Louis de France (1661-1711)
Ce fut dans les arts et les divertissements que se réfugiera le Grand
Dauphin, et là réside certainement l’attrait de cette belle exposition :
Chasse, musique, théâtre… Le visiteur pourra également rêver devant le
faste de ses collections avec la présentation notamment de quelques
chefs-d’œuvre de pierres dures et autres gemmes d’exception (superbe
aiguière en héliotrope), des tableaux remarquables dont un Raphael ou
encore un Poussin (La nourriture de Bacchus) qui raviront le regard. Tous
les arts sont convoqués et le goût de Louis de France dit aussi « Le Grand
Dauphin » s’imposera tout au long du parcours de cette riche et belle
exposition. |
|
|
|
«
Rosso et Primatice : Renaissance à Fontainebleau »
Exposition Beaux-Arts de Paris
jusqu’au dimanche 1er février 2026 |
|

L’exposition, actuellement présentée au musée des Beaux-Arts de Paris,
nous propose de découvrir les coulisses ayant présidées à la décoration du
château de Fontainebleau sous le règne de François 1er. Deux grands
artistes italiens, Rosso Fiorentino et Francesco Primaticcio - dit Le
Primatice, furent conviés par le monarque amoureux des arts afin de
réaliser les décors peints et sculptés de Fontainebleau. Mais, ces deux
incontournables artistes ne furent cependant pas seuls pour cette mission,
et d’autres artistes d’importance leur furent également associés. C’est
donc à Rosso et Primatice, mais aussi à leur entourage de prestige auquel
s’est attaché la présente exposition, ainsi que le relève le dicteur des
Beaux-Arts de Paris Eric de Chassey : « L’exposition met justement en
valeur les deux artistes majeurs qui ont été conviés en France par
François Ier – le Florentin Rosso et le Bolonais Primatice – mais se
distingue des expositions consacrées à leurs dessins ou au chantier de
Fontainebleau par la part faite aux graveurs qui leur furent associés sur
le lieu et ne furent pas seulement des interprètes habiles des
compositions de ces deux maîtres mais aussi des inventeurs de formes et
des expérimentateurs de la technique nouvelle de l’eau-forte, qu’ils
renouvelèrent en profondeur ».

Francesco Primaticcio "L’Automne sous la figure de Bacchus"
Plume, encre brune, lavis brun et rehauts de blanc sur papier brun, 22,2 x
12,8 cm
©
Beaux-Arts de Paris
A partir d’une cinquantaine de dessins et estampes, le parcours de
l’exposition conçu par les deux commissaires Hélène Gasnault et Giulia
Longo permet de retracer la genèse de cet immense chantier qui fut alors
l’occasion d’introduire la maniera italienne par le truchement des deux
artistes invités et dont Rosso Fiorentino fut l’un des grands
ambassadeurs. |
Qu’il s’agisse des œuvres préparatoires à la décoration de la Galerie
d’Ulysse et de l’appartement des Bains du château, aujourd’hui disparus,
mais aussi de la Salle de Bal, de la Galerie François 1er ou encore de la
Porte Dorée, un impressionnant « laboratoire iconographique » se mit alors
à l’époque en place, « Laboratoire iconographique » dont le visiteur de
l’exposition aura un heureux et inspirant aperçu par les dessins et
estampes présentés. Les thèmes choisis – alternant entre Histoire Sainte
et mythologie – les styles et formes retenus, conduisent à imprimer une
inspiration italienne à la décoration du château qui sera le point de
départ de la diffusion artistique de la Renaissance tardive dans tout le
royaume. Le parcours soulignant la force et la maîtrise des créations des
deux grands artistes Fiorentino Rosso et le Primatice, met également en
avant des artistes plus méconnus et influencés par les deux grands maîtres
italiens : Léon Davent, Antonio Fantuzzi, Jean Mignon, Juste de Juste,
entre autres.

Rosso Fiorentino "Pandore libérant les fléaux de sa boîte"
Plume, encre brune et lavis brun,
tracé préparatoire à la pointe de plomb sur papier, 24,2 x 39,3 cm
©
Beaux-Arts de Paris
Le visiteur s’émerveillera ainsi de la délicatesse de cette Etude de
draperies et de pieds de Primaticcio, de la virtuosité de cette feuille
signée Nicolo dell’Abate évoquant Le Parnasse, ou encore de cette
Eau-forte de Léon Davent réinterprétant, probablement à sa manière, le
thème biblique de Rebecca donnant à boire à Eliezer au livre de la Genèse.
Carnet d’études n°60, 200 ×
225 mm , 192 pages, Beaux-Arts de Paris Editions, 2025.

Afin de compléter idéalement cette visite dans l’intimité toujours
inspirante du Cabinet d’arts graphiques du musée des Beaux-Arts de Paris,
le visiteur se reportera avec profit au catalogue très complet avec des
textes d’Hélène Gasnault et Giulia Longo, co-commissaires de l’exposition,
mais aussi les contributions de Luisa Capodieci, professeure d’Histoire de
l’art moderne et membre du Conseil scientifique du château de
Fontainebleau, et de Dominique Cordellier, conservateur général du
patrimoine honoraire. Un catalogue au format carré, toujours aussi soigné,
et qui fête à l’occasion de cette exposition « Rosso et Primatice :
Renaissance à Fontainebleau » son 60e numéro ! |
|
|
|
Gerhard Richter
Exposition Fondation Louis Vuitton
jusqu'au 2 mars 2026
|
|

La Fondations Louis Vuitton propose une rétrospective d’envergure
consacrée au peintre Gerhard Richter en réunissant pas moins de 275 œuvres
de l’artiste réparties en un parcours chronologique sur trois niveaux,
comme il se doit, en ce lieu de la capitale devenu incontournable. Les 34
salles du bâtiment conçu par l’architecte Frank Gehry composent en effet
un écrin de choix pour évoquer l’ampleur de la création du peintre
allemand né à Dresde en 1932 et qui s’échappa de la RDA avant de
s’installer à Cologne où il vit et travaille encore aujourd’hui. Si
l’œuvre de Richter n’est plus à présenter tant elle a été consacrée par
les plus grandes institutions, c’est cependant la première fois que son
riche parcours est évoqué en France, allant de 1962 – à nos jours. Richter
est l’un des rares artistes à dater très précisément ses toiles, sa
première œuvre intitulée Tisch (table) remonte à 1962, celle-ci reniant
tout ce qu’il avait fait auparavant, selon ses souhaits. Aujourd’hui, âgé
de 93 ans, l’artiste continue toujours non pas à peindre, mais à dessiner,
ce dernier ayant décidé d’arrêter de peindre en 2017.

© Lexnews
La première impression qui dominera le visiteur tout au long de cet
admirable parcours est que Gerhard Richter est un artiste à part entière
qui ne cesse de questionner son art, non seulement avant de le créer, mais
surtout au cours de son processus de création. En établissant,
progressivement, des immixtions de plus en plus fréquentes d’abstraction
dans son travail figuratif, ce processus se complexifiera pour gagner de
nouvelles dimensions échappant au premier regard, mais s’imposant à force
d’observation. Richter par le truchement de ses œuvres instaure un rapport
quasi hypnotique. Celui qui se revendique être « un faiseur d’images »,
quels que soient les nombreux médiums utilisés, n’a cessé de questionner
la surface de la toile, la matière picturale, les effets successifs du
pinceau et du racloir. L’image surgit alors subrepticement, parfois à
l’insu de l’artiste, pour s’imposer en une composition quasi extatique
convoquant le hasard, mais un hasard bien compris.

© Lexnews
Tel est le cas notamment de ses peintures Cage en hommage au grand
compositeur avec lequel cette partie de son œuvre nourrit des liens
manifestes. Ce rapport à l’œuvre, se réalisant essentiellement au sein de
son atelier, n’est pas sans quelques rapprochements avec la ferveur qui
étreignit Michel-Ange avec la Sixtine au point de se fondre avec elle.
Questionnant inlassablement toutes les formes qui pouvaient exprimer son
art, c’est sans nul doute ses abstractions qui imposent le respect, la
métamorphose provoquée par le cycle des Titien en étant la meilleure
preuve. Du modèle initial (la plupart du temps une photographie) à sa
décomposition naît une expression nouvelle, n’excluant pas pour autant les
réminiscences, Richter n’étant pas pour autant un adepte de la tabula
rasa.
Aussi le visiteur pourra au fil des salles s’imprégner de ces images,
parfois perceptibles, d’autres fois suggérées, façonnant un rapport à
l’œuvre éminemment subjectif que sa longue contemplation nourrit. Richter
ne cherche pas à imposer son travail, mais lance autant d’invitations à le
contempler, ce qui n’est pas le moindre de ses mérites. |
Catalogue « Gerhard Richter » de Nicolas et Dieter Schwarz, 400 ill.,
416 p., Editions Mazenod, 2025.

Pour accompagner la rétrospective consacrée à Gerhard Richter à la
Fondation Vuitton, il fallait assurément un catalogue d’envergure, ce
qu’ont décidé les éditions Mazenod en confiant sa réalisation à deux des
meilleurs spécialistes du peintre allemand en la personne de Nicholas
Serota et Dieter Schwartz, tous deux historiens de l’art. Ainsi que le
rappellent les auteurs de ce somptueux catalogue, parvenant à saisir la
richesse et la beauté du travail de l’artiste, l’œuvre de Richter explore
les potentialités de la peinture, questionnant inlassablement sujets et
médiums.
Évoquant la part personnelle vécue de l’artiste et son environnement,
l’ouvrage élargit ces influences pour mettre en évidence l’atemporalité du
travail de Richter, une image du monde dépassant les contingences et les
frontières. Le lecteur aura grand intérêt à découvrir l’essai introductif
« Regarder en arrière, regarder en avant » des deux auteurs permettant de
mieux comprendre la genèse et l’originalité du parcours du peintre qui
reçut une formation des plus classiques, ce qui ressort de la perfection
de son trait dans ses œuvres figuratives.

Pour la période 1962-1970, André Rottmann évoque, quant à lui, le réalisme
restitutif de Richter, un artiste délaissant le modèle selon la nature,
pour lui préférer la photographie. Le flou s’invite dans ces tableaux
conçus selon des règles héritées du classicisme, des traits et hachures
introduisent des ruptures annonciatrices de l’abstraction future avant de
parvenir à la période 1971-1975 évoquée par Michael Lüthy avec les œuvres
conceptuelles de Gerhard Richter, notamment celles du cycle Titien, et de
manière plus éclatante avec les Grau.

De 1976 jusqu’à 1986, les peintures abstraites brisent les frontières
entre le sujet et l’aboutissement final de l’œuvre, notamment par l’usage
essentiel chez Richter du racloir. A partir de cette période, le peintre
n’aura de cesse de questionner ses sources d’inspiration : les années
sombres (1987-1995) comme les frontières du hasard (1996-2010) qui
donneront naissance à l’apothéose du travail de l’artiste notamment avec
Birkenau, un aboutissement lourd de sens pour celui qui n’a jamais cessé
de questionner les images du monde.
|
|
|
|
Berthe
Weill. Galeriste d’avant-garde
Musée de l'Orangerie
jusqu'au 26 janvier 2026 |
|

Si la notion d’ « avant-garde » paraîtra évidente aux visiteurs qui
découvriront cette belle exposition consacrée à Berthe Weill au musée de
l’Orangerie ; une femme, pourtant, bien méconnue au regard de sa
clairvoyance, elle qui ouvrit dès 1901 une galerie réunissant les futurs
maîtres incontestés de l’art du XXe s. Ce chemin ne se fit cependant pas
sans encombre, surtout pour une femme, de surcroît, de confession juive en
ce début de siècle anti-dreyfusard… Mais, il en fallait plus pour
décourager celle qui confessait « Ma résolution est inébranlable ; on
verra bien ! ».
Le 25, rue Victor-Massé dans le quartier de Pigalle deviendra ainsi le
point de ralliement de nombreux artistes, cette communauté du bas de
Montmartre vivant la plupart du temps dans un dénuement complet. Malgré
cette adversité, Berthe Weill saura développer des trésors d’inventivité
afin d’apporter une aide réelle à ces artistes et faire vivre sa propre
galerie.

Maurice de Vlaminck (1876-1958)
Le Restaurant de la Machine à Bougival, 1905
Huile sur toile 60,0 x 81,5 cm
Paris, musée d’Orsay, Donation Max et Rosy Kaganovitch, 1973
© Musée d’Orsay, dist. GrandPalaisRmn / Patrice Schmidt
© Adagp, Paris, 2025
La vente de livres, la présentation de gravures et d’illustrateurs
contribueront ainsi à apporter non seulement une aide financière, mais
également à établir sa réputation. Viendront alors les temps de
l’inspiration, ceux conduisant Berthe Weill à reconnaître les talents d’un
jeune peintre espagnol tout juste arrivé de Barcelone, un certain Pablo
Picasso…. |
Alors même que les tableaux de sa période bleue n’intéressaient guère
personne, Berthe Weill lui achète ses premières œuvres dont le fameux « Le
Moulin de la Galette ». Nombreux seront les artistes également repérés par
la galeriste décidément inspirée : Matisse, Maurice de Vlaminck, André
Derain, Albert Marquet, Raoul Dufy… dont certaines de leurs œuvres sont
exposées dans le parcours comme pour mieux rappeler la perspicacité de
cette femme atypique.

Raoul Dufy (1877-1953)
30 ans ou la Vie en rose, 1931
don Mathilde Amos, 1955
© CC0 Paris Musées / Musée d’Art Moderne de Paris
Fauvisme et cubisme attirent Berthe Weill alors même que la plupart de ces
artistes étaient décriés par la critique assassine. Toujours le combat
animera Berthe Weill, même lorsqu’à la fin des années 30, l’antisémitisme
récurrent gagnera la capitale et rendra les temps difficiles pour une
femme juive qui plus est marchande d’art.

Émilie Charmy (1878-1974) Autoportrait, 1906-1907
Huile sur toile 81 × 65 cm Collection particulière
Photo: © Studio Gibert. courtesy Galerie Bernard Bouche
© Adagp, Paris, 2025
Malgré cette adversité, Berthe Weill poursuivra son combat et exposera
encore nombre d’artistes à cette époque méconnus : Otto Freundlich, Alfred
Réth, et bien d’autres encore profitant de la générosité de cette femme
qui, si elle survivra aux temps de guerre, disparaîtra dans le plus grand
dénuement en 1951 après avoir fait briller certaines étoiles de l’art qui
lui doivent une partie de leur éclat.
|
|
|
|
Exposition « Rêveries de pierres – Poésie
et minéraux de Roger Caillois »
L’Ecole des Arts Joailliers, Paris 9e
jusqu'au 29 mars 2026 |
|
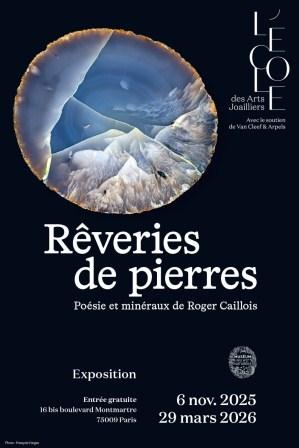
Au 16 bis boulevard Montmartre à Paris, une
exposition éblouissante attend le visiteur curieux de découvrir une
sélection des minéraux et autres pierres ayant appartenus à l’académicien
Roger Caillois, esprit à la fois curieux et émerveillé des rapports entre
nature et art. C’est sa voix qui retentira dès la première salle rotonde
plongée dans une douce pénombre propice aux premiers scintillements réunis
en droite lignée des esthètes de la Renaissance et du romantisme allemand
ayant anticipé cette passion des pierres. Roger Caillois est un érudit
collectionneur ainsi que le présente l’exposition conçue avec un rare sens
de l’esthétique et de la rigueur scientifique par le professeur François
Farges. Nous voici ainsi plongés en effet entre art et sciences, un espace
qui sut saisir Roger Caillois dès ses premiers contacts avec le monde
minéral avec lequel il ne cessera dès lors d’entretenir un rapport fait de
passions et d’attractions complexes que rappelle le parcours admirablement
scénographié.
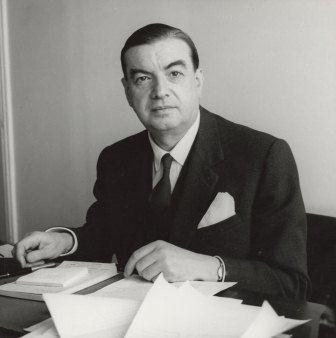
Ce dernier parvient à ressusciter cette fascination
en réunissant près de deux cents spécimens sur les mille que comptait la
collection Roger Caillois acquise depuis 2017 par le Museum national
d’histoire naturelle de Paris. A chaque vitrine, des pages reproduisant
des textes de l’écrivain-essayiste, auteur notamment de « Pierres » et de
« L’Ecriture des pierres ». Grâce ce parcours développant progressivement
les rapports complexes et intimes de Roger Caillois avec l’univers
minéral, l’exposition retrace ces mémoires de pierres, évoque ces
sculptures secrètes ou encore ces démons de l’analogie et autres images
crépusculaires qui ne cessèrent de hanter l’écrivain.
Signes, réminiscences, analogies et même
transcendance tissent ainsi un réseau complexe particulièrement éclairé
par les minéraux réunis dans les différentes vitrines en autant de témoins
silencieux résonnant avec les textes voisins de Roger Caillois. Le point
d’orgue sera au terme de cette éblouissante visite constituée par l’ultime
recueil « Pierres anagogiques » de Roger Caillois que son décès brutal
empêcha de finaliser et qui vient de paraître aux éditions Gallimard.
|
« Roger Caillois Pierres anagogiques » ; Édition
critique et photographies de François Farges, professeur au Muséum
national d’histoire naturelle, Editions Gallimard / L'École des Arts
Joailliers, 2025.

Le goût absolu de Roger Caillois pour les pierres
n’est plus à rappeler, l’académicien leur ayant consacré, en plus d’une
collection exceptionnelle, des ouvrages passés depuis longtemps au statut
de « classiques ». Mais, au-delà de ces premières remarques, curieusement,
aucune étude poussée n’avait été jusqu’alors menée sur le rapport
entretenu par Caillois entre le processus de pensée et celui d’écriture,
source d’une prose scintillante à l’image des reflets de ses cristaux
chéris. C’est à cette tâche que s’est attelé François Farges, professeur
au Muséum d’histoire naturelle de Paris, avec un somptueux ouvrage publié
par les éditions Gallimard explorant les liens ténus reliant ces pierres «
anagogiques » à l’auteur et au lecteur.

C’est à partir des archives du fonds Caillois que
François Farges a eu, en effet, la surprise de découvrir un ensemble de
textes à la fois distincts, mais présentant néanmoins une logique qui se
dégageait progressivement laissant entrevoir la possibilité d’un ouvrage à
venir, ainsi que le détaillent de manière passionnante les annexes de ce
beau livre. Malgré les lacunes et autres difficultés rencontrées en route,
un manuscrit intitulé « Pierres anagogiques », jamais achevé, a ainsi pu
être par l’intuition fructueuse et la persévérance de François Farges
reconstitué pour donner naissance à cette passionnante édition critique.
Par le truchement de photographies somptueuses de la collection de
l’écrivain, c’est toute l’alchimie secrète qui se dévoile entre la
fascination de Roger Caillois pour ces minéraux et l’inspiration qui put
en découler pour une prose singulière. Au fil des pages, le lecteur
retrouvera en effet cette fascination quasi hypnotique de Caillois pour la
nature initiant des formes sources de mystères pour l’observateur qui
saura les percevoir. Entre onirisme et méditation poétique, la pensée de
l’écrivain se saisit de l’univers minéral comme métaphore du réel. C’est
l’aboutissement de cette passion qui se trouve en quelque sorte recueillie
avec une réussite certaine dans cet ouvrage. |
|
« Mineralia » de Domitilla Dardi, 208 p. Editions In Fine, 2025.
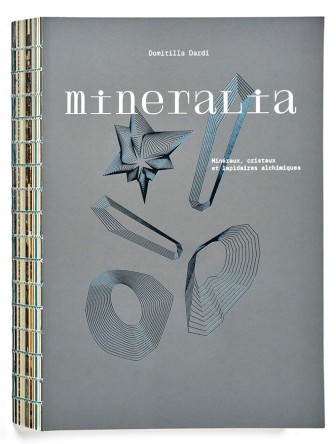
Cet ouvrage, entre beau livre et savante digression
sur le monde minéral, débute par le rappel d’une antique évocation sous la
plume de Paul Valéry et d’un dialogue platonicien entre Socrate et Phèdre.
La découverte sur la plage d’un débris à la forme indécise devient le
sujet d’une réflexion sur l’origine des formes et des objets, leur auteur
et leur finalité… Cette subtile accroche se trouve en effet être le
parfait écho du sujet de ce passionnant ouvrage entre science, esthétique
et mystère, une thématique chère notamment à l’académicien Roger Caillois
qui lui a consacrée de sublimes pages (lire notre dossier).
Avec Mineralia, l’historienne de l’architecture Domitilla Dardi poursuit,
après Herbaria, son enquête et plonge le lecteur dans l’univers fascinant
du minéral, un monde a priori inerte à la différence du monde végétal et
animal, et cependant, o combien animé au regard des multiples projections
dont il a fait l’objet depuis les débuts de l’humanité. Par la
transversalité du regard porté par l’auteur, les minéraux, cristaux et
autres lapidaires alchimiques sont non seulement objet de cet ouvrage mais
deviennent également sujet à part entière par le truchement des multiples
thèmes et réalisations auxquels ils ont donné lieu au fil de l’Histoire.
Il est difficile de trouver une discipline qui échappe à leur
scintillement, une attractivité quasi constitutive du vivant si l’on
considère ces fameuses poussières d’étoiles dont nous sommes issus. Après
avoir questionné les taxonomies minérales, l’auteur nous plonge ainsi dans
l’univers médiéval des lapidaires, celui notamment de Matthew Paris au
XIIIe s., mais également celui d’Alphonse X et bien d’autres sources
littéraires entre science et alchimie, théologie et art. Les usages
symboliques des pierres ont pris une place d’importance dans la culture
des temps anciens au point, notamment grâce à l’alchimie, d’atteindre la
connaissance absolue, mais également au risque d’en perdre la raison…
Ces pages parfois oniriques, d’autres fois pragmatiques (description
scientifique au XVIIIe s. des Champs Phlégréens par Pietro Fabris),
invitent constamment à la poésie grâce à leur esthétique soignée et à leur
remarquable iconographie.
Au terme de ce riche parcours, le lecteur ne pourra que mesurer combien
les pierres recèlent de mystères que ce livre contribue à dévoiler, et
révèlent une vitalité qu’on leur croyait, à tort, dénuée.
|
« Joyaux et pierres précieuses » ; Introduction
Judith Miller, 26, 5 x 30,8 cm, 360 pp. Editions Larousse, 2025.
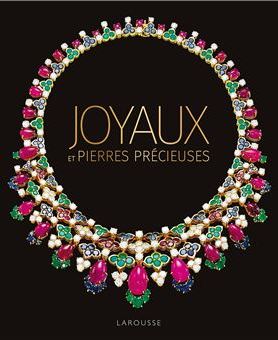
Les éditions Larousse livrent avec cet ouvrage «
Joyaux et pierres précieuses » une superbe évocation du monde fascinant
des joyaux hérités de la nature et façonnés par l’homme au fil de
l’Histoire. Judith Miller qui signe l’introduction rappelle combien les
pierres précieuses ont exercé une fascination dès les premiers temps de
l’humanité. Quel que soit les lieux et les cultures, très tôt en effet
l’homme a su porter un regard à la fois artistique et mercantile sur ces
pierres métamorphosées lors de leur transformation.

L’ouvrage abondamment illustré par de somptueuses photos rappelle, en
premier lieu, la nature et l’origine d’un minéral à l’état pur avant de
s’intéresser aux pierres gemmes, fines et précieuses comme le rubis, le
saphir, l’azurite et bien d’autres pierres plus ou moins recherchées selon
les lieux et les temps. Une section est également réservée aux gemmes
organiques que sont les perles, nacre, le jais ou encore l’ambre.
L’ouvrage se conclut sur les gemmes rocheuses et autres roches telle que
l’obsidienne, le grès, le granite.
Enfin, au terme de cet éclatant voyage, le lecteur pourra encore prolonger
sa découverte du monde minéral en s’émerveillant sur ce très pratique et
esthétique guide des couleurs pour chaque pierres précieuses et minérales.
|
|
|
|
«
Dessins des Carrache – La fabrique de la Galerie Farnèse »
Exposition jusqu’au 2 février 2026
Musée du Louvre Mezzanine Napoléon |
|
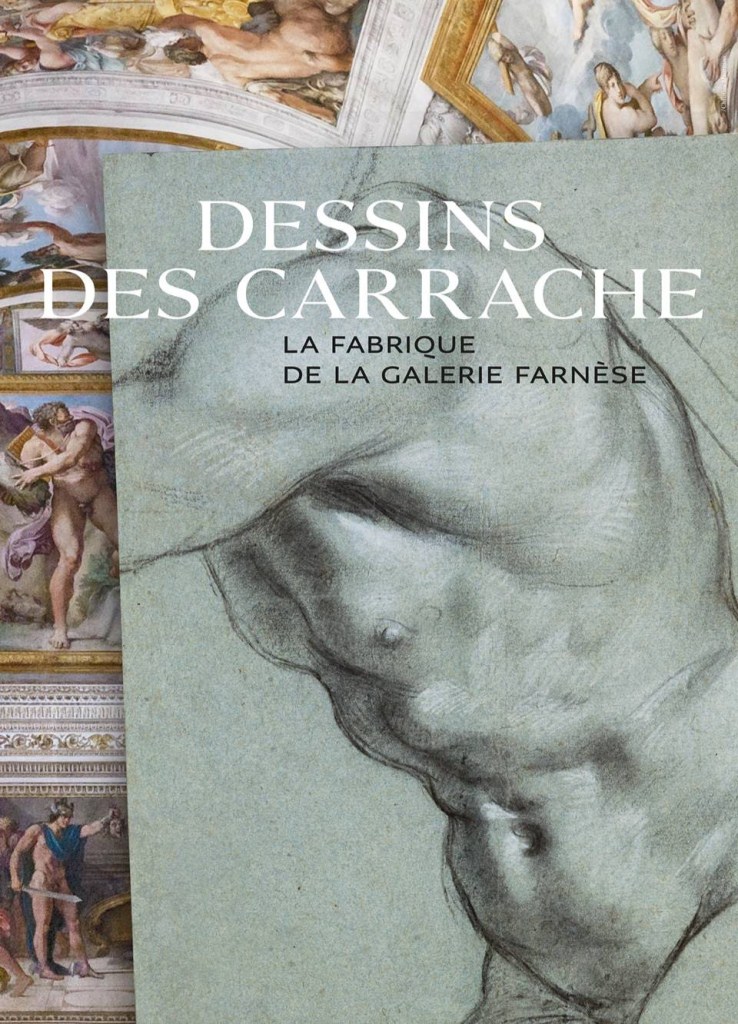
Celles et ceux qui ont eu le privilège de pouvoir découvrir la Galerie
Farnèse au cœur du palais éponyme se souviennent de la splendeur
magistrale qui saisit le visiteur en contemplant cette voûte composée par
les Carrache au XVIIe siècle. C’est à cette lente fabrique d’un chef
d’œuvre que nous convie la remarquable exposition du musée du Louvre «
Dessins des Carrache – La fabrique de la Galerie Farnèse » jusqu’au 2
février 2026 à la Mezzanine Napoléon.

©Lexnews
Le commissaire de l’exposition et conservateur Victor Hundsbuckler signe
en effet pour celle-ci un parcours éblouissant qui permet de mieux
appréhender les étapes successives conduisant à cette œuvre souvent
comparée, à juste titre, à la chapelle Sixtine du siècle précédent.
Éclatant la célèbre Galerie du palais Farnèse en autant de pièces de
puzzles composés par les dessins préparatoires, le visiteur aura
l’exceptionnelle opportunité – ces dessins étant rarement exposés - de
prendre conscience de la lente élaboration de cette fresque répondant à un
strict programme de composition ne laissant rien au hasard. Qu’il s’agisse
d’esquisses rapides jetées à la volée ou de dessins soigneusement
élaborés, préludes à la grande œuvre, l’esprit de la Galerie Farnèse se
façonne peu à peu au fil du parcours avant d’aboutir au grand carton de
plusieurs mètres de côté, à l’échelle de la fresque. |
Pour cette exposition, le musée du Louvre a le privilège de détenir la
première collection au monde de ces dessins, un héritage provenant des
anciennes collections royales françaises, sans oublier 25 œuvres prêtées
par les collections royales britanniques.

©Lexnews
L’un des attraits de cette exposition est le contraste entre la
magnificence de l’œuvre finale restituée au plafond grâce à une
scénographie immersive convaincante et la dimension humaine des Carrache,
Annibal, le principal protagoniste, mais également son frère Agostino.
Fait touchant, l’art du jeune artiste atteindra avec cette œuvre son acmé.
Après son achèvement, Annibal sombrera en effet dans une profonde
prostration certainement due à l’extrême fatigue suivant cette réalisation
et ne réalisera plus de peintures avant de mourir à l’âge de 48 ans.

©Musée du Louvre
Cette apothéose puise aux sources de la mythologie à partir des «
Métamorphoses » d’Ovide et des amours des dieux. Organisé à partir du
point de tension entre amour profane et amour sacré, chaque élément du
cycle de la fresque développe ainsi tout un langage allégorique soumis à
la sagacité des visiteurs de l’époque, jeu de piste intellectuel apprécié
au XVIIe siècle et dont l’exposition nous restitue quelques bribes, de la
plus belle des manières !
A noter le très précieux catalogue de l’exposition permettant
d’anticiper ou d’approfondir sa visite, notamment quant à la mise en scène
de la Galerie et les explications détaillées du programme iconographique
retenu par les Carrache. « Dessins des Carrache – La fabrique de la
Galerie Farnèse » de Victor Hundsbuckler, Louvre/Liénart Éditions, 2025. |
|
|
|
« Fra Angelico »-
Exposition Palazzo Strozzi - Museo di
San Marco, Florence
jusqu’au 25 janvier 2026
|
|

Voici une exposition incontournable pour les amateurs de peintures du
Gothique tardif et de la Renaissance florentine. L’exposition « Fra
Angelico », de son vrai nom Guido di Piero (1395 circa – 1455), rassemble
à Florence, en effet, plus de 140 œuvres de, et autour du, célèbre artiste
du Quattrocento, l’un des plus illustres maîtres de l’art italien. Les
commissaires de l’exposition ont réussi ce pari de réunir des œuvres
rarement exposées ensemble, notamment des retables souvent dispersés aux
quatre coins du monde et de nouveau réunis grâce au projet scientifique
des spécialistes Carl Brandon Strehlke, Angelo Tartuferi et Stefano Casciu.

L’évènement se déroule sur deux espaces prestigieux et emblématiques de
Florence : le Palazzo Strozzi et le Museo di San Marco, dernier lieu où
l’artiste vécut et où ce dernier réalisa certaines de ses plus grandes
œuvres. La scénographie remarquable retenue pour cette exposition met en
valeur des œuvres éblouissantes sur fond d’or où les matières précieuses,
tel le lapis-lazuli, révèlent et subliment la lumière. Fra Angelico,
incomparable notamment dans son art à représenter les anges, se trouve au
croisement du Gothique international et de la Renaissance en introduisant
certaines novations, notamment quant à la perspective. |
L’art du Beato Angelico s’inscrit bien entendu dans le cadre de l’art
sacré, ses œuvres évoquant non seulement des thématiques bibliques, mais
encourageant, à part entière, la méditation.
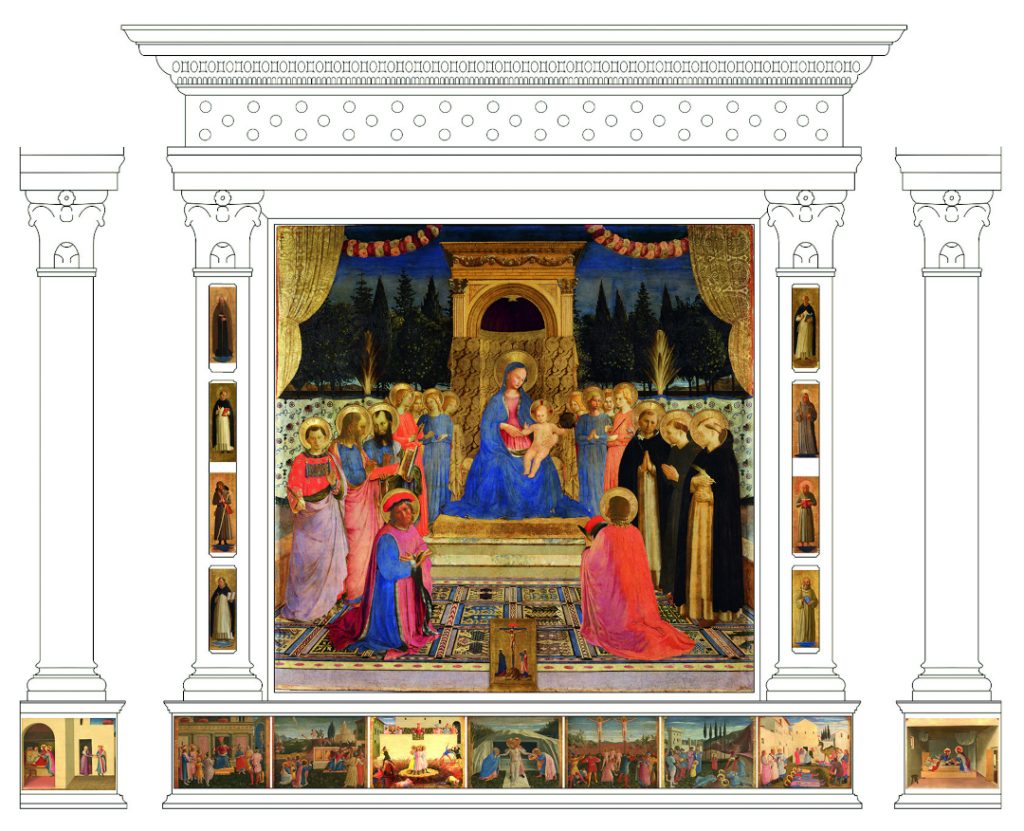
La Pala di San Marco di Beato Angelico et sa reconstitution
Le visiteur pourra ainsi découvrir, et apprécier, la technique du maître,
notamment sa manière de penser les rapports entre personnages et espace
dans l’esprit de la jeune Renaissance. Suggérant des dialogues entre le «
Peintre des anges » et d’autres artistes majeurs tels Lorenzo Monaco,
Masaccio, Filippo Lippi, mais aussi avec des sculpteurs incontournables
tels Lorenzo Ghiberti, Michelozzo ou encore Luca della Robbia. Une
exposition attendue depuis la dernière rétrospective à Florence remontant
à 1955 et qui fera date, à n’en pas douter.

A noter le remarquable catalogue (en italien) paru à cette occasion : «
Beato Angelico » a cura di Carl Brandon Strehlke con Stefano Casciu,
Angelo Tartuferi, Marsilio Arte, 2025. |
|
|
|
John Singer
Sargent - Éblouir Paris
Musée d'Orsay
jusqu'au 11.01.26
|
|
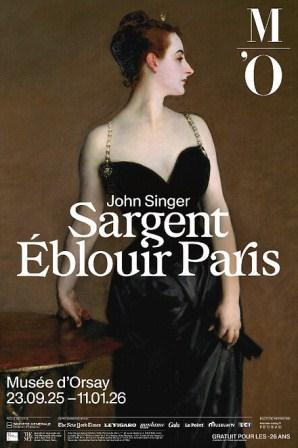
Si le peintre John Singer Sargent (1856-1925) avait fait le choix
artistique d’éblouir Paris, la capitale ne lui avait pas pour autant rendu
la pareille, oubliant celui qui avait quelque peu bouleversé les cadres
figés de la IIIe République… C’est afin de réparer cet oubli du temps que
le musée d’Orsay lui consacre aujourd’hui cette première grande
rétrospective, une manière pour le public d’apprécier un artiste par
ailleurs largement célébré en Angleterre comme aux États-unis. Aussi, en
retenant pour cette exposition plus de 90 œuvres revenant pour la plupart
d’entre elles sur le territoire qui les vit naître, le parcours ne
manquera pas d’éblouir celles et ceux qui n’auraient à l’esprit que son
contemporain italien, le fougueux Giovanni Boldini.

La Vicomtesse de Poilloüe de Saint-Périer 1883
huile sur toile sans cadre H. 159 ; L. 121 cm
Donation sous réserve d'usufruit M. Marie Louis René de Poilloüe, comte de
Saint-Périer
et
Mme la comtesse, née Suzanne Raymonde François, 1929
© droits réservés
|
Tous deux apprécièrent, il est vrai, la Belle Époque et ces femmes
élégantes ne demandant qu’à être immortalisées sur la toile. Sargent, pour
sa part, n’est pas dépourvu d’audace si l’on songe à certains de ses
portraits qui transgressèrent les codes de cette fin de siècle balbutiant
entre une aristocratie affaiblie et une bourgeoise de plus en plus
prospère. Maîtrisant rapidement les codes de cette société, John Singer
Sargent n’hésitera pas effectivement à choquer en représentant
l’américaine Virginie Gautreau en « femme fatale », preuve s’il en était
que cette société encore prude tolérait les écarts de morale à la
condition qu’ils demeurent cachés.
Mais l’exposition a fait choix de dévoiler également d’autres facettes que
ce chef-d’œuvre inexorablement associé à l’artiste en présentant ses
peintures « de voyages » privilégiant le réalisme et le naturalisme,
notamment ses « instantanés » pris sur le vif à Venise. Et, bien entendu,
en présentant nombre de ses portraits puisque c’est, avant tout, en tant
que portraitiste que l’artiste s’imposera, peu de temps après être arrivé
dans la capitale française.

John Singer Sargent, "La
Carmencita" (vers 1890)
229 x 140 cm - Musée d’Orsay
© Musée d'Orsay /
Laëtitia Striffling-Marcu
Entre 1877 et 1884, Sargent s’affirme, en effet, en tant que portraitiste
de talent dont la virtuosité n’occulte pas pour autant, bien au contraire,
le caractère de chacun de ses sujets. Dans cet art toujours difficile
entre flatterie et fidélité, Sargent parvient à garder une juste mesure,
ces miroirs renvoyés reflétant souvent plus encore le portrait de la
société de son époque que celle de ses modèles. Qu’il s’agisse de ces
belles insouciantes ou de ces besogneuses femmes du peuple, Sargent
excelle dans l’art de rendre chaque sujet unique en son genre, une époque
qui retrouve ainsi vie en ce XXIe siècle à Orsay. |
|
|
|
Exposition Jean-Baptiste Greuze
Petit Palais
jusqu’au 25 janvier 2025
|
|
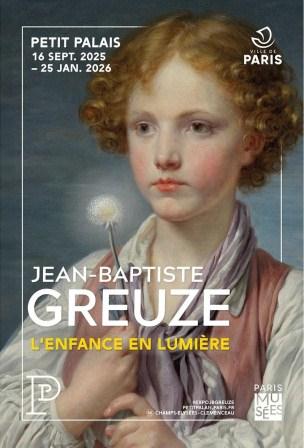
Il est des peintres de nos jours méconnus et pourtant célèbres en leur
temps. Le peintre français du XVIIIe siècle Jean-Baptiste Greuze compte
parmi eux et l’actuelle exposition que lui consacre le Petit Palais vient
réparer cet injuste oubli. Les commissaires de cette rétrospective, Annick
Lemoine, Yuriko Jackall et Mickaël Szanto, ont retenu le thème de
l’enfance, si important chez l’artiste, en une scénographie inspirée et
évocatrice de l’univers du Siècle des Lumières.

Jean-Baptiste Greuze, Un enfant qui s’est endormi sur son livre, dit Le
Petit paresseux, 1755.
Huile sur toile, 65 × 54,5 cm. Montpellier, musée Fabre.
(© Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole / Photo Frédéric
Jaulmes)
C’est en effet au cœur de l’intimité de ce siècle marqué par tant de
philosophes essentiels tels Rousseau, Diderot ou encore Montesquieu que
s’inscrit le travail de Jean-Baptiste Greuze (1725-1805) qui connut le
succès avec les deux derniers monarques Louis XV et Louis XVI avant de
sombrer dans la déchéance et l’oubli. L’homme sut saisir l’esprit de son
temps, reléguant le faste à l’arrière-plan pour mieux privilégier
l’intimité des caractères de ses sujets.La dimension psychologique inspire
manifestement son pinceau, qui délaisse la pompe au profit d’un trait
indiscutablement virtuose, mettant en avant l’éclairage et la sensibilité
des âmes saisies sur la toile. |
L’enfance a sa prédilection car elle se joue des masques et affiche,
souvent, une insouciance encore préservée, ainsi qu’il ressort assurément
des portraits de ses deux filles, Anne-Geneviève et Louise Gabrielle. Plus
proches de la sensibilité de nos instantanés numériques que des portraits
officiels, Greuze explore la matière humaine non seulement dans ses formes
mais aussi dans sa profondeur.

Jean-Baptiste
Greuze, Tête de jeune fille, vers 1773. Sanguine, 31 × 25,5 cm.
Londres, Collection particulière. (© Collection particulière)
Sourcil légèrement relevé pour souligner la perplexité, yeux captivés par
une autre source de curiosité que le peintre, un certain naturalisme se
dégage de l’art de Jean-Baptiste Greuze. Cette approche le conduira
notamment à des représentations plus graves comme celle de la perte de
l’innocence avec « La Cruche cassée »…

Jean-Baptiste Greuze, Jeune Fille à la colombe, vers 1780. Huile sur bois,
64,4 × 53,3 cm.
Douai, musée de la Chartreuse.
(© Musée de la Chartreuse, Douai, France / Photo Daniel Lefevre)
Le parcours habilement dressé par cette exposition permettra au visiteur
d’observer et d’apprécier ses différentes facettes, toujours renouvelées
en fonction du sujet qui s’impose à l’artiste. Avec Greuze, nous entrons
au cœur de l’intimité d’un siècle, celui d’avant la Révolution, une page
d’histoire de l’art à redécouvrir au plus vite au Petit Palais ! |
|
|
|
« Les Maîtres du Feu - L’âge du Bronze en
France 2300 – 800 av. J.-C.»
Exposition jusqu’au 9 mars 2026
Musée d’Archéologie nationale de Saint
Germain en Laye.
|
|
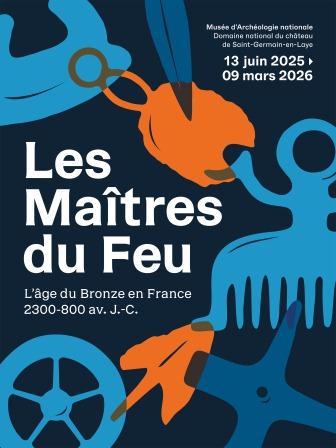
Voici présentée au Musée d’Archéologie nationale de Saint Germain en Laye
jusqu’au 9 mars 2026, une exposition didactique sur l’âge du Bronze en
France. Grâce à un parcours éclairant et détaillé, le MAN propose en effet
à ses visiteurs une synthèse particulièrement pédagogique à partir des
dernières recherches archéologiques. En collaboration avec l’Inrap et l’Aprab,
le célèbre musée dirigé par Rose-Marie Mousseaux fait ainsi la
démonstration de l’importance capitale du développement de la métallurgie
du bronze dans l’ensemble de l’Europe occidentale sur une période allant
de 2300 à 800 avant J.-C.

Le bronze, ce nouvel alliage constitué de cuivre et d’étain, allait en
effet venir révolutionner non seulement les utilisations agraires et
militaires, mais avoir également des répercussions déterminantes sur les
échanges commerciaux et les moyens de communication par voie terrestreou
maritimes, entre des régions souvent très éloignées les unes des autres,
ainsi que l’atteste une carte détaillée dans le parcours de l’exposition. |
Ces échanges faciliteront eux-mêmes des brassages culturels qui seront
manifestes sur différents artefacts, témoignant ainsi de l’expansion sans
précédent de cet âge initié par ces artisans du feu dont le métier est
présenté dans le détail.

L’exposition rappelle quelles furent les innovations essentielles de cette
période préludant le monde moderne : rasoir, outils, pince à épiler,
fibule, torque, décorations d’orfèvrerie, soudure, etc.

La représentation du monde et de ses espaces se trouve également
transformée par ces bouleversements, qu’il s’agisse de la cosmogonie et de
la mythologie, sans oublier l’organisation sociale. Ces magiciens du feu
des 3e et 2e millénaires avant J.-C. jettent des ponts qu’aucune société
n’était jusqu’alors parvenue à faire à cette échelle, une étape
déterminante dans l’histoire de l’humanité que cette exposition vient
souligner et éclairer de la plus passionnante manière !
Catalogue « Les Maîtres du feu - - L’âge du Bronze en France 2300 – 800
av. J.-C » Editions Faton, 2025. |
|
|
|
« GEORGES DE LA TOUR – Entre ombre et
lumière »
Du 11 septembre 2025 au 25 janvier 2026
Musée Jacquemart-André, Paris |
|
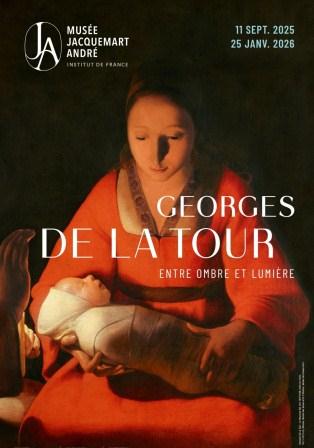
À l’évocation de Georges de La Tour (1593-1652), ce sont immédiatement des
visions d’une clarté mystérieuse, d’une obscurité habitée par la lumière,
qui surgissent à l’esprit. Maître inégalé du clair-obscur, le peintre
lorrain a su en effet donner à ses toiles une atmosphère d’intimité et de
silence qui en fait toute la singularité. Le musée Jacquemart-André invite
aujourd’hui à plonger dans cet univers fascinant à travers une exposition
d’une rare intensité.

©Lexnews
Si on pourrait croire, trop vite, que Georges de La Tour ne fut qu’un
disciple du Caravage, prolongeant la révolution du clair-obscur inaugurée
par le génie lombard, l’exposition conçue par Gail Feigenbaum et Pierre
Curie démontre au contraire combien l’artiste a su développer un langage
personnel, loin d’une simple imitation. Plus qu’une rétrospective – la
première depuis un quart de siècle, cette exposition offre aux visiteurs
une belle mise en perspective de son œuvre, grâce à des prêts
exceptionnels de musées internationaux ; vingt-trois toiles du maître sont
ainsi rassemblées, soit plus de la moitié des œuvres du peintre
aujourd’hui connues.
Dès les premières salles, l’évidence s’impose : chez Georges de La Tour,
le sacré et le profane se confondent pour donner naissance à un art de la
contemplation. Scènes de genre ou figures de saints, toutes ses toiles
semblent traversées par une lumière intérieure. "Le Nouveau-Né", prêté par
le musée de Rennes, en donne un exemple bouleversant : ni tout à fait une
Nativité, ni simple scène domestique, mais une méditation silencieuse où
chaque regard tend vers une clarté invisible, presque surnaturelle.
|
La spiritualité irrigue également ses représentations de saint Jérôme
pénitent, ici réunies dans deux versions différentes, et où se déploie une
palette subtile entre dépouillement mystique et intériorité fervente.

©Lexnews
Les visiteurs pourront aussi contempler les Larmes de saint Pierre
provenant du musée de Cleveland ; un vieil homme accablé, figé dans la
conscience de sa faiblesse, qui semble inviter chacun à partager ses
doutes et son abandon…
Si Georges de La Tour a été largement célébré de son vivant – Louis XIII
lui-même aurait exigé de garder dans sa chambre le Saint Sébastien offert
par le peintre –, l’artiste sombra ensuite, étrangement, dans un oubli
prolongé, avant sa redécouverte au XXe siècle.

©Lexnews
L’exposition du musée Jacquemart-André nous rappelle toute la puissance
tranquille de ce maître français du XVIIe siècle, dont le style se nourrit
d’un naturalisme dépouillé, sublimé par la lumière. Ses célèbres
compositions à la bougie – de la Madeleine pénitente ou encore le
Reniement de saint Pierre – comptent parmi les sommets de la peinture
française du XVIIe s. Mais son pinceau sut aussi saisir la réalité la plus
humble qu’il s’agisse de la troublante Femme à la puce ou du saisissant
Vielleur au chien, des toiles révélant la même acuité à capturer la vérité
humaine, entre quotidien et éternité.
Avec cette rétrospective, le musée Jacquemart-André offre bien plus qu’une
exposition : une méditation visuelle où l’ombre et la lumière se
répondent, révélant l’intensité secrète d’un artiste intemporel.
« GEORGES DE LA TOUR Entre ombre et lumière
» catalogue d’exposition Cultures Espaces / Hazan Editions, 2025. |
|
|
|
« Le Génie et la
Majesté – Louis XIV par Le Bernin »
exposition Château de Versailles
jusqu’au 28 septembre 2025
|
|
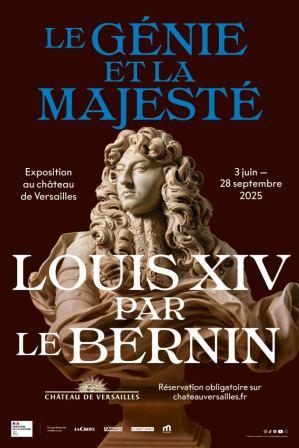
Lorsque le plus virtuose des ambassadeurs de l’art italien en la personne
du Bernin rencontra l’incarnation même de la souveraineté absolue, ces
instants uniques de génie et de majesté furent cristallisés dans le
marbre, sujet de la présente exposition au château de Versailles. Louis
XIV fut immortalisé en effet dans le marbre par le grand sculpteur Gian
Lorenzo Bernini, dit Le Bernin (1598-1680); cette œuvre admirée de tous
est devenue depuis ce XVIIe siècle un chef-d’œuvre incontournable dont la
présence dans le salon de Diane du royal château a su s’imposer, bien que
les millions de visiteurs qui s’y pressent finissent souvent par
l’ignorer.

©
Christophe Fouin
Un injuste oubli que l’exposition entend justement réparer grâce à cette
présentation écrin qui replace l’importance de ce buste quant à la
rencontre de deux mondes : le génie du baroque et le solaire représentant
de l’absolutisme royal. A l’occasion des travaux du salon de Diane,
l’évènement entend faire redécouvrir ainsi ce chef-d’œuvre du Bernin né
d’une rencontre unique entre le monarque phare de l’Europe du XVIIe siècle
et le génial sculpteur égalant la virtuosité de Michel-Ange dans ses
œuvres les plus célèbres (Apollon et Daphné, Le Baldaquin de Saint-Pierre,
L’Extase de Sainte Thérèse sans oublier la Colonnade de Saint-Pierre). |
Les mémoires de ces quelques mois où l’artiste vint en France saisir l’âme
et la physionomie du plus grand personnage du royaume ont également
immortalisé des instants uniques durant lesquels ces deux esprits nourris
des arts dialoguèrent et saisirent l’importance de cette commande.

©
EPV / Thomas Garnier
Manifestement ému, Le Bernin pourtant habitué à répondre aux plus
prestigieuses commandes, notamment celles d’Urbain VIII et d’Alexandre VII,
a bien eu conscience que, plus que de servir la grandeur d’un puissant, il
inscrivait son œuvre dans l’Histoire de l’art et de l’Histoire.
Le buste du Bernin ainsi exposé pour la première fois à hauteur d’homme
depuis sa présentation par l’artiste à Louis XIV est replacé dans son
contexte, éclairé par des peintures et autres sculptures soulignant
l’esprit unique inspirant le ciseau du Bernin lorsqu’il sculpta ce marbre
royal. Une exposition éclairante et intimiste à découvrir avant que le
buste ne retrouve son prestigieux écrin habituel…
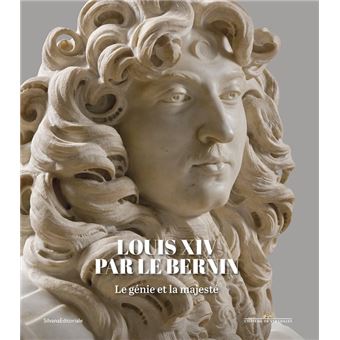
Catalogue "Louis XIV par Le Bernin Le génie et la majesté" sous la
direction de Lionel Arsac, 24 x 28 cm, 128 pages, Coédition Château de
Versailles - Silvana, Editoriale, 2025. |
|
|
|
« Bronzes royaux
d’Angkor, un art du divin »
Exposition Musée Guimet
Paris, jusqu’au 8 septembre 2025
|
|
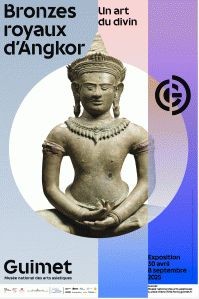
C’est à un évènement auquel nous convie cet été le
musée Guimet (jusqu’au 8 septembre). Le célèbre musée des arts asiatiques
présente en effet, le temps d’une exposition, les plus beaux trésors des
bronzes royaux d’Angkor, dont certains - notamment l’exceptionnel Grand
Vishnou couché du Mebon occidental d’Angkor - sont venus tout spécialement
du Cambodge à cette occasion, ce que confirme la présidente du musée
Yannick Lintz : « L’organisation de l’exceptionnelle exposition Bronzes
royaux d’Angkor, un art du divin s’inscrit dans l’histoire profonde des
relations de coopération et d’amitié qu’entretient le musée Guimet avec le
ministère de la Culture et des Beaux-Arts du Cambodge, le Musée national
du Cambodge et l’ensemble des institutions patrimoniales de ce pays ».
Cette confiance et cette collaboration ont ainsi conduit et permis des
prêts inédits d’œuvres inestimables associées au fond déjà plus que
complet du musée parisien.
Ce sont des années de recherche et de restaurations qui ont préludé cette
exposition évènement qui ne doit pas pour autant intimider le visiteur,
tant le parcours didactique cherche à le familiariser avec les nombreuses
divinités de l’hindouisme et du bouddhisme au cœur de la culture
cambodgienne.

©
Musée national du Cambodge, Phnom Penh / photo Thierry Ollivier pour le
musée Guimet
Personnage féminin agenouillé, support de miroir (?), art khmer, époque
angkorienne, première moitié du 12e siècle, Prasat Bayon, Angkor Thom,
province de Siem Reap, Cambodge, bronze
Ces chefs-d’œuvre de bronze sont, pour la plupart d’entre eux, d’autant
plus précieux que rares, les pillages et les refontes pour remploi ayant
eu raison des autres trésors disparus à jamais. L’exposition parvient
ainsi non seulement à faire entrer le visiteur au cœur même du long
processus de la métallurgie des bronzes d’Angkor, mais également à lui
faire percevoir la complexité de cet art inextricablement lié à la culture
et aux croyances de cette civilisation khmère.
Servie par une scénographie intimiste privilégiant l’éclat de ces œuvres
aux formes délicates, l’exposition rappelle les prémices de cet art
angkorien dès l’époque protohistorique qui s’étirera sur une période de
six siècles (9e-14e/15e s.). Au fil des salles, nous découvrirons ainsi un
véritable panthéon d’alliage de cuivre et d’étain aux reflets
incomparables. L’influence de l’Inde dès les premiers siècles de notre ère
sera déterminante tant sur le plan religieux qu’artistique ainsi que
l’attestent ces statues présentées de l’époque préangkorienne. Rapidement,
cet art prendra son autonomie pour devenir une pratique à part entière au
service des rois du Cambodge ancien, avant d’atteindre son apothéose à
l’âge d’or au cours du 11e siècle. |
Parallèlement aux œuvres de pierre honorant les dieux du bouddhisme et de
l’hindouisme, les œuvres métalliques demeuraient au cœur des processus
rituels où elles avaient une place de choix lors du culte rendu. Le
visiteur se familiarisera ainsi avec les plus belles représentations de
Vishnou et de Shiva, méditera sur les multiples représentations de Bouddha
aux poses intimant sagesse et éveil à son observateur…

Buste de Vishnou Anantashayin Cambodge, province de Siem Reap, district de
Puok, Angkor, Mebon occidentalÉpoque angkorienne,seconde moitié du 11e
siècle
Bronze, dorure au mercure, argent, plomb,cinabre Phnom Penh, Musée
nationaldu Cambodge, versement Conservation d’Angkor, 1950,Ga.5387
Point d’orgue de ce riche parcours, le rez-de-chaussée du musée, qui par
ailleurs abrite une collection permanente de référence de l’art khmer,
accueille le temps de cette exposition le trésor le plus inestimable : Le
Vishnou du Mébon occidental restauré et présenté pour la première fois de
la manière la plus complète avec ses fragments réassociés au buste, une
merveille à découvrir et à ne pas manquer au musée Guimet !
« BRONZES ROYAUX D’ANGKOR Un art du divin
», Catalogue d’exposition, collectif, Reliure Cartonnée contrecollée, ill.
274, 22 x 28,5 cm, 304 p., In Fine Editions, 2025.

Pour accompagner l’exposition actuellement au Musée
Guimet de Paris, exposition aussi essentielle quant à la thématique des
bronzes khmers d’Angkor, il fallait un catalogue d’envergure, ce qu’ont
réalisé avec brio les éditions In Fine et les auteurs de cette remarquable
publication. Se focalisant sur une problématique souvent négligée, parce
que longtemps ignorée, cette publication fait, en effet, la démonstration
de la place importante tenue par les bronzes et autres objets de culte
fondus en métaux précieux dans la civilisation de l’Empire khmer. Nous
avons tous à l’esprit les monumentales constructions enchâssées, et
menacées, par la végétation luxuriante de la forêt cambodgienne, mais qui
connaît véritablement la place et l’importance tenues par cet art du divin
que sont les bronzes royaux d’Angkor en dehors de quelques spécialistes ?
Cette publication fait la brillante démonstration, parallèlement à
l’exposition en la complétant idéalement, que le bronze est à l’origine au
Cambodge du développement d’un art de la statuaire à part entière
influencé essentiellement par l’hindouisme et le bouddhisme prédominants.
L’ouvrage s’attache ainsi à montrer comment cette activité s’est
rapidement spécialisée en tant que technique sacrée limitée à une petite
élite d’artisans dans les ateliers royaux. La publication souligne
également combien nos connaissances sur ce sujet resté longtemps
confidentiel ont fait l’objet d’avancées spectaculaires avec les fouilles
récentes rappelées en ces pages abondamment illustrées à travers 200
œuvres remarquables.
Le point d’orgue est bien entendu constitué par l’impressionnant Vishnou
couché du Mebon occidental, trésor national du Cambodge et plus grand
bronze jamais retrouvé à Angkor. Qu’il s’agisse des prémices de l’âge du
bronze à l’époque préangkorienne jusqu’à la description détaillée de la
fonderie royale d’Angkor, techniques et arts se conjuguent au service du
pouvoir afin d’en souligner la magnificence telle qu’il ressort de ces
somptueux chefs-d’œuvre de la statuaire de bronze dans l’art khmer.
|
|
|
|
Interview Denis
Raisin Dadre
Paris, le 30/05/19. |
|
 |
 |
|
Lexnews
a eu le plaisir de rencontrer Denis Raisin Dadre à l'occasion de la sortie
de son splendide livre-disque consacré à Léonard de Vinci et la musique.
Fondateur de l'ensemble Doulce Mémoire et grand spécialiste de la musique
Renaissance qu'il honore par ses concerts et enregistrements
internationalement renommés, Denis Raisin Dadre nous a livré ses
confidences sur ce grand maître de la renaissance qui était également un musicien
talentueux !
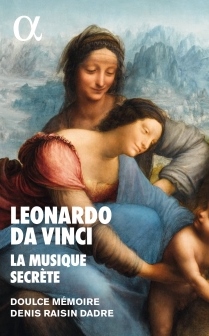
 uelle
a été votre première rencontre avec Léonard de Vinci et quel souvenir
avez-vous gardé de ses œuvres ? uelle
a été votre première rencontre avec Léonard de Vinci et quel souvenir
avez-vous gardé de ses œuvres ?
Denis Raisin Dadre : "Curieusement, ce n’est pas la Joconde
qui a retenu en premier mon attention ! Mon caractère me portait plutôt
vers des choses moins connues. C’est à Florence que date cette première
rencontre, à une époque où je me rendais très souvent en Italie. C’est son
Annonciation qui, la première, m’a frappé. Je découvrais alors un
Vinci encore très marqué par la peinture flamande de son époque ainsi que
par l’atelier du Verrocchio où il a travaillé dès son plus jeune âge. Si
je connaissais déjà ce style de peinture, surtout celui de ses
contemporains de la fin du XVe siècle avec ce côté extraordinairement
minutieux des arrière-plans, cette première rencontre demeure pour moi
associée aux Offices de Florence, et cette Annonciation m’est
apparue mystérieuse, comme un grand nombre de ses œuvres d’ailleurs".
Quels sont les motifs qui vous
ont poussé à réaliser ce livre-disque sur Léonard alors même que vous
avouez qu’il ne nous reste aucun témoignage direct des musiques qu’il
pouvait jouer en tant que musicien talentueux ?
Denis Raisin Dadre : "Nous n’avons en effet pas de musique de
Léonard lui-même si ce n’est un petit canon, mais c’est également le cas
de tous les autres musiciens de lira da braccio de cette fin du XVe
siècle, car il s’agissait d’un instrument sur lequel on improvisait. Cette
lacune n’est donc pas liée à Léonard, mais à son instrument, cette lyre
sur laquelle les musiciens n’ont pas laissé de traces écrites. Ce qui est
intéressant et surtout frappant chez Vinci, c’est que beaucoup de ses
contemporains parlent de lui et de cette musique qu’il jouait, Vasari bien
entendu mais également d’autres sources. Ce n’était pas du tout un amateur
et il devait avoir une très haute maîtrise pour avoir été invité à Milan
non seulement comme peintre mais également comme joueur de lyre. À Milan,
lorsqu’il organise les fêtes du duc, il jouait lui-même de la lyre et
improvisait des vers en chantant. Cette période concerne essentiellement
ses années de jeunesse jusqu’à sa trentaine. Aussi, me suis-je demandé
avec Vincent Delieuvin, Conservateur en chef - chargé de la peinture
italienne du XVIe siècle chez Musée du Louvre, s’il n’y avait pas
justement une relation dans cette pratique de l’improvisation et cette
façon de peindre très spécifique à Vinci".
_____________
il existait aux XVe et XVIe siècles des
musiques dites expressément « secrètes » qui étaient réservées à des
élites, et qui ne sortaient pas des lieux où elles étaient jouées
_____________
Pouvez-vous revenir sur cette
belle expression « musique secrète » des peintures de Léonard ?
Denis Raisin Dadre : "Deux références doivent être soulignées quant
à cette expression de « musique secrète ». Tout d’abord, une
référence musicale très précise, puisqu’il existait aux XVe et XVIe
siècles des musiques dites expressément « secrètes » qui étaient réservées
à des élites, et qui ne sortaient pas des lieux où elles étaient jouées.
La plus connue, même si cela est plus tardif, est celle recopiée par
Mozart à la Chapelle Sixtine. Cette pratique de musique secrète a lieu
également à la cour de Ferrare où les fameuses dames qui chantaient pour
le duc tous les soirs avaient interdiction de les divulguer, ce qui
explique qu’elles n’ont pas été éditées. L’autre grand exemple sont les
Prophéties des Sibylles de Lassus qui ont été composées dans sa
jeunesse et qui n’ont pas été éditées pendant longtemps parce que son
commanditaire ne souhaitait pas qu’elle soit divulguée tellement cette
musique était exceptionnelle. La seconde référence à cette « musique
secrète » vient d’une citation expresse du critique d’art Marcel
Biron. Ce dernier avouait ne pas regretter la présence des anges musiciens
qui devaient encadrer en un retable de chaque côté la Vierge aux
rochers (qui se trouve actuellement à Londres) parce que la peinture
de Vinci était une peinture dans laquelle on entendait une musique… «Une
musique secrète » ! Cela m’a beaucoup marqué et a constitué le point
de départ de cette idée d’enregistrement".
La musique franco-flamande
prédomine en ce dernier tiers du XVe s. en Italie, peut-on dire que c’est
ce répertoire qu’a pu essentiellement entendre et jouer Léonard ?
Denis Raisin Dadre : "Entendre, c’est certain ! Car, après une
longue période de recherche sur les manuscrits, j’ai pu avoir une idée
assez précise des musiques de son époque lorsqu’il était dans l’atelier de
Verrocchio à Florence. Il est même assez étonnant de constater cette
omniprésence de la musique franco-flamande sans trouver une seule
référence italienne ! Il suffisait que Vinci entre dans une des églises de
Florence pour qu’il entende ce répertoire franco-flamand. Par contre,
lorsque Léonard jouait de la lira da braccio, il s’inscrivait dans
ce grand mouvement d’indépendance de la musique italienne contre cette
mainmise de la culture bourguignonne. Ses improvisations sur la lyre n’avaient rien à voir avec ces classiques établis par les grands maîtres franco-flamands".
Le début du XVIe s. voit la
naissance en Italie du premier livre de frottole et l’apparition de
musiciens italiens, prélude à la grande période du madrigal. En quoi ces
nouveautés seront-elles importantes pour la musique italienne ? Comment un
peintre tel que Léonard pouvait-il juger ces nouveautés ?
Denis Raisin Dadre : "J’ai puisé quelques pièces dans ces livres de
frottole (brève chanson profane italienne, à l’honneur de la fin du XVe
siècle jusqu’au milieu du XVIe s. ndlr) qui constituent des témoignages de
l’art de la lira de Vinci. Il s’agit de morceaux où il est indiqué «
Personetti », c'est-à-dire servant à l’improvisation, des sources
absolument rarissimes du début du XVIe siècle concernant cette pratique
née à la fin du XVe siècle avec une dizaine de grilles dont on se servait
pour réciter -« recitare » - à la lyra, véritable témoignage de
l’art de Léonard. D’autre part, nous savons que Léonard a été très
sollicité par Isabelle d’Este qui était la sœur de Béatrice, elle-même «
grande patronne » de la frottole résidant à Milan". |
Trois femmes puissantes sont ainsi à l’origine de l’émergence d’un art
proprement italien dans les cours : Isabelle, donc, et sa sœur Béatrice
d’Este sans oublier la duchesse d’Urbain. En encourageant les musiciens et
cette pratique de l’art de la frottole au début du XVIe siècle,
nous assistons dans les manuscrits à cette évolution vers des « proto
madrigaux » avant le fleurissement à part entière de l’art du madrigal
dans les années 1530. Léonard de Vinci a vu l’émergence de cet art protégé
par ces femmes exceptionnelles. Il est certain que cet esprit novateur a
puissamment inspiré et correspondu avec l’art de Léonard non seulement
dans la peinture, mais également vis-à-vis de la musique qu’il pratiquait.
La lira est un instrument d’expérimentation par excellence
puisqu’on ne joue pas de musique écrite. De nombreuses recherches
musicologiques ont d’ailleurs lieu actuellement sur cet art et je pense
que cela va permettre d’expliquer comment nous sommes passés de la
première mise en musique de l’Orfeo de Poliziano au XVe siècle à l’Orfeo
de Monteverdi, en 1607. La lira, instrument d’Orphée et de l’aède
grec qui récitait un texte, est sans aucun doute un des très grands
moteurs de l’émergence de l’opéra. Avec la lyra, seul le chant est
accompagné de l’instrument, alors que dans toute la musique du XVIe s., la
polyphonie prédomine avec la superposition de plusieurs voix répondant à
des règles complexes. On a longtemps sous-estimé l’importance de la
lyra et il ne faut pas oublier que, naguère, le public pleurait
littéralement sur les places de Florence où étaient jouées et récitées ces
épopées".
La technique du peintre,
notamment son fameux sfumato, rejoint-elle certains effets et
ornementations posés par la musique notamment avec la lira ?
Denis Raisin Dadre : "Je me suis permis de faire cette comparaison
– et cela n’a évidemment aucun caractère scientifique – car c’est un
ressenti qui m’a beaucoup frappé. Il est très troublant de constater que
la lyre autour de la voix crée un halo sonore qui n’a rien à voir avec la
façon dont on écoute la musique habituellement, d’autant plus que cet
instrument n’a pas de basse. Ordinairement, lorsque vous écoutez de la
musique, vous trouvez toujours une basse et des accords. Or avec la lyre,
il n’en est rien. De plus, cet instrument se place au-dessus de la voix de
l’homme ; en terme d’octave, la lyre est, en effet, plus aiguë que la voix
d’un homme. Ce système qui est à l’inverse de notre écoute habituelle avec
un accompagnement au-dessus et sans basse crée une sorte de « sfumato
sonore » qui estompe les lignes ainsi que notre écoute…"
_____________
C’est une époque d’une extraordinaire
complexité notamment en terme musical avec des citations permanentes, des
thèmes entrecroisés, des jeux contrapuntiques absolument fous
_____________
Une très grande liberté présidait dans la composition et ses
déclinaisons en « jeux intellectuels », est-ce là encore un parallèle avec
les nombreuses variations, corrections et évolutions apportées par le
peintre à ses œuvres toute sa vie durant ?
Denis Raisin Dadre : "C’est une époque d’une extraordinaire
complexité notamment en terme musical avec des citations permanentes, des
thèmes entrecroisés, des jeux contrapuntiques absolument fous. Ce rapport
intellectuel à la musique n’a pu que séduire Léonard de Vinci qui lui-même
était un esprit complexe, érudit et scientifique. À son époque, on parle
véritablement d’une science de la musique, et nous savons combien ce génie
a fréquenté de nombreux mathématiciens qui étaient eux-mêmes des
musiciens. Lorsque vous lisez les traités de musique de cette période,
vous avez souvent l’impression de lire un traité de mathématique…"
Quel regard portez-vous sur la
dimension religieuse de certaines des œuvres de Léonard de Vinci ?
Denis Raisin Dadre : "Je crois que c’est quelque chose de très
original chez Léonard de Vinci, ne serait-ce que par les thèmes traités
comme celui de sainte Anne avec la Vierge, thème assez rare dans la
peinture. La première chose qui me frappe chez Léonard, c’est que nous
sommes vraiment aux antipodes d’une peinture qui exalterait la puissance
de l’Église, à la différence d’un Tintoret ou d’un Véronèse au XVIe siècle
qui se dirigeront, eux, plus vers des choses « baroques » exaltant cette
puissance institutionnelle. L’intimité des tableaux de Léonard semble à
mon avis l’élément marquant de son art sur le plan religieux. Un dialogue
est en quelque sorte instauré entre celui qui regarde et le tableau. Ce
genre relève d’ailleurs plus de la dévotion privée que de l’art officiel.
Il est d’ailleurs troublant de constater cette ambiguïté entre profane et
religieux, sainte Anne et sa fille laissent l’impression d’avoir le même
âge, son saint Jean-Baptiste apparaît sous les traits d’un joli jeune
homme… Léonard de Vinci fait preuve d’une liberté absolue dans la manière
dont il évoque ces personnages sacrés. Je fais d’ailleurs un parallèle
quant à cette liberté avec le Caravage dont les peintures religieuses
apparaîtront souvent scandaleuses car n’obéissant pas aux normes de son
époque. Cette approche religieuse est poussée à son paroxysme avec la
Cène et cette agitation extrême des disciples que personne n’avait osé
représenter ainsi auparavant. Dans la musique de la même époque, cette
intrication sacrée profane est usuelle, et même permanente, avec des
musiques sacrées écrites sur des chansons profanes. Un grand nombre de
musiques sacrées existait avec un double texte : un soprano ayant recours
au latin d’un Requiem pendant que le ténor récitait une chanson. Cette
distinction entre sacrée et profane n’existait pas à cette époque. Ce qui
me frappe surtout pour Léonard de Vinci, c’est cette liberté quant à
l’institution. C’est quelqu’un qui toute sa vie a fait ce qu’il voulait.
Le meilleur exemple étant peut-être Isabelle d’Este qui n’a jamais réussi
à obtenir son tableau alors même qu’elle n’a eu de cesse de relancer
Léonard à ce sujet !"
_____________
Je crois que nous avons retrouvé cette
immense tendresse et douceur dans la musique, à l’image de celle
omniprésente dans les œuvres de Léonard de Vinci.
_____________
Qu’avez-vous ressenti dans la pénombre de l’abbaye de Noirlac lors de
l’interprétation de ce programme composant votre dernier enregistrement ?
Denis Raisin Dadre : "Je dois avouer que ce programme a été
certainement l’un des problèmes les plus compliqués de toute mon existence
! Tout d’abord, ces tableaux sont très intimidants, et ce d’autant plus
que je ne souhaitais pas présenter une version purement intuitive, mais
aussi une proposition scientifique à partir de recherches sur les musiques
de cette époque. Et je dois avouer, comme souvent dans ces situations les
plus compliquées, qu’il peut y avoir des miracles ! Soudainement la
musique « apparaît » avec un lien très fort avec ces tableaux dont les
reproductions étaient devant nous. Je crois que nous avons retrouvé cette
immense tendresse et douceur dans la musique, à l’image de celle | |