|

Lexnews était... et a
entendu pour vous...
|
INFOS EXPRESS |
Mozart « Le Devoir du premier
commandement » (drame sacré), solistes : Gwendoline Blondeel, Mathilde
Ortscheidt, Julien Behr et Jordan Mouaissia, Ensemble Il Caravaggio,
dirigé par Camille Delaforge, Chapelle Royale de Versailles, 16/11/24.

©Lexnews
La Chapelle royale de Versailles fut
comble en cette soirée du 16 novembre 2024. Il faut dire que l’ensemble
Il Caravaggio, dirigé par la claveciniste Camille Delaforge et
accompagné de quatre talentueux solistes, honorait en ces lieux la
mémoire non seulement de Mozart, mais aussi de la musique sacrée avec Le
Devoir du premier commandement , un drame sacré composé par un très
jeune Mozart, alors âgé de seulement onze ans.
Si la précocité du compositeur n’est plus à démontrer, le public
nombreux ne put qu’admirer – et saluer – sa maturité pour ce drame en
musique, dont il ne subsiste malheureusement qu’un seul des trois actes.
Le thème, aujourd’hui pour le moins abscons, explore des notions
complexes : justice divine, rédemption, querelles théologiques héritées
de saint Augustin et du moine Pélage au Ve siècle, sans oublier les
débats houleux entre jansénistes et jésuites, sur fond d’absolutisme et
de velléités d’indépendance de Port-Royal.
Fort heureusement, pour les non-initiés en théologie, Mozart parvient à
transcender cet imbroglio doctrinal avec une virtuosité saisissante,
comme en témoigna la prestation enlevée des musiciens sous la direction
inspirée de Camille Delaforge. Dès les premières pages de l’œuvre, le
charme mozartien opère : des passages orchestraux séduisants laissent
entrevoir les promesses du compositeur en devenir.

©Lexnews
L’émerveillement ne tarda pas à gagner
les mélomanes, notamment par la maîtrise de l’écriture vocale, alternant
moments d’introspection intense et envolées passionnées ; des nuances
rendues avec une précision et une vivacité remarquables par les quatre
solistes - Gwendoline Blondeel, Mathilde Ortscheidt, Julien Behr et
Jordan Mouaissia.
Le génie musical de Mozart s’élève au-delà de la sécheresse du livret d’Ignatz
Anton von Weiser, un livret qui condamne toute tiédeur spirituelle pour
offrir au jeune compositeur de somptueuses variations empreintes d’une
liberté créatrice rendue avec conviction par l’Ensemble Il Caravaggio.
Une prestation vivement saluée par une ovation chaleureuse du public,
qui s’est conclue par trois bis, dont un final enjoué : le célèbre duo «
Pa-, pa-, pa-, Papageno » de La Flûte enchantée, interprété avec une
complicité évidente par nos quatre solistes.
Philippe-Emmanuel
Krautter
Concert donné dans le cadre de la
nouvelle Saison musicale de l'Opéra Royal de Versailles
A noter la sortie récente en CD
de ce programme Label CVS

|
| |
King Singers mardi 5 novembre 2024 salle Gaveau
Depuis sa fondation en 1968, le
sextuor vocal anglais des King’s Singers porte au plus haut l’art
lyrique polyphonique a cappella et c’est toujours un régal que de
pouvoir assister à une de leurs représentations, tant ils brillent dans
chacune de leurs interprétations quel que soit le répertoire abordé. Ce
récital du 5 novembre 2024 à la Salle Gaveau, lieu que l’Ensemble
affectionne particulièrement, n’a pas dérogé à la règle malgré l’absence
forcée pour raisons de santé du contre-ténor Patrick Dunachie et la
distribution à cinq voix qui en a résulté, preuve de leur magnifique
capacité à s’adapter…
C’est donc à cinq et dans un dispositif inhabituel que s’est déroulé un
programme florissant et majestueux en deux parties avec une ouverture
délicate et sobre du The Lord’s Prayer des Beach Boys. Les quatre bijoux
Renaissance de Weekles, Morlay, Tallis et Byrd furent selon drôles,
énergiques, profonds, émouvants, lumineux, captivants. Les deux Schubert
Flucht et Die Nacht et la Sérénade d’Hiver de Saint-Saëns réunirent
grâce, légèreté et arquelinade. La plongée dans la musique
sud-américaine, celle du temps des Conquistadors et celle de Villa Lobos,
furent un régal de jeux de couleurs et de modes de jeu totalement
époustouflants. La seconde partie « Close Harmony », sélection de titres
que chacun pourra retrouver sur leurs albums « Close Harmony » et « When
You Wish Upon A Star », fut tout autant un régal et un délice dans
l’interprétation pleine de vie de ces arrangements de chansons
emblématiques et fortes du cinéma de Walt Disney ou de Miyazaki. Car qui
n’a pu s’émerveiller dans ces versions a capella fastes et virtuoses
provenant notamment de Mulan, Mary Poppins, The Lion’s King. Enfin, pas
de King’s Singers sans au moins une chanson des « Fab Four », ici deux
avec Yesterday et Ob-la-Di. La touche finale aura été ce merveilleux «
Ave Maria » en clôture et en hommage à la reconstruction et réouverture
très prochaine de Notre Dame de Paris.
Si le grand regret et à la fois le grand bonheur et privilège fut aussi
d’avoir assisté au dernier concert à la Salle Gaveau de
l’extraordinaire, le talentueux et charismatique Jonathan Howard, qui
après quatorze ans de contribution, a décidé de mettre un terme à sa
participation au sein du groupe vocal, chacun aura pu se régaler de
l’immense capacité des King’s Singers à transmettre, partager, inviter,
régaler en alliant à la fois théâtralité, allégresse, sincérité et
musicalité irréprochable. Bravo à eux, ils sont juste splendides et à
leur place dans la lumière de l’excellence musicale !
Jean-Paul Bottemanne
|
| |
Concert Matthieu Delage - Mercredi 20
mars 24, Le Zèbre de Belleville.

Tout musicien qui se respecte le sait, il n’y a rien de superflu chez
Bach. La générosité permanente qui traverse son œuvre est à la hauteur
de l’exigence qui lui est due. Celle d’abord de ne pas la trahir, celle
ensuite de la révéler, celle enfin de la servir. Ce triptyque immuable
est incontournable et ne souffre d’aucune digression ni faiblesse.
C’est donc un pari magnifique et osé que le saxophoniste émérite
Matthieu Delage a su relever dans le cadre de ce concert présentant son
nouvel album « Bach ». Car qui sinon lui aurait pu imaginer et accomplir
pour son instrument avec autant de brio ces transcriptions, notamment de
la Suite n°4 pour violoncelle ou ces extraits audacieux du Clavier Bien
tempéré et Variations Goldberg, en pleine complicité avec l’altiste
Violaine Despeyroux, le percussionniste Baptiste Dolt et le guitariste
Benjamin Garson. Car, n’en déplaise aux puristes, le souffle immuable du
génie de Bach était là, entier, la fluidité mélodique et le contrepoint
s’exprimant avec merveille dans ce saxophone régalien par sa capacité à
sublimer sans infidélité, tout comme par la finesse du jeu percussif de
Dolt, la pureté de la guitare électrique de Garson, la chaleur de l’alto
de Despeyroux.
En solo, duo, trio ou quatuor, chaque transcription, chaque lecture,
chaque interprétation sont savamment dosées, précises, maîtrisées et
enfin loyales au génie du Kapelmeister de Weimar. L’enchantement opère
de bout en bout dans la féerie de cet univers instrumental singulier
prouvant ainsi une réalité : n’importe quel instrument, n’importe quel
timbre, peut s’adapter à Bach. Et ici, Delage, tout comme ses trois
acolytes, en musicien exceptionnel, le démontre avec son instrument. Qui
aurait rêvé de goûter Bach au saxophone peut maintenant être sûr que son
souhait est exprimé et c’est un pur délice à ce niveau d’accomplissement
et d’inspiration. L’album au cœur de ce concert est à retrouver sur le
label « Chapeau l’Artiste », un album dont on peut saluer ici la
performance totalement aboutie et réussie.
Jean-Paul Bottemanne
|
| |
Concert « La Traviata » Opera A
Palazzo, Fondation Simone et Cino Del Duca.

Le concept à l’initiative de Musica A
Palazzo né en 2005 à Venise tient en deux mots : l’opéra de salon.
L’expérience proposée au spectateur est de s’immerger au sein même de
l’œuvre et en donnant, pour cela, le drame lyrique dans des salles de
réception de demeures fastueuses mettant en rapport direct le spectateur
avec les artistes, musiciens et chanteurs, effaçant ainsi la barrière de
la scène. L’auditoire, en nombre restreint et intime, participe dès lors
pleinement, parfois même de manière interactive, au spectacle. Mais,
tout aussi important, l’œuvre elle-même est condensée autour des scènes
et airs les plus importants, permettant ainsi une dynamique alerte. Ce
concept, repris et proposé à Paris depuis trois ans par Opera A Palazzo
a donc de quoi séduire dans sa redéfinition des conditions de
représentation de la temporalité théâtrale et lyrique par opposition aux
représentations proposées dans les grandes salles traditionnelles.

« La Traviata », présentée en ce soir
du 15 mars 2024 à la fondation Simone et Cino Del Duca, s’articulait
autour des trois personnages principaux avec Émilie Rose Bry dans le
rôle de Violetta, Christophe Poncet de Solages incarnant Alfredo Germont
complété de Benoit Gadel pour le rôle de Giorgio Germont, les trois
chanteurs accompagnés par Philip Richardson au piano, Estelle Diep au
violon et Carlotta Persico au violoncelle. La puissance de cette
transposition musicale par Verdi de la Dame aux Camélias est poignante
et tient notamment dans ce magnifique Libiam nei lieti Calici de l’acte
I, ouvrant le bal de la comédie humaine qui ne peut qu’aller vers le
drame, air virevoltant, puissant et entraînant, dont Bry et Solages ont
délivré une interprétation plus que convaincante ; deux voix
parfaitement adaptées, deux jeux théâtraux à la hauteur du rôle.
D’emblée, chacun est comme le témoin direct de cet amour naissant entre
ces deux personnages, dans le jeu de la séduction, du coup de foudre et
de la passion. Dès lors, la magie opère, car il n’en faut pas finalement
plus pour que cet amour vécu, puis contrarié à l’acte II par
l’apparition du père, avant le dénouement funeste de l’acte III,
imprègne le lieu, l’instant, sans jamais s’effacer. Le plus magique,
dans ce déroulement, étant certainement le fait que le spectateur soit
et reste avec les personnages. Tout dire sur le déroulé et la mise en
scène serait inapproprié, car il n’y aurait de magie sans secret…
En résumé, voilà une expérience pleine de charmes notamment celui de
pouvoir goûter à l’expression lyrique de haut vol de si près avec des
artistes maîtres de leur art et technique.
Jean-Paul Bottemanne
Prochaine représentation le 29 mars
2024 |
| |
Concert The Gesualdo Six 14 mars 2024
Oratoire du Louvre

Depuis sa création en 2014, « The
Gesualdo Six », ensemble vocal britannique d’exception, a su s’imposer
comme une référence incontournable dans le domaine de la polyphonie
lyrique. Celui, bien entendu, de la Renaissance et de son répertoire
exigeant au cœur du programme en miroir de ce concert, mais également
ouvert à des œuvres contemporaines telles que les deux pièces « Watch
For Me » de leur compatriote Judith Bingham, en 2016 et le motet « It Is
Finished » composé en 2020 par Owain Park, directeur et basse de The
Gesualdo Six, venant ici judicieusement compléter le récital.
L’événement, en résonance au temps liturgique de Pâques et de la Semaine
Sainte, s’articulait autour de l’expression de la Foi chrétienne et le
cadre choisi, le Temple de l’Oratoire du Louvre, n’en est que plus
précieux et parfait pour en rendre la quintessence. Ainsi, cette entame
avec la première partie des Lamentations of Jeremiah de Tallis dans la
force unifiée du plain-chant se transfigurant en polyphonie scintillante
de générosité, poursuivie par l’organique Watch For Me de Bingham,
contribuèrent pleinement à l’invite d’un temps spirituel et enluminèrent
les deux Tenebrae Responsories, ceux de Gesualdo et de Luis de Victoria
et le Miserere Mei central de Byrd, trois pièces intenses toutes en
profondeur et vigueur, d’où chaque voix, chaque phrase ressortent
cristallines et limpides. Trois œuvres à l’équilibre parfait dans
l’architecture caractéristique de cet âge d’or de la polyphonie vocale a
cappella de la Renaissance, par la fluidité mélodique et harmonique non
encore contraintes par la tonalité. Trois œuvres inspirées et
inspirantes. « It is finished » de Park, petit bijou d’écriture vocale
poursuivit et prolongea le concert avec le même brio, élégance et
finesse, avant la conclusion toute en grâce de la seconde partie des
Lamentations de Tallis.
Le régal rare et la beauté de ce programme sont enfin à souligner par
l’alchimie de l’exceptionnel talent des membres de The Gesualdo Six,
leur cohésion, leur souplesse, leur équilibre et capacité perpétuelle à
rendre intelligible chaque pupitre. Les contre-ténors, Guy James et
Alasdair Austin, furent admirables de pureté, les ténors Joseph Wicks et
Josh Cooter remarquables de douceur affirmée. Michael Craddock, baryton,
exceptionnel par son ancrage gracile et suave, et enfin Owain Park,
basse, s’imposa avec splendeur par son attention, son élégance délicate
et sa direction sobre et habile. Sept timbres vocaux chatoyants et
sémillants, chauds et voluptueux, sept âmes unies dans l’instant, sept
virtuoses remarquables, à l’apogée et service de leur art … Bravo !
Jean-Paul Bottemanne
N. B. La captation du concert est à retrouver présentée par Clément
Rochefort le 28 mai sur France Musique
|
| |
Jeanne Leleu 22 janvier 2024 BNF
Richelieu, Salle Ovale
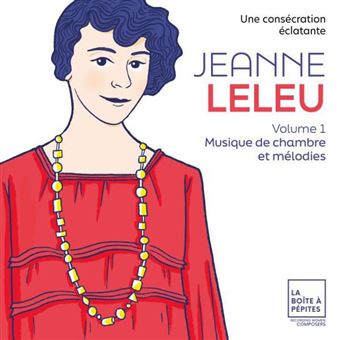
La musique de Jeanne Leleu, talentueuse et inspirée compositrice
française du 20e siècle, a subi après son décès en 1979 le même sort
d’oubli et d’ignorance que celle de la quasi-totalité de ses alter ego
féminins en disparaissant des programmes de concert ; et pourtant, voilà
une artiste d’envergure encensée à son époque et qui eut le privilège
d’une reconnaissance notoire et justement méritée en tant qu’interprète
et compositrice. Jeune fille, Jeanne Leleu donna à onze ans la première
de Ma Mère l’Oye de Ravel et remporta le Prix de Rome en 1923, avant de
poursuivre tout au long de sa vie une carrière aux plus hauts sommets.
Aujourd’hui, il était le temps de faire revivre quelques-uns de ses
chefs-d’œuvre exhumés des archives de la BNF à force de patience et de
passion par Héloise Luzatti, honorée et élevée pour cet accomplissement
au rang de Chevalière des Arts et Des Lettres au terme de la soirée.
Entourée de ses compagnons d’armes de l’Ensemble La Fronde, Alexandre
Pascal, Léo Hennino et Célia Oneto Bensaid, ainsi que la soprano
Marie-Laure Garnier, Luzzati nous a fait ainsi découvrir plusieurs
pépites. Car la puissance de l’œuvre de Leleu est irradiante. Son
écriture pianistique, instrumentale, mélodique, se dore d’éclats
vivaces, court avec élégance. Sa brillance efface la complexité dans une
esthétique moderne où le chromatisme est harmonie. Et clairement, les
quatre instrumentistes, Oneto Bensaid, pianiste émérite au toucher divin
et cristallin en tête et présente à tous les numéros, ont relevé avec
brio et perfection l’audace musicale supérieure.
Entrée en matière par deux extraits de Ma Mère l’Oye rendus avec grâce
et émotion dans ce duo Luzatti-Oneto, juste prélude à la délicatesse des
Six Sonnets de Michel-Ange, d’un jeu subtil émanant du dialogue entre la
prosodie sublimée par la vocalité profonde de Garnier et le clair/obscur
du piano venant s'imbriquer, souligner et élever sans que jamais le fil
mélodique ne se brise ni ne s'égare. Tout dans l'interprétation est
amené avec naturel et passion, perfection et onirisme. Et que dire enfin
du Quatuor final, endiablé, polymorphe, traversé de bout en bout de
traits de génie à tous les pupitres par l'Ensemble La Fronde. Le violon
puissant de Pascal, l'alto effronté de Hennino, le violoncelle galant de
Luzzati, le clavier effervescent d'Oneto se parent de mille feux au gré
des trois mouvements. Le charme opère, les thèmes et motifs s'envolent
avec évidence, l'équilibre des timbres est un régal d’arc-en-ciel duquel
chaque couleur miroite avec netteté. Chaque trait, chaque coup d'archet,
chaque appui sont précis, dosés, appropriés. La lecture soignée n'en
souligne que davantage la beauté intrinsèque de l'œuvre. Plus que
séduisant, c'est ici un vrai bijou d'interprétation, avec des musiciens,
tous brillants dans leur domaine, non seulement de par leur maîtrise
technique, mais aussi et surtout de par leur virtuosité expressive.
Un programme qui, dans sa totalité, justifie l'urgence et la nécessité
absolue non seulement de ce concert, mais aussi de l'album monographique
prévu ce mois, consacré à Jeanne Leleu par le label La Boite à Pépite,
enregistré par Luzatti et ses compagnons. (voir
la chronique du cd). Merci et bravo.
Jean-Paul Bottemanne
|
| |
Concert salle Gaveau 8 novembre
Olivier Cavé et les Ambassadeurs -La grande Ecurie, Alexis Kossenko

Haydn et Mozart, deux maîtres du
classicisme, furent au cœur du programme interprété avec brio par
Olivier Cavé, pianiste au jeu d'une grande finesse et l'ensemble Les
Ambassadeurs - La Grande Ecurie dirigé avec finesse par Alexis Kossenko.
Mariage musical heureux de ce soliste rare avec ces deux formations
unies depuis 2020, tous s'imposant d'emblée avec le Concerto Hob. XVIII
en Ré Majeur d'où se dégagent la grâce enlevée à souhait du Vivace,
l'émotion « sur le fil » de l'Adagio parfaitement rendue par Olivier
Cavé et le superbe Rondo alerte, drolatique et enjoué. Magnifique choix
en introduction pour la place laissée ensuite à Mozart et sa Symphonie
n.25 traversée par des thèmes forts, lisibles, jouant sur la force des
tuttis. Mozart toujours avec l'Andante pour flute et Orchestre KV315,
offrant à Kossenko la possibilité de poser un instant sa baguette de
chef pour se saisir de sa flute en soliste, prouvant encore une fois non
seulement son talent de musicien, mais combien Mozart fut capable de
sublimer cet instrument. Mozart, enfin et toujours, en final avec le
concerto pour Piano n.9. L'œuvre plus que séduisante, est totalement
relevée par Cavé, tout à son affaire, dont l'aisance affirmée au clavier
est capable de transfigurer, porter l'émotion intrinsèque de chaque
œuvre qu'il aborde et vit.
Un beau moment, une invite réussie à se régaler de ces quelques pages
mémorables.
Jean-Paul Bottemanne
|
|
2004 : ANNÉE MARC-ANTOINE CHARPENTIER
JORDI SAVALL ET MARC-ANTOINE CHARPENTIER : une interview
exclusive
|
|
Notre revue a eu le grand plaisir de demander à Jordi
SAVALL quelles étaient ses impressions quant au grand musicien français dont
nous fêtons le 300ième anniversaire de sa mort. Avant le concert consacré à
CHARPENTIER qu'il donnait cette soirée à Vézelay, il a bien voulu rappeler
quelles furent les conditions de sa rencontre avec l'oeuvre du musicien et quels
conseils il propose à l'auditeur contemporain pour aborder cette oeuvre
délicate...
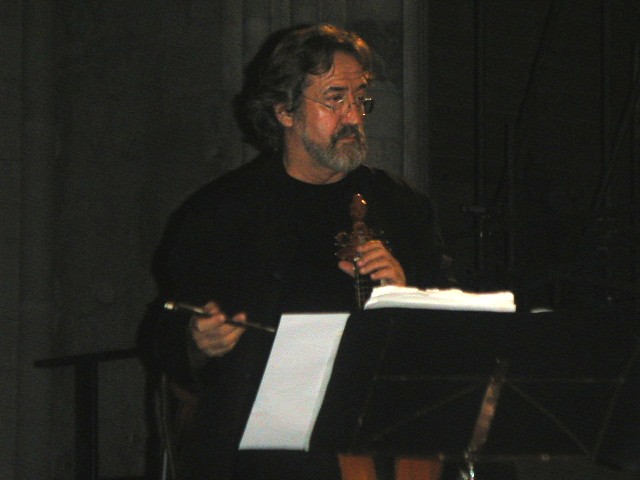
©
LEXNEWS 2004
LEXNEWS : « Comment avez-vous
découvert CHARPENTIER dans votre parcours musical ? »
Jordi SAVALL :
« J’ai
découvert CHARPENTIER dans la première période de mon parcours où j’étudiais la
musique française de Marin MARAIS, François COUPERIN, et bien d’autres encore
que je découvrais avec passion à la Bibliothèque Nationale et également à la
Bibliothèque de Versailles. C’est avec ce travail de recherche que je me
préparais à apprendre à jouer de la viole de gambe et à cette occasion je me
suis rapidement rendu compte que CHARPENTIER était l’un des plus grands de cette
époque. C’est à cette même époque que j’ai réalisé que autant LULLY, et après
lui Marin MARAIS et François COUPERIN, avait pris une place très importante dans
la musique d’opéra et la musique instrumentale, autant CHARPENTIER avait
vraiment développé avec la musique religieuse un art dans lequel il excellait au
dessus de tous. J’ai essayé en premier lieu de m’imprégner de son œuvre. Après
quelques années de travail, j’ai pu réunir un bon ensemble de chanteurs avec la
Capella Reial et en 1989 nous avons fondé le Concert des Nations avec
lequel nous avons pu réaliser le premier enregistrement de CHARPENTIER.
J’essayais alors de choisir des pièces qui montraient le parcours de la vie de
Marie mis en musique. C’est ainsi que j’ai pu introduire des pièces dans ce
disque qui dataient de ces premières années de recherche. Je dois avouer que
c’est toujours un souvenir émouvant que d’évoquer cette période où j’avais
réussi à réunir toute l’œuvre complète de CHARPENTIER en microfilms : cela
tenait en 4 ou 5 grands rouleaux de microfilms ! C’est ainsi que je pouvais
aller d’un livre à l’autre et choisir à loisir toutes les œuvres de ce grand
musicien. C’est en plus une musique qui est écrite de manière très claire, la
plupart des œuvres que nous avons enregistrées pour ce disque ont d’ailleurs été
jouées à partir de l’original sans transcriptions. C’est en effet un de mes
meilleurs souvenirs quant au travail sur la musique religieuse baroque de cette
époque avec MONTEVERDI ! »
|
LEXNEWS : « Quel conseil Jordi
Savall pourrait il donner à un auditeur contemporain pour écouter CHARPENTIER de
nos jours ? »
Jordi SAVALL :
« Je pense que c’est une musique qui comme toutes les musiques est tributaire de
son interprétation. Il y a certes des musiques qui s’avèrent être plus
tolérantes quant à leur approche. Elles peuvent supporter des interprétations
plus souples sans pour autant les dénaturer. A l’inverse, pour la musique de
CHARPENTIER, comme celle de Marin MARAIS d’ailleurs, l’interprétation, le jeu de
la viole, la manière de chanter ainsi que tous les autres processus contribuent
à la dimension spirituelle de cette musique. Les œuvres de CHARPENTIER comme
celles de MONTEVERDI ou celles de Tomas Luis de VICTORIA sont beaucoup plus que
de belles compositions ou de beaux contrepoints, il y a toujours un message
spirituel très fort et il faut le retrouver. Il faut vraiment dépasser le cadre
du concert et considérer ces musiques comme de véritables œuvres vivantes
spirituelles. Je pense que c’est ce qui fait que ces musiques sont parfois plus
difficiles d’accès à un auditeur si l’interprète n’est pas véritablement habité
par cette approche. Je pense que c’est le danger de faire du CHARPENTIER comme
on pourrait faire du HAENDEL ou du VIVALDI, ce n’est pas la même chose ! Si des
œuvres de CHARPENTIER peuvent apparaître de prime abord comme spectaculaires, ce
n’est pas cet aspect qui prime chez ce compositeur… Je pense qu’il est possible
de lui appliquer cette phrase de COUPERIN qui disait : « J’aime mieux ce qui me
touche que ce qui me surprend » ! CHARPENTIER offre toujours une musique pleine
de grâce, de finesse, de contrepoint, d’harmonies très recherchées ainsi qu’un
travail sur les voix, sur la conception même de l’œuvre.
Les œuvres de CHARPENTIER ont un peu souffert d’autres
répertoires plus populaires. A l’époque le prestige qu’avait LULLY grâce à ses
privilèges éclipsait les autres musiciens de faire connaître leur art. Il ne
faut surtout pas considérer l’œuvre de CHARPENTIER sous cet angle car il n’est
pas un musicien de cour. Son œuvre religieuse est d’une grande pureté inspirée
notamment par l’Italie avec le travail réalisé avec CARISSIMI. Pour moi, c’est
un peu le PURCELL français avec qui il partage sa dimension créatrice, sa
maîtrise du contrepoint et son goût pour la recherche d’harmonies très
hardies.
Il me semble que le meilleur conseil que je puisse donner à
un auditeur contemporain c’est de prendre son temps pour découvrir tout cela. Il
faut se laisser porter par la musique et essayer d’entrer dans cette dimension
spirituelle et esthétique de l’œuvre de CHARPENTIER. »
© LEXNEWS 2004
|

|