|
| |
|
Littérature - Poésie - Romans
|
|
« Le Mépris » d’Alberto Moravia ;
Traduit de l’Italien par Claude Poncet, Editions Flammarion, 2025.

Si le film « Le Mépris » de Godard a suscité l’admiration de plus d’une
génération, phénomène qui a pu être de nouveau vérifié récemment lors de
la disparition de Brigitte Bardot, l’œuvre éponyme de l’écrivain italien
Moravia parue en 1954, et dont fut tiré le film, ne suscite pas moins la
même fascination, voire peut-être plus par certains côtés, notamment du
fait de la singularité du style de son auteur. En effet le lecteur de ce
chef-d’œuvre retrouvera toute la force de l’emprise fabuleuse de Moravia,
cette subtile façon de distiller un rythme, une atmosphère enveloppant
toujours un peu plus non seulement ses protagonistes, mais aussi son
propre lecteur ; Aussi, le film de Godard se révèle-t-il par les besoins
et exigences cinématographiques extrêmement condensé… A ce titre, il faut
lire et relire « Le Mépris » de Moravia dans cette traduction de Claude
Poncet, cette banale histoire d’amour d’un homme, Riccardo, devenu contre
mauvaise fortune cinéaste, et qui pense, croit, se persuade ne plus être
aimé de sa femme, histoire que l’auteur italien métamorphose en un long
récit tragique aussi déroutant que fascinant… Mêlant judicieusement
monologues, dialogues impromptus et piquants, et descriptions de
caractère, Moravia enferme son lecteur, chapitre après chapitre, doucement
mais surement, dans le piège des sentiments. Entre doutes, certitudes
vacillantes et désespoir, laissant entrevoir toute la beauté et la
puissance des paysages à nuls autres pareils de Capri, ce sont les
sentiments de chaque protagoniste qui se perdent, tel Ulysse, dans le bleu
azur entre ciel et mer jusqu’au « Mépris »… Moravia happe littéralement
son lecteur à l’image d’un lent poison distillé lentement, une force de
plume qui signera nombre de ses œuvres ; on songe notamment à « L’ennui »,
au « Conformiste », plus de trente ouvrages jusqu’à sa mort en 1990 et
faisant d’Alberto Moravia l’un des grands auteurs italiens du XXe siècle.
L.B.K.
Gustave Roud "Petit traité de la marche
en plaine, précédé d’Adieu et de Feuillets" collection Poche
Editions Zoé, 2025.
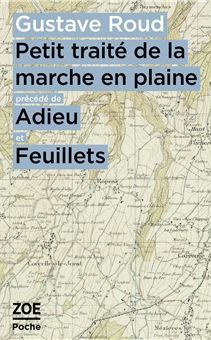
Les éditions Zoé ouvrent leur collection Poche à trois
petits textes composés par Gustave Roud qui forment, ensemble, un aperçu
éclairant et inspirant quant à la prose de cet écrivain. Figure majeure du
monde littéraire suisse du siècle passé, Gustave Roud livre, en effet, en
ces pages une rare intimité où l’esthétique s’entrelace avec acuité à
l’introspection.
« Adieu » composé en 1927 introduit l’éloge de la route, premier mot
ouvrant cette brève digression ponctuée de sensations à fleur de peau où
la nature dialogue avec le narrateur en un jeu intime de références : «
Voici naître aux feuillages la longue plainte harassée et sourde et si
triste où mon cœur a reconnu le chant même de sa voix perdue »… Jeux de
miroirs, quêtes inassouvies, adieux jamais confiés pour une Parole « qui
ne jaillira plus ».
« Feuillets », composé deux ans plus tard, propose des fragments glanés
ici ou là, nourris d’impressions subreptices ou assumées au détour de
paysages et de rencontres. Convoquant Mallarmé, Rimbaud, Baudelaire ou
encore Shakespeare, Gustave Roud prend conscience de sa singularité, de sa
distance avec ce que le tout-venant nomme la vie.
Véritable apothéose de ce petit recueil, le « Petit traité de la marche en
plaine » introduit par un incipit des Confessions de Jean-Jacques Rousseau
associe inexorablement identité et voyages. Roud confesse une mystique des
Alpes sous l’égide desquelles il ressort tout un entrelacs de rencontres,
de solitudes, de marches inlassables pour atteindre l’apogée ou … le
désespoir. L’écrivain suisse ne cherche pas pour autant à adopter un ton
élégiaque, ses confessions sont plus intimes, plus existentielles où
l’indicible prendra la forme d’un détour de chemin et les étoiles se
feront témoins d’un émoi inavouable.
Philippe-Emmanuel Krautter
Valère Novarina « Une langue
inconnue » Zoé Poches, 2025.
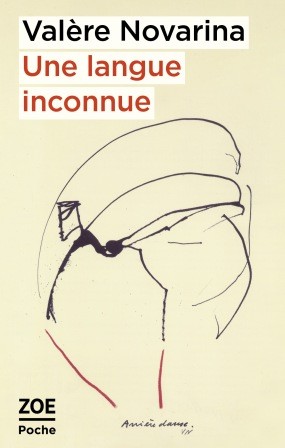
« Une langue inconnue » de Valère Novarina équivaut à une longue et
patiente exploration de nos rapports avec les langues, la langue...
Partant de son singulier rapport à une langue « maternelle » inconnue de
lui, en l’espèce le hongrois, le célèbre auteur de théâtre et essayiste,
témoigne de cette intime relation qu’il interroge depuis des lustres,
déjà. Pouvons-nous concevoir ce lien, en apparence incompréhensible, entre
une langue maternelle et le sentiment d’extranéité qui lui serait propre ?
Tel pourrait être notre propre rapport avec toute langue, la nôtre, comme
celle que nous empruntons parfois à d’autres cultures, un subtil équilibre
de familiarité et d’étrangeté, toujours prêt à se rompre pour les plus
belles efflorescences comme les pires incompréhensions…
Arpentant patiemment les différentes faces de cette montagne abrupte
qu’est la langue, Novarina invite son public, tout comme son œuvre, à se
familiariser avec ces paradoxes langagiers constitués de sommets et de
précipices, de surfaces et de profondeurs insondables. Composé de trois
textes, autobiographiques ou analytiques, « Une langue inconnue » témoigne
de cette recherche vivante et sans cesse questionnée afin de permettre ces
jaillissements dont le comédien sera le vecteur sur scène, tout autant que
le lecteur en son for intérieur.
Un essai rassérénant sur la langue, à l’heure où celle-ci se trouve de
plus en plus mal menée, voire agressée…
"La maison du magicien" d’Emanuele
Trevi ; Traduit de l’italien par Nathalie Bauer, Philippe Rey Éditions,
2025.
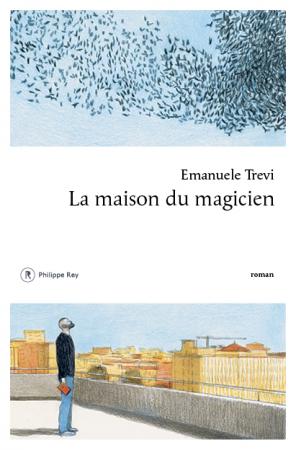
Avec Emanuele Trevi et « La maison du magicien », nous déambulerons au
cœur de l’un de ces mandalas dont son père, analyste jungien renommé en
Italie, en avait la pratique, une habitude héritée en cela de son maître
suisse, le non moins célèbre Karl Gustave Jung… Que révèle ce mandala
donné sous forme de roman ? Une quête identitaire ? La recherche de
racines ? L’auteur ne cherche pas à asséner des réponses, mais suggère
plutôt des voies, parfois étranges, dans les méandres de la conscience se
heurtant ou composant avec celles de l’inconscient. Dans ces horizons
évanescents, et parfois déconcertants, la plume aussi mordante que
poétique d’Emanuele Trevi accompagne le lecteur dans ses propres
questionnements. Car nous sommes toutes et tous amenés à errer un jour ou
l’autre dans une maison de magicien, qu’il s’agisse de celle d’un parent
comme dans le cas présent, ou plus imaginaire. À la recherche de ce père
imprévisible, Emanuele Trevi reparcourt dans ces pages, elles-mêmes
inattendues, les filigranes du souvenir. En cette quête où la psyché
scande si souvent à notre insu les évènements et les êtres, l’auteur tente
de prendre la distance nécessaire – sans y réussir toujours!
L’auteur revisite ainsi le passé et le présent selon des réminiscences
constitutives, notamment cette précieuse mémoire redécouverte à partir du
livre de Carl Gustav Jung abondamment annoté par son père. Le lecteur ira
de découverte en découverte, parfois triviales comme cette femme de ménage
digne d’un film de Fellini ou cette déconcertante prostituée péruvienne
qui, paradoxalement, viendront ancrer le romancier dans ce qui jusqu’alors
relevait d’un monde flottant… Une pérégrination aussi légère que profonde
dans les tréfonds de « L’Homme à la découverte de son âme » pour reprendre
un titre jungien…
Philippe-Emmanuel Krautter
« Les Adieux » de Philippe de la
Genardière, Editions Actes Sud, 2025.

C’est toujours un vif plaisir de retrouver Philippe de la Genardière, cet
écrivain qui écrit avec parcimonie et dont les livres sont dès lors
toujours attendus et salués. Et nul doute que son dernier ouvrage, « Les
Adieux » ne fera pas exception avec son atmosphère quelque peu évanescente
presque diaphane…
Il nous laisse, ici, en effet en compagnie de Césaire, écrivain veuf qui
n’écrit plus, mais qui le soir sur sa terrasse ou descendant vers la
rivière bordant cette maison du Sud (qu’on imagine belle) parle à sa
défunte épouse, Sofia, l’amour de sa vie, sculptrice disparue dix ans
auparavant et dont l’atelier est demeuré intact dans ce jardin ; Césaire
qui parle encore à son chien, à sa voisine aussi ou à sa doctoresse…
Césaire parle et contemple les étoiles, la rivière, égrenant ses pensées
et méditant sur l’écriture, la poésie, la beauté, l’amour ou le plaisir…
Et puis ce temps qui passe, le néant, la mort, bien sûr, mais « mourir,
c’est une autre affaire », vous dira-t-il … Des interrogations, encore, la
foi, l’humanité et « le silence comme respiration du monde»… Sans oublier
ce carnet comme un testament ou une lettre d’amour retrouvée de Sofia…
Le lecteur se laisse entraîné à la suite de Césaire, cet homme seul
avançant doucement vers un âge certain ; on se surprend à l’écouter
marmonner, pérorer ou songer sur son banc comme on rêve à hier et aux
années passées ; partageant émotions et temps qui passe, partageant ces
liens ténus et intimes que l’auteur nous fait avec élégance et délicatesse
« éprouver et effeuiller comme le grand livre des émotions ». Rien de
lourd ni de lassant, cependant, Philippe de la Genardière sait trop bien
se faire léger, redoutant plus que tout, la pesanteur des mots et la
lourdeur des phrases, leur préférant « la légèreté d’une feuille morte »
vous dira tout bas Césaire…
L.B.K.
Jean Rouaud : « La constellation
Rimbaud », Folio essais, Gallimard, 2024.

A noter, cet essai Folio signé Jean Rouaud intitulé « La constellation
Rimbaud ». Sous ce titre, l’auteur a entrepris d’interroger les nombreux
témoins de l’existence du poète. Proches ou moins proches, incontournables
ou plus éphémères, toutes ces sources nous disent à leur manière qui était
Rimbaud ; qui était celui qui délaissa si tôt la poésie pour les paysages
d’Afrique ; Paul Verlaine, Georges Izambard, bien sûr, mais aussi des plus
lointains se souvenant encore en 1954 l’avoir aperçu se promenant… ou
encore ces souvenirs vibrants, plus proches de nous, datant des années
1970, de sa nièce, Émilie Tessier, petite grand-mère recroquevillée dans
son fauteuil dans sa maison de retraite de Vouziers à quelques kilomètres
d’Attigny et qui interdisait à sa petite-fille de prendre le nom de
Rimbaud, « le nom de ce chenapan » …
Abordés ou plus exactement rangés selon les lieux, Charleville, Charleroi
à Marseille en passant par Aden, Harar, etc. , ces pages livrent sous la
plume de Jean Rouard aux observateurs aveugles que nous sommes aujourd’hui
une véritable pléiade des témoins de la brève existence du poète, ce que
l’auteur a appelé à juste titre : « La constellation Rimbaud » !
L.B.K.
Fouad El-Etr : "L’escalier de la rue de
Seine", Éditions L'Atelier contemporain, 2024.

Empruntons une à une les marches de l’escalier de la rue de Seine à la
suite du poète éditeur Fouad El-Etr en compagnie de son ami l’artiste Sam
Szafran grâce à cet ouvrage paru aux éditions de l’Atelier contemporain.
Réunissant deux textes témoignages, « Esquisse d’un traité du pastel » et
« L’Escalier de la rue de Seine », ce fort volume retrace le parcours
d’une vie et d’une revue passée à la postérité, La Délirante… A la fois
chantre d’une aventure qui relève du récit picaresque tant les défis à
relever semblaient quasi impossibles pour un seul homme, et poète des
temps modernes Fouad El-Etr a toujours été convaincu de sa démarche,
parfois contre vents et marées. Les solides amitiés qui résistèrent à
cette personnalité fougueuse et entière permirent cette aventure digne de
celle d’un Ulysse du XXe siècle. Face aux géants de l’édition moderne, un
homme sut en effet imposer une revue unique en son genre réunissant la
fleur de la littérature (Borges, Brodsky, Cioran, Paz, Schéhadé, Yeats,
etc.) et des arts (Bacon, Balthus, Botero, Szafran…).
Rédigés à cinquante ans d’intervalle, ces deux textes retracent ainsi
cette aventure romanesque de La Délirante et l’amitié qui lia l’auteur à
Sam Szafran. Le fil directeur réside dans ce fameux escalier du 54 de la
rue de Seine, un immeuble de six étages au cœur du quartier de
Saint-Germain-des-Prés où logeait Fouad El-Etr. C’est ce même escalier qui
allait bientôt sur les encouragements du poète éditeur devenir l’atelier
de travail de Sam Szafran, un atelier quasi-hypnotique qui devait se
transformer en labyrinthe prolongeant au siècle passé les gravures
tourbillonnantes des fameuses prisons de Piranèse. Dès la première lettre
datée de 1974, Fouad El-Etr jette les esquisses d’un traité informel du
pastel : « Je me rends compte seulement à quel point la technique du
pastel, que tu es le seul à perpétuer de nos jours avec un tel éclat,
s’est libérée avec le temps d’une destinée de demi-teinte pour se ranger,
avec ses poudres et couleurs, du côté de la peinture. Quel chemin depuis
le profil d’Isabelle d’Este esquissé à la pierre noire par Vinci, et
rehaussé de sanguine, de craie ocre et de blanc, et repris à l’estompe,
jusqu’aux splendides portraits de Chardin et de Perronneau, qui sont de
véritables hymnes au pastel !… ». Fixer l’éphémère grâce au pastel en
un fragile équilibre toujours menacé, telle était la crête envisagée. .
Ce « monologue poudré » est ponctué de réminiscences de Chardin, tout
autant que de perfections évoquées par le poète Francis Ponge. Cette
délicatesse exigeante devient alors omniprésente, page après page, le
lecteur devenant lui-même hypnotisé par tant de nuances encore accentuées
par le mouvement spiralaire récurrent des marches de l’escalier… Ce
vertige ouvrant vers de multiples infinis devient alors l’élan de la
création la plus incroyable, l’escalier formant lui-même une métaphore de
l’existence.
Avec « L’Escalier de la rue de Seine », nous franchissons ainsi les
barrières du temps en revenant dix années auparavant, un soir d’octobre
1965, véritable coup de foudre artistique. Acte de naissance de La
Délirante dont le premier numéro sortira en 1967, cette amitié aura à
braver les intempéries et les aléas politiques et sociaux (mai 68),
économiques (les impossibles financements) tout en poursuivant un
cheminement fécond entre poésie, art et littérature. L’indépendance de
Fouad El-Etr nourrie du dialogue fécond entretenu avec les plus grands
noms des arts et des lettres du siècle passé, sans compter les grands
auteurs plus anciens, donnera naissance à un travail éditorial unique en
son genre dans la grande tradition typographique conjuguant excellence et
raffinement. Un témoignage délectable et inspirant… on ne peut qu’en
remercier l’auteur, Fouad El-Etr.
Philippe-Emmanuel Krautter
Erri De Luca : « Les règles du
Mikado » traduit de l’italien par Danièle Valin, Editions Gallimard, 2024.

« Les règles du Mikado » présidant à la rencontre fortuite
d'un vieil homme et d'une gitane fuyant les siens, tel est le thème du
dernier roman d'Erri de Luca paru aux éditions Gallimard. En une évocation
à la fois pudique et profonde, le narrateur – dont l’auteur n’est jamais
très éloigné – ouvre la main pour recueillir cet oiseau apeuré poursuivi
par les siens. L’accueil, le partage, l’échange, la foi en l’être humain
quels que soient ses secrets, constituent les thèmes récurrents de ce
roman discret à l’image de son auteur. Le vieil horloger – nous ne
connaîtrons pas les noms des protagonistes comme s’en explique le roman en
préface – apprécie la minutie du geste, celle des mécaniques de précision
tout autant que l’habileté à se saisir des fins bâtonnets de bois du
fameux jeu de patience d’origine japonaise. Tout est lié, le destin des
hommes à l’image des parties composant la nature, la moindre modification
provoquant une suite d’effets souvent insoupçonnables, à l’image de cette
jeune femme dont le destin se trouvera étonnamment bouleversé tout autant
que celui de son bienfaiteur… Derrière l’intrigue apparemment simple se
cache une multitude d’analyses sur les situations, les caractères, le
destin et les multiples interactions suscitées par la vie. De Luca dresse
un portrait sensible de ses protagonistes où la poésie n’est jamais
éloignée, un récit initiatique en forme d’accueil de l’altérité qui laisse
une profonde inspiration de liberté après sa lecture dans la belle
traduction de Danièle Valin.
Henry Miller : "Jours tranquilles
à Clichy" ; Traduction de Gérald Robitaille ; Préface de Michael Paduano ;
Photographies de Brassaï, Editions Bartillat, 2023.

Les éditions Bartillat ont eu l’heureuse idée de publier pour la première
fois en français « Jours tranquilles à Clichy » de l’écrivain américain
Henry Miller illustré des photographies du non moins célèbre photographe
Brassaï. Ces récits entre roman et autobiographie d’années passées à
Clichy dans les années 30 du siècle passé relèvent tout autant de
l’impromptu incisif que d’une méditation sur la vie. Avec sa spontanéité
jouissive, le narrateur sait se saisir des petits riens du quotidien
illuminant une journée alors que les amours tarifées, la nuit venue,
scandent le récit selon le rythme libertaire bien connu de l’écrivain
américain. Bien entendu, certains propos seront difficilement admissibles
de nos jours, mais tel n’est pas le cœur de l’ouvrage traduit avec une
rare acuité par Gérald Robitaille qui sait en restituer le souffle
millérien.
À l’image du célèbre « Colosse de Maroussi », Miller sait en ces pages se
saisir de la vie comme d’une flamme entre les doigts, exercice hautement
périlleux où beaucoup ont péché par excès ou trop grande prudence. À la
différence de l’univers blafard, pour ne pas dire glauque d’un Céline
relatant le milieu proxénète de la ville de Londres quelques années
auparavant, Miller parvient à trouver un rayon de soleil dans les camaïeux
de gris de la capitale française. Période féconde de l’écrivain pourtant
dans le plus grand dénuement ainsi que nous le rappelle en postface
Michael Paduono, « Jours tranquilles à Clichy » parvient à restituer une
tranche de l’histoire d’un quartier populaire de Paris dans les 30 (mars
1932 à fin 1933 plus précisément) au 4 rue Anatole Franche à Clichy avec
son ami Alfred Perlès. Un récit haut en couleur, un hymne quasi extatique
à la vie.
Philippe-Emmanuel Krautter
Antoine Sanchez : « Le Pégase »,
Éditions L’Atteinte, 2020.

Il y a toujours quelques pépites littéraires que l’on découvre un peu plus
tard notamment lorsque la maison d’édition est discrète et édite
tranquillement des ouvrages de quelques dizaines de pages sensibles et
tournées vers l’intime et l’humain. Tel est le cas de ce court roman «
Pégase » dont l’auteur, Antoine Sanchez, musicien et écrivain, transcrit
les rythmes des mots de tous les jours des habitués accoudés au zinc ou
assis à une des tables de ce bar-tabac de village, hors du temps, non loin
de l’église et de sa place où joue Norbert, le musicien, que tous
connaissent. Pégase sauvé de sa fermeture par Raymond et Odile est un lieu
hanté par ses habitués, par toutes ces personnalités qui y laissent une
trace journalière, d’une banalité parfois déconcertante, mais qui sont les
meilleures vigies de tout ce qui peut ou pourrait se passer dans le
village. Fins observateurs des autres, ces personnages iconiques de ce
lieu sont eux-mêmes regardés et commentés par les autres. Ils s’inquiètent
du retard de l’un, de la santé de l’autre, de l’absence trop prolongée
d’un tel… Tous ont bien plus de « relief » que ne laissent paraître leurs
rituels quotidiens.
« Au Pégase, il a ceux qui sont là depuis toujours. Le zinc, la bête et ce
verre que l’on brandit en guise de prière, entre soif de joute et
d’immobile. » Au Pégase, il a aussi ceux qui ne feront que passer.
Un café, un petit blanc, un thé, un scotch… si tôt ! Un autre ?
Tient que ce passe-t-il, un brin de déprime, de nostalgie ou de
mélancolie, vas-y parle-nous, raconte… « Ce court texte émaillé de
réflexions philosophiques et métaphysiques, est un vrai petit théâtre,
fait de vies cabossées dont on détourne habituellement le regard » écrit
l’éditeur et de ce fait il n’est plus possible d’entrer dans un bar et de
ne pas observer ce foisonnement de moments de vies qui y passent un court
instant sans imaginer la suite de toutes ces histoires potentielles,
celles qui réjouissent l’imagination des écrivains.
« Les derniers clients sortent leurs billets, leurs pièces, leurs cartes.
Raymond regarde dehors, la nuit, la lumière des lampadaires, des
silhouettes fuyant sous la pluie. Une journée comme une autre. Rien qu’une
journée comme une autre. »
Sylvie Génot-Molinaro
Richard Rognet : « Patienter sous les nuages », NRF,
Editions Gallimard, 2024.

Dans son dernier recueil, le poète Richard Rognet nous convie à «
Patienter sous les nuages », belle invite que le lecteur ne manquera pas
de suivre à la lettre ! L’auteur puise en ces pages inspirées à l’encre
diaphane de ces formes évanescentes par excellence, nous entraînant dans
une contemplation que les temps modernes tendent trop souvent d’occulter.
L’ouverture de ces poèmes en prose se fait sous la forme d’une promenade
où les sens sont aux aguets, prompts à saisir l’insaisissable, frôlements,
ombres, songes… L’écriture se conçoit alors comme viatique à la douleur et
autres peines du monde. Le langage entendu ainsi devient synonyme de vie,
toujours en devenir, jamais révolu.
La poésie de Richard Rognet se veut mouvement, vibrations, parfois
imperceptibles de la nature et du monde. En un élan toujours renouvelé, le
poète tente d’en retenir l’essence, de l’approcher à l’affût, la nature
revêtant alors un autre manteau, non plus accessoire de nos loisirs mais
bien celui incontournable de la vie même. Cette inspiration élégiaque qui
transparaît de cette prose sensible n’a rien de convenu mais relève plutôt
du souffle vital du poète qui y puise notamment ces vers d’une grande
délicatesse dont les dialogues impromptus avec les éléments renforcent
encore notre émerveillement : « J’entre dans la lumière qui fourmille
parmi les arbres, je lui demande quel chemin elle veut bien me proposer
pour que j’aille toucher les ultimes langues de neige qui étincellent sur
les les pentes, j’entre dans la profondeur de la lumière… ».
Philippe-Emmanuel Krautter
« Giocanda » de Nikos Kokàntzis,
traduction du grec par Michel Volkovitch, Mikros Littérature, Éditions de
l’Aube, 2022.
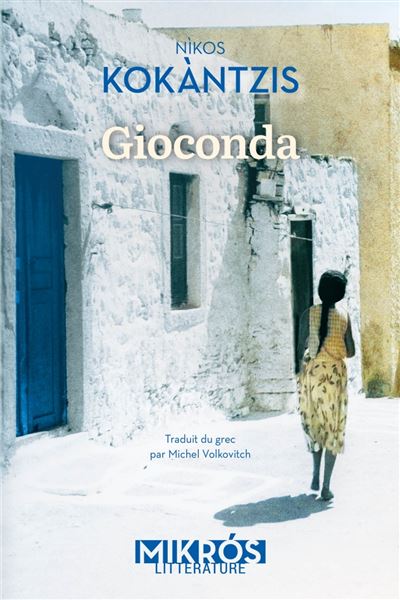
Giocanda est l’œuvre d’une vie et d’un souffle, celui de
l’amour inconditionné et éternel réunissant à jamais deux êtres que
l’Histoire cherchera pourtant à séparer… Nikos Kokantzis livre, en effet,
avec ce témoignage sensible et poignant l’histoire – sa propre histoire –
d’un jeune adolescent dans la ville cosmopolite de Thessalonique où
communautés juives et locales vivaient en harmonie jusqu’à ce que le vent
de la Seconde Guerre mondiale ne vienne balayer à jamais tous ces liens.
Giocanda est une jeune fille juive, voisine de Nikos, l’auteur et
narrateur, les deux adolescents scellant rapidement leur destin en des
liens purs et absolus. Kokantzis, page après page, se remémore ces amours
naissantes, ce rapprochement indéfectible entre deux êtres qui allaient
bientôt – trop tôt – être séparés à jamais. Mais c’était sans compter sur
le travail de mémoire et d’écriture qui allait combler ces vides et
perpétuer ce souvenir passionnel transcendant ainsi les affres du temps.
Nul lyrisme, nul pathos dans l’écriture limpide et poétique de l’écrivain
grec si bien rendue par la belle et sensible traduction de Michel
Volkovitch, mais la présence et la sensualité de ces deux jeunes
adolescents en des pages qui pourraient bien être une définition de
l’amour absolu... Une évocation dont le lecteur ne sortira pas indemne et
qui contribue à perpétuer la mémoire de tous ces êtres brisés par le
destin.
À noter la récente parution du même auteur disparu en 2009 : « Le vieil
homme et l’étrangère » aux mêmes éditions de L’Aube.
Philippe-Emmanuel Krautter
« Pièces roses » et « Pièces
baroques » de Jean Anouilh, Coll. « La Petite Vermillon », Éditions La
Table ronde, 2023.
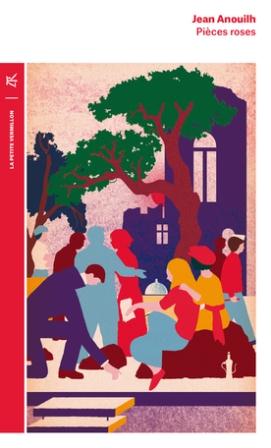
Si Antigone demeure l’œuvre la plus célèbre de Jean Anouilh, ses
nombreuses autres créations ne sauraient pour autant être négligées
notamment celles dénommées « Pièces roses » ou encore « Pièces baroques »
que le lecteur retrouvera dans ces deux volumes récemment parus dans la
collection « La Petite Vermillon » aux éditions La Table ronde. Des œuvres
empreintes de fantaisie, de légèreté et d’humour, ainsi que leur titre
respectif le laisse présager. L’auteur avait lui-même rangé et regroupé
ses pièces selon cette thématique : « roses », « baroques » ou encore «
Pièces costumées », « Pièces grinçantes », etc. également parues dans
cette collection.
« Humulus ou le muet » qui ouvre le recueil « Pièces roses » sera la
première pièce de Jean Anouilh qui sera représentée en 1932. L’histoire
est celle d’un muet, Humulus, qui ne peut après avoir été soigné prononcer
qu’un seul et unique mot par jour ; Comment en ces circonstances déclarer
son amour ? Pièce courte pleine de fantaisie mais aussi un brin cruelle… «
Le bal des voleurs » qui suit sera l’un des premiers succès de l’auteur
après « Le voyageur sans bagage » et signera une longue coopération entre
Anouilh et Barsacq. Enfin, représentée en 1940, « Léocadia » après « Le
Rendez-vous de Senlis » et qui referme ce volume est probablement la pièce
la plus connue avec une jolie thématique intemporelle, celle du temps et
de la vie…
Le lecteur retrouvera dans le volume « Pièces baroques » trois autres
pièces de théâtre créées dans les années 1960-70 notamment « Cher Antoine
ou l’amour raté » de 1966 ; un huis clos caustique sur fonds d’ouverture
de testament offrant un jeu aussi âpre que pétillant suivi de « Ne
réveillez pas Madame » et du « Le Directeur de l’Opéra », des oeuvres
également pleines d’un humour sans concession sur le monde de la scène et
l’amour…
L.B.K.
« Le Tour du Monde en 80 jours »
de Jules Verne et « Jane Eyre » de Charlotte Brontë, Editions Larousse,
2023.
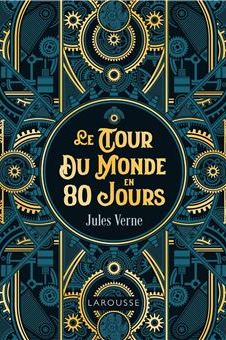
Quel plaisir de retrouver ces titres de toujours – « Le Tour du monde en
80 jours » de Jules Verne ou encore « Jane Eyre » de Charlotte Brontë – dans
cette collection collector chez Larousse ! Un ravissement qui allie autant
le plaisir des yeux que celui de la lecture avec une mise en page claire,
des caractères lisibles, de belles illustrations et de jolis culs-de-lampe
ou autres ornements ; tout enchante dans ces ouvrages d’antan offerts aux
siècles derniers à Noël aux enfants fortunés ou pour les plus studieux à
titre de récompense, ce que l’on nommait alors « Prix de fin d’année »…
« Le Tour du monde en 80 jours » de Jules Verne, cet incontournable
classique publié pour la première fois en 1872, enchante toujours autant
les grands et plus jeunes avec ces extraordinaires aventures de Phileas
Fogg et de son fidèle domestique ; qui n’a jamais rêvé en tenant entre ses
mains ce fabuleux voyage ? L’un des meilleurs romans de Jules Verne ayant
connu bien des traductions et adaptations… Sa lecture demeure cependant
dès plus jubilatoire !
« Jane Eyre » de l’anglaise Charlotte Brontë, l’aîné des trois « sœurs
Brontë », est, pour sa part, un roman inoubliable qui a bouleversé nombre
de générations depuis le XIXe siècle. Comment oublier, en effet, la vie de
cette orpheline qui subira les affres de sa tante et cousines, avant que,
devenue gouvernante, elle ne tombe amoureuse du père de son élève, Mr.
Rochester, pour le meilleur et pour le pire… Un ouvrage considéré comme le
chef d’œuvre de Charlotte Brontë!
L.B.K.
François de Saint-Chéron : «
Malraux devant le Christ », Editions Desclée de Brouwer, 2023.
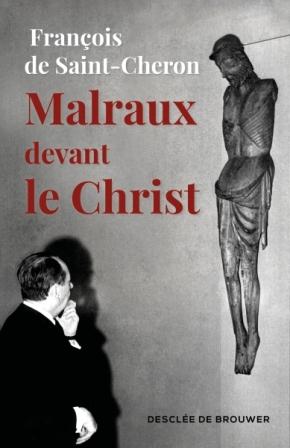
On connaît (certes, plus ou moins bien) l’œuvre, la vie ou la pensée de
cette incomparable personnalité éprise de culture et d’art que fut André
Malraux, et François de Saint-Cheron a par son talent et fidélité beaucoup
contribué et œuvré à cette connaissance. Il demeure cependant un point –
plus intime – sur lequel Malraux demeure moins connu, celui de la
religion. Si son attrait pour certaines religions notamment
extrême-orientales et sa fascination pour l’Inde sont plus familières ou
si nous avons tous en mémoire ses fabuleux ouvrages concernant l’art
chrétien (« Le Monde chrétien », « Le Surnaturel »), quelle était
cependant sa position ou croyance face à la religion chrétienne dans
laquelle il était né ? Si Malraux se présentait, ainsi que le souligne
l’auteur, comme agnostique, cette seule affirmation n’épuise cependant pas
à elle seule toute la question, tant s’en faut !
À la lumière de son œuvre et convoquant de nombreux témoignages (lettres,
biographies…), François de Saint-Cheron faisant preuve de pudeur et d’une
belle sensibilité révèle, en effet, au lecteur un Malraux bien plus
complexe et déconcertant : Son attrait ou attachement à certains saints –
on songe à saint Jean l’Evangéliste dont il demandera à une sœur lecture,
en 1944, alors qu’il pensait être fusillé au petit matin, mais aussi saint
François d’Assise ou Lazare – titre d’un récit autobiographique ; Son
respect, ses interrogations ou affirmations à certains de ses amis
notamment au Père Bockel, aumônier de la brigade Alsace-Lorraine, à
Mauriac ou à Bernanos, parfois appuyées ou reprises dans les pages de ses
ouvrages ; Son intérêt, enfin, accordée au Christ, à l’âme, au mal, à la
foi ou transcendance… Croyance, quête ou regret ?
C’est un Malraux effectivement plus intime et bien moins péremptoire que
certains n’avaient voulu le dire que découvriront les lecteurs de cet
ouvrage ; nombre de ses proches ou amis l’avaient pour beaucoup
parfaitement pressenti ou senti. Au-delà de sa réelle connaissance de la
culture chrétienne, Malraux semble, non pas obsédé, mais « hanté » par la
question de la transcendance, « cette part éternelle qui en lui [l’homme]
le dépasse. » écrira-t-il au Père Bockel… Ce n’était peut-être pas pour
rien que le Général de Gaulle lui avait un jour répondu : « Pourquoi
parlez-vous comme si vous aviez la foi, puisque vous ne l’avez pas ? »
L.B.K.
Chris Offutt : « Les Gens des
collines », Coll. « Totem », Éditions Gallmeister, 2023.
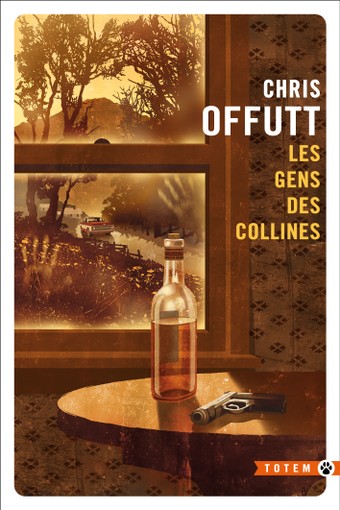
Mick Hardin est un enquêteur du CID, la division des enquêtes criminelles
de l’armée, spécialité homicides, en permission dans sa région natale du
Kentucky où vivent sa sœur, Linda, première femme shérif du comté, ainsi
que sa femme Peggy, enceinte et proche d’accoucher. Ce pourrait être le
début d’une histoire toute simple mais il n’en est rien … Mick aime un peu
trop le bourbon et les moments de solitude dans une cabane en bois au
milieu des collines, c’est là que Linda le trouve et lui demande de l’aide
sur une enquête. Mick a participé aux grands conflits militaires
américains et se pose en vétéran respectable mais cela suffira-t-il pour
que les habitants les aident à retrouver le témoin de ce crime et dont
tous connaissent l’identité de la victime ? Et quand bien même, quelqu’un
serait-il prêt à « cracher » le nom du meurtrier... Une course contre la
montre et une enquête serrée se profilent car Mick doit aussi reprendre du
service même avec pas mal de jours de retard et se débattre avec des
différends entre lui et Patty…
Chris Offutt joue sur sa connaissance des gens bruts et méfiants des
collines qui cachent leurs non-dits et leurs secrets. Dans les trois
premières pages du roman, le scénario s’écrit et une tension s’installe. «
…Quelque chose arrêta son regard, une couleur ou une forme qui n’aurait
pas dû être là… Il se redressa pour s’étirer le dos et vit une femme
allongée dans une position disgracieuse, le corps contre un arbre, la tête
pendant vers le bas, le visage tourné. Elle portait une robe élégante. Ses
jambes étaient nues et une chaussure manquait à son pied. L’absence de
culotte le fit douter qu’il puisse s’agir d’une chute accidentelle. Il
s’approcha et reconnut suffisamment ses traits pour savoir son nom de
famille. » Une ambiance western policier actuel, un rythme
cinématographique, des chapitres comme des plans-séquences et un style
clair nous plongent dans les familles du coin et la diplomatie parfois
limite que Mick affectionne pour obtenir ce qu’il veut entendre. Mick ne
voit plus les choses comme tout le monde, trop d’horreurs de guerre dans
son esprit, sans doute, et trop chercher empêcherait de trouver : « …Ne
cherche pas les champignons, regarde là où ils poussent. La nuit, ne
cherche pas la piste d’un animal, va juste là où il n’y a pas d’arbre.
Vois les formes et les couleurs, pas la chose elle-même. » Une porte de
sortie pour l’esprit de Mick, le chant des oiseaux, la beauté des arbres
et de la nature qui l’entourent et où il aime se réfugier.
Heureusement car pour tenir le coup et mener à bien cette enquête, Mick et
Linda vont compter les morts qui jalonneront les routes escarpées des
collines du Kentucky, comme l’intervention d’un agent du FBI, pas vraiment
le bienvenu dans ce comté. Mais il faudra bien faire avec les
susceptibilités de chacune et chacun et les méthodes peu orthodoxes de
monsieur Hardin, le passé de tous et trouver qui manipule qui suivant la
devise de Mick :
« Fais ce qui doit être fait ».
Sylvie Génot-Molinaro
« Je pense à votre destin – André
Malraux et Josette Clotis – 1933-1944 » de Françoise Theillou ; 256 p.,
Coll. « Essai français », Editions Grasset, 2023.
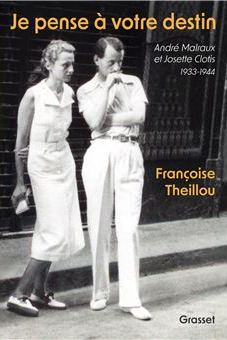
La vie et la personnalité de Josette Clotis, deuxième compagne d’André
Malraux de 1933 à 1944, sont quelque peu moins connues ; on songe en
comparaison, bien sûr, à sa première épouse, Clara Malraux, union dont
naîtra Florence Malraux. André et Josette se rencontre avant-guerre à la
NRF, Malraux est déjà un écrivain connu et il obtiendra le Prix Goncourt
quelques semaines plus tard. Josette, apprenant la nouvelle chez ses
parents en province, ne sera pas peu fière de cet amant… mais André
Malraux est marié, et Clara enceinte de Florence… L’auteur, Françoise
Theillou, s’est appuyée pour écrire cet ouvrage sur de nombreuses archives
dont les journaux intimes de Josette Clotis. Elle nous donne ainsi à lire
cette liaison faite de séparations, d’absences, d’amour et
d’incompréhensions. Heureuse, se morfondant, désespérée, combien de
chambres d’Hôtel, d’heures passées à attendre André...
Ils sillonneront ensemble, séparément ou parallèlement durant les années
de guerre la France du Nord au Sud et du Sud au Nord. Durant ces années,
si Malraux affirme sa personnalité et sa vocation d’écrivain, s’enfermant
pour écrire, Josette, elle, y renoncera ; André deviendra également le
fameux colonel Berger. Malraux n’aura pas toujours, ni même souvent, sous
la plume de Françoise Theillou la part belle. L’auteur, fidèle en cela aux
archives en sa possession, n’a pas entendu travestir la réalité. L’ouvrage
est d’ailleurs complété par de nombreux inédits issus notamment des
papiers personnels de Josette, de billets ou de correspondances d’André
Malraux à Josette ou encore d’un Cahier de préparation également inédit
d’André Malraux.
De ces années de vie côte à côte, naîtront deux fils que le destin ravira
violemment à André lors de leur adolescence dans un tragique accident de
voiture, après lui avoir déjà ravi quelques années auparavant dans un non
moins tragique accident de train ; leur mère, Josette Clotis ; celle qui
durant plus de dix années de 1933 à 1944 n’aura jamais hésité à attendre,
à courir et rejoindre sur les quelques mots d’un message celui qu’elle
n’aura jamais cessé d’aimer, celui qui signait de chats en fil de fer,
André Malraux.
L.B.K.
« Hommage à Philippe Sollers »,
NRF, Editions Gallimard, 2023.
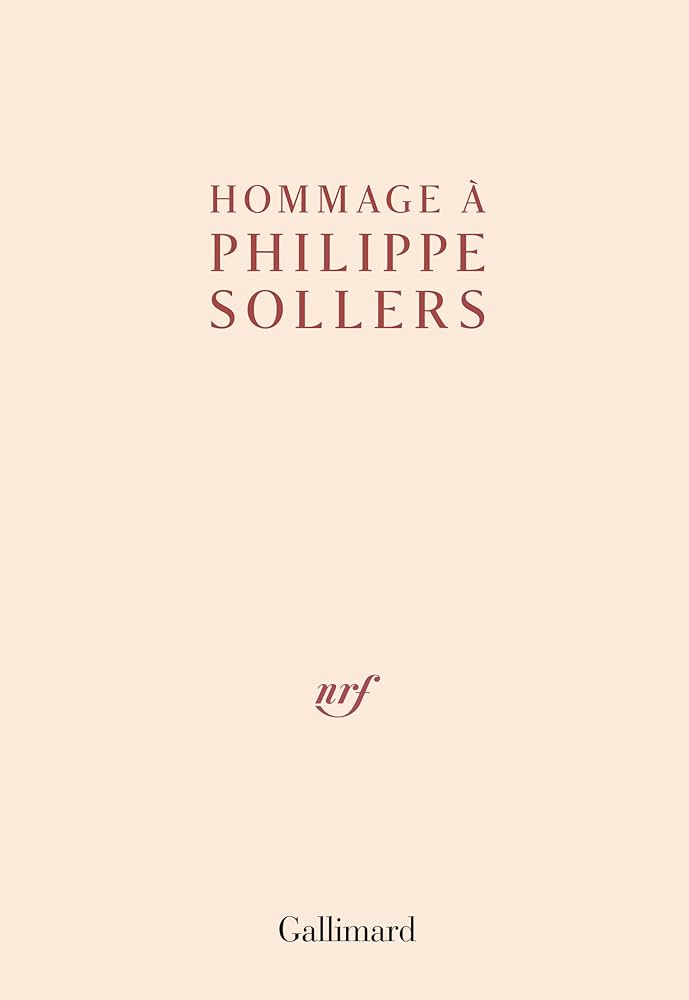
Comment rendre hommage à Philippe Sollers après sa disparition au
printemps 2023 à l’âge de 86 ans ? Qui ne connaît pas Philippe Sollers ?
Mais le connaît-on vraiment ? Derrière les clichés trop souvent véhiculés
plus vite que la lumière se cache un homme épris de liberté, de beauté et
d'amour, éléments d'un ciment imperturbable qui édifia, année après année,
une réflexion majeure et innovante dans notre société en crise de fausses
certitudes. Si l'homme attire ou agace certains, Philippe Sollers ne
laisse assurément pas de glace, mais brûle d'un feu qui jette des
éclaircies dans notre quotidien.
Cet « Hommage à Philippe Sollers » publié aux éditions Gallimard réunit
ses amis, ses connaissances de longue date en autant de rencontres que
l’écrivain suscitait ou accordait toujours avec générosité. Hommage donc
non point à un défunt, mais à un éternel amoureux de la vie qui se
prolongera encore par ces nombreux témoignages laissés en sa mémoire.
« Francis Ponge , Philippe Sollers -
Correspondance. 1957-1982 », Édition de Didier Alexandre et Pauline Flepp,
Collection Blanche, Editions Gallimard, 2023.
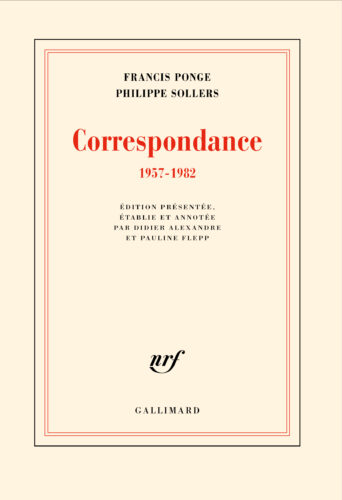
Voici réunis en un seul et fort volume publié aux éditions Gallimard
vingt-cinq ans de correspondance entre deux personnalités emblématiques de
la littérature du XXe siècle, Francis Ponge et Philippe Sollers. Cette
parution établie par Didier Alexandre et Pauline Flepp survenant au
lendemain de la disparition de Philippe Sollers, le 5 mai 2023, permettra
d’apprécier la richesse et la verve toujours présente chez l’écrivain
dialoguant avec le poète, son aîné. 37 ans séparent, en effet, ces deux
hommes que l’amitié va réunir, Ponge pressentant rapidement les qualités
littéraires du jeune écrivain qui signe encore sa correspondance par
Philippe Joyaux, son patronyme officiel. Les quinze premières années de
cet échange nourri témoignent du soutien indéfectible de Ponge pour ce
jeune espoir qu’il recommande notamment à Marcel Arland et Jean Paulhan
pour la NRF. Très rapidement, le ton change et du formel « Cher Monsieur »
les différentes lettres seront introduites pas un « Cher Francis » et «
Cher Philippe »… Couvrant la période 1957-1982, cet échange épistolaire –
inimaginable de nos jours à l’heure numérique – reflète les grandes heures
de la littérature et de la culture de la deuxième moitié du siècle
dernier, tout autant que les petits tracas de la vie quotidienne et de
santé. Les livres en maturation transparaissent au fil des lettres,
l’œuvre en genèse des deux écrivains se dessinant parmi les cabales menées
à l’encontre de leur génie respectif. Cinéma, architecture – Sollers
confessant qu’il ne quittera plus la Cappella dei Pazzi de Santa Croce à
Florence !, peinture, musique… tout fait signe pour ces deux âmes éprises
de beauté. Malheureusement, comme toute amitié entière, les heurts ne
manqueront pas, notamment à partir de la rupture accélérée par les
évènements de mai 68, Ponge du côté de l’ordre en place, Sollers tournant
ses regards vers la Chine…
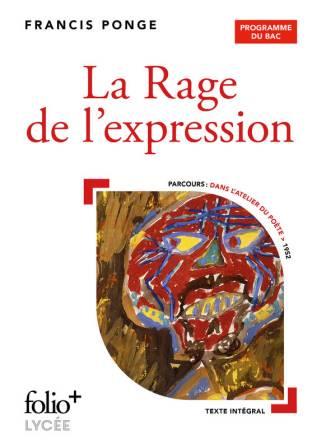
Vient de paraître également aux éditions Gallimard, collection Folio+
Lycée, le dossier programme du bac consacré au texte fondamental de
Francis Ponge « La Rage de l’expression ». Une publication très didactique
présentant toute la richesse de la démarche du poète dans le contexte
historique de son époque. Un dossier pédagogique également passionnant
pour les post-bacheliers !
"Deux vies" d’Emanuele Trevi, récit
traduit de l'italien par Nathalie Bauer, Prix Strega 2021, Philippe Rey
Éditions, 2023.
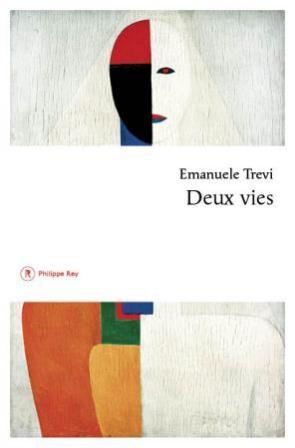
« Deux vies » convoque inexorablement une troisième vie qui
leur est intimement associée, celle du narrateur et auteur Emanuele Trevi
qui livre avec cet ouvrage un beau témoignage sur l’amitié et la vie dans
cette édition soignée et traduction inspirée de Nathalie Bauer. Ce récit
qui aurait pu être le sujet d’un roman se trouve être celui d’un survivant
qui avec le recul des années rend témoignage de deux âmes éprises de
littérature et de liberté. Pia Pera et Rocco Carbone, tous deux écrivains,
eurent en commun une vie pleine d’aspirations pour une durée trop
éphémère. À l’image de ces papillons d’un jour, ces deux personnages
illuminèrent la vie de l’auteur qui en ces pages à la fois attendries et
sans concessions sur le caractère de ses deux amis livre un plaidoyer
émouvant sur l’amitié sincère, si lointaine des virtualités digitales. De
quoi est composée cette amitié ? De proximités, mais aussi de distances
parfois, ainsi que le souligne l’auteur, le fameux « Parce que c’était
lui… » n’étant pas un long fleuve tranquille… Nous nous surprenons à
sourire de certains traits de caractère, à verser une larme sur ces
attentes à jamais insatisfaites, ces petits riens qui composent la vie
comme ils émaillent l’espoir. Mais, toujours, revient ce lien indéfectible
qui scande par ses pulsions le souvenir des années passées, ces sourires
et instants radieux passés ensemble et qui ne pourront jamais disparaître
de la mémoire du narrateur, ces flammes d’un amour partagé pour les
lettres et l’écriture même si parfois les avis fort heureusement pouvaient
diverger. Emanuel Trevi livre avec ce témoignage un récit sensible et
poignant, un hommage tout autant à ses amis disparus qu’un Tombeau
poétique perpétuant une antique tradition que l’auteur honore ainsi.
Philippe-Emmanuel Krautter
Robert Walser : « Retour dans la
neige » ; Traduit par Golnaz Houchidar ; Préface de Bernhardt Echte, Zoé
Poche éditions, 2023.
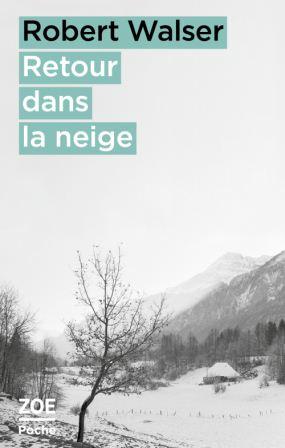
L’écrivain suisse Robert Walser (1878-1956) qui termina ses jours dans un
hospice à Herisau où il résidera 23 ans, sa raison l’ayant quitté, nous a
laissé pourtant de nombreux ouvrages témoignant de sa lucidité et de la
profondeur de ses jugements. À l’image de Nietzsche, peut-être a-t-il
traversé le miroir vers d’autres contrées qui nous paraissent
inexpliquées… Toujours est-il que le présent recueil de nouvelles « Retour
dans la neige » témoigne de son acuité à dresser en quelques pages un
tableau littéraire fait de concision, de détails ciselés en une prose à la
fois légère et percutante, sans oublier cette candeur et surprise au monde
qui se renouvelaient au quotidien chez l’écrivain. « … et il a fallu que
tous les traits si précieux de mon caractère, empreint de la musique de
mes origines, se perdent… (…) et qui sait, l’innocence de la campagne
reviendra un jour jusqu’à moi et alors je pourrai à nouveau me tordre les
mains dans la solitude ».
La belle traduction que livre Golnaz Houchidar de ces vingt-cinq proses
brèves restitue le charme de cette écriture à cette époque charnière de la
vie de l’écrivain venant de quitter Berlin et les avant-gardes pour
rejoindre sa ville natale. En un élan primesautier dans certaines pages,
Walser sait exulter et magnifier la nature qui sera un perpétuel
ravissement à ses yeux. L’écrivain parvient également en quelques lignes à
dresser un portrait d’une rare sensibilité, à contre-courant de ce qui
pouvait être réalisé jusqu’alors (splendide portrait de Madame Scheer).
Cette lucidité indocile ne cessera en ces pages de surprendre le lecteur
qui s’étonnera de son caractère rebelle tout autant qu’il sourira de ses
introspections. Nul dolorisme ni atermoiement chez Walser mais un
perpétuel étonnement aux choses de la vie ainsi que le relève Bernhard
Echte dans sa préface : « Au fil de ces textes, l’innocence du regard,
l’infinie curiosité du flâneur, la pudeur devenue précepte littéraire,
acquièrent une force intemporelle ». Avec « Retour dans la neige », Robert
Walser offrira au lecteur du XXIe s. de brèves et inoubliables pages
sublimant le quotidien.
Philippe-Emmanuel Krautter
"Le Corbeau - E. A. Poe, C.
Baudelaire, S. Mallarmé, gravures de Gustave Doré » ; Broché, 138 x 204
mm, 160 pages, Éditions de l'Escalier, 2022.
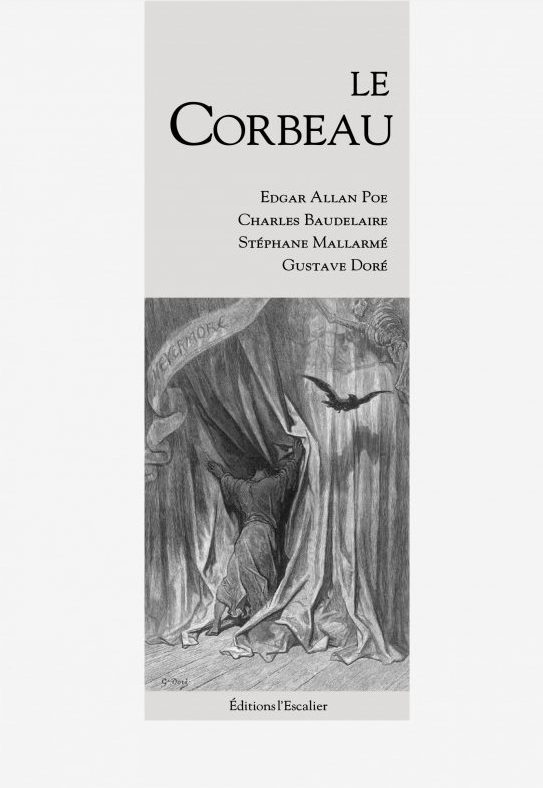
Trois incontournables poètes et un non moindre grand graveur pour un même
et seul animal, tel est le choix fait par les éditions de l’Escalier pour
cette mise en rapport originale du célèbre poème d’Edgard Poe « The Raven
» ou « Le Corbeau ». On y retrouve cette atmosphère singulière et irréelle
si chère à Poe. Un poème à la métrique stricte traduit, en effet, non
seulement par Charles Baudelaire, mais aussi par Stéphane Mallarmé, et
même gravé par Gustave Doré…
Ces relectures transversales qu’autorise ce recueil bien mené devraient
attirer l’attention de tous les amateurs de poésie, de traductions, mais
aussi de variations autour d’une même œuvre. À partir de quel point de
rupture le traducteur s’éloigne-t-il, en effet, de l’intention de l’auteur
? Existe-t-il d’ailleurs une intention unique de l’œuvre qui resterait
indissociable de son créateur ? Ces éternelles questions se poseront
irrémédiablement aux lectures successives de ce poème écrit en anglais par
l’écrivain américain Edgard Poe en 1845.
Là où Baudelaire débute par :
« Une fois, sur le minuit lugubre, pendant que je méditais, faible et
fatigué, sur maint précieux et curieux volume d’une doctrine oubliée,
pendant que je donnais de la tête, presque assoupi, soudain il se fit un
tapotement, comme de quelqu’un frappant doucement, frappant à la porte de
ma chambre. « C’est quelque visiteur, — murmurai-je, — qui frappe à la
porte de ma chambre ; ce n’est que cela, et rien de plus. »
Mallarmé propose :
« Une fois, par un minuit lugubre, tandis que je m’appesantissais, faible
et fatigué, sur maint curieux et bizarre volume de savoir oublié, — tandis
que je dodelinais la tête, somnolant presque, soudain se fit un heurt,
comme de quelqu’un frappant doucement, frappant à la porte de ma chambre,
— cela seul et rien de plus ».
Le lecteur se passionnera ainsi à passer d’une version à l’autre en
l’agrémentant de ses contemplations des gravures de Gustave Doré conférant
à leur tour au poème un éclairage encore autre et nouveau. Cette richesse
et ces ouvertures laissent une petite idée de la fécondité d’un thème,
lui-même emprunté par Poe à Charles Dickens avec le corbeau parlant Grip
dans « Barnaby Bridge » !
Régine DETAMBEL « Sarah quand même
», Editions Actes Sud, 2023.
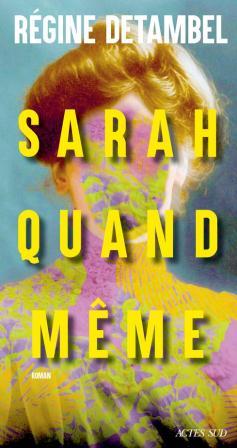
Susan claque la porte de Sarah Bernard, elle est épuisée par le caractère
de cette artiste, si grande soit-elle, dont elle rêvait d’être la
secrétaire particulière. Durant vingt ans, c’est ce rêve qui est devenu
réalité, Susan sera auprès de Sarah, dans son intimité jusqu’à en
connaître les moindres recoins, ses amours multiples hommes et femmes
(elle en fera l’expérience éphémère), sa famille, ses amis, ses rôles, ses
voyages, ses finances, ses contrats, sa santé, ses passions, ses colères
et son extravagance… Elle sera de tout. Et tout deviendra aussi son
cauchemar. « J’ai une chambre de domestique dans son hôtel de l’avenue
Pereire. Je n’ai plus d’autre chez-moi depuis vingt ans. Je n’ai pas
d’autre argent que celui qu’elle me donne. Je suis la personne la plus
proche de Sarah. Après son fils. Après toute une kyrielle d’autres
esclaves de Sarah. » . Sarah fait d’elle son souffre-douleur et le témoin
de sa très grande liberté. « Je suis donc la dame de compagnie et la
comédienne à domicile qui lui donne la réplique, la copiste ordinaire, la
costumière et la maquilleuse, parfois la cuisinière et même la confidente…
Parce que Sarah déteste être seule… Seule, elle deviendrait suicidaire. Il
lui faut toujours des adorateurs et adoratrices pour passer ses nerfs. »
Cette femme si chérie et admirée serait-elle finalement trop grande pour
ses épaules ? Les contorsions de la vie théâtrale de Madame Bernhardt, ses
déboires avec les nouveaux comédiens et comédiennes qui juste par leur
jeunesse et l’inventivité d’un autre jeu théâtral mettent en péril sa vie
avec un grand V, dévouée corps et âme pour la scène, avec ses
interprétations de personnages masculins ; des rôles qui, certainement,
ont fait avancer une certaine cause des femmes dans ce milieu mais ont
également déclenché et entretenu de la moquerie et presque du rejet. C’est
sans connaître la Bernhardt qui même amputée d’une jambe (son choix
conscient et éclairé, le 22 février 1915) poursuivra jusqu’au bout sa vie
de femme libre. « - Vous jouez depuis combien de temps ? – Depuis que
Victor Hugo m’a offert un diamant. – Et quand est-ce que vous allez
arrêter ? – Jamais.» Si même, parfois, dans un moment de tristesse ou de
désespoir Sarah raconte sa vie à Susan, ce en quoi l’auteur, Régine
Detambel, nous régale d’anecdotes sur sa vie tant historiques que privées.
C’est la version de Sarah qui restera « elle aura toujours été au plein
milieu de sa vie, sans aucun sens de la mort à préparer ou de la nécessité
de s’arrêter pour contempler le chemin parcouru… D’ailleurs non, elle
n’était pas au milieu de sa vie, elle en a toujours été à l’extrémité la
plus piquante, à la pointe violente et capricieuse, fougueuse et
séductrice de la vie. » Écrit Susan dans ce texte rédigé comme un journal
à rebours, de sa première rencontre avec son idole jusqu’à la déchirante
rupture, question de survie… « En arrivant à New York j’ai trouvé le
courage de la quitter. Je file sans un mot. » Là, dans tout ce tourbillon
Susan aurait tellement voulu que Sarah l’aime…
« Je ne veux pas être normale, je veux être extraordinaire. » et « Quand
même » était la devise de Madame Sarah Bernhardt.
Sylvie Génot Molinaro
Sébastien de Courtois : « L'ami des
beaux jours », Collection « La Bleue », Éditions Stock, 2022.
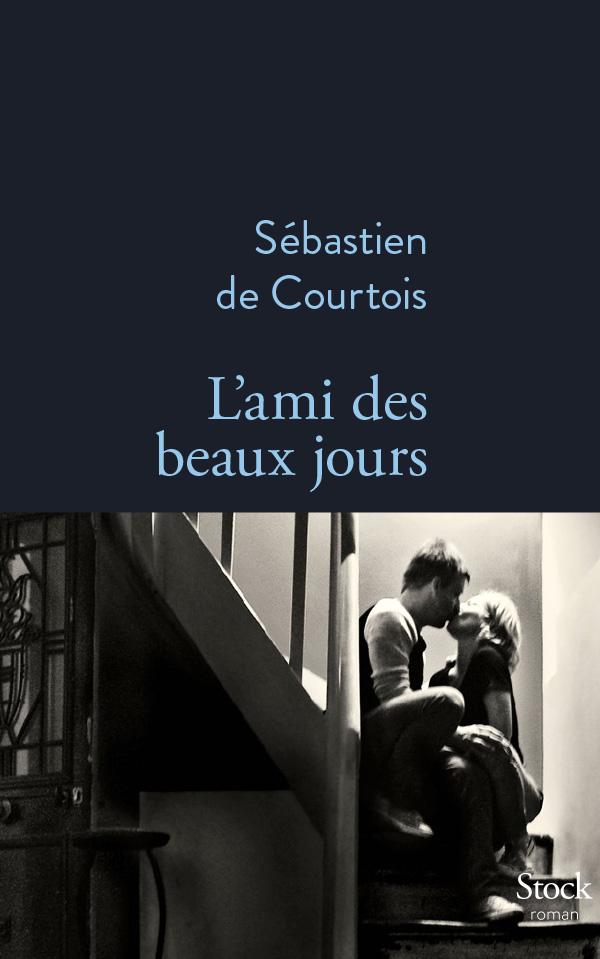
Si nous connaissions le journaliste et talentueux animateur de l’émission
« Chrétiens d’orient » sur France-Culture, Sébastien de Courtois, c’était
sans compter ses qualités de romancier, ainsi qu’en témoigne cet ouvrage «
l’ami des beaux jours » paru chez Stock. Happant le lecteur dès les
premières pages, ce récit d’une rare sensibilité ne pourra laisser
indifférent, tant un véritable scénario de film naît immédiatement et
spontanément dans l’esprit du lecteur de ces pages inspirées. L’histoire
est pourtant banale, celle d’une amitié entre deux jeunes étudiants de
province et d’un amour commun naissant pour une jeune femme de quelques
années plus âgée. Ce trio romanesque conduira le lecteur dans les tréfonds
de l’identité, une quête éperdue de l’être et du soi. Frédéric, « L’ami
perdu », à la recherche duquel le narrateur part sur le tard, posant ainsi
la question de l’altérité, mais aussi de celle de la communion si chère à
Montaigne et à de La Boétie. Et parce que justement c’était lui, Frédéric,
Sébastien le narrateur n’a de cesse de s’interroger tout au long de ces
pages au style incisif et percutant, des mots qui claquent tout autant
qu’ils font couler du miel. Cette introspection à la fois douloureuse et
cathartique questionne le sens de nos vies, entre idéaux et contingences,
passions et abandons… Et si « L’ami perdu » était en réalité le double du
narrateur ? Celui que nous possédons toutes et tous en nous et que nous
oublions trop souvent. C’est Sophie, anima du narrateur, qui le
conduira à cette prise de conscience…
Philippe-Emmanuel Krautter
Cedar Bowers « Astra » Éditions
Gallmeister, 2022.
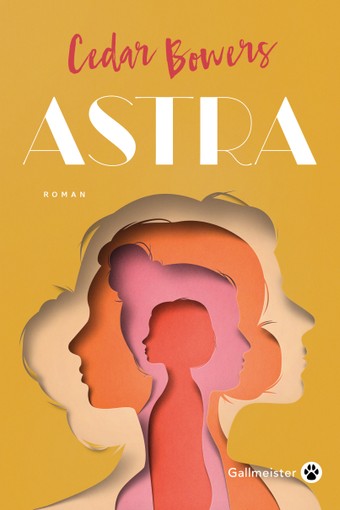
Astra ! Avec un tel prénom, une petite fille peut-elle vraiment grandir
sur terre avec d’autres personnes de son âge ou bien être une sorte
d’électron libre sans limites entourée d’adultes tout aussi éloignés de la
réalité ? C’est là le récit de Cedar Bowers qui pour son premier roman
brosse le portrait de cette petite sauvageonne devenue adulte et mère à
travers le regard et les sentiments de différentes personnes qui lui ont
été ou qui lui sont proches. Des regards croisés pour comprendre la vie d’Astra
qui a grandi sans entrave dans l’ouest du Canada et qui en gardera toute
sa vie les cicatrices psychiques comme physiques. De petite fille sauvage
à l’adolescente fugueuse, puis à la femme séductrice et néanmoins
vulnérable, chacun la décrit dans un parcours personnel, jusqu’au
témoignage de son fils Hugo qui la vénère. Mais ce portrait de femme nous
livre bien autre chose. Ce récit nous pose cette question qui nous taraude
tous : Connaît-on vraiment et complètement une personne ?
Dès la première phrase du livre, « Raymond Brine ne veut pas penser au
bébé à venir… Il ne veut pas penser aux liens du sang, ni à la filiation,
ni à la tendance irrépressible de l’humanité à surpeupler cette planète
exsangue. » Et pourtant c’est bien lui Raymond, le père d’Astra.
À partir de là, quel sera le futur d’Astra dont Gloria, sa mère, va mourir
trop vite ? Qui va entourer cette enfant dans cette ferme communautaire
nommée Celestial ? Quels seront ses repères à la réalité alors qu’elle n’a
cessé d’entendre cette phrase à la fois poétique mais destructrice de tout
équilibre possible pour une enfant : « N’oublie jamais qui tu es, Astra.
L’étoile du cosmos, l’impératrice des cieux. Tu es libre de tes actes. »
Mais « Elle n’est pas autonome, Raymond. Et tu ne devrais pas lui dire
qu’elle appartient au cosmos. C’est faux. Elle est ta fille. » C’est là la
source de tout ce que va vivre Astra, de ses choix instinctifs d’enfant
comme de ceux qu’elle fera une fois adulte. Astra est-elle une enfant
comme une adulte abandonnée à cette liberté trop grande pour elle ? « Qui
est cette fille, au fond ? Comment est-elle devenue ce qu’elle est ? » Un
constat dérangeant tout autant que fascinant entre mensonges, imagination,
violence, désordres, vérités et résilience. Lire Astra, c’est essayer de
déceler les fissures de son histoire, celles qu’elle-même a racontées avec
des chapitres manquants, d’autres modifiés, avec des phrases bancales et
des mots clés dispersés aux quatre coins de sa vie. Lire Astra, c’est
faire le chemin avec elle en la regardant de loin.
Sylvie Génot Molinaro
Liane de Pougy : « Dix ans de fête
– Mémoires d’une demi-mondaine », Editions Bartillat, 2022.
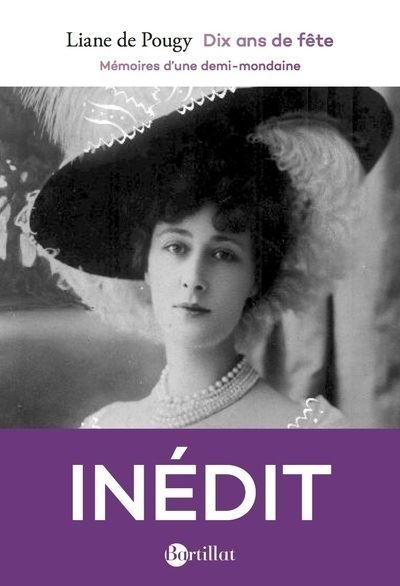
Les mémoires de la célèbre demi-mondaine Liane de Pougy (1869-1950)
viennent enfin d’être publiées, réunies en volume pour la première fois
par les soins d’Eric Walbecq, spécialiste notamment de Jean Lorrain, aux
éditions Bartillat ; pas moins de dix années du début du siècle précédent
vues par le bout de la lorgnette dorée de celle qui aurait pu être
désignée par Proust de « cocotte » à l’image d’Odette de Crécy dans la
Recherche… Car c’est bien le milieu de ces femmes oscillant entre
mondanités et plaisirs de luxe qui se trouve en ces pages décrit par le
menu détail par une femme qui semblait plus gouter les charmes féminins
que les amours tarifées de ses riches amants !
Les âmes dévotes et sensibles devront peut-être s’abstenir dans ces pages
parfois crues qui évoquent sans pudeur ce que pouvait être le quotidien de
ces femmes faisant vaciller le cœur des plus grandes fortunes de l’époque
et souvent plus attirées par les amours saphiques…
Mais de tels souvenirs pourraient être d’un intérêt limité s’ils ne
faisaient intervenir quelques grands personnages de cette fin du XIXe et
début du XXe s. notamment des écrivains tels Gabriele d’Annunzio ou encore
Jean Lorrain ; ce dernier subjuguera littéralement cette femme pourtant
guère impressionnable et dont le lecteur apprendra quelques révélations
étonnantes !
Celle qui naquit Anne-Marie Chassaigne rendra son dernier souffle en tant
que sœur Anne-Marie de la Pénitence après s’être convertie et avoir
prononcé ses vœux. Toute la vie de Liane de Pougy sera pétrie de
paradoxes, sa dernière chambre d’un palace à Lausanne ayant été par ses
soins transformée en cellule monacale…
Philippe-Emmanuel Krautter
Amos Oz : "Les terres du chacal" ;
Traduit de l'hébreu par Jacques Pinto ; Folio Folio N° 7151 Gallimard,
2022.
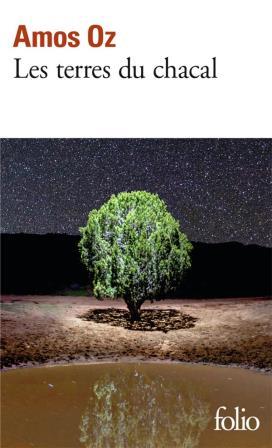
Ce recueil de nouvelles de jeunesse signé de l’écrivain israélien Amos Oz
et aujourd’hui réédité en Folio par les éditions Gallimard devrait ravir
les lecteurs fidèles de l’écrivain, mais également ceux découvrant son
œuvre.
L’univers des kibboutz à la fois clos, mais confronté à un extérieur
souvent menaçant constitue la trame de fond de ces courts récits de
jeunesse réunis sous le titre « Les terres du chacal » dans la belle
traduction de Jacques Pinto. L’animal, lui-même, sera également, en effet,
omniprésent dans ces récits trempés à l’encre déjà affirmée du romancier
Amos Klausner, mort en 2018, et plus connu aujourd’hui sous son nom
d’auteur Amos Oz. Ayant rejoint jeune le kibboutz de Houlda, c’est de
l’intérieur que le nouvelliste a pu s’imprégner de ces couleurs, ces
sonorités et senteurs qu’il parvient à rendre avec une rare acuité et une
sensibilité à fleur de peau. Cette hypersensibilité qui irise chaque
description, des plus triviales aux plus complexes, n’écarte pas pour
autant la dureté qui règne dans ces collectivités à l’image de la
description de ce jeune chacal pris au piège en un parallèle saisissant
avec la jeune Galila tombant dans la toile tissée par Matatyanou et dont
elle apprendra le terrible secret dans la première nouvelle « Les terres
du chacal », récit ayant donné son nom au recueil. La stupeur d’instants
de tensions mis en suspens se trouve en écho avec les éléments naturels
eux-mêmes tendus aux extrêmes qu’il s’agisse de la nuit, du jour, du
soleil ou encore de la pluie. Ces points d’intrications extrêmes se
prolongent jusqu’au moment où tout bascule, emportant avec soi le destin
des êtres en une fatalité parfois déroutante. Pour ces courts instants
inouïs d’introspection et de descriptions ciselées, le recueil de
nouvelles « Les terres du chacal » mérite d’être (re)découvert.
Albane Prouvost : « renard poirier
», collection Poésie, 88 pages, La Dogana, 2022.
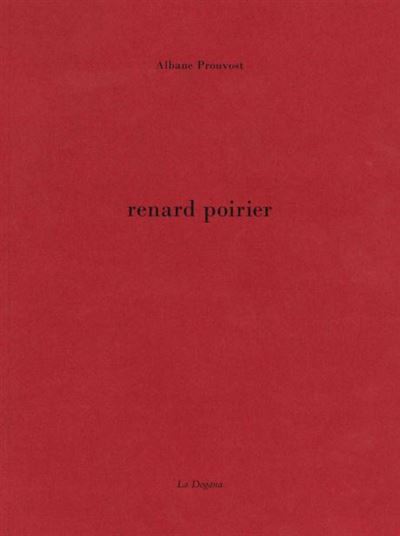
Albane Prouvost poursuit la longue maturation de son travail poétique.
Ainsi, après « meurs ressuscite », la poétesse a retenu pour titre
de son dernier recueil paru aux éditions de La Dogana, « renard poirier
», une réminiscence du poète russe Ossip Mandelstam et de « le poirier
a tiré sur moi » ou encore « le merisier et le poirier m’ont pris
pour cible »… En un long poème s’étirant tout au long du livre, «
renard poirier » suscite tour à tour étonnement, perplexité et
fascination, à l’image d’une longue litanie répétée à partir de quelques
notes ou mots épars. Passée la surprise, les associations de mots créent
un climat – glacé ou brûlant tour à tour – syntaxique envoûtant, sorte
d’état extatique dans lequel le lecteur se surprend à réciter ces mantras
d’un autre temps. En rapprochant de manière inhabituelle certains mots,
puis en les recomposant encore en autant d’autres manières, de nouvelles
associations surgissent et se créent, des sensations émergent
subrepticement ou submergent, comme celles ressenties à l’écoute de contes
anciens surgis des temps, voir même de certains accents pauliniens :
« les poiriers seront de la neige pour les pommiers
le renard croit le poirier
aussi le poirier croit le renard embrasé
poirier embrasé croit tout pardonne tout
espère tout »
Tel un rite initiatique, le poirier révèle ce qu’il suggérait jusqu’alors,
à l’image de l’identité d’Ulysse aux yeux de son père Laërte lors de son
retour à Ithaque à l’évocation des arbres de son verger dont il lui fit
présent. L’arbre chétif peut il espérer couvrir l’étendue de la neige sans
pleurer ?, questionne Alban Prouvost ; quel départ et quelle arrivée nos
souvenirs enneigés sont-ils capables de susciter comme nouvelles
interrogations ? La longue quête de la poétesse nous invite à dépasser les
contingences et nos propres limites pour élargir notre regard au-delà «
des barrières de fleurs », un merveilleux cheminement en compagnie des
goupils et des poiriers…
Philippe-Emmanuel Krautter
Mario Andrea Rigoni : « Colloques
avec mon Démon », Editions Arcadès Ambo, 2022.
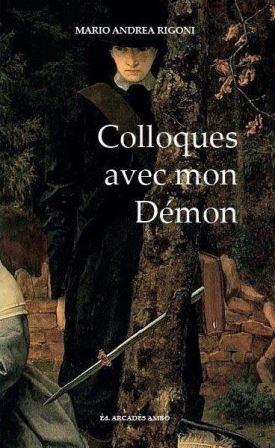
Mario Andrea Rigoni, professeur à l’université de Padoue et grand
spécialiste de Léopardi, était aussi poète. Disparu en 2021 alors qu’il
venait de confier aux éditions Arcadès Ambo son recueil « Colloques avec
mon Démon », il n’aura malheureusement pas eu le plaisir de le voir
publié.
Son pessimisme l’avait rapproché de la pensée de Cioran qui correspondait
à sa vision lucide du tragique de la vie. L’homme de lettres cultivait
également un jardin secret, celui de Calliope. Dans les dernières années
de sa vie, son goût s’exacerba pour les éléments, tectoniques, minéraux,
mais aussi quelque peu plus immatériels tels le vent ou la brume dont il
sut saisir l’impermanence dans des évocations délicates : « Je l’aime
parce qu’il effleure la terre et ne l’habite pas. »…
Au fil des pages de ce recueil, sa poésie s’ouvre aux échos mythiques du
temps, souvenances à peine voilées de ces témoins du passé si présents à
celles et ceux qui peuvent encore y prêter attention. Cette pensée
symbolique qui l’occupa sa vie durant transparaît ici ou là, toujours de
manière diaphane à l’image même de sa poésie. Tendue vers l’infini,
l’écriture poétique de Rigoni n’en dédaigne pas pour autant les gouffres
vertigineux, démarche fragile entre ces extrêmes.
C’est entre ces lignes ténues que parfois se tapit son démon intérieur,
double du poète ou esprit rencontré au fil de ses cheminements antiques ?
Cette éternelle question, le poète se la pose et nous questionne, à nous
d’y réfléchir grâce à ce beau et sensible recueil.
Philippe-Emmanuel Krautter
« Très russe » de Jean Lorrain
suivi de son adaptation théâtrale par Oscar Méténier. Édition établie,
présentée et annotée par Noëlle Benhamou, Honoré Champion Éditions, 2022.
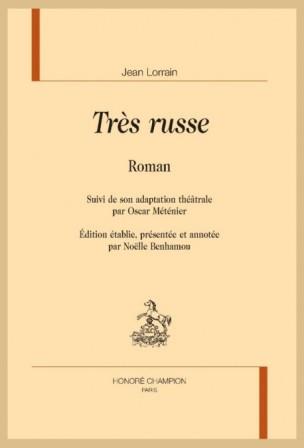
Avec « Très russe », Jean Lorrain (1855-1906) signe son deuxième roman qui
eut, entre autres effet, de provoquer la colère de Maupassant qui crut se
reconnaître sous les traits du ridicule Beaufrilan, amoureux transi et
quelque peu ridicule de la délicieuse Madame Livitinof. Le duel fut évité
in extremis, Lorrain ayant préféré les excuses au fleuret… L’action
se déroule entre Yport et Fécamp, sur la côte normande, lieu de
villégiature de cette société de la fin de siècle. Ce roman fut complété
d’une pièce de théâtre avec la collaboration d’Oscar Méténier, pièce
représentée le 3 mai 1893 au Théâtre d’Application.
Les éditions Honoré Champion offrent ainsi la première édition jointe de
ces deux œuvres grâce à l’heureuse initiative de Noëlle Benhamou. C’est en
effet un délicieux récit que livre en ces pages un Jean Lorrain plus
caustique que jamais sur la société de son temps. Le roman est celui d’une
femme fatale – Madame Livitinof, Sonia pour ses nombreux intimes – autour
de laquelle gravitent des amoureux transis, Mauriat, Beaufrilan sans
oublier le narrateur Jacques Harel.
En hommage à Flaubert et Elémir Bourges, Lorrain souhaitait livrer avec «
Très russe » un récit à la croisée du roman réaliste, du roman décadent et
du dialogue, ainsi que le rappelle Noëlle Benhamou dans son introduction à
cette édition soignée. Ce roman aux multiples références musicales est
également émaillé des nombreux coups de griffe et portraits au vitriol
qu’affectionnait l’auteur de Monsieur de Phocas. L’humour corrosif
du dandy qui en quelques mots parvenait à rabaisser ses adversaires
réussit également en ces pages alertes à dresser le portrait de ses
contemporains et de la société dans lequel il évoluait avec un plaisir
manifeste. Donnant lieu à de véritables pamphlets que Molière n’aurait pas
reniés – Lorrain n’hésite pas à citer explicitement quelques vers du
Misanthrope dans ce récit – « Très russe » sait également saisir les
emportements du cœur de ces âmes souvent tourmentées. Allant de la
diatribe acerbe dans laquelle crut se reconnaître Maupassant jusqu’à ce
touchant portrait du couple âgé, les Alexander, Lorrain enchante en
passant en quelques lignes de l’émotion à l’humour corrosif, ce qui n’est
pas la moindre des qualités de ce roman à découvrir.
Philippe-Emmanuel Krautter
|
« Sollers, le musicien de la vie »
de Yannick Gomez ; Préface de Rémi Soulié, Nouvelle Marge Editions, 2025.
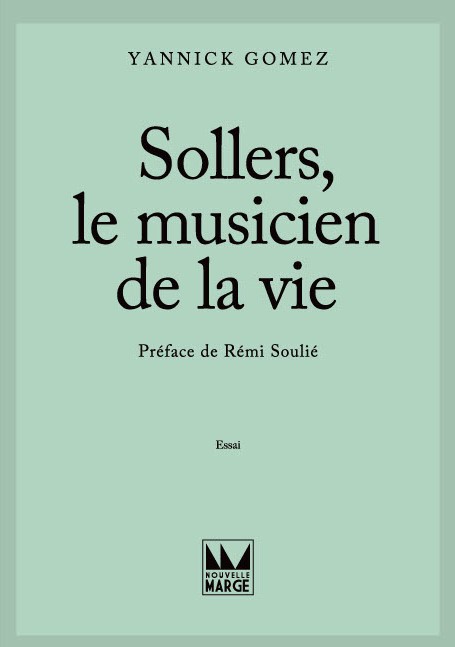
Le pianiste et compositeur Yannick Gomez propose avec cet essai paru aux
éditions Nouvelle Marge d’entrer au cœur de l’écriture de Philippe Sollers
par à la musique, car nulle autre écriture ne fut peut-être plus associée
à la musique que celle de Philippe Sollers. Tout fait note effectivement
chez Sollers, à commencer par son pseudonyme débutant par la note Sol,
mais aussi la consonance « île » comme l’île de Ré chérie où il repose de
nos jours… Entre ces deux notes, une ligne mélodique répétée en d’infinies
variations et autres rhapsodies que Yannick Gomez, en fin connaisseur des
écrits de Sollers, analyse en dressant un portrait de l’écrivain-musicien
plus que fidèle. Il faut reconnaître que le grand regret de Sollers fut de
ne pas avoir été musicien, lacune des fées qui lui conférèrent cependant
un don de plume valant plus d’un coup d’archet !
Sollers a toujours été à la recherche de la légèreté qu’il puisait,
notamment, dans ce XVIIIe siècle magnifié par Bach, Haydn, Mozart,
Scarlatti et bien d’autres encore. Si ses préférences ne le portaient
guère vers le XIXe siècle romantique qu’il jugeait trop mélancolique, il
goûtait cependant tout ce qui portait vers la vie, un musicien de la vie
transcendant la grisaille et autre « France moisie »…
Véritable voix qui chante dans le désert culturel contemporain, Sollers
fera toujours choix de la musique quant au rythme, et par là même au choix
des mots qui composaient son écriture. Il suffira pour s’en convaincre de
voir, et surtout d’écouter, les nombreuses vidéos réalisées par Sophie
Zhang et Georgi Galabov chez l’écrivain prenant un secret plaisir à offrir
une cantillation de ses textes.
C’est une foi à part entière qui animait ce passeur aimant les
transversalités ainsi que le rappelle en ces pages Yannick Gomez, même si
certaines d’entre elles ont pu lui être reprochées. Provocant Sollers ? A
l’évidence notamment avec celles et ceux qui ne souhaitaient pas
l’écouter, mais aussi et surtout enchanteur, Sollers, pour celles et ceux
qui savaient apprécier cette musique, cette musicalité littéraire, et
telle est la conclusion de ce bel essai qui ne pourra qu’encourager son
lecteur à ouvrir et « écouter » les nombreux livres de ce musicien de la
vie…
Philippe-Emmanuel Krautter
« Huysmans vivant » d’Agnès
Michaux, Editions Le Cherche Midi, 2025.

Les passionnés de Huysmans, tout comme les esprits curieux prêts à
redécouvrir une plume et un style quelque peu négligés à tort par nos
contemporains, seront ravis de dévorer ces 700 pages, à la fois denses et
alertes. Car avec « Huysmans vivant », l’essayiste et romancière Agnès
Michaux réinsuffle en effet toute la vitalité qui anima l’écrivain, tour à
tour naturaliste, sulfureux et, pour finir, converti…
Il faut avouer que la tâche n’était guère aisée, car si on en croit les
premières pages de cet ouvrage, rien ne semblait en effet prédestiner son
auteur à s’attaquer à un tel monument. Or, loin de là, l’auteur transmet
contre toute attente à son lecteur une étonnante vitalité et fluidité tant
ces pages se dévorent comme un roman, alternant entre érudition et
légèreté pour mieux révéler les multiples facettes de cette personnalité à
part, non dénuée de contradictions.
Au fil des chapitres, le lecteur assistera à la lente maturation de
l’écrivain qui franchira chaque étape initiatique avec une étonnante et
déroutante adaptation, sans que cette métamorphose n’apparaisse pour
autant dénuée de sens. Ainsi découvrirons-nous tout d’abord un Huysmans
plus méconnu, celui de ses années naturalistes aux côtés de Zola, figure
du père tutélaire. Le lecteur qui n’aurait en effet en mémoire que son
ouvrage « À rebours » sera surpris de découvrir dans ces œuvres de
jeunesse une veine totalement différente avec « Marthe » et « Les Sœurs
Vatard », d’une part, « En ménage » et « À vau-l’eau », d’autre part, plus
proche effectivement de Zola que du décadentisme dans lequel il excellera.
Mais, petit à petit, la voix de Huysmans émergera du réalisme et du
naturalisme pour s’orienter vers une dérision et une désillusion quelque
peu plus cyniques au fil des pages et de ses personnages. Et, si la
transcendance n’est pas encore présente, le vide laissé par ces vies la
convoque déjà en quelque sorte, une brèche qui ne demandera qu’à s’élargir
avec les œuvres à venir de l’écrivain.
En effet, Huysmans se tournera par la suite, ainsi qu’il ressort de cette
biographie alerte, vers le décadentisme, un tournant sonnant ainsi le glas
du naturalisme. Vient alors, bien entendu, à l’esprit l’auteur du fameux À
Rebours, livre culte des esthètes. Instillant, sans le savoir exactement,
les germes de ses autres ouvrages ; Huysmans avec « À Rebours » pose de
nouveaux jalons, rompant ainsi avec la tradition, ce que certains de ses
contemporains ne comprendront pas. Seul Barbey d’Aurevilly fut plus
perspicace en louant l’auteur et en reconnaissant : « Après un tel livre,
il ne reste plus à l’auteur qu’à choisir entre la bouche d’un pistolet ou
les pieds de la croix »… Et les dernières lignes de ce roman atypique
feront figure d’annonce : « Seigneur, prenez pitié du chrétien qui doute,
de l’incrédule qui voudrait croire, du forçat de la vie qui s’embarque
seul, dans la nuit, sous un firmament que n’éclairent plus les consolants
fanaux du vieil espoir ! ».
Multiples seront encore les différentes facettes de l’écrivain révélées
par cette biographie complète et qui ne pourra que s’imposer en ouvrage de
référence : le critique d’art redouté, le converti tourmenté et hanté par
les contradictions de la chair, l’esthète à la recherche du beau… Agnès
Michaux livre ici un beau témoignage sur une personnalité attachante dont
elle sait rendre la complexité et les combats intérieurs, notamment lors
de sa lente conversion spirituelle conduisant à ses textes mystiques, un
Huysmans humain et profondément actuel, à redécouvrir !
"Œuvres poétiques complètes – A
l’orée du pays fertile" de Jacques LACARRIÈRE, Editions Seghers, 2025.
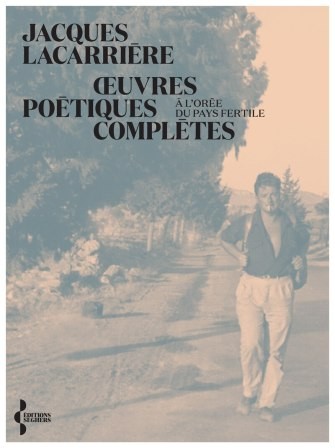
Si Jacques Lacarrière n’est plus à présenter, son œuvre poétique demeure
encore quelque peu confidentielle, et ce, de manière injustifiée. L’auteur
de « Chemin faisant » et du fameux « L’été grec » cultivait en effet ce
jardin secret depuis sa plus tendre enfance, ainsi que peut le découvrir
le lecteur de ces « Œuvres poétiques complètes » dans cette nouvelle
édition revue et augmentée aux éditions Seghers. Jacques Lacarrière compte
parmi ces pèlerins de la nature trouvant à chaque détour de chemins, qu’il
arpenta sa vie durant sous le soleil de Grèce ou de France, le sens de la
vie, ou tout au moins ses voies possibles. Sa poésie sut trouver sa source
d’inspiration lors de ces lentes pérégrinations, sans autre objectif que
la poésie du paysage, le goût exacerbé des rencontres et cette idée de
partage toujours sensible en ces pages qui débutent sous l’influence
encore présente du surréalisme auquel il adhéra dans sa jeunesse. Puis,
viendront les années déterminantes des longues déambulations pour cet
insatiable marcheur qui aiguisa sa curiosité non seulement dans les
espaces géographiques parcourus, mais aussi dans les méandres de la
langue.
Tout fait signe avec Jacques Lacarrière, qu’il s’agisse des arbres qu’il
chérissait tant, des mythes ou même d’une statue ignorée et à laquelle il
parvint avec ses vers à redonner vie… Cet orfèvre du sensible confesse sa
gourmandise pour ces « petits riens » qui prennent sous sa plume la
dimension d’une architecture antique. Le regard que porte ce poète sur ces
espaces que nous croisons également transcende la réalité profane pour
aboutir à des apothéoses souvent éblouissantes. Un recueil d’œuvres
poétiques à la fois solaire et lucide dont l’acuité n’a d’égale que
l’évasion qu’elle encourage et que sous-entend si justement son titre « A
l’Orée du Pays fertile »…
Frank Venaille - "Avant l’Escaut -
Poésies & proses, 1966-1989" ; Edition de Stéphane Cunescu ; Préface de
Marc Blanchet ; Editions L'Atelier Contemporain, 2023.

Les éditions L’Atelier Contemporain ont eu l’heureuse initiative de
publier « Avant l’Escaut », une somme (752 p.) de poèmes et de proses
rendant un vibrant hommage au poète Frank Venaille (1936-2018). Ce poète à
la plume tourmentée convie le lecteur à partager son univers introspectif
à partir de recueils allant de 1966 à 1989. Âmes sensibles ne pas
s’abstenir, tant l’écriture expressive de l’auteur vibre, selon les pages,
du cœur sensible des êtres et des espaces. Les irisations du fleuve
accompagnent les fragmentations de l’écriture : « Je ne suis rien – et
le monde m’échappe – je fais un grand tas de bois de ma vie – et dans les
longues nuits venises – timidement m’en réchauffe » (Bestia).
Le quartier populaire où il passa son enfance, l’adhésion au PCF, un
séjour en Belgique avec la découverte de l’Escaut, la guerre d’Algérie
sont autant de marqueurs d’une écriture ardente et anxieuse. Venaille suit
le cours de l’Escaut comme le fil d’une vie, ce témoin pourtant silencieux
suscite des réminiscences et nourrit l’écriture sans concession du poète.
Les nombreuses blessures de la vie irriguent ces pages explorant ces
territoires intérieurs dont l’évocation ne laissera pas le lecteur
indemne… Préfacé par Marc Blanchet et enrichi d’un « Accompagnement
critique » signé Stéphane Cunescu, ce recueil de dix œuvres déterminantes
de Frank Venaille fait, à n’en pas douter, date dans l’édition de la
poésie contemporaine et plonge le lecteur dans l’intimité de la création
de ce poète au « monologue polyphonique ».
Philippe-Emmanuel Krautter
« Annemarie Schwarzenbach – De
monde en monde – Reportages 1934-1942 » ; Traduit de l’allemand par Nicole
Le Bris et Dominique Laure Miermond-Grente, Editions Zoé, 2024.
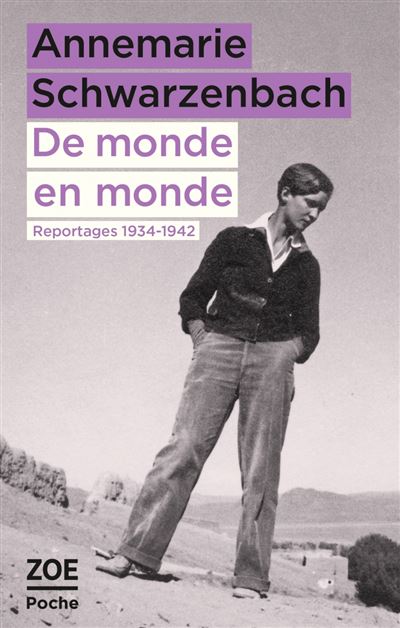
Il est toujours plaisant et instructif de partir « De monde en monde » en
compagnie d’Annemarie Schwarzenbach. Archéologue et reporter, cette
dernière nous invite en ces pages au travers de ses reportages ou
chroniques dans un autre temps, celui du siècle dernier de 1934 à 1942, à
découvrir avec elle, par son regard et son insatiable curiosité aussi bien
la Perse avec l’Iran que les États-Unis d’Amérique, Prague, Istanbul ou
encore Lisbonne ou Tanger…
Traduit de l’allemand par Dominique Laure Miermond-Grente et Nicole Le
Bris qui en signe également l’introduction, ce volume nous livre en effet
le regard d’une jeune femme moderne, aventureuse et audacieuse. Suisse,
née en 1908 dans une famille bourgeoise, Annemarie Shwarzenbach a publié
de son vivant pas moins de 300 articles pour la presse. Engagée contre le
nazisme, morte accidentellement malheureusement trop jeune en 1942, à
l’âge de 34 ans, elle n’a eu de cesse de témoigner du monde dans lequel
elle vivait, parcourant dans les années trente notamment les routes du
Proche-Orient (1933-1934), mais aussi à la veille de la Seconde Guerre
mondiale celles de l’Afghanistan (1939-1940), sans oublier en 1941-42 le
Portugal et le Maroc avec Persépolis ou encore le Congo ; son article
inséré dans le chapitre « Europe de l’Est », écrit de Prague pour le
National Zeitung (donné aujourd’hui intégralement), et daté précisément du
30 septembre 1938, ne peut que retenir l’intention….
Près d’une soixantaine de chroniques dans lesquelles le lecteur retrouvera
ce style à la fois varié – passant de l’Histoire au quotidien des
populations, des us et coutumes aux paysages souvent grandioses… Ces pages
révèlent à la fois son exigence de rendre compte au plus près du monde des
années 1930, mais aussi toute sa poésie, cette poésie que reflètent ses
propres photographies illustrant ce volume et entraînant son lecteur avec
intérêt et une vive curiosité « De monde en monde ».
L.B.K.
« Le Parloir » Paule du BOUCHET,
Éditions La Belle Etoile, 2025.

« La loi qui a été votée au Parlement le 23 juin 1989 permet la révision
d’un procès sur la réouverture d’un fait nouveau non plus « de nature à
établir l’innocence d’un condamné, mais seulement de nature à faire naître
un doute ». Nous sommes dans ce cas. »
Ceci pourrait introduire toute l’histoire que Paule du Bouchet, l’auteur,
nous conte tout au long de son dernier livre « Le parloir ».
Isabel, une jeune femme « bien mariée », mère d'une petite fille Marisol,
vivant bourgeoisement à Lyon est de nature réservée et silencieuse... Un
jour elle prend enfant et valises et part en Bretagne à Poullic, au fin
fond du Finistère, chez Violette à qui elle loue une petite maison. Pour
combien de temps ? Une nouvelle fuite ? Sans regarder derrière elle... «
Ici , c'est Poullic, Poulfétan, commune de Landéla. Ce n'est pas le bout
du monde, c'est le monde au premier jour. Ici j'ai commencé à respirer. »
Violette, vieille Bretonne toute en subtilité et psychologie, décèle chez
Isabel une mélancolie ou une dépression latente. Les prenant sous son
aile, elle et Marisol, Violette lui trouve un travail à la bibliothèque de
la ville, car ici on ne peut pas rester sans rien faire ! Un jour Violette
parle à Isabel de l'époque où elle tenait une correspondance avec un
prisonnier, insistant sur le bienfait de ces échanges pour chacune des
parties. Au cours de longues conversations, les deux femmes se racontent
pudiquement, établissant ainsi un lien durable et sincère. Cette ambiance
bienveillante autour d'Isabel déclenche en elle le premier pas ou plutôt
le premier mot et décide de devenir correspondante en milieux carcéral.
Une première lettre envoyée à la Maison Centrale de Poissy dans les
Yvelines, en région parisienne, si loin de Poullic et la voilà qui entame
des mots écrits et qui vont rester (les paroles s'envolent et les écrits
restent...) avec un homme dont elle ne sait rien et qui purge une longue
peine. De lettre en lettre, de phrase en phrase, et de mot en mot
s'établit entre Isabel et ce Louis une correspondance régulière. Un jour,
il lui faut le rencontrer car les lettres ne suffisent plus, alors elle
fait une demande de parloir. Évidemment, cela implique d'aller à Poissy...
Alors elle prend le train jusqu'à la gare Montparnasse et puis le RER
jusqu'à Poissy. « Elle y va. Elle s'est engagée à aller. Ce type est
devenu sans doute le seul être, hormis Marisol, avec qui Isabel se sente
engagée... Maintenant il ce « parloir ». Lui dans ce parloir. D'un coup la
porte s'ouvre, il est là, immense, et elle retrouve quelque chose de la
solitude. » C'est un pas décisif pour ces deux étrangers qui petit à petit
entre lettre et rencontre, entre silence et coup de gueule, entre absence
et retrouvailles, vont accepter qui est l'autre et se découvrir et
s'apprivoiser mutuellement. Au fil des pages, cette relation nous amène
dans les vies familiales de chacun et jusque dans un cabinet d'avocat car
au fond de chaque être il y a une histoire à réhabiliter et celle de Louis
est on ne peut plus surprenante. Lui qui s'est mis à lire et à étudier la
philosophie dans sa privation de liberté se sent plus libre qu'elle qui se
laisse envahir par son propre silence et ses propres doutes. Mais les
rencontres que l'on noue ne sont-elles pas faites pour laisser de côté un
peu de son propre théâtre intérieur et devenir non pas autre, mais qui
l'on doit être ? Isabel va plonger dans l'histoire de Louis et s'autoriser
à vivre pleinement sa vie. Le contexte carcéral, le rapport à la justice,
la psychologie sensible et profonde des personnages, la définition même de
la liberté, tout rend ce récit tellement plausible qu'il pourrait ne pas
être un roman, mais une biographie de l'instant T où deux êtres basculent
ensemble vers ce pourquoi ils se sont rencontrés, acceptés, compris, ce
qu'ils se sont donné sans attendre quoi que ce soit de l'autre, ce
pourquoi ils s'aiment maintenant.
Sylvie Génot-Molinaro
Pierre Adrian : « Hotel Roma »,
Collection Blanche, Editions Gallimard, 2024.

Nous avions déjà apprécié Pierre Adrian en 2016 pour sa quête poétique
évoquée dans son livre « La piste Pasolini », c’est encore en terres
italiennes que nous le retrouvons aujourd’hui avec un autre grand nom de
la littérature italienne du XXe s. : l’écrivain Cesare Pavese. Empruntant
le sillage discret et toujours désengagé de celui qui décida de mettre un
terme à sa vie à l’Hôtel Roma de Turin le 27 août 1950, Pierre Adrian rêva
d’évasion dans la ville aux arcades alors qu’il était comme la plupart
d’entre nous en confinement dans la ville de Dieppe durant la crise du
Covid. Et, son rêve devint réalité dès la crise levée à l’automne 2021, le
narrateur ne cherchant plus à lire ni à comprendre Pavese - ce qu’il fit
des années durant – mais à le vivre, en découvrant ses univers et les
lieux de son quotidien. Ce cheminement le mènera jusqu’en Calabre à
Brancaleone où Pavese fut retenu en exil en 1935 accusé d’antifascisme à
l’image de Carlo Levi. Mais Pavese ne fut pas homme de combat, indifférent
au bruit du monde ainsi que le relève Pierre Adrian. Sa vision pessimiste
du monde, qu’il partageait notamment avec le réalisateur Antonioni, ne le
conduisit pas à une vision valorisante des hommes, sans parler des femmes
avec lesquelles il entretint toute sa vie une relation plus que complexe.
« Pavese était resté un inadapté, un citadin contrarié » relève encore
Adrian alors que l’écrivain italien au terme de son parcours fit ses
adieux à sa terre natale à Santo Stefano Belbo du 8 au 10 juillet 1950.
Malgré ses amours, toujours improbables, notamment pour une actrice
américaine Constance Dowling, Pavese marche inexorablement dans les rues
de Turin – sa ville de prédilection - à la recherche de son destin qu’il
savait déjà tout tracé : « Pavese portait le suicide en lui comme une
malédiction » écrit encore Pierre Adrian ; l’écrivain l’accueillit sans
atermoiement dans cette chambre 346 de l’Hôtel Roma où il passa ses
dernières heures. Cette évocation délicate du dernier été de Pavese écarte
tout bavardage ainsi que le souhaitait l’écrivain et touchera plus d’un
lecteur pour sa poésie et sa sensibilité.
Philippe-Emmanuel Krautter
Blaise Cendrars : « J’ai tué »,
Editions Zoé, 2024.

À l’heure des bruits de bottes parcourant la planète, il faudra
redécouvrir aux éditions Zoé ces deux courts textes écrits par le poète et
romancier Blaise Cendrars, à partir de son expérience personnelle du
premier conflit mondial. Celui qui allait devenir l’un des grands
écrivains de langue française du XXe s. n’était encore qu’un jeune homme,
né en Suisse, embrassant la cause française en s’engageant volontaire dans
cette guerre qui allait submerger toutes les valeurs jusqu’alors établies.
Les premières lignes écrites à l’encre de sang décrivent un chaos
généralisé dans lequel même la nature semble dépassée par le déchaînement
de violence. Puis vient le temps redouté de l’attaque, rien n’est
prévisible sinon l’inéluctable. L’absurdité de la guerre se déploie par
l’intensité de l’écriture incandescente de Cendrars, bien plus encore que
ne saura le faire par la suite le 7e art.
Nous accompagnons le narrateur en constatant avec lui le paradoxe aberrant
des moyens gigantesques mis en œuvre lors de ce conflit pour finir par un
combat au corps à corps à la baïonnette dans une tranchée…
Dans le second texte « J’ai saigné », Cendrars évoque avec un réalisme cru
les horreurs de la guerre où il perdit son bras droit. Le poète blessé au
cœur de sa chair réalise « que ma vie m’échappait, s’en allant goutte à
goutte, sans que je ne puisse rien pour la retenir… » Ce texte d’une
densité émotionnelle incroyable déploie l’éventail terrifiant de la
douleur lors de son arrivée à l’hôpital de Châlons-sur-Marne en plein
chaos. Paradoxalement, la peur s’immisce chez le narrateur alors même
qu’il est laissé à son arrivée, nu et seul, sur un brancard dans le hall
de ce lieu baigné d’un silence impensable. Suivront par la suite, des
pages inoubliables sur l’humanité poignante d’une infirmière contrastant
avec la détresse et le désespoir de ces épaves échouées de l’absurdité.
Un petit ouvrage à découvrir de toute urgence aux éditions Zoé avec une
préface éclairante de Christine Le Quellec Cottier.
Philippe-Emmanuel Krautter
Anne Rothschild : « Conversations
avec mes arbres » ; Préface de Marc-Alain Ouaknin ; Coll. « La culture
sauvera le monde », 256 p., Editions Le Passeur, 2024.

« Conversations avec mes arbres » est un délicieux ouvrage signé Anne
Rothschild. L’auteur, également graveuse, peintre et sculptrice, y déploie
tel un pin parasol séculaire, jour après jour, sous forme d’un journal, sa
relation privilégiée avec son jardin et ses arbres. Pronoms possessifs,
parce qu’Anne Rothschild entretient effectivement avec la nature qui
l’entoure une profonde et sincère relation intime. C’est aux arbres
qu’elle a pour la plupart plantés qu’elle confie, plus encore qu’aux pages
de ce journal, son cœur, ses joies et tristesses. Égrenant, se souvenant,
peignant de mots pour son lecteur ou elle-même, telles des pétales d’amour
lancées au vent : arbres de hauts jets, les cyprès, micocouliers,
arbrisseaux, arbres à fruits ou exotiques habitant son jardin et que
l’auteur a le plus souvent rapportés de ses voyages…
Le lecteur partagera avec elle plongé dans cette nature luxuriante du sud
de la France bien des plaisirs ; plaisir de la poésie et de la
littérature, Seféris, poésie soufie, Homère ou Virgile, mais aussi plaisir
des références aux grands textes fondateurs des trois religions
monothéistes ; Directrice du service éducatif du Musée d’art et d’histoire
du Judaïsme à Paris, pendant de longues années, Anne Rothschid n’a eu de
cesse de prôner le partage avec l’autre et la paix. Plaisir enfin des sens
: Comment en effet résister à ce soleil et vent du Languedoc ? À cette
pluie d’orage laissant s’épanouir tout le parfum de la terre chaude et
humide ? Comment ne pas savourer ces parfums emplis de sucs et de vie du
sud de la France, ces parfums de figues gorgées de soleil et dont Anne
Rothschild nous transmet en ces pages toutes la poésie, la vie et les
saveurs ; figuiers, vignes, fruits murs des étés, oiseaux et chats, ses
chats enchantent les terrasses et allées de ce jardin…
Le lecteur appréciera également toute la richesse et poésie de la préface
qu’offre à cet ouvrage, à son amie Anne Rothschild, le rabbin Marc-Alain
Ouaknin tel un prélude à la sensibilité et délicatesse du texte.
Pier Paolo Pasolini : « La Divine
Mimesis » ; Traduction de Danièle Sallenave ; Préface de Walter Siti,
Éditions Bartillat, 2024.

Pier Paolo Pasolini a habitué tout au long de sa vie son
public à se décentrer pour ouvrir à un autre regard. Qu’il s’agisse de sa
poésie, de son cinéma ou encore de sa prose, cet inlassable questionneur
du monde bouleverse les cadres pour une remise en question perpétuelle de
nos certitudes. La Divine Mimesis est un bel exemple de cette exigence que
le poète italien imposa non seulement à ses contemporains mais aussi et
avant tout à lui-même. Ce court texte calqué sur le schéma de la Divine
Comédie de Dante fut écrit entre 1963 et 1967 (pour n’être publié qu’en
1975 après sa mort). Au fait de la gloire de l’intellectuel, ce texte
souligne la rupture entre les années 1950 et les années 1960 le conduisant
à passer de la littérature au cinéma, avec comme arrière-plan son intérêt
croissant pour le Tiers Monde où il espérait trouver encore cette culture
et nature originelle vierge de toute contamination occidentale.
Plaquant l’acuité de son regard sur les conséquences prévisibles et déjà
constatables de la société capitaliste et de consommation, Pasolini invite
dans ce texte son lecteur à emprunter le cheminement dantesque, non point
en compagnie de Virgile mais… de lui-même en un dédoublement d’une
redoutable conscience sans ménagement. Comment s’engager ? Comment
échapper au broyage entrepris par cette société qui conduit insidieusement
à l’absence de reliefs, à cette petite bourgeoisie exclusivement mue par
cette soif intarissable de posséder ? Nous retrouvons ainsi deux Pasolini,
celui des années 1950, et celui en crise à l’âge de la quarantaine,
conscient que les trésors qu’il chérissait de la poésie et de la
littérature ne seraient pas suffisants pour apporter des réponses à ses
interrogations.
S’éloignant du Parti communiste italien, il aspire à trouver la lumière
grâce à d’autres médias, le cinéma notamment, dont il saura tirer des
leçons d’une grande force même si, plus tard, il en connaîtra également
les limites (Trilogie de la vie) avant d’entamer son roman initiatique
inachevé Pétrole…
Philippe-Emmanuel Krautter
Piero CALAMANDREI : « Rencontre
avec Piero della Francesca » ; Postface de Carlo Ossola, Collection «
Versions françaises », Éditions Rue D’Ulm, 2023.

C’est bien d’une rencontre avec Piero della Francesca et
non d’une étude académique qu'il s’agit dans cet opuscule paru aux
éditions Rue d’Ulm et signé Piero Calamandrei. L’auteur, grand juriste
italien, mais aussi esthète de l’art, livre en effet dans ce récit
émouvant les relations intimes qui l’unissent à la grande œuvre de Piero
della Francesca – la Madonna del Parto - conservée dans le petit village
de Monterchi entre Toscane et Ombrie. À travers ce témoignage très
personnel né d’une rencontre fugace au cours d’une excursion en 1938,
Calamandrei développe le réseau de liens inextricables tissés entre
l’œuvre d’art, symbole à la fois d’un art universel et local, et la
population. Quelques années plus tard, la tempête de la Seconde Guerre
mondiale ravagera bien des lieux en Italie et dans le reste de l’Europe,
ravages dont sortira miraculeusement indemne la fragile fresque gravée
dans le cœur de chaque habitant de Monterchi voyant dans la Vierge à la
fois leur protectrice et leur mère. Car, en observant avec les yeux de
Calamandrei, nous découvrons sur les reproductions insérées dans ce livre
soigné combien la Vierge représente la maternité, cette maternité
universelle qui glorifie le divin par une incarnation unique dans
l’histoire de l’humanité. Marie, mère de Dieu, un mystère dans lequel les
plus grands artistes ont plongé leur pinceau ainsi qu’il ressort de ce
chef-d’œuvre aujourd’hui bien connu. Cette méditation intime et touchante
rassérène à l’heure du relativisme ambiant, une méditation qui comme le
souligne Carlo Ossola dans sa aussi belle que riche postface « va au-delà
du tableau de Piero della Francesca et embrasse toute la condition humaine
»…
Philippe-Emmanuel Krautter
Herman Melville : « Poésies » ;
préface et notes de Thierry Gillybœuf ; Traduit de l'anglais (États-Unis)
par Thierry Gillyboeuf ; Relié, 17 x 23 cm, 592 p., Editions Unes, 2022.
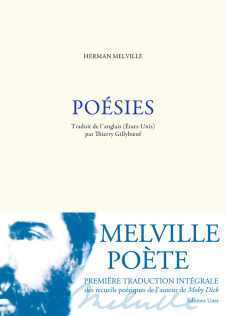
Qui ne connaît Moby-Dick et le fameux capitaine Achab rongé par la
vengeance ou encore Bartleby et sa célèbre sentence « I would prefer not
to » ? Ces œuvres qui ont fait la réputation de l’écrivain américain
Herman Melville (1819-1891), même si leur célébrité fut posthume, ne
doivent pas faire oublier un autre pan plus méconnu de la créativité de
cet esprit ouvert à l’aventure que fut la poésie. Cette dernière occupa en
effet ses temps libres parallèlement à ses fonctions plus que modestes
d’inspecteur des douanes qui ne l’enchantaient guère… Ce vaste champ
poétique n’est, cependant, guère parcouru en dehors des spécialistes et
amateurs de l’écrivain, aussi faut-il saluer l’initiative et la qualité du
travail de traduction réalisés par Thierry Gillyboeuf avec ce fort volume
dénommé simplement « Poésies » et paru aux éditions Unes. Cette
publication soignée propose l’intégralité de la poésie d’Herman Melville
et s’ouvre avec l’impressionnant « Tableaux et aspects de la guerre »
restituant le souffle épique de la guerre de Sécession. Fervent unioniste,
Melville - ainsi qu’il le souligna lui-même, n’a pas cherché à faire œuvre
historique mais à « poser une lyre à la fenêtre et de noter les airs
contrastés que les vents capricieux ont joués sur ses cordes ». Le
traducteur Thierry Gillyboeuf rappelle la dimension homérique transposée
de l’autre côté de l’Atlantique pour cette œuvre à la fois puissante,
émouvante et d’une rare sensibilité. Dépassant de loin les plus belles
réalisations du 7ième art sur ce sujet – on pense notamment au fameux film
de John Ford « Les Cavaliers » en 1959 - « Tableaux et aspects de la
guerre » ne se limite pas à restituer l’aventure « fleur au fusil » de
cette guerre fratricide mais entre au cœur même des passions humaines
comme le fit des millénaires auparavant le rédacteur (ou les rédacteurs)
de l’Iliade.
Après la terre, c’est autour de la mer de retenir l’inspiration poétique
de Melville avec John Marr et autres marins avec quelques marines (1888),
une épitaphe inspirée de celui qui arpenta les mers du globe. Herbes
folles et sauvageons avec une rose ou deux constituera en quelque sorte le
testament de l’écrivain poète, des poèmes d’amour plus introspectifs
dédiés à Lizzie son épouse et soutien indéfectible qu’il réservait à un
nombre limité de connaisseurs. Cette parenthèse à la noirceur de l’âme
humaine qui occupa tant sa création surprend tout autant qu’elle rassérène
le lecteur ému de telles confessions, celles émouvantes du trèfle par
exemple, à milles lieux des cauchemardesques cachalots et jambe de bois…
Il faut découvrir cette poésie restituée avec enchantement et profondeur
par Thierry Gillyboeuf, une redécouverte essentielle sur une part méconnue
d’Hermann Melville.
Philippe-Emmanuel Krautter
Constantin Cavafis : « Poèmes anciens ou
retrouvés » ; Édition bilingue ; Traduit par Gilles Ortlieb et Pierre
Leyris, Coll. « Poésie Seghers », Editions Seghers, 2023.
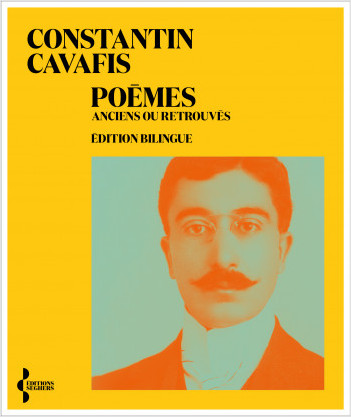
Constantin Cavafis, une voix inimitable de la diaspora
grecque, fait l’objet d’une nouvelle édition bilingue dans une traduction
inspirée de Gilles Ortlieb et Pierre Leyris. Poète né à Alexandrie en 1863
de parents grecs, Constantin Cavafis n’aura de cesse d’associer ce legs
hellénique avec celui de la ville dans lequel il résida quasiment toute sa
vie. Après quelques années de jeunesse passée en Angleterre dont le poète
garda l’accent dans sa langue maternelle, Cavafis conciliera en effet
d’antiques réminiscences et désirs des sens en d’intimes évocations,
toutes plus passionnelles les unes que les autres. Pudique et sensuel,
discret et pourtant ouvert à l’altérité, Cavafis embrassa la poésie avec
respect, une attitude qui le porta à réviser toute sa vie ses poèmes et à
en écarter radicalement un grand nombre, fort heureusement pour beaucoup
préservés de la destruction. Les « Poèmes anciens ou retrouvés » publiés
aux éditions Seghers offrent un tableau complet de cet « historien poète »
ainsi qu’il se plaisait à se nommer. Ces pages à l’écriture sensible
traduisent un esprit captant tout autant l’air du désert proche que les
murmures de l’antique parvenus jusqu’à sa plume. Une épigraphe abandonnée
sur une tombe est l’occasion de redonner vie au passé en de vertigineuses
présences alors qu’un miroir placé dans l’entrée d’une riche maison
conservera pour toujours le souvenir ému de la beauté d’un jeune garçon.
La poésie de Cavafis brille discrètement de ses feux comme un saphir à la
tombée de la nuit. Ses scintillements se font rêveries et ses songes plus
vivants encore que les âmes défuntes qu’il évoque délicatement. Les
barrières du temps s’estompent alors que les sens s’exacerbent en une
multitude d’émerveillements. La lecture de ces Poèmes ne pourra laisser
indifférent grâce notamment au remarquable et toujours délicat travail de
traduction de Gilles Ortlieb et Pierre Leyris qu’il faut, ici, saluer.
Philippe-Emmanuel Krautter
Italo Svevo : « Ma paresse » traduit de
l’italien par Thierry Gillyboeuf, Allia Editions, 2024.
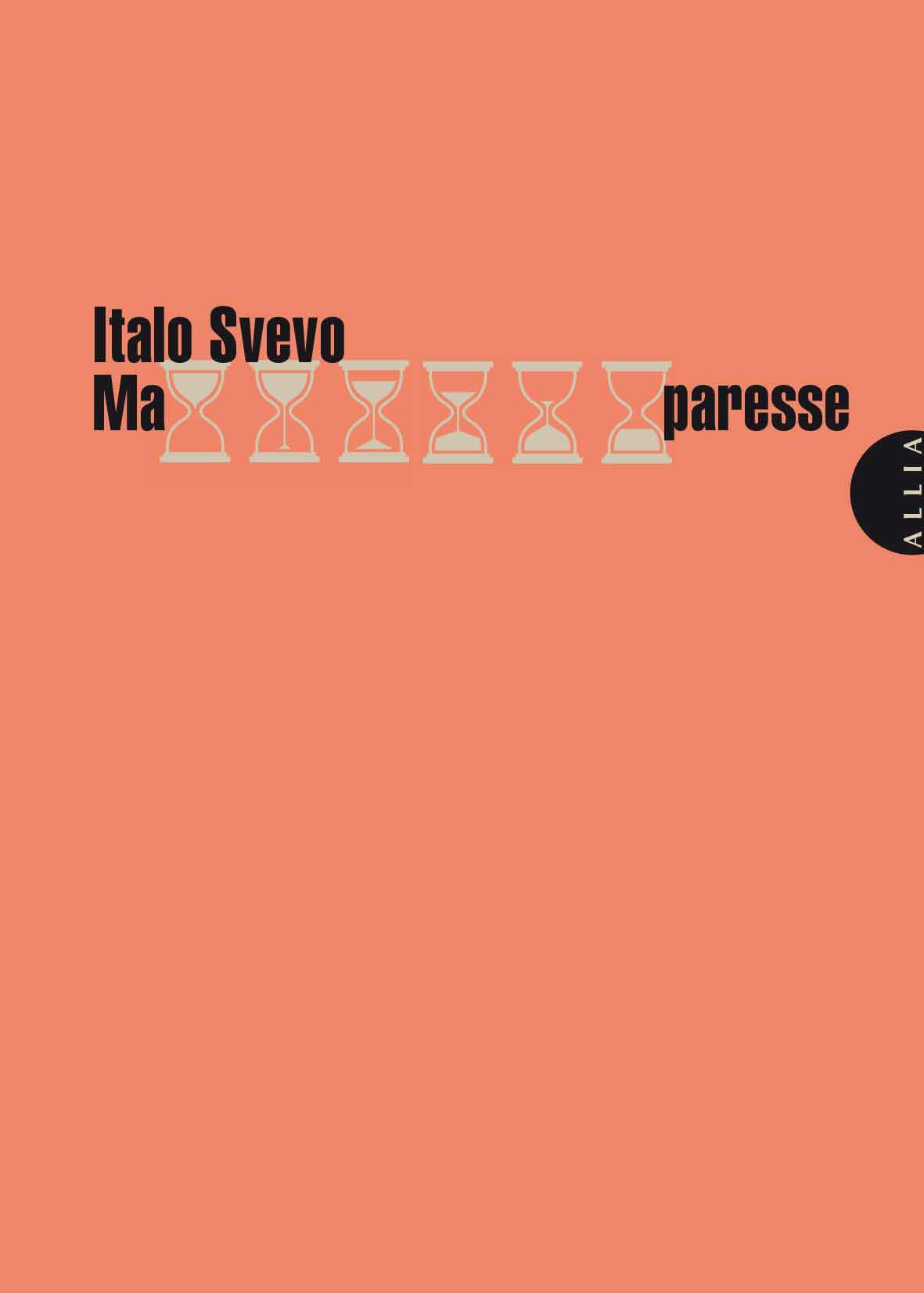
Voici un petit texte peu connu en France et qui pourrait
offrir une belle porte d’entrée à la découverte de l’un des plus grands
écrivains de l’Italie du XXe siècle : Italo Svevo, né à Trieste en 1861,
de son vrai nom Aron Hector Schmitz, qu’il ne goûtait guère. L’écrivain
triestin lui préféra en effet ce nom de plume signifiant littéralement «
Italien Souabe » en raison des racines familiales de ces deux aires
géographiques. Au carrefour de ces cultures, allemandes et italiennes, et
des disciplines qu’il affectionnait (littérature, philosophie avec
Schopenhauer, psychanalyse avec Freud par le truchement de Weiss), Svevo
ne connut guère de succès avec ses premiers écrits, la critique l’ignorant
superbement. Il faudra, en effet, la providentielle rencontre avec James
Joyce à Trieste même (qui devint, par le plus beau des hasards, son
professeur d’anglais particulier), pour que son talent se révèle aux yeux
de l’écrivain irlandais et que ce dernier l’encourage à persévérer dans la
voie.
C’est avec « La Conscience de Zeno » paru en 1923 que l’écrivain connaîtra
la consécration pour ses qualités littéraires, qualités qui pointent déjà
dans « Ma paresse », ce texte d’une soixantaine de pages paru aux éditions
Allia dans une traduction de Thierry Gillyboeuf. À partir du
quasi-monologue du narrateur, un vieil homme au terme de sa vie, « Ma
paresse » offre une véritable introspection sur les tourments du
personnage, notamment ceux liés à son âge, sa santé et virilité… A la
manière d’un laborantin observant l’objet de sa recherche au microscope,
Svevo met en œuvre une rare acuité dans l’analyse du narrateur et de son
entourage, une analyse qui n’écarte rien des sentiments en une modernité
seulement égalée par ses contemporains Proust et Joyce. Ce sens aiguisé de
l’observation, cette autodérision et regard sans concessions sur la
société dans laquelle il évolue étonne, surprend et séduit.
Malheureusement, Svevo devait terminer son trop bref parcours dans la
littérature en 1928 après un fatal accident de voiture.
Philippe-Emmanuel Krautter
Robert de Montesquiou : « DU SNOBISME »
; Préface Le Grand-Paon à l’Œil rose par Gérald Duchemin ; Deux
illustrations par Sarah Elie Fréhel ; Format 12×16 cm, 288 pages, Editions
Le Chat Rouge, 2022.
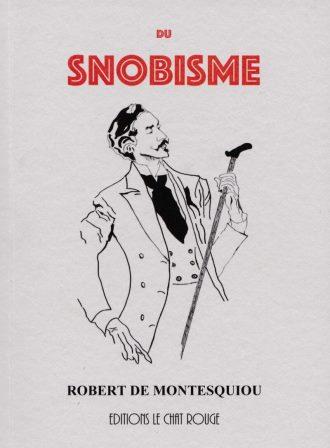
De Robert de Montesquiou n’est souvent resté que
des caricatures qui, si elles s’avèrent signées par les plus grands noms
de la littérature – Proust, Huysmans, Lorrain, de Régnier, etc., n’en
demeurent pas moins la plupart du temps bien réductrices eu égard à ce que
fut l’écrivain-poète-esthète. Il faut reconnaître que l’homme n’était
guère facile, son caractère le portant à se faire autant d’ennemis que
d’admirateurs, ces derniers étant pourtant nombreux… Robert de Montesquiou
qui revendiquait une prestigieuse ascendance, incluant le fameux
D’Artagnan, était aussi exigeant qu’intransigeant sur les arts, les
lettres et la poésie qu’il chérissait tant. « Souverain des choses
transitoires » tel fut l’un des qualificatifs qu’il s’attribua dans son
fameux recueil de poésie « Les chauves-souris ».
Régnant sur le Tout-Paris de la fin du XIXe s. au début du siècle suivant,
cette âme éprise du beau eut à cœur de lancer nombre de poètes et
d’artistes en un mécénat plus que généreux tel fut notamment le cas pour
le peintre Gustave Moreau ou encore le jeune Marcel Proust qui n’hésita
pas, pourtant et en remerciement, à singer par la suite son généreux
protecteur…
Les éditions Le Chat Rouge ont fort heureusement entendu réparer cette
injuste omission de l’histoire et offrir un portrait à la fois complet et
varié de ce personnage grâce à une introduction enlevée de Gérald Duchemin
et une sélection des aphorismes que chérissait Montesquiou. Cet esprit
curieux de tout rédigea également un grand nombre de notices dont
certaines d’entre elles ont été également réunies pour ce recueil
décidément passionnant : Gustave Moreau, Aubrey Beardsley, Sarah
Bernhardt, Lalique et Gallé, William Blake… Nombreuses seront les facettes
de l’esthète et poète qui seront révélées par cet ouvrage unique en son
genre et dont la lecture permettra de se faire une idée plus juste de
celui qui avouait en son temps :
« Ce que j’ai nommé le bon Snobisme, celui qui consiste à se sentir
amplifié par la fréquentation des êtres de valeur mentale ou morale, c’est
de celui-là qu’on peut dire qu’il faudrait être bien sot pour ne pas le
ressentir et le pratiquer »…
Philippe-Emmanuel Krautter
Odysseas Elytis : "À l'ouest de la
tristesse" précédé de "Les Élégies d'Oxopétra", édition bilingue, traduit
du grec, présenté et commenté par Laetitia Reibaud ; broché 120 p. , 15 x
21 cm, Éditions Unes, 2022.

C’est à un poète encore trop méconnu en France qu’est
consacrée cette belle parution aux Éditions Unes, une édition soignée et
élégante de deux recueils d’Odysseas Elytis, prix Nobel de littérature en
1979. Les deux recueils, « A l’ouest de la tristesse » et « Les Élégies d’Oxopétra
», font en effet l’objet d’une traduction sensible et délicate par
Laetitia Reibaud qui signe par ailleurs une belle introduction en guise de
préface sur le poète grec. Elytis n’est pas un poète facile à lire,
privilégiant l’expérience de la lumière diffractée en une poésie à la fois
solaire et toujours en quête d’éblouissements, même lors des
questionnements les plus ultimes. « A l’ouest de la tristesse » paraît un
avant la mort du poète et il sera difficile de ne pas y lire quelques
testaments jetés ici ou là après une longue vie de poésie. La puissance
tellurique du poète demeure identique en une vitalité qui ne cesse
d’étonner, parvenu à un âge aussi avancé et dépassant les affres des
années de vieillesse. Elytis discerne encore les rivages de Troie tout
autant que ce bleu Ioulita, synonyme d’amours éternelles… Aussi le
poète nous tend un relais toujours aussi vaillant, « la Poésie seule est
ce qui demeure », ces pages inspirées en témoignent, à nous de les saisir.
« Pourtant ce n’est pas toujours en rêve que tous nous cherchons
D’une génération à l’autre cet ambre
Qui adoucissait les liens des hommes
La matière grise inconnue qui savait
Formuler des lois diaphanes ; pour que l’un, tête nue, fixe des yeux
Les vallées de l’autre en lui-même, soit de nuages
Voilées soit au soleil exposées »
Michel Orcel : "LEOPARDI (poésie,
pensée, psyché)", Editions Arcades Ambo, 2023.

Le nom de Michel Orcel est indéniablement associé au poète italien Giacomo
Leopardi (1798-1837), poète plus connu, il est vrai, dans son pays natal
que de ce côté-ci des Alpes. C’est pour réparer cette injustice littéraire
que l’auteur de ces études rassemblées aujourd’hui sous le titre «
Leopardi – Poésie, pensée, psyché » aux éditions Arcades Ambo, n’a eu de
cesse de rappeler et d’analyser les multiples facettes de l’auteur des
Canti dont il livre en ces pages une vision à la fois inspirée et
poétique.
Ayant arpenté l’œuvre de Leopardi, des années durant en tant que
traducteur mais aussi au titre de poète, Michel Orcel nous convie à cette
intimité de la poésie léopardienne ainsi que le relevait Jean Starobinski
: « Et, si techniquement rigoureuses que soient ces études, elles nous
retiendront pour une autre raison encore : nous les lirons comme un
fragment du journal intellectuel (du Zibaldone) d’un poète de notre temps
». L’ouvrage exigeant nous invite, en effet, à nous mettre à l’écoute
par exemple de ce poème l’Infini dont il déchiffre pour nous l’incroyable
composition où toute souffrance – thème récurrent chez le poète – semble
être absente. Cet « ailleurs de la parole », cette voix de l’intériorité
pure, converge vers la poésie en des sommets époustouflants où pensée
lyrique et poésie tissent des dialogues intimes ainsi qu’il ressort de ces
riches études que nous livre aujourd’hui Michel Orcel.
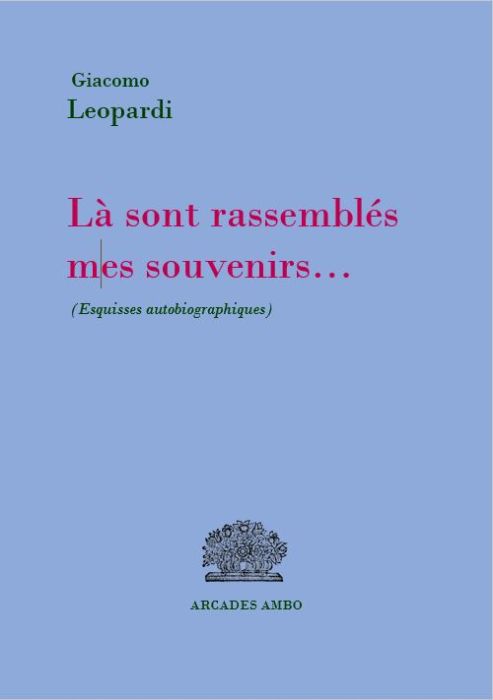
À noter la parution aux mêmes éditions, des esquisses autobiographiques
du jeune Leopardi, « Là sont rassemblés mes souvenirs ».
Philippe-Emmanuel Krautter
Pier Paolo Pasolini : « Dialogues en
public » ; Traduction de François Dupuigrenet Desroussiles avec une
préface de Florent Lahache, Collection « penser-situer », Editions Corti,
2023.

Nous connaissions Pasolini poète, cinéaste, critique, romancier… mais une
autre facette se dévoile avec cette parution « Dialogues en public »,
celle d’un intellectuel de haut vol se prêtant à une correspondance
publique « en direct » dans l’hebdomadaire communiste Vie Nuove entre 1960
et 1965. Sans fards et avec une rare liberté de parole, l’homme de lettres
correspond spontanément avec des mineurs, de jeunes adolescents, des mères
de famille, des catholiques. Cette liberté de ton étonnera autant qu’elle
séduira… Car Pasolini en ces pages ne cède ni à la facilité et encore
moins à la démagogie. A ses correspondants qui lui reprochent parfois un
vocabulaire trop savant et des idées difficiles à saisir, l’intellectuel
répond sans hésiter qu’il leur faut faire un effort, que la condition
ouvrière ne saurait à elle seule justifier de les maintenir à un niveau
élémentaire. Ces lettres qu’il reçoit parvenues de l’Italie entière – à
l’image de ce Tour d’Italie que le cinéaste réalisa pour son enquête sur
la sexualité des Italiens – dressent un portrait vivant des années 60 par
le biais des interrogations des lecteurs du journal communiste.
Et si certains clichés du marxisme de l’époque peuvent, certes, ressortir,
ces échanges révèlent autant la personnalité des correspondants que celle
du prestigieux épistolier qui leur répond. Véritable mosaïque de la pensée
des années 60 vue par un intellectuel engagé, « Dialogues en public » ne
pourra que ravir les amateurs de l’écrivain-cinéaste et de l’Italie de
cette époque.
Pierre Voélin : « Quatre saisons,
plusieurs lunes – Les poèmes trop courts », 112 p., 12 x 18 cm, Éditions
Empreintes, 2022.
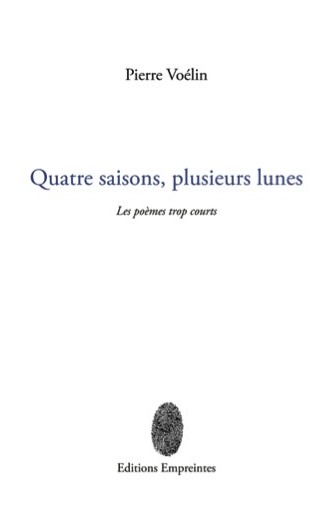
Combien de lunes ont-elles ciselé ces vers épris de nature comme certains
de liberté ? Le poète Pierre Voélin (lire
notre interview) n’est point ici en quête de bucolisme, ni de cette
forme de poésie japonaise nommée haïku, même si certains chemins
parfois peuvent converger avec ceux de l’auteur de « Quatre saisons,
plusieurs lunes » :
« Juillet sur les bords de l’étang,
la pluie s’avance penchée
mais droit – et digne
le héron solitaire ».
Le poète semble plutôt attiré, telle la phalène vers la flamme, par
l’union de la forme et de l’instant, une quête subreptice qui opère par
touches diaphanes, la clarté n’est jamais loin, même en pleine nuit :
« A chaque lune d’allumer l’incendie !
Une fois le feu lancé, vite,
aux humbles feuillages
de l’éteindre »
Cette saisie de l’instant se manifeste en ces infimes moments du quotidien
que le poète traque tel l’entomologiste aux détours des forêts et jardins,
aux aguets de ces manifestations éternelles du fugitif. Sa démarche tient
également du peintre qui parvient à immortaliser parfois l’impermanence,
quête délicate dans laquelle Pierre Voélin excelle sans affect. Tous les
sens sont à l’affût de ces infimes bribes qu’il réussit à cristalliser
dans ses vers placés sous l’égide de Villon, de La Fontaine, de Nerval ou
encore Jean Grosjean. Une poésie où parfois des nuages se profilent et
quelques angoisses pointent, noirceurs vite dissipées par cette poétique
approche des éléments sublimés par le verbe.
Philippe-Emmanuel Krautter
« Mario Vargas Llosa : « L’appel
de la tribu », Coll. Folio, Gallimard, 2022.
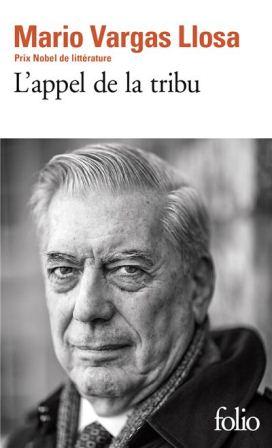
Dans cet ouvrage « L’appel de la tribu », réédité aujourd’hui en Folio,
Mario Vargas Llosa (tout récemment élu à l'Académie française) nous donne à lire le portrait de sept penseurs ou
intellectuels décisifs ayant marqué ses propres convictions libérales. Des
économistes, bien sûr, Adam Smith et Hayek sans oublier Karl Popper, mais
aussi des intellectuels notamment français – on songe à Raymond Aron ou
encore à l’académicien Jean-François Revel ; des penseurs ou philosophes
libéraux également dont Sir Isaiah Berlin ou quelque peu plus connu, et
pour un libéralisme plus culturel, José Ortega y Gasset. Le libéralisme,
la libre concurrence, la liberté des marchés, le seul système ou mode de
pensée (économique, philosophique, moral…) capable, pour l’auteur, de
garantir la liberté et la démocratie : « …ce qui nous a le mieux défendus
contre l’inextinguible « appel de la tribu. », souligne d’emblée dans sa
préface Vargas Llosa.
Un ouvrage roboratif qui, quelles que soient les convictions du lecteur,
laisse à penser, à réfléchir, car derrière le terme même de libéralisme,
se cachent bien des variations, nuances, précisions, paradoxes ou même
contradictions assumées ou non. Sans céder à la facilité, Mario Vargas
Llosa mêle à grands traits et avec un rare bonheur vie et œuvres de ces
grands penseurs formant son panthéon libéral ; des figures majeures
révélant non seulement l’évolution du libéralisme – du père du libéralisme
avec Smith au néo-libéralisme, mais aussi le propre parcours intellectuel
et politique de Vargas Llosa, ce grand écrivain péruvien, Prix Nobel de
littérature en 2010. « Le parcours qui m’a mené du marxisme et de
l’existentialisme sartrien de ma jeunesse au libéralisme de ma maturité… »
écrit encore en sa préface Mario Vargas Llosa.
Sans adopter un style hagiographique, mais sans renoncer pour autant à une
approche parfois subjective ou à des anecdotes cocasses, l’auteur souligne
les thèses, points forts et faiblesses de ces auteurs libéraux ayant
chacun marqué de leur plume leur siècle, du XVIIIe avec Smith jusqu’au
XXe-XXIe siècle pour Jean-François Revel. En contrepoint, des pages ou
critiques des systèmes totalitaires, qu’il s’agisse du nazisme, marxisme,
communisme ou encore des intellectuels de gauche ; Un « appel de la tribu
» qui, selon l’auteur, verra l’individu disparaître englouti dans la masse
; un appel ou des convictions depuis longtemps abandonnées par Mario
Vargas Llosa. Se glissent ainsi dans ces pages, notamment celles
consacrées à Raymond Aron, des lignes acerbes et sans appel à l’encontre
de J.-P. Sartre, celui qui « déjà aveugle, hissé sur un bidon, (…)
pérorait aux portes des usines de Billancourt ».
Quelles que soient les convictions du lecteur, cet ouvrage au style
impeccablement fluide - et dont on ne peut que saluer la traduction par
Albert Bensoussan et Daniel Lefort, se laisse dévoré ou du moins si
agréablement lire.
L.B.K.
« Sénèque - Tragédies complètes" ;
Édition et traduction du latin par Blandine Le Callet, traduction inédite,
Collection Folio classique (n° 7143), Gallimard, 2022.
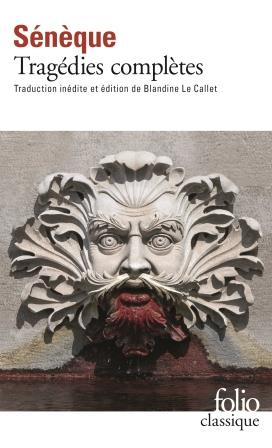
Si l’on connaît bien Sénèque pour son fameux De
Brevitate Vitae (De la brièveté de la vie), les tragédies du grand
philosophe stoïcien restent, il faut l’avouer, plus méconnues. C’est cette
lacune que vient combler avec bonheur la réunion des « Tragédies complètes
» de Sénèque en Folio par Blandine Le Callet avec une traduction inédite
et un appareil critique complet.
Paradoxalement, ces tragédies jouissaient d’une grande notoriété à la
période de la Renaissance avant de perdre les faveurs du public aux
siècles suivants. Et pourtant, ainsi que le souligne Blandine Le Callet en
préface, « Les tragédies de Sénèque apparaissent, en effet, comme de
véritables manifestes politiques et philosophiques, nourris du stoïcisme
de leur auteur et de son expérience du pouvoir ». Peut-être est-ce
l’une des raisons pour lesquelles ces œuvres parfois subversives ont pu
être écartées à une époque où l’absolutisme voyait d’un mauvais œil toute
critique du pouvoir ? Sénèque connaissait, en effet, intimement les
arcanes du pouvoir et ses noirceurs, cette fameuse « tête hideuse de la
Gorgone » qu’évoquait le théoricien du droit Hans Kelsen. Le philosophe
était le précepteur du jeune Néron qui sut rapidement se départir de la
sagesse de son mentor pour devenir le monstre que l’on sait (même si cette
dérive se trouve quelque peu atténuée par les recherches de ces dernières
années). Témoin vivant des intrigues de cet empereur responsable de folies
(on lui prête le fameux incendie de Rome en 64 dont l’empereur aurait jeté
la responsabilité sur les chrétiens), Sénèque a matière pour composer des
tragédies nourries de ces horreurs, véritable anthologie des sombres
turpitudes dont l’homme peut se rendre coupable.
Bien évidemment, il ne faut pas voir dans ces pièces ayant pour nom «
Œdipe », « Hercule furieux » ou encore « Agamemnon », un goût complaisant
pour le morbide, mais bien une invitation à la réflexion sur la nature de
l’homme et ses dérèglements. Soulignons que la noirceur de ces tragédies
révèle cependant en contrepoint la lumière qui peut entourer celles et
ceux qui consacrent leur vie à la philosophie et aux préceptes stoïciens
d’une vie simple.
En cela, et pour bien d’autres raisons, cette édition des Tragédies
complètes de Sénèque constitue une belle invitation à la sagesse, toujours
d’actualité…
A noter le remarquable travail réalisé par Blandine Le Callet en fin
d’ouvrage avec un précieux et volumineux dictionnaire de la mythologie
plus qu’utile à la pleine compréhension de ces tragédies.
Philippe-Emmanuel Krautter
Raymond Queneau : « Ma vie en
chiffres » ; dessins de Claude Stassart-Springer ; Fata Morga éditions,
2022.
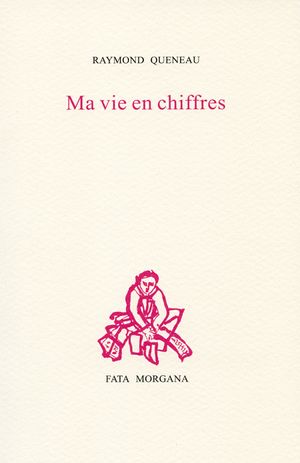
Avec ces quelque vingt-quatre pages consacrées à une digression sur la vie
en chiffres, Raymond Queneau se joue des conventions sociales plus que des
équations dans lesquelles il excellait. Cet amoureux de sciences et de
pataphysique se révélait « à l’étroit dans le sens commun » ainsi que le
résume très justement Pierre Bergounioux en avant-propos à ce petit livre
soigné et illustré par les virevoltants dessins de Claude
Stassart-Springer.
Queneau s’amuse et nous divertit sur notre quotidien souvent trop pesant,
une apesanteur que l’écrivain et cofondateur du groupe Olipo se faisait un
plaisir de cultiver dans ses digressions byzantines. S’évader du quotidien
par le truchement de ses bizarreries, tel pourrait être le credo de
Queneau dans ce court récit.
Lorsque le narrateur se risque à évoquer sa vie selon le filtre des
chiffres, tout paraît soudainement étrange alors qu’il ne s’agit pourtant
que de notre propre quotidien. Le nombre de secondes occupées par notre
travail, les grammes d’azote, de carbone et ses deux croissants
religieusement absorbés chaque jour (5 372 croissants au 29 mars 1957…),
tout prend ainsi un autre éclairage sous la plume de Queneau trempée dans
l’encre numérique. Le tourbillon des chiffres s’emballe, devient prétexte
à quelques rencontres amoureuses que ne renierait pas Cervantes, pour
finalement livrer une autobiographie « trafiquée », le qualificatif étant
faible, même si l’exercice s’avère être d’une redoutable efficacité.
A découvrir dans cette exquise édition de 112 grammes exactement, soit un
peu plus de deux croissants !
Philippe-Emmanuel Krautter
Marcel Proust : « Lettres à Horace
Finally » ; Edition établie par Thierry Laget ; Avant-propos de Jacques
Letertre ; Collection Blanche, Gallimard, 2022.
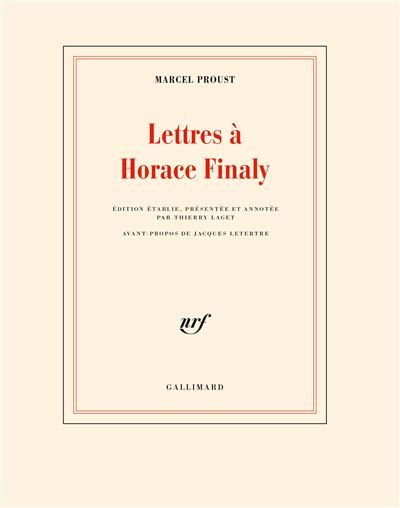
Horace Finaly compte parmi ces grands banquiers d’affaires de
l’entre-deux-guerres ayant joué un rôle essentiel à la Banque de Paris et
des Pays-Bas. Curieusement, son nom tombé dans l’oubli resurgit
aujourd’hui par le truchement de son célèbre camarade de classe au Lycée
Condorcet, un certain Marcel Proust…
Devenu personnage de roman pour Giraudoux dans « Bella » et pour certains
identifié à Bloch dans la « Recherche », cet ami de toujours, disponible
alors que son agenda ne le permettait guère, aidera Proust dans les
problèmes rencontrés avec son encombrant compagnon de l’époque Henri
Rochat. Sollicitant les relations du banquier pour lui trouver un poste au
lointain Brésil, Finaly s’exécutera généreusement malgré les déconvenues
survenues par l’attitude de l’encombrant personnage, ainsi que le rappelle
Jacques Letertre en avant-propos.
Le présent recueil de cette correspondance inédite s’ouvre sur une lettre
datée de 1920, le reste de la correspondance de jeunesse étant
malheureusement perdue. L’auteur de la « Recherche » s’adresse à son «
cher ami d’autrefois et de toujours » en souvenir des années passées à
Condorcet. Proust au fil des lettres égrène ses chers souvenirs même si
les « espérances ne se réalisent pas », le passé n’étant jamais perdu pour
l’écrivain. La maladie de Proust, cloué maintenant la plupart du temps au
lit, est omniprésente, ce qui ne l’empêche pas pour autant de « caser »
son protégé loin de l’Hexagone grâce à l’influence et relations de son
vieil ami.
Pointent quelques traits d’humour « proustiques » ainsi qu’il se qualifie
lui-même. Rochat se trouve finalement envoyé en Amérique du Sud par Finaly,
au lieu de la Chine initialement prévue. Puis viendront les tendres et
touchants témoignages d’amitié lors du décès de l’épouse tant aimée
d’Horace en mai 1921, témoignages émaillés par les frasques de Rochat au
Brésil, sans oublier les multiples fièvres de la santé déclinante de
Marcel Proust au terme de sa vie. Durant ces derniers mois qui lui restent
à vivre, l’écrivain adressera en avril 1922 un dernier témoignage à son
ami de toujours sous la forme d’un envoi autographe sur la page de garde
du tome I de « Sodome et Gomorrhe » paru le même mois. Dans cette ultime
adresse, Marcel Proust, même s’il « n’aime pas mêler de la littérature à
un souvenir douloureux et vivant en moi » pense une dernière fois à son
fidèle ami sous le signe de l’amitié et du souvenir de sa défunte épouse.
Un vibrant et ultime témoignage un siècle exactement après la disparition
de l’écrivain.
Philippe-Emmanuel Krautter
« André Suarès – Vues sur
Baudelaire » ; Préface de Stéphane Barsacq, Coll. Portraits, Éditions des
Instants, 2022.
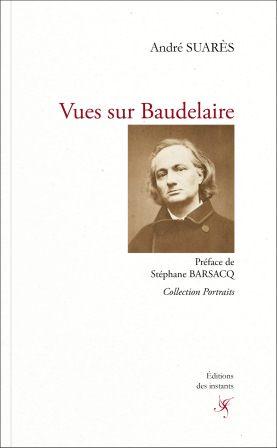
Comment ne pas saluer cet ouvrage « Vues sur Baudelaire » qui vient de
paraître aux éditions des Instants regroupant six textes, articles ou
préface, consacrés au poète maudit et signés de la main d’André Suarès ?!
Suarès, écrivain et poète assoiffé de liberté, vouera une admiration
indéfectible à Baudelaire ; il fera partie de son Parnasse avec Mallarmé
et Rimbaud, se disputant la première place avec Verlaine. Suarès sera,
surtout, l’un des premiers écrivains à consacrer au poète et à sa poésie
de véritables analyses ; études qu’il n’hésitera pas à renouveler sa vie
durant – le premier de ces textes paru dans « La Grande Revue » datant de
1911, le dernier de 1940. « Baudelaire est pour lui une figure tutélaire,
presque une obsession. » écrit André Guyaux dans « Le Baudelaire de Suarès
».
Mais, en ces écrits, Suarès n’entend nullement cependant livrer une
biographie ou une chronique nécrologique du poète disparu deux ans avant
sa naissance en 1868. Non, Suarès tourne et retourne autour de Baudelaire,
inaccessible et pourtant si fascinant, comme pour mieux entrer dans son
âme de poète maudit ou dans « ce pays de son génie » écrira Marcel Proust
dans « Contre Sainte-Beuve » ; c’est son « Cœur mis à nu » plus encore que
Suarès souhaite approcher, presque disséquer comme pour mieux en percer le
mystère. Baudelaire, « le plus nu et le plus vrai des poètes, en son temps
» écrira-t-il.
Et si bien des points de contact existent entre eux, Suarès se garde bien
pour autant de faire de mauvaises ou d’orgueilleuses projections ; non,
ici encore, il tourne, soulignant les multiples visages mais tenant ses
distances préférant rapprocher les plus grands astres entre eux : Keats et
Baudelaire, Baudelaire et Wagner. Baudelaire poète, mais aussi critique
d’art, puisqu’il « manifeste en tout cette nature noble et rare, faite
pour les plus hauts entretiens de l’intelligence, et pour les soucis de
l’art. » écrira encore André Suarès.
Convoquant Gracq, Bonnefoy, Pierre Jean Jouve et bien d’autres encore, ce
sont également quelques-uns de ces multiples portraits ou visages de
Baudelaire mais aussi d’André Suarès que Stéphane Barsacq a souhaité
livrer dans sa longue et riche préface. Le préfacier revient ainsi sur ces
incontournables thèmes que sont celui du double, Doppelgänger, si cher à
Dostoïevski, ou encore celui du masque renvoyant à Roger Caillois… mais
comment ne pas également songer à Jean Starobinski…
Dans ces jeux de miroirs, chaque grand écrivain, poète ou penseur ne
semble avoir échappé à cette fascination baudelairienne, à cette « Folie
Baudelaire » ainsi que l’a nommée Roberto Calasso et cet ouvrage
regroupant ces écrits d’André Suarès viennent avec une singulière
puissance en témoigner.
L.B.K.
A noter, également aux éditions des Instants, d’André Suarès : « Sur
Molière suivi de Clowns ».
Dexter Palmer : « Mary Toft ou La
reine des lapins », Éditions Quai Voltaire, 2022.
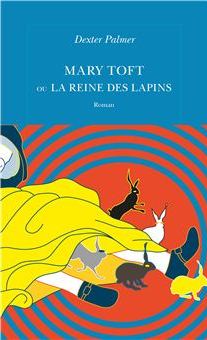
« Les lecteurs du présent ouvrage auront compris que j’ai traité mon sujet
avec la liberté du romancier : certains personnages incarnent des acteurs
de l’histoire vraie de Mary Toft et d’autres sont inventés… »
Nous voilà prévenus ! Un fameux mélange de réalité et d’imaginaire dans ce
conte réjouissant de Dexter Palmer nous projette dans un contexte
historique vrai, en plein 18e siècle, lorsque les cabinets de curiosités
médicales étaient un spectacle de foire où de pauvres personnes difformes,
naines, siamoises à deux têtes ou souffrant d’autres infirmités régalaient
l’imaginaire des populations des villes provinciales comme des capitales.
Londres in situ, lorsqu’un phénomène incroyable se produisit dans la
petite ville de Godalming et suscita toute l’attention de John Howard,
médecin et chirurgien de son état, ainsi que du jeune Zachary Walsh, le
fils du pasteur et apprenti médecin aux côtés du docteur Howard. Mary Toft
accouche dans d’atroces souffrances d’un lapin morcelé et démembré et
pleurant des larmes de sang d’après les dires de Joshua, son époux, venu
en catastrophe chercher le secours du bon docteur. À cette époque de
croyances et de légendes multiples, les interprétations pouvaient aller
bon train surtout lorsque « l’événement » ce reproduisit à intervalles
réguliers… « Peut-être allons aujourd’hui être témoins d’un prodige. » se
dit John Howard en préparant sa sacoche et embarquant avec lui son
apprenti. Là, Mary donna naissance à un premier lapin et le docteur aura
beau relire ses livres de médecine rien ne pourrait expliquer cette
anomalie de la nature. Le diable serait-il passé par là ? Nul ne saurait
le dire. Les prières ou incantations du pasteur n’eurent aucun effet et
laissent supposer que Mary si elle n’est pas possédée aurait peut-être un
don divin, supposition qui au fur et à mesure des nouvelles naissances de
morceaux de lapins dépassera les frontières de Godalming. Cette curiosité
arrive aux oreilles du Roi Georges qui demande alors expertises et
rapports à différents médecins londoniens dépêchés sur place, et qui
finirent sur ordre royal par faire venir à Londres cette curieuse femme
pour études et observations médicales approfondies. Si elle était déclarée
miraculeuse, qu’au moins cela se passe au plus près du Roi. Ainsi Mary,
son mari, John et Zachary partent pour Londres, après que les journalistes
du British Journal se soient mêlés du sujet en publiant quelques articles,
on pourrait alors dire que c’est ainsi que les ennuis commencèrent pour
John Howard mais également pour Mary Toft.
Dexter Palmer nous fait partager à la fois les recherches et explications
médicales des plus douteuses aux plus sérieuses ainsi que le pouvoir de
l’imagination populaire. Tout le monde veut avoir un avis sur cette
étrangeté, des avis qui baignent dans des croyances et des illusions qui
font la richesse de ceux qui exploitent la crédulité des plus naïfs. On
aimerait tant que ce soit vrai et en même temps, qui, sinon le diable
autoriserait cela ? Réalité, supercherie ou miracle ? « L’affaire Toft
agissait comme une sorte de turbine, attirant à elle vérités et mensonges
et les mélangeant tant et si bien que toutes choses étaient vraies et
aucune ne l’était. » Écrit comme une aventure et enquête étayée de la
véritable histoire de Mary Toft dont l’auteur nous conseille dans une
bibliographie très fournie, la lecture d’articles et de confessions de
Mary Toft alors qu’elle était retenue dans les geôles de la prison de
Bridewell, ce roman/conte raconte dans ce 18e siècle cette éternelle
histoire où les hommes de science, de religion et autres recherchent la
reconnaissance, la notoriété, et ce presque à n’importe quel prix. Et rien
n’interdit d’y trouver une forte résonance actuelle… « En quoi
importe-t-il qu’une assertion ne soit pas prouvée, s’il se trouve assez
d’individus pour croire en sa vérité ? » CQFD
Sylvie Génot Molinaro
Alain Dulot : « Tous tes amis sont
là », Editions La Table ronde, 2022.
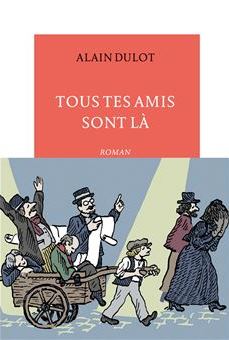
« Je ne sais rien de gai comme un enterrement ! » Ainsi commence le
célèbre poème « L’enterrement » de Paul Verlaine.
« C’est alors que du silence jaillit une voix. Une voix de femme, une voix
qui porte, ardente et claire celle-là… Cri déchirant en ce qu’il déchire
le dernier silence, et pourtant cri d’exultation : six mots, six pauvres
mots surgis du fond d’un cœur et jetés au vent et à l’Histoire :- «
Regarde, tous tes amis sont là !... » crie Eugénie Krantz,
l’ex-courtisane, la pocharde de la rue Saint-Jacques, mégère de la rue
Descartes, harpie épiant sa rivale, la femme détruite par les alcools et
les années… ».
Eugénie, dernière compagne de Paul Verlaine, aujourd’hui au cimetière des
Batignolles. Oui, tous les amis de Verlaine, le « Prince des poètes »,
sont là, suivant le cortège mortuaire, ce vendredi 10 janvier 1896, à
travers Paris. Deux jours avant, le mercredi 8, Paul Verlaine surnommé «
le Villon des temps modernes » meurt chez lui au 39 rue Descartes, Paris
où il s’était installé quelques semaines plus tôt avec sa compagne,
Eugénie Krantz. Alain Dulot fait parler les hommes qui ont entouré
Verlaine de son vivant, qui l’on soutenu, aidé financièrement,
affectivement et admiraient son œuvre poétique si nouvelle, si moderne, si
dérangeante, si loin de l’académique… Oui, l’académie où comme Baudelaire,
il ne sera jamais admis, car les mœurs de ce poète n’ont jamais été du
goût des immortels. Qu’à cela ne tienne, l’hommage, le vrai se joue ici, à
travers les rues de Paris, où se masse une foule de gens, des curieux
comme tous ceux et celles qui savaient qui tu étais, toi à qui Victor Hugo
mort dix ans plutôt, écrivait après avoir lu les Poèmes saturniens : « Une
des joies de ma solitude, c’est, Monsieur de voir se lever en France, dans
ce grand dix-neuvième siècle, une jeune aube de vraie poésie. Toutes les
promesses de progrès sont tenues et l’art est plus rayonnant que jamais(…)
Certes, vous avez le souffle. Vous avez le vers large et l’esprit inspiré.
Salut à vos succès. »
L’auteur lui-même, Alain Dulot, se mêle à cette foule qui défile dans ces
rues parisiennes où se sont déroulés tant d’événements de la vie du poète,
sa mère, ses études, ses amours, ses souleries, ses amitiés, ses
publications, les critiques de certains, ses moments intimes ou publics
jusqu’à sa mise en abîmes, ses dérives, la maladie et la mort, celle qui
est si banale qui que l’on soit. L’auteur est aux côtés des amis fidèles,
comme François Coppée, Edmond, Lepelletier, Catulle Mendès, Robert de
Montesquiou, Mallarmé, Frédéric-Auguste Cazals, Albert Cornuty et tant
d’autres qui soutiennent Eugénie et Charles, seul Georges, son fils n’est
pas là… Les fantômes de Rimbaud et Baudelaire survolent la cérémonie, les
discours flottant dans les limbes verts de l’absinthe pour l’éternité.
« Vous êtes prié d’assister au convoi, service et enterrement de M. Paul
Verlaine, poète, décédé le 8 janvier 1896, muni des sacrements de
l’Église, en son domicile, rue Descartes, 39, à l’âge de 52 ans, qui se
feront le vendredi 10 courant, à dix heures très précises, en l’église
Saint-Etienne-du-Mont, sa paroisse. De profundis
On se réunira à la maison mortuaire.
De la part de M ; Georges Verlaine, son fils, de M. Charles de Sivry, son
beau-frère, de son éditeur, de ses amis et admirateurs.
L’inhumation aura lieu au cimetière des Batignolles. »
Ainsi commence ce roman touchant d’Alain Dulot, ainsi s’achève la vie de
Paul Verlaine.
Sylvie Génot Molinaro
John Ruskin : « Écrits naturels »
; Illustrations de John Ruskin ; Préface, traduction et notes de
Frédérique Campbell ; Livre broché, 12 x 18 cm, 224 pages, Éditions
Klincksieck, 2021.

Belle initiative des éditions Klincksieck et Frédérique Campbell que de
rendre disponible ces courts textes du grand poète et critique d’art
anglais John Ruskin (1819-1900). L’auteur, bien connu pour son célèbre «
Les Pierres de Venise », cultivait également un jardin secret avec
l’observation de la nature. La géologie, la botanique et la zoologie
avaient très tôt attiré la curiosité de cet esprit vif à l’analyse
pénétrante. Ces « Écrits naturels » regroupent justement quatre textes
accompagnés d’un appendice mettant en avant cet attrait fécond pour
l’Histoire naturelle. Celui dont le regard aiguisé sur les arts avait
attiré l’attention et l’admiration d’un Oscar Wilde et d’un Marcel Proust
s’intéressait également aux choses de la nature tels les Arachnés, le
rouge-gorge, le crave à bec rouge ou encore les ondes vivantes. Cette
étonnante diversité - dans l’esprit victorien tout en demeurant opposé au
darwinisme ambiant – force l’admiration non seulement pour le fond, mais
surtout la forme, tant le style de ces conférences s’avère ciselé de
manière cristalline, ce qu’a admirablement rendu Frédérique Campbell dans
sa traduction.
|
« Italo Calvino - Récits » ;
Traduction de l'italien par Éliane Deschamps-Pria, Marie Fabre, Mario
Fusco, Gérard Genot, Maurice Javion, Jean-Paul Manganaro, Christophe
Mileschi, Martin Rueff, Roland Stragliati et Jean Thibaudeau, Édition
établie par Christophe Mileschi et Martin Rueff ; Préface de Martin Rueff,
Collection Quarto, Gallimard, 2025.

Insaisissable et protéiforme : tels sont, sans doute, les qualificatifs
qui s’imposent à l’évocation de l’œuvre d’Italo Calvino, l’un des
écrivains italiens majeurs du XXe siècle. À l’occasion de la parution du
volume Quarto aux éditions Gallimard rassemblant ses Récits essentiels,
c’est tout un parcours littéraire qui se donne à lire ; une œuvre tissée
au fil des périodes de vie de l’écrivain, passant de la veine néoréaliste
de ses débuts aux formes les plus audacieuses de l’expérimentation
narrative. Martin Rueff, dès sa préface, avertit le lecteur : Que ce
dernier mette sur pause tablettes et téléphones, qu’il oublie pendant
quelques soirées ses séries TV préférées et qu’il prenne le temps et la
quiétude d’ouvrir ce volumineux Quarto de plus de mille quatre cents
pages. Conseil judicieux pour goûter aux multiples facettes de cet
écrivain facétieux dont les premiers pas en littérature furent marqués par
des récits de jeunesse (1943-1947), sans oublier l’expérience initiatique
de la Résistance, auxquels le volume réserve les deux premières parties.
Qu’il s’agisse des récits d’avant son engagement en août 1944 caractérisés
par des paraboles énigmatiques laissant percevoir déjà l’attirance de
l’auteur pour l’absurde et la drôlerie ou de ceux dictés par le drame vécu
au quotidien dans les collines avec ses compagnons d’armes, Calvino cisèle
un style déjà marqué par une rare sensibilité, délaissant l’héroïsme
guerrier au profit d’un regard oblique, attentif aux marges et aux
perceptions enfantines. Ainsi s’affirme cette acuité de l’observation qui
ne cessera de le caractériser, une attention presque scientifique au réel,
bientôt transfigurée par l’imaginaire.
C’est avec cette même acuité acquise lors des années de guerre que Calvino
observera la société dans laquelle il évolue, un exercice qui le conduit
alors à identifier ce qui demeurait caché, en fouillant et décomposant
notamment une banale journée de votes lors d’une élection comme le fit
Amerigo dans « La Journée d’un scrutateur »… Alternant fables et rêveries,
Calvino scrute le monde contemporain selon diverses tonalités, mais
toujours avec un style jubilatoire. Conjuguant imagination et raison,
l’écrivain italien brise les frontières et quitte le néoréalisme pour lui
préférer la fable et l’allégorie. Ce goût du décalage irriguera l’ensemble
de son œuvre et sera perceptible également dans « Marcovaldo » (1963),
recueil de nouvelles évoquant les tribulations d’un ouvrier déraciné dans
une grande ville industrielle du Nord. Derrière le rocambolesque assumé —
qui n’est pas sans rappeler Charlot ou Totò — se dessinent les tensions de
la société postindustrielle et la difficulté à maintenir un lien poétique
avec la nature dans un monde dominé par la production et la consommation.
Avec Monsieur Palomar, Calvino pousse encore plus loin cette quête
d’observation. Ce personnage discret devient le prétexte à une série de
micro-expériences du regard, mettant en scène une attention extrême au
monde, presque autobiographique. L’écrivain l’a souvent rappelé : le récit
naît de l’image, non d’une thèse à démontrer, autour de laquelle s’étend
un réseau de significations toujours mouvantes, refusant toute
interprétation univoque.
Le lecteur de cette chronique l’aura compris nombreuses seront les
découvertes proposées par ce Quarto Calvino, que celui-ci retienne le fil
chronologique proposé, ou qu’il lui préfère – ce qui n’aurait pas déplu à
l’écrivain - le hasard de ses pérégrinations. Quel que soit son choix, il
réalisera combien l’œuvre de celui qui fut tour à tour résistant puis
membre de l’Oulipo, communiste puis apolitique, demeure cohérente,
explorant de manière continuelle les formes et les possibles de la
littérature, malgré les nombreux chausse-trappes semées par l’écrivain
lui-même, Calvino aimant tant pour le pur bonheur de ses lecteurs
brouiller les pistes…
Philippe-Emmanuel Krautter
"Le Sacré dans la vie quotidienne"
de Michel Leiris, 144 p., Editions Allia, 2025.

Sur les franges de nos vies, certains espaces s’immiscent, parfois
encadrés par la foi de nos anciens, mais d’autres fois aussi, tissés à
notre insu, au fil des heures et des années. C’est dans ces espaces que
s’est aventuré l’ethnologue et penseur Michel Leiris, bien connu au XXe
siècle pour avoir signé des ouvrages fondamentaux comme « L’Afrique
fantôme » ou « L’Âge d’homme ». Dans « Le Sacré dans la vie quotidienne »,
l’auteur quitte le champ anthropologique des lointains pour s’introduire
dans nos représentations intimes, ce que les psychologues qualifieront de
refoulement et de névroses et que l’ethnologue appréhende pour sa part en
termes de sacré.
Il ne s’agit pas là d’une religion institutionnelle, mais des lieux et des
instants gravés dans une vie où tout fait signe, à l’image d’une
révélation. Le point de départ se trouve le plus souvent au temps de
l’enfance et l’auteur n’hésite pas à évoquer pour nous ces espaces
particuliers de la « brousse » entre les fortifications de Paris et
Auteuil… Ce texte empreint d’une poésie certaine dévoile une autre
approche de l’enfance, transcendant le simple exercice du souvenir, pour
lui donner une autre dimension, plus constitutive et qui, à condition d’y
consentir, pourra se perpétuer bien au-delà jusqu’à la vie adulte.
Avec cette distanciation de l’ethnologue contrastant avec la subjectivité
du narrateur, sujet de sa recherche, Leiris emporte son lecteur en une
belle digression bien plus profonde qu’elle ne pourrait apparaître de
prime abord. Une lecture stimulante de notre quotidien…
Philippe-Emmanuel Krautter
Lawrence Durrell : « L’Île de
Prospero » ; Traduit de l’anglais par Roger Giroux; Préface inédite de
l’auteur, Editions Bartillat, 2025.

Les réminiscences de Corfou par l’écrivain anglais Lawrence Durrell
forment en ces pages un écrin entre poésie et récits de voyage,
pérégrinations hédonistes et questionnements philosophiques. L’Île de
Prospero, titre quelque peu énigmatique et qui trouvera toute sa saveur
lors de la lecture de cet écrit de jeunesse de l’auteur âgé seulement de
vingt-cinq ans, atteste de la complexité des lieux, un thème cher à
Durrell qui sera développé notamment avec « L’Esprit des lieux » 1976.
Celui qui faisait métier d’écrivain et de poète « à l’étranger », comme il
se plaisait à le rappeler, n’eut cesse de nourrir sa vie durant un rapport
particulier avec la Grèce, pays propice à son inspiration littéraire et
poétique, ainsi qu’en témoignent ces quelques notes lancées aux quatre
vents helléniques. A la veille de la Seconde Guerre mondiale, durant
quatre années, Durrell va en effet s’immerger littéralement dans ce lieu
unique où la mythologie, notamment avec Ulysse, se dispute avec la culture
populaire que l’écrivain savoure avec gourmandise dans ces notes
consignées jour après jour. L’écriture ciselée aux reflets des éléments,
la pulsation vitale de la terre et de la mer si proches de sa maison, tout
concourt à faire de ce témoignage non seulement une évocation unique d’une
Grèce d’avant-guerre à jamais disparue, mais également de l’inspiration
littéraire de Lawrence Durrell, de la force de ces portraits d’une rare
acuité, sans oublier ce sacre de la nature qu’un Stravinsky n’aurait
probablement pas renié. Entre Shakespeare et Homère, les saints orthodoxes
et les fêtes de village où coulent les plus doux nectars, le lecteur ne
saurait demeurer indifférent à cette lecture vivifiante.
Christine Feret-Fleury : «
Crèvecœur », Editions La Belle Etoile, 2025.

« De toute façon, chacun savait qu’à Crèvecœur, rien ne bougerait jamais,
sauf si la nature s’en mêlait... La conversation s’arrêtait là… Le jardin
était notre royaume. De mi-juin aux premiers jours d’octobre, aucun être
humain âgé de plus de dix-sept ans n’avait le droit de pousser la grille
de fer forgé ...» Les souvenirs d’enfance de chacun de ces étés sont
ancrés dans les mémoires des enfants de la famille. Ah ! L’enfance, son
imaginaire, ses disputes, ses jalousies, et puis les premiers émois de
l’adolescence... À Crèvecœur, l’été les enfants - Esther, Gaspard, Éva et
Emma les jumelles, et les autres, étaient libres, si libres de tout qu’ils
ne respectaient aucun des interdits jusqu’à mettre leurs vies en danger.
Toutes ces vies fraîches, pleines d’une énergie incontrôlable, emplies de
joie jusqu’à l’accident. Attention, à Crèvecœur, il n’y a pas que les
humains qui comptent, la maison des hommes et celle des femmes tout au
bord de la falaise y sont de vrais personnages qui comme les habitants des
lieux peuvent disparaître elles aussi. Et puis, il y a les jeux puérils
d’enfants comme essayer de savoir ce qu’il y a dans la boîte d’Éva… Du
vide, du plein de la vie ou de la mort ? Et cette détonation qui venait du
deuxième étage…
C’est la disparition soudaine de Gaspard, son meilleur ennemi, son
meilleur ami, son amour inavoué, qui va bouleverser Esther jusque dans sa
vie d’adulte « Je ne reviendrai jamais ici ». Pourtant, elle reviendra,
adulte, dans ce paradis d’enfant, mais où tout, alors, est en
transformation, le paysage, la mer et ses vagues qui grignotent la falaise
comme ses souvenirs autant que le terrain et la maison des femmes qui est
au bord de basculer. « Pour la dernière fois, je remets mes pas dans les
pas du passé, pour la dernière fois, je vois grandir la façade biscornue,
si familière. Demain, elle aura peut-être disparu, et dans quelques jours,
je tournerai le dos, définitivement, à cet été-là, et à tous les autres. »
C’est terrible, huit ans après que Gaspard ne soit plus là, de voir tous
ces bouleversements. Où est-il ? Où dans le monde ? Où dans les souvenirs
?
« Quitter Crèvecœur. Y revenir. Encore, et encore. Parce qu’il nous était
impossible de faire autrement, parce que le flux et le reflux nous
gouvernaient tous. » Ce texte particulièrement dense et pourtant si fluide
à lire révèle à quel point la mémoire n’échappe jamais à la recherche de
vérité et que bien des lieux de nos vies réagissent comme des organismes
vivants prêts à donner vie comme à la reprendre. Un texte ou se mélangent
les générations et les époques. Les absences et les présences, les vivants
et les fantômes.
Sylvie Génot Molinaro
André Suarès : « Ariel dans
l'orage » ; Préface de Stéphane Barsacq, Editions Le Condottiere, 2025.
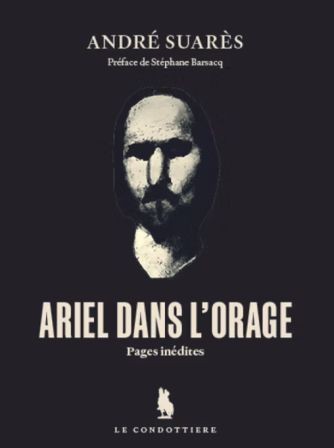
L’écrivain André Suarès (1868-1948) peut parfois donner l’impression
d’être un disciple de Protée. Mais, au-delà, les nombreuses facettes de sa
personnalité et de son œuvre masquèrent difficilement son amour
inconditionnel de la liberté qu’il chérissait plus que tout. Les ports (il
est né à Marseille) et les rivages qui avaient bercé son enfance
l’encouragèrent très tôt à regarder vers les lointains. Tout était motif
de son intarissable soif de connaissances, la poésie et les lettres, bien
sûr, mais aussi l’art et la musique, sans oublier les voyages et la mer
omniprésente ayant contribué à sa notoriété avec son incontournable
ouvrage : Le voyage du Condottière…
Cette plume, appréciée des plus grands écrivains tels André Gide, Paul
Claudel, Stefan Zweig, James Joyce, Rilke, André Malraux, Roger Nimier et
bien d’autres encore, allait tout au long de sa vie signer bien des
ouvrages, plus d’une centaine, sans oublier de nombreux articles publiés
dans des revues, des carnets ainsi qu’une abondante correspondance. Malgré
cette profusion connue et diffusée, il demeure – chose inconcevable, mais
bienheureuse ! - quelques inédits, fort heureusement rassemblés
aujourd’hui par les éditions bien nommées « Le Condottiere » sous
l’initiative de Stéphane Barsacq qui en signe la préface.
Le lecteur y retrouvera le style inimitable d’André Suarès qui n’a d’égal
que sa discrétion, sans omettre le caractère quelque peu farouche d’un
oiseau crépusculaire. Ainsi que le relève Stéphane Barsacq : « Chez lui,
tout n’est que parfums, sensations directes, noces avec l’esprit et la
lumière ». Cette âme éprise de pèlerinages goute le primitivisme et
déteste le maniérisme. À la manière du grand Léonard, Suarès suit la voie
de l’homme de la Renaissance, épris de tous les horizons… Et, c’est selon
cet éclairage qu’il faudra goûter à ces petits textes réunis par Stéphane
Barsacq.
Tout fait signe en effet dans ces pages inédites quant à cette insatiable
curiosité d'André Suarès. Et si le volume débute par ces mots
programmatiques : « Être vrai avec soi-même : peut-être n'y a-t-il pas une
autre règle d'or ». L'auteur de ces lignes tempère immédiatement : « être
vrai avec soi-même : ne pas être dupe du rôle que l'on joue ». Lucide,
Suarès ? Notre écrivain est trop conscient de ce qui habite l’homme pour
méconnaître les illusions de la gloire, oripeaux de la vanité... Ce qui ne
justifie pas pour autant qu'un critique puisse tout se permettre, surtout
s'il s'agit d'une question de personne et non de création. Bas les masques
! recommande Suarez, ce qui vaut aussi bien pour le domaine de la critique
littéraire que pour la Raison d'État qui, selon les termes du célèbre
juriste autrichien Hans Kelsen, cache la face hideuse de la Gorgone…
Suarez n'est pas plus tendre, lui qui estime que : « Là-dessous, ce vieux
cadavre pourri cache son horreur séculaire et ses flétrissures. » Le ton
est donné, l’écrivain sait garder le cap sur ces flots « intranquilles »
qui rappellent, par certains de leurs sombres aspects, notre époque «
moderne », un siècle plus tard. L'homme de lettres visionnaire a su, en
effet, repérer bien des évolutions avant qu'elles ne jettent leur fiel ;
ces populismes bientôt destructeurs dont il eut très tôt le funeste
pressentiment…
Notons, cependant, pour terminer que ce délectable volume se conclut
heureusement par une entrée plus qu'inspirée « Sur la grâce », quelques
lignes ciselées selon le miroir de l'âme et qui, plus que la beauté,
peut-être, pourra sauver le monde…
Philippe-Emmanuel Krautter
Gabriella Zalapì : "Ilaria ou la
conquête de la désobéissance", Zoé Editions, 2024.

Ce troisième roman signé Gabriella Zalapi emportera son lecteur dans les
tourbillons non seulement de l’enfance bouleversée, mais plus largement de
l’identité. Dans ce récit aux accents autobiographiques, la jeune Ilaria
se trouve embarquée avec son père dans un road movie malgré elle,
alternant entre appréhension causée par cette fuite et construction de
soi. Du nord au sud de l’Italie, les paysages défilent à la vitesse des
sentiments complexes et chaotiques des protagonistes où la complicité
laisse place à l’incompréhension de cette jeune enfant bien trop mûre pour
son l’âge.
Mais, cette distanciation, loin d’être une indifférence, devient le
rempart de cette âme blessée par la séparation de ses parents, le père
apparaissant souvent plus infantile que sa fille portée par une tragique
lucidité. Ce regard, rapporté par l’auteur en une écriture parfois acérée,
ou tout au moins incisive, porte droit au but : l’issue ne semble guère
faire de doutes dans cette course-poursuite de l’identité où les affects
souvent contradictoires se succèdent au fil des paysages italiens.
Une évocation de l’errance, aussi prenante que poignante, signe de la
qualité de ce roman que l’on imagine sans peine porté à l’écran…
Philippe-Emmanuel Krautter
Friedrich Dürrenmatt : « La Panne
» ; Traduit de l’allemand par Alexandre Pateau, Zoé Editions, 2025.

Voici une bien curieuse histoire que celle née de la plume de Friedrich
Dürrenmatt, intitulée La Panne, et qui a contribué à la célébrité de
l’écrivain suisse au siècle dernier. Un soir d’été, le représentant de
commerce Alfredo Traps tombe en panne. Confiant son automobile à un
garage, il trouve une chambre d’hôte chez un juge à la retraite… Ce qui
pourrait sembler n’être qu’une histoire banale va progressivement
s’emballer en un récit abasourdissant. Voici que notre homme, que l’on
devine ordinaire, se retrouve sujet d’un jeu des plus singuliers : le juge
à la retraite et ses amis, réunis pour l’occasion lors d’un dîner,
proposent en effet à notre commis voyageur de se prêter à un procès «
privé »… le sien !
À partir de cette intrigue originale, Dürrenmatt fait preuve d’une force
d’écriture impressionnante avec ce court récit conçu à l’origine pour une
radiodiffusion. Du jeu, le récit passe rapidement à la vivisection de
l’âme humaine et de ses travers les plus sordides. Chaque heure passée
lors de cette soirée abondamment arrosée, présentée sur le ton de la
plaisanterie, se métamorphose en un redoutable huis clos révélant les
instincts les plus sombres des êtres.
Cette nouvelle traduction d’Alexandre Pateau restitue à merveille
l’écriture incisive de l’écrivain suisse. Dürrenmatt a d’ailleurs livré
plusieurs versions de ce texte, certaines à la conclusion encore plus
sombre, tandis que celle de la présente édition offre une fin moins
cruelle. Reste, cependant, que le lecteur ne sortira pas indemne d’une
telle lecture : ces quelques soixante pages équivalent à un lourd traité
sur les tréfonds de l’âme humaine…
Philippe-Emmanuel Krautter
Virgile : « Le souci de la terre
(Géorgiques) » ; Traduit du latin et présenté par Frédéric Boyer, Poésie
Gallimard, 2024.

« Le souci de la terre », c’est un titre inspirant qu’a retenu Frédéric
Boyer pour cette belle traduction des « Géorgiques » de Virgile. Cette
œuvre bien connue des amoureux de la littérature classique antique, plus
souvent citée que lue, pose en effet un regard à la fois tendre et
rigoureux, ému et réaliste sur les rapports entretenus entre la nature et
l’homme. Bien plus qu’un traité agronomique, cet éloge du sensible ne se
transforme pas pour autant en vision béate, Virgile étant bien trop
conscient que la nature peut offrir des faces aussi sombres que radieuses.
Frédéric Boyer a su se saisir de la poésie omniprésente née des vers de
Virgile, une poésie offrant des respirations indispensables après les
terribles guerres civiles ayant fragilisé la République romaine. Les
épisodes sombres ne manquent pas en effet en cette fin de régime qui
connaîtra l’assassinat de César et les premières années troublées de l’ère
augustéenne. Aussi, ainsi que le souligne justement Frédéric Boyer dans sa
préface, cet éloge de la terre italienne a valeur métaphorique, ce souci
des choses, le soin à apporter à ce qui importe, loin des fastes inutiles
de la cour. Beauté, fugacité, caractère éphémère de la vie rejoignant par
certains aspects les préoccupations des stoïciens, tout fait signe dans la
poésie de Virgile jusqu’à la métaphore finale de la société des abeilles.
Le travail gigantesque réalisé par Frédéric Boyer entravé par des deuils
personnels prend ainsi valeur initiatique, son élan étant de proposer une
forme moderne de lecture sans pour autant renier le souffle virgilien.
Autant dire que l’entreprise est réussie, la présente traduction
instaurant dès les premières pages un lien étroit entre le lecteur
contemporain et la poésie classique, à l’image de ce « Printemps neuf –
Quand fond l’eau glacée des montagnes blanches – Le vent défait le sol
poudreux »… Ce long poème de près de 2 000 vers commandé par l’ami de
Virgile, Mécène, nous invite à méditer sur la vie, la mort, les liens
entre la nature malmenée par les guerres et les hommes. Une réflexion
poétique servie par une traduction inspirée qui trouvera bien entendu de
nombreux échos contemporains auprès du lecteur.
Philippe-Emmanuel Krautter
Mark Haskell Smith : « Mémoires »;
Traduit de l’américain par Julien Guérif, Editions Gallmeister, 2024.
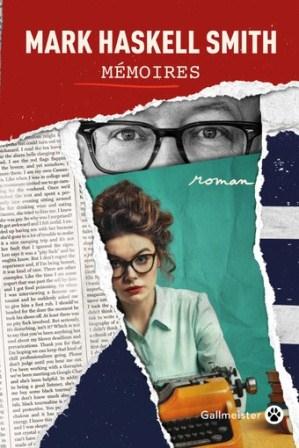
« J’essaye de me convaincre que le changement est la seule constance de
l’existence – Héraclite » écrit Amy Elshof, à la fin d’une lettre destinée
à Olivier, son éditeur. C’est à cette journaliste sans gros revenus, un
peu déprimée, à qui cet Olivier a confié l’écriture de la biographie de
Mark Haskell Smith, lui-même, auteur peu connu, taiseux et semblant être
agoraphobe, vivant en Grèce ou ailleurs, dont la vie pourrait ne pas
sembler très intéressante du point de vue d’un lecteur potentiel. Tout
ceci pouvant se discuter, mais au-delà de cette commande, Amy accepte
surtout pour l’argent et pour voyager sans frais aussi ! « Les écrivains
ont toujours besoin d’argent ? C’est notre talon d’Achille », dira-t-elle.
Là commence alors un polar déjanté, drôle et haletant, fourmillant de
personnages connus, de références de lecture, citations tombées à pique,
de dialogues envolés et caustiques, de situations à rebondissements
surprenants. Enlèvements, courses à travers l’Europe, services secrets ou
pas, CIA ou pas, grands plans de la Tech ou pas, noms familiers des
puissants du web, affaires louches, rumeurs louches, tentatives
d’assassinats… Meurtres… Qui manipule qui ? « J’ai toujours su repérer les
signes avant-coureurs et les mauvais présages. Je sens venir l’orage, et
je m’attends souvent au pire… Dans la vie, on n’est jamais sûr de rien. »,
pensera-t-elle aussi.
Qu’Amy n’ai pas suivi son intuition nous régale en tant que lecteur, car
sans sa soif de curiosité et de l’appât du gain, Mark Haskell Smith
n’aurait pas pu nous embarquer comme auteur et sujet dans cette fiction
qui prend intelligemment en compte certains paradoxes actuels de nos
sociétés. Donc qui est ce Smith ? Que cache-t-il ? Qui sont ceux qui le
poursuivent et pourquoi ? Jusqu’où Amy est-elle prête à aller pour
atteindre ou pas son objectif et acceptera-t-elle les paramètres et dégâts
collatéraux ? Le lecteur suit l’enquête journalistique que mène Amy pour
la biographie commandée mais la bobine du fil de cette histoire lui
échappe et le dérapage semble inévitable… « Mais prenons un peu de recul
et pensons à ce que Nietzsche aurait eu à dire du dilemme auquel je me
trouvai confrontée. Il se demandait si ce qu’on appelle quelqu’un de bien
est l’opposé de quelqu’un de mauvais. S’agit-il de deux caractéristiques
distinctes ou de deux facettes d’une même personne ? Il n’est pas absurde
d’admettre que les gens sont à la fois bons et mauvais… » CQFD non ?
« Avez-vous déjà entendu votre cœur battre à l’intérieur de votre tête ?
C’est exactement ce que j’ai ressenti. J’ai cru que ma vie était terminée.
Ce n’était manifestement pas le cas. »
Sylvie Génot-Molinaro
Yannis Ritsos : « Grécité » ;
Édition définitive ; Texte français de Jacques Lacarrière ; Illustrations
d’Alecos Fassianos. 40 p., 14 x 22 cm, Editions Fata Morgana, 2023.

La poésie de Yannis Ritsos (1901-1990) ne peut laisser indifférent
quiconque aspire à la liberté, celle des mots et de l’esprit. Tendu vers
une quête perpétuelle d’amour et de fierté, héritée de ses ancêtres,
Ritsos ne livre pas une poésie de combat même si un grand nombre de ses
vers ont été repris par le grand musicien Theodorakis comme refrain de la
lutte contre l’oppression, mais bien une ode à l’insoumission. Le verbe de
« Grécité » n’échappe pas à ce souffle libertaire où « ces cœurs ne
peuvent se rassasier que de justice ». Mais réduire le poète à cette seule
dimension – essentielle malgré tout chez lui – serait encore lui faire
injustice, les images retenues, les associations rapprochées concourent à
un souffle unique de la poésie grecque conduisant à ce chant puisé à
l’antique.
« Grécité » se veut la réaction poétique de Ritsos à la dictature des
colonels de 1967 à 1974, régime pourtant si opposé à la démocratie née sur
ces rivages et qui le conduira à être déporté dans les îles de longues
années. Le soleil, la chaleur, la lumière aveuglante bannissent tout
entre-deux : « Ce pays est aussi dur que le silence » et « Quelle épée
tranchera le courage / Quelle clé fermera le portail de ton cœur / Le
portail grand ouvert sur les jardins étoilés de Dieu ? ». Chaque vers de «
Grécité » trouve un écho dans la musicalité des images admirablement bien
rendue par la traduction de Jacques Lacarrière, hellène de cœur sinon de
sang. Nul étonnement dès lors que le rébétiko – ce chant plaintif né dans
les années 20 du siècle passé – ne se soit saisi de cette poésie pour en
tirer de magnifiques mélodies. Un souffle à découvrir dans cette belle
édition illustrée par les dessins du grand peintre grec Alecos Fassionos.
Philippe-Emmanuel Krautter
Frédéric Wandelère : « Divers
ennemis du réveil - Dix-sept poëmes pour Martin Steinrück », Editions
Arcades Ambo, 2024.

Le poète suisse Frédéric Wandelère dont nous avions déjà pu apprécier en
ces colonnes « La Compagnie capricieuse » parue à La Dogana, réunit
aujourd’hui « Dix-sept poëmes pour Martin Steinrück » aux éditions
Arcades Ambo. Goûtant aux instants transitoires entre songes et éveil,
l’auteur explore ces sensations qui rôdent près du sommeil, sans que l’on
sache si elles relèvent du rêve ou de la conscience :
« Dans un
demi-sommeil, je rêve et je ne rêve pas ;
Je tiens un livre en main, relâché ce n’est rien ;
La chose évanouie je la retrouve telle
De l’autre côté de mes yeux clos. »
Sa poésie sait se saisir de cette fugacité qui sied tant à son auteur,
Frédéric Wandelère, et dans laquelle il excelle à rendre les nuances d’un
thé ou d’une porcelaine avec cette même acuité qu’il convoque pour
observer un nuage ou des fleurs. Cette vision ne se veut pas bucolique
pour autant, ce qui pourrait sembler trop convenu, mais privilégie plutôt
un art de l’incertitude propice aux « choses transitoires » chères à
Robert de Montesquiou : « Durer, ne pas durer ; s’éteindre, s’oublier,
renaître. »…
L’éphémère onirique scruté par une attitude vigilante, tel pourrait être
l’un des maîtres mots de ce recueil d’une sobriété secrète. Ces vers sont
telle une armée des songes qui sollicite le poète comme tenterait de le
faire un peintre sur sa toile ; touches discrètes, lavis discrets,
effleurements des mots à la surface des pages.
Philippe-Emmanuel Krautter
Chateaubriand : « Voyage en Italie
», Coll. Folio Classique, Editions Gallimard, 2024.

Chateaubriand a laissé des pages inoubliables nées de ses multiples
voyages, pour certains au long cours (Amérique, Jérusalem…), d’autres plus
proches tel celui effectué en Italie de 1803 à 1804. Ce sont ces
pérégrinations, toujours inspirées, que l’écrivain livre en ces pages en
des notations souvent prises sur le vif – mais aussi parfois héritées de
ses prédécesseurs… Nature, art et société se conjuguent souvent en des
réflexions alternant entre méditations philosophiques et remémorations
historiques. La solitude pointe de temps à autre dans cette campagne
romaine que l’on croirait désertée des ses habitants et où sourdent ici ou
là quelques mélancolies propres à Chateaubriand et voilant quelque peu le
soleil d’Italie. Les ruines omniprésentes, si elles savent encore parler à
l’érudit de la langue latine qu’était Chateaubriand, accentuent encore ce
sentiment de solitude et de silence oppressant. Le voyageur s’émeut à
l’approche de la Ville Éternelle : « la multitude des souvenirs,
l’abondance des sentiments vous oppressent ; votre âme est bouleversée à
l’aspect de cette Rome qui a recueilli deux fois la succession du monde,
comme héritière de Saturne et de Jacob ». Nul effroi pourtant quant à
cette sourde impression, mais plutôt un contraste saisissant entre la
grandeur passée omniprésente rapportée à sa découverte vingt siècles plus
tard. La poésie récurrente dans ces pages atténue cependant les notes
pessimistes qui, à l’image de l’Ecclésiaste, soulignent la vanité humaine
qui ressort de ces ruines… Quelques belles pages encore, moins sombres,
lorsque Chateaubriand entrant dans une petite chapelle esseulée bâtie sur
les ruines de la villa de Varus se mit à prier en silence en communion
avec un autre homme qui lui sembla si malheureux qu’il ne se hasarda à
aucune parole. Chacun de ces pas en terre italienne convoque les siècles
révolus tout autant que les années passées de l’écrivain, une longue
marche initiatique à laquelle Chateaubriand convie son lecteur entre
mélancolie et joie esthétique.
« Pierre loti – Mon mal j’enchante
– lettres d’ici et d’ailleurs (1866-1906) », éditions établie et présentée
par Alain Quella-Villéger et Bruno Vercier, Éditions La Table Ronde, 2023.

Plaisir que de voyager avec Pierre Loti (1850-1923) au travers de ces «
Lettres d’ici et d’ailleurs », sous-titre de cette belle édition établie
et présentée par Alain Quella-Villéger et Bruno Vercier. Une édition des
plus soignées réunissant un choix de lettres, pas moins de 360 allant de
1866 alors que Loti est encore jeune adolescent chez ses parents jusqu’en
1906, année à partir de laquelle ses courriers se font plus rares et
essentiellement liés aux affaires. Des lettres qui livrent - ainsi que le
soulignent les auteurs en leur introduction, un saisissant autoportrait ;
et quel plaisir, en effet, pour le lecteur que de suivre au fil des années
et voyages, d’abord Julien, puis Julien Viaud ou J. Viaud, avant que
naisse pleinement à l’écriture Pierre, et enfin Pierre Loti ou P. Loti.
Après quelques lettres de jeunesse, c’est très vite à partir de la
capitale, puis de l’école navale que commence cette vie faite de voyages,
d’écriture et de poésie… La correspondance de Pierre Loti est
indissociable de sa vie d’écrivain, et ce, de son tout premier livre «
Aziyadé » en 1879 aux « Désenchantées », son dernier ouvrage. Il faut dire
que l’exercice épistolaire était pour Pierre Loti, né au XIXe siècle, «
une habitude, un rite, une sorte de religion même », notent encore à juste
titre Alain Quella-Villéger et Bruno Vercier. L’écrivain n’hésitera
d’ailleurs pas à redemander ses lettres pour les insérer ou les intercaler
dans son journal intime (également publié à La Table Ronde). Aussi, le
lecteur retrouvera-t-il en ces lettres les proches, les amantes et amis de
l’écrivain, croisant Sarah Bernard, Élisabeth de Roumanie ou encore Émile
Zola et bien d’autres encore, partageant ses sentiments, émotions,
tristesses ou deuils…
Par cette belle édition et choix de lettres, c’est non seulement toute la
vie de l’écrivain, de Pierre Loti qui se trouve ainsi donnée à lire, mais
surtout un homme complexe qui se dévoile.
L.B.K.
Mario Rigoni Stern : « Histoire de Tönle
» ; Nouvelle traduction de l‘italien par Laura Brignon, Coll. « Totem »
n°233, Editions Gallmeister, 2023.
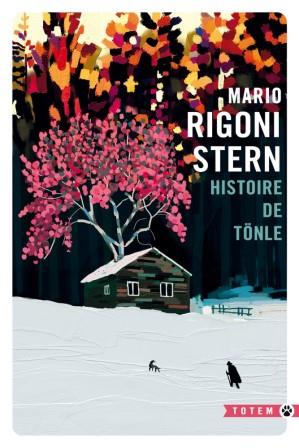
Si le nom de Mario Rigoni Stern est injustement peu connu
en France, l’Italie a depuis longtemps, en revanche, célébré cette plume
unique que salua en son temps le grand Primo Levi : « Le fait que Rigoni
Stern existe est en soi miraculeux »… D’où vient ce miracle né ? À la fois
d’une expérience de la vie et d’une sensibilité à fleur de peau qui
transparaît à chaque page de « Histoire de Tönle » dans cette nouvelle
traduction de Laura Brignon. Et c’est avec une plume affinée que
l’écrivain explore en ces pages autant les tréfonds de l’âme humaine que
les moindres aspérités du paysage montagneux de cette province de Vicence
en Vénétie, où il naquit en 1921 à Asiago, et qu’il connaît intimement.
Engagé volontaire en 1938 dans les chasseurs alpins de l’armée italienne,
Mario Rigoni Stern fera, en effet, rapidement corps avec cette montagne
dont il livrera les sentiers et secrets dans ses romans notamment dans
cette « Histoire de Tönle » qui comporte de nombreux éléments
autobiographiques. À l’image du vieux berger, l’auteur s’échappera d’un
camp de prisonniers et rentrera à pied dans son village natal par ces
temps de guerre qui bouleversent les équilibres ancestraux. Ce qui était
naguère acquis est remis en question par la folie des hommes alors que la
nature, imperturbable, perpétue cet éternel cycle des saisons dont
l’auteur livre toute la poésie.
Ce premier opus d’une trilogie du haut plateau saisit littéralement le
lecteur non seulement pour l’évocation de cette nature sublime, mais
également pour les liens puissants qu’elle suscite et fait naître entre
les hommes malgré l’adversité. Un témoignage fort et sensible, rendu avec
poésie par cette nouvelle traduction.
Philippe-Emmanuel Krautter
« Mademoiselle Julie » d’August
Strindberg ; Traduction et notes d’Alain Gnaedig ; Présentation de Ulf
Peter Halberg ; Préface d’August Strindberg ; Coll. « folio Théâtre »,
Folio, 2023.

Nous ne pouvons que recommander cette nouvelle édition dans la collection
« folio Théâtre » de la célèbre pièce « Mademoiselle Julie » du dramaturge
suédois August Strindberg (1849-1912). Outre la riche présentation signée
Ulf Peter Halberg, le lecteur appréciera également la traduction inédite
et les notes d’Alain Gnaedig pour cette œuvre écrite en 1888. Huis clos
dramatique jugé tout d’abord subversif, la pièce connaîtra un succès
croissant au XXe siècle jusqu’à aujourd’hui et donnera lieu à de belles
représentations, mais aussi à de nombreuses adaptations, ballets, cinéma ou
encore TV ; on songe, bien sûr, à Juliette Binoche dans le rôle de Julie…
Aussi, est-ce avec profit que le lecteur trouvera en fin de volume un
riche dossier concernant notamment l’« historique et (la) poétique de la
mise en scène », ainsi qu’une préface signée de la main même d’August
Strindberg exposant sa propre conception du théâtre.
Influencé par Zola, l’auteur a souhaité faire de « Mademoiselle Julie »
une « tragédie naturaliste » ; Grinçante et glauque, la pièce met, en
effet, en scène trois protagonistes dans des dialogues forts et tendus
lors de la nuit de la fête de la Saint-Jean dans un château en Suède :
Mademoiselle Julie, jeune aristocrate, fille du comte, emportée après sa
rupture de fiançailles par les chants de fête entend séduire le domestique
de son père, Jean ; ce dernier succombera-t-il, lui qui fut depuis
toujours amoureux de Mademoiselle ? Enfin, pour témoin, Kristin, la
cuisinière au cœur penchant pour Jean… Séduction, confrontations de
classes, illusions et désillusions et sa fin tragique font de cette pièce
une œuvre forte qui mérite à plus d’un titre d’être redécouverte.
L.B.K.
Sylvain Tesson : « Avec les fées »
Collection Littérature, Éditions Des Équateurs , 2024.
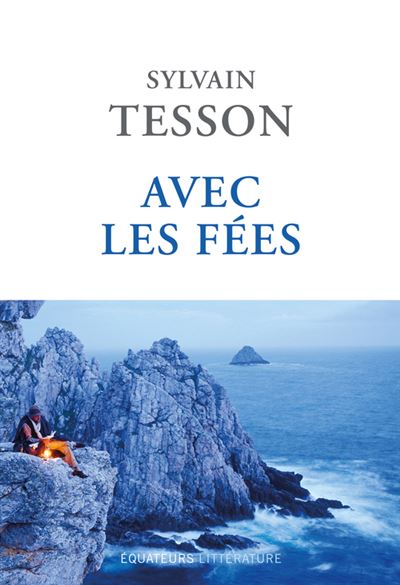
Si Sylvain Tesson confesse ne plus croire aux fées, il leur consacre
cependant ce dernier essai, sous forme de balade celtique poétique.
Paradoxe ? Esprit de contradiction ? Point du tout, mais une quête
inassouvie de ce Graal éternel, celui de la beauté et de ces nuances qui
irisent notre quotidien, quotidien que nous ne savons plus voir, ainsi que
le confiait le poète Maeterlinck cité en exergue : « C’est bien curieux
les hommes… Depuis la mort des fées, ils n’y voient plus du tout et ne
s’en doutent point. » Armé de sources classiques, celtiques et poétiques,
d’un navire et de fidèles compagnons, notre Ulysse des temps modernes part
à la recherche des fées, depuis la Galice espagnole jusqu’au sommet de
l’Écosse en un arc bandé vers ce qui n’a pas encore totalement été dévasté
par la modernité. Avec cette « qualité du réel révélée par une disposition
du regard », l’auteur embarque pour une odyssée qui tient à la fois de
l’introspection et de l’altérité, en un va-et-vient semblable à celle du
reflux marin.
C’est en cabotant de criques en falaises, à la manière des anciens Celtes,
que Sylvain Tesson part à la rencontre du surgissement du merveilleux, ces
fées témoins d’un monde encore préservé de la dévastation. Dans ces
pérégrinations qui tiennent à la fois de la confession poétique et de la
quête éternelle de liberté, l’homme retrouve la beauté et l’adversité, le
saisissement de forces qui le dépassent et simultanément cette osmose avec
les éléments, seul moyen d’échapper au naufrage. Alors que très souvent
les côtes dévastées par la « modernité » rendent impossible toute évasion
de ce genre, c’est sur le fil séparant falaises et flots qu’évolue Sylvain
Tesson en équilibriste du merveilleux…
Cet ouvrage nous emporte avec lui entre embruns marins, quelques rares
rencontres humaines et surtout cette symphonie de varech, basalte, granit
et iode qui ne cesse d’amplifier les accords au fil des pages.
Philippe-Emmanuel Krautter
Honoré de Balzac : « Honorine »
dans une édition établie par Jacques Noiray, Coll. « Folio Classique »,
Éditions Folio, 2023.

« Honorine » est une captivante et longue nouvelle écrite par Balzac en
1842 et qui sera publiée dans « La Condition humaine » en 1845. Retenant,
une nouvelle fois comme dans « La Femme abandonnée », la technique d’un
récit dans le récit, Balzac tient son lecteur en haleine… avec l’histoire
de l’étrange personnalité du Comte Octavio donnée à entendre lors d’une
belle soirée genevoise, à ses hôtes, par son ancien secrétaire, devenu
Consul de France. Il est vrai que le Comte Octavio suscite la curiosité,
lui si calme, muré dans sa droiture et rigueur légendaire telle une ramure
inviolable. Mais le lecteur apprendra grâce au récit de son ancien
secrétaire, Maurice de Hostal, qu’il a été abandonné par sa belle et jeune
épouse, partie pour un fugace amant qui l’a délaissée très vite à son
tour… Histoire presque banale, me diriez-vous, si ce n’est que le Comte,
inconsolable, prêt à tout pardonner pour qu’Honorine revienne, s’ingénie à
la suivre et à lui faciliter la vie en arrangeant et payant sous couvert
de prête-noms sa « liberté ». Jusqu’où sera-t-il prêt à aller pour qu’elle
revienne ? … ira-t-il jusqu’à envoyer auprès d’elle son secrétaire,
Maurice de Hostal, pour la convaincre de revenir ? Et quelle sera l’issue
de ce récit que nous a donné à entendre le consul durant cette douce
soirée genevoise ?
« Honorine » demeure un récit romanesque réjouissant de par la description
de la personnalité des différents protagonistes : Le Comte Octavio, sombre
et haut magistrat, intrigue et retient l’attention de son secrétaire par
la préciosité de sa droiture et son inconsolable obstination ; la Comtesse
fascine, quant à elle, par sa jeunesse, sa sensibilité et beauté, mais
aussi par son orgueilleux effacement, se croyant libre, et jusqu’à la fin,
cet infaillible honneur ; enfin, Maurice de Hostal, ce secrétaire, devenu
consul, notre narrateur, et dont on ne pouvait prévoir un tel dévouement
et fidélité.
Balzac joue avec son lecteur, brouillant les sentiments et multipliant les
angles. On y retrouve, certes, la hauteur d’âme, l’honneur, mais aussi la
passion, la possession, la rigidité des sentiments et des jugements… Et
si, comme toujours, Balzac éblouit par la finesse et la profondeur de sa
plume, « Honorine », ainsi que le souligne d’emblée Jacques Noray dans sa
préface, demeure « sans doute un des textes les plus riches, les plus
ambigus, les plus étranges, les plus inquiétants aussi de « La Comédie
humaine » (…) ». Balzac se vantera d’avoir composé cette longue nouvelle
en seulement trois jours.
L.B.K.
Pierre Bouretz : "Sur Dante",
Coll. « NRF Essais », Editions Gallimard, 2023.
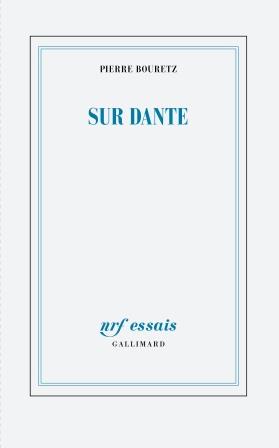
C’est à une lecture de Dante – qui n’aurait pas déplu au célèbre
compositeur Frantz Liszt ! - à laquelle nous convie le philosophe Pierre
Bouretz en un essai aussi passionnant qu’exigeant paru aux éditions
Gallimard. L’auteur nous rappelle que si le grand poète florentin
s’inscrit dans le Moyen Âge (XII°-XIII° siècles), son oeuvre et sa pensée
se projettent, quant à elles, bien au-delà préfigurant en cela déjà les
Temps modernes.
La Comédie n’est pas seulement, en effet, qu’un chef-d’œuvre poétique, ce
que l’on retient habituellement, mais bien le fruit de la pensée d’action
de son auteur prônant, à l’opposé des théologiens de son temps, « une
humanitas universalis » définie par l’unité d’un intellect qui le
rapproche de l’héritage aristotélicien, ainsi que le souligne Pierre
Bouretz. La Comédie peut être ainsi comprise comme un voyage dans
l’au-delà où serait éclairé tout ce que ses contemporains souhaitaient
découvrir à partir de cette expérience dans le pays des morts : «
Auteur impliqué dans son récit, il promettrait enfin de tout raconter de
la façon la plus exacte, établissant un régime de vérité sans exemple dans
le registre de la fiction poétique », relève encore Pierre Bouretz.
Avec cette grande œuvre, il n’est plus question de fiction ni de mythe,
mais de déployer l’éventail des passions : amour, politique, philosophie…
Cette « expérience » proposée par le grand poète italien se veut la plus
étendue possible, et pour cela Dante retient la langue vernaculaire et non
point le latin usuel à son époque parmi les élites. Grâce à des procédés
comme l’emploi de terza rima conférant une musicalité au texte propice à
sa meilleure réception, Dante élargit ainsi encore le cercle de ses
lecteurs. Mais c’est surtout quant à la manière employée pour dévoiler ces
vérités de l’au-delà que réside l’originalité de l’œuvre en ayant recours
à un poète païen en la personne de Virgile, ce qui n’était guère attendu
en son siècle chrétien…
L’essai de Pierre Bouretz montre combien Dante par la forme poétique et la
fiction cherche en fait à transposer les thèses défendues dans ses écrits
politiques et philosophiques (« Banquet », « Monarchia »). Cette pensée
résolument hostile aux abus du pouvoir de l’Église et opposée à cette
ingérence du pape Boniface VIII sur les communes toscanes ne pouvait que
susciter une réaction violente puisque Dante sera condamné à l’exil et ses
biens confisqués. Aussi le legs de Dante doit-il tout aussi bien
s’entendre sur le plan poétique avec la Comédie le classant parmi les plus
grandes œuvres du Moyen Âge, mais également sur le plan philosophique et
politique justifiant selon Pierre Bouretz que le poète soit ainsi placé «
au début d’une histoire des Lumières » pour sa clairvoyance. Un ouvrage
qui invite donc son lecteur à une lecture instructive et vivifiante de
Dante.
Philippe-Emmanuel Krautter
Julien Gracq : « La Maison », postface
de Maël Guesdon et Marie de Quatrebarbes, Coll. Domaine français, 84 p.
Editions Corti, 2023.

Un inédit de Julien Gracq demeure toujours un évènement,
surtout lorsqu’il s’agit d’un manuscrit travaillé selon la légendaire
rigueur de son auteur, en témoignent les deux versions successives en
fac-similé qui accompagnent cette publication aux éditions Corti. Celui
qui avait refusé le prix Goncourt qu’on souhaitait lui décerner en 1951
pour « le Rivage des Syrtes » a probablement rédigé ce court récit dans
les années d’après-guerre, mais celui-ci semble n’avoir trouvé place dans
les publications envisagées alors par Gracq, ainsi que le relèvent dans
leur postface à l’ouvrage Maël Guesdon et Marie de Quatrebarbes.
Les éditions Corti ont historiquement accompagné l'auteur qui avait refusé
que ses livres paraissent en format poche, aussi n’est-il pas surprenant
que ces dernières publient aujourd’hui ce court récit d’une trentaine de
pages enfoui jusqu’à présent dans les archives de l’écrivain. Un texte
court, mais qui concentre de manière serrée et diablement efficace cet art
de la contemplation unique dans lequel excellait l’auteur de « Au château
d’Argol » paru en 1938. En un récit passant progressivement d’un certain
réalisme à un univers presque onirique, Gracq transporte son lecteur en un
cheminement étrange fait d’attractions et de répulsions entremêlées. À
l’image de cette végétation retournée à l’état sauvage, le contraste
saisissant de cette maison que le narrateur pensait abandonnée surprend
tout autant qu’il intrigue. En une conjugaison d’images associant
attirance, effroi, curiosité, sensualité et émoi, « La Maison » déploie un
éventail de sensations dont le lecteur ne ressortira pas indemne, à
l’instar du narrateur…
Philippe-Emmanuel Krautter
Geneviève Haroche-Bouzinac : «
Madame de Sévigné », Coll. « Grandes Biographies », Editions Flammarion,
2023.
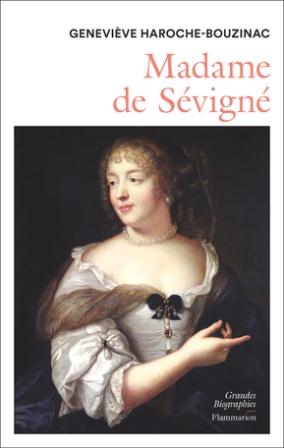
C’est une biographie fort plaisante et des plus informées consacrée à
Madame de Sévigné que signe Geneviève Haroche-Bouzinac aux éditions
Flammarion. L’auteur n’en est pas à son premier coup de maître, et a déjà
publié de nombreuses biographies notamment « La vie mouvementée
d’Henriette Campan » ou encore « Louise de Vilmorin, une vie de bohème »,
Grand Prix, entre autre, de la biographie littéraire de l’Académie
française en 2020. Professeur émérite de l’Université d’Orléans, Geneviève
Haroche-Bouzinac est directrice de la revue Epistolaire, c’est donc à une
plume aisée et avertie que s’est vue confiée Marie de Rabutin-Chantal,
marquise de Sévigné.
Et il faut le reconnaître, l’histoire de France, de la Cour et des
campagnes de ce XVIIe siècle prend dans ces jeux d’écriture et de miroirs
des siècles un relief tout particulier plein de saveurs. Il est vrai que
si la marquise de Sévigné eut, par choix après un veuvage précoce, une
existence rangée avant tout tournée vers ses enfants et plus
particulièrement sa fille, Françoise, sa vie n’en fut pas pour autant
terne ! Cette grande épistolière qui sut si bien alterner vie de Cour et
vie de château à la campagne, exerça déjà en son temps par son charme et
son style une fascination constante, multipliant les prétendants et non
des moindres, admirée par les peintres et plus encore célébrée par les
poètes, amie de madame de Lafayette, de la grande Mademoiselle, etc.
Comment une telle fascination pouvait-elle ne pas perdurer jusqu’à nos
jours enchantant par ses lettres des générations !
En compagnie de celle qui naquit le 5 février 1626 à Paris et qui
s’étreindra un 17 avril 1696 au château de Grignan, le lecteur traverse
ainsi véritablement le Grand Siècle, guerres et révoltes, mais aussi
dîners, théâtres, opéras et vie littéraire ou encore entend vanter les
vertus du chocolat ou de l’eau de Vichy…
Ce sera surtout lors du mariage et de l’éloignement de sa fille que le
rôle d’épistolière à la fois intime et publiquement célébré prendra dans
la vie de la marquise de Sévigné toute son importance. Et si ses lettres
se voulaient des divertissements, cette biographie en garde le caractère
avec ses précieuses précisions, ses digressions parfois cocasses, ses «
menus faits et anecdotes » pour reprendre un de ses sous-titres. Bref,
c’est un régal, un voyage dans le faste du Grand Siècle et cette France du
XVIIe siècle ; Mais, comment pouvait-il en être autrement en si bonne
compagnie !
L.B.K.
« La Vie de Léon Tolstoï ; Une
expérience de lecture » d’Andreï Zorine, traduit du russe par
Jean-Baptiste Godon, 250 p., Editions des Syrtes, 2023.
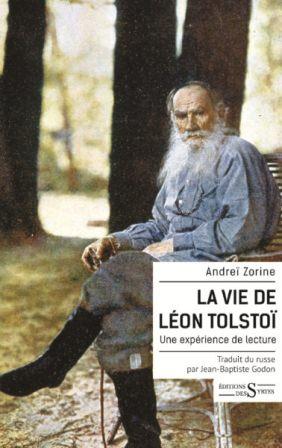
A noter cette biographie inspirée consacrée à « La vie de Léon Tolstoï »
et signée d’Andreï Zorine aux éditions des Syrtes, première biographie
depuis la fin de l’Union soviétique à être traduite en langue française –
ici, par Jean-Baptiste Godon. Un ouvrage allant à l’essentiel sans pour
autant omettre les parts sombres de cette vie faite de convictions et de
passions que fut celle de Lev Nikolaïevitch Tolstoï (1828-1910). L’auteur,
spécialiste de l’histoire de la culture russe, a fait choix à juste titre
de ne pas distinguer le « Tolstoï écrivain » du « Tolstoï homme » ou du «
Tolstoï spirituel ».
Personnalité complexe, changeante, mais aussi sensible qu’engagée et
passionnée, Tolstoï mérite en effet d’être découvert tant en sa qualité de
grand écrivain russe que l’on connaît qu’en sa qualité d’homme, de
philosophe et d’homme spirituellement engagé qu’il était aussi ; lui, qui
perçut « l’absurdité de l’existence », Tolstoï ne pouvait se résigner à
une vie rectiligne sans doutes ni questionnements ou remises en cause.
L’auteur, conscient des difficultés biographiques que revêt cette vie
tumultueuse faite d’élans, de tournants, d’introspection et de
dépressions, a su éviter bien des écueils en multipliant et croisant ses
sources, pour nombres d’entre elles peu connues, voire inédites. C’est
donc toutes les facettes, et par là même, toute la richesse de l’un des
plus grands écrivains russes, personnalité entière, que le lecteur
découvrira en ces pages : un enfant sensible, mais anxieux, un jeune homme
aristocrate ambitieux et versatile, un époux et père aimant mais
difficile, un homme plus qu’engagé aux gouffres profonds, écrivain
novateur et génial, auteur d’une œuvre protéiforme – « La Guerre et la
paix » ; « Anna Karénine » ; nouvelles, contes, etc., pédagogue plus que
de raison, philosophe et prophète controversé. Un Tolstoï qui tenta tant
de fois de s’enfuir et qui s’est « enfui », pour de bon, un jour de
novembre 1910...
C’est cette incroyable, bouillonnante et passionnante vie, « cette pensée
continuellement en mouvement » que nous donne à lire dans un style clair
et concis Andreï Zorine, un défi plus que réussi !
L.B.K.
Blaise Cendrars : « Trop c’est
trop » ; Edition présentée et annotée par Claude Leroy, Folio, Editions
Gallimard, 2022.
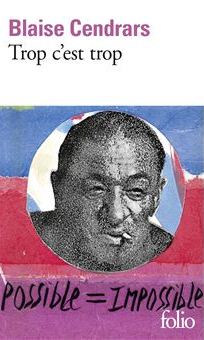
Les amateurs de Blaise Cendrars apprécieront assurément cette parution en
FOLIO de ces nouvelles réunies sous le titre « Trop c’est trop »
présentées et annotées par Claude Leroy. Pas moins de dix-sept histoires,
plus vraies que natures, articles de presse, contes, nouvelles et
portraits, un recueil publié au début de 1957 et que l’auteur lui-même
qualifiait de « presse-papier ». On y retrouve ce voyageur infatigable et
ce non moins intarissable conteur que fut Blaise Cendrars. « Au début de
1957, toute la presse s’accorde (…) pour saluer le retour du Cendrars de
l’Homme foudroyé ou de Bourlinguer, tel qu’on l’attendait, fidèle à sa
réputation d’aventurier, d’arpenteur du monde entier et de chercheur d’or.
» écrit Claude Leroy dans sa présentation au recueil.
Et c’est si vrai ! Le lecteur, en effet, s’il est curieux, se laissera
volontiers entraîner dans ces contrées de littérature, ces théâtres
notamment emplis de couleurs que sont les paysages du Brésil ou encore ces
Noëls des quatre coins du monde… Aussi curieux qu’attentif à son époque,
de Brasilia, de Rio à Paris, Blaise Cendrars joue et se joue, enjambant
frontières et espaces, tel un magicien n’ayant qu’une préoccupation celle
de captiver, de transporter et de faire voyager en sa compagnie son
lecteur. « Le voici de retour, tel que l’a façonné une légende de
poète-voyageur…» écrit encore en sa présentation Claude Leroy.
L.B.K.
Yves Bonnefoy : « Œuvres poétiques
», Édition d'Odile Bombarde, Patrick Labarthe, Daniel Lançon, Patrick Née
et Jérôme Thélot, Bibliothèque de la Pléiade, n° 667, 1808 p., Editions
Gallimard, 2023.
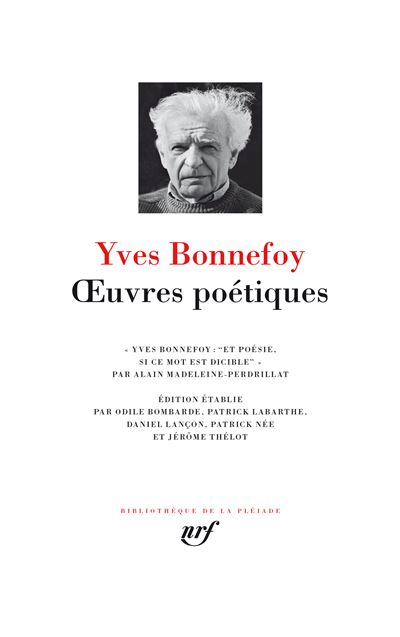
Yves Bonnefoy qui nous a quittés en 2016 (lire
l’interview accordée à notre revue) compte parmi les poètes majeurs
des XXe et XXIe siècles. Poète incontournable mais aussi traducteur
apprécié, sans oublier sa plume d’essayiste aussi exigeante qu’inspirée,
Yves Bonnefoy trouve sa pleine consécration avec la parution de ses Œuvres
poétiques dans la collection de La Pléiade aux éditions Gallimard à
laquelle il attachait une grande importance ; une édition établie par
Odile Bombarde, Patrick Labarthe, Daniel Lançon, Patrick Née et Jérôme
Théolot et à laquelle le poète collabora lui-même au seuil de sa vie.
Daniel Lançon et Patrick Née rappellent en avant-propos cette polarité
entre deux lieux qui conduisit Yves Bonnefoy à cet attrait pour
l’ailleurs, « j’ai souvent éprouvé un sentiment d’inquiétude à des
carrefours » confiait-il dans l’incipit de L’Arrière-pays. «
Cette idée d’une réalité supérieure, je la crois inhérente à tout
commencement poétique, en effet. Et plus vite et plus fortement on la
forme, et plus facilement on a chance d’en faire cette critique qui est le
sérieux de la poésie » confiait-il encore lors de notre entretien. Son
attirance pour une autre façon d’appréhender et de vivre la réalité
humaine allait désormais nourrir sa poésie en un perpétuel rêve d’essence
métaphysique tout en insistant sur le fait que « ce rêve n’est pas la
vérité, et la poésie, qui le subit de plein fouet, a pour vocation de
percer à jour cet illusoire. De reconnaître qu’est plus haute lumière ce
que Rimbaud nommait la « réalité rugueuse » ; ou ce que Baudelaire vivait
dans la misère des jours avec celle qui « essuyait son front baigné de
sueur et rafraîchissait ses lèvres parcheminées par la fièvre ».
Cette image d’« un homme au rêve habitué » en référence à Mallarmé
sied particulièrement à la personnalité d’Yves Bonnefoy selon l’essai
ciselé d’Alain Madeleine-Perdrillat en introduction. La lecture de la
chronologie du poète donnera le vertige au lecteur, défilent les années et
les centres d’intérêt multiples du poète, de l’essayiste, du traducteur,
du critique d’art et tant d’autres contributions encore au monde de la
culture et de la pensée.
Adoptant une présentation chronologique des œuvres, le présent volume de
La Pléiade fort de plus mille huit cents pages permet de suivre la
maturation du poète, même si ce choix conduisit à « éclater » certains
recueils de temporalités différentes. Le lecteur pourra ainsi découvrir en
ces pages toute la force poétique de la parole, cette unité de la poésie
comme expérience du monde chère à Yves Bonnefoy, qu’il s’agisse des
premiers recueils « Le Cœur-espace » (1945 et 1961), « Traité du pianiste
» (1946) jusqu’à ses derniers livres « Ensemble encore » et « L’Écharpe
rouge » publiés l’année de sa disparition en 2016. A leur lecture,
l’unicité et le multiple sous-tendent la poésie de Bonnefoy en de nombreux
plans intriqués :
« Et de qui aima une image,
Le regard a beau désirer,
La voix demeure brisée,
La parole est pleine de cendres. »
(« Une pierre » 1993 p. 682)
Ou encore :
« Qui désespère, qu’il entre ici, c’est plus qu’un dieu
Cet absolu qui erra dans la flamme.
Ce fut presque de l’être, ce vent qui prit
Dans la calcination d’une lumière.
Aimez ce sanctuaire, mes amis,
Où se dénouent les signes, c’est presque l’aube ».
(« Après le feu » 2016, p. 1058)
La prose, enfin, accompagnera également les découvertes dans ce précieux
volume ainsi que ses traductions qui sont considérées de nos jours comme
incontournables et dont on se délectera en compagnie de Shakespeare,
Celan, Yeats, Leopardi, mais aussi Pétrarque ou Emily Dickinson, reflets
de l’immense culture et sensibilité du poète au service des autres poètes.
En ce perpétuel travail de résurrection des mots, Yves Bonnefoy nous
invite à cette lucidité créatrice dont il fut le représentant le plus
sensible.
Philippe-Emmannuel Krautter
« Kokin waka shû - Recueil de
poèmes japonais d’hier et d’aujourd’hui » ; Introduction et traduction de
Michel Vieillard-Baron, 520 p., Éditions Belles Lettres, 2022.
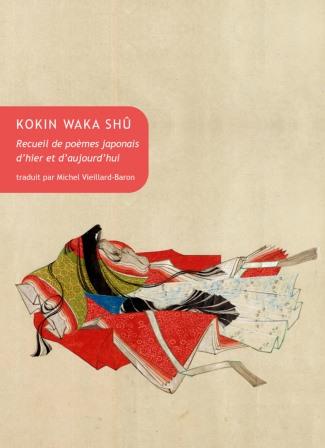
Classique parmi les classiques, le Kokin waka shû remonte aux origines de
la poésie japonaise puisque ce recueil fut commandé par l’empereur Daigo
au tout début du Xe siècle… Les éditions Les Belles Lettres et le
traducteur, Michel Vieillard-Baron, professeur à l’Inalco ont eu
l’heureuse idée de rendre disponible cette somme incontournable au lecteur
français.
Ce fort volume constitue en effet l’une des premières compilations de
poésie japonaise réalisée par quatre des plus éminents poètes de cette
époque à savoir: Ki No Tomonori, Ki no Tsurayuki, Ōshikōshi no Mitsune et
Mibu no Tadamine. Par cette décision à la fois culturelle et politique,
l’empereur souhaitait en cette période de renaissance de la poésie
nationale (waka) en souligner l’héritage classique sur laquelle elle
reposait depuis le milieu du VIIIe s. Ce ne sont pas moins de mille cent
onze poèmes qui se trouvèrent dès lors réunis dans ce recueil répondant
pour la plupart d’entre eux à la forme tanka de 31 syllabes. Fait original
à relever, parmi les cent vingt-deux poètes présents dans ce volume,
vingt-six femmes y figurent en bonne place, signe de leur importance dans
le monde lettré à cette lointaine époque.
Contrairement à ce que la forme d’anthologie pourrait laisser penser, ce
recueil répond à une certaine organisation et logique interne, abandonnant
la présentation chronologique pour lui préférer des sections thématiques
telles les saisons si chères à la sensibilité japonaise ; sensibilité
encore extrêmement présente aujourd’hui, ainsi que le relève Michel
Vieillard-Baron dans sa préface. Le lecteur remarquera également la
proximité qui réunissait poésie chinoise et japonaise, le Kokin waka shû
ayant été introduit à l’époque par deux préfaces, l’une rédigée en chinois
par Ki No Yoshimochi et l’autre en japonais par Ki no Tsurayuki.
Pour mieux apprécier la richesse et les évolutions successives de cette
poésie exigeante et néanmoins si inspirante, le lecteur lira avec profit
la très complète étude préliminaire préfaçant le recueil. Un ouvrage
indispensable non seulement à la découverte de la poésie japonaise mais
également à la pleine appréciation de la culture japonaise d’hier et
d’aujourd’hui.
Kamo no Chômei, Urabe Kenkô
Cahiers de l’ermitage, Trad. du japonais par Sauveur Candau, Charles
Grosbois et Tomiko Yoshida. Édition et préface de Zéno Bianu
Extrait de Les heures oisives suivi de Notes de ma cabane de moine
(Connaissance de l’Orient)
Collection Folio Sagesses (n° 7159), Gallimard, 2022.
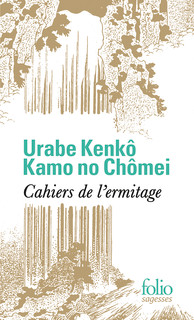
Ce petit recueil paru dans la collection Folio sagesses livre en seulement
une centaine de pages un concentré de méditation et d’ascèse bouddhique
remarquable. En réunissant en effet les deux maîtres Urabe Kenkô et Kamo
no Chômei, Zéno Bianu qui signe ici une passionnante préface, offre en
effet une belle leçon sur la voie du renoncement menée par ces deux grands
poètes ermites. Abandon des passions, mépris de la haine tout autant que
de la crainte, imaginer sa vie aussi éphémère que la forme d’un nuage dans
le ciel, telle est la précieuse leçon livrée en ces pages inspirantes. Il
ne s’agit pas d’un éloge d’une vie creuse, mais bien du plaisir éprouvé
par la richesse d’une pleine conscience de tous les instants ainsi que le
rappelle Kamo no Chômei : « Depuis que j’ai quitté le monde, et que j’ai
choisi la voie du renoncement, je me sens libre de toute haine comme de
toute crainte ». Place est alors faite à la contemplation du quotidien,
ces petits riens que les deux poètes exaltent et posent au-dessus de tous
les tracas du monde. Des instants précieux pour la plupart du temps
constitués de contemplation de la nature, de gestes du quotidien telle
l’édification pour le moins minimaliste de la fameuse cabane du moine…
Cet ascétisme que l’on retrouve dans le bouddhisme zen n’est pas non plus
sans rappeler celui prôné par le stoïcisme à maintes occasions notamment
dans ce passage où Urabe Kenkô dédaigne ces lieux avec « trop d’objets
autour de soi, trop de pinceaux sur l’écritoire, trop de bouddhas sur
l’autel domestique, trop de pierres, de plantes et d’arbres dans le
jardin… » Antidote à notre quotidien anxieux et surabondant de biens
matériels, cette lecture devrait apporter un vent d’air frais et bien
venu...
Robert Desnos : « Poèmes de
minuit, inédits 1936-1940 » ; Préface de Thierry Clermont, Coll. Poésie
Seghers, 176 p., 135 x 210 mm, Editions Seghers, 2023.
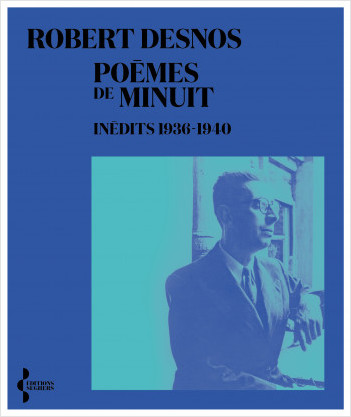
C’est par une confession de Robert Desnos (1900-1945), étonnamment lucide,
que débute la préface de Thierry Clermont aux Poèmes de Minuit
(1936-1940), des poèmes inédits du poète et publiés aux éditions Seghers.
Quelque temps seulement avant d’être arrêté par la Gestapo, puis déporté
avant de mourir du typhus un mois après la libération du camp de
concentration de Theresienstadt, Robert Desnos faisait ainsi remarquer : «
Ce que j’écris ici ou ailleurs n’intéressera sans doute dans l’avenir
que quelques curieux, espacés au long des années. Tous les vingt-cinq ou
trente ans on exhumera dans des publications confidentielles mon nom et
quelques extraits, toujours les mêmes » !
Espérons que la publication de ces inédits datés des dernières années du
poète invalideront ce jugement sévère et permettront à un plus grand
nombre de découvrir le grand poète que fut Robert Desnos. La découverte de
ces inédits inattendus mais si bien venus est due à la sagacité du
passionné des lettres Jacques Letertre qui dirige aujourd’hui la Société
des Hôtels Littéraires. Ce collectionneur et bibliophile impénitent a
acquis de manière quelque peu fortuite ces manuscrits contenant ces
trésors, pas moins de 123 poèmes autographes dont, découverte incroyable,
86 inédits, sans titres et accompagnés de dessins du poète. Desnos s’était
astreint dans ses dernières années à composer un poème chaque soir avant
son sommeil. Dans ces pages souvent sombres et pourtant enclines à
l’ironie, on trouvera aussi quelques saillies prémonitoires tel ce poème
du 9 janvier 1936 :
« Sur cette terre
Moi j’aurai bien rigolé
Pas autant cependant si je ne meurs avant »
Parmi ces traits d’humeur, ou d’humour, c’est selon, cet éternel amoureux
des calembours goûte les évocations farfelues où quelque bizarre animal
débarque soudainement dans un beau salon pour y semer une belle pagaille :
« Fait son entrée – Se vautre sur les canapés – Attise le feu –
Détraque la pendule »… « Drôle d’animal - Joli Salon », conclut
Desnos, un portrait du poète ?...
Des questionnements épars rythment ces pages où animaux, personnages
fantasques ou à peine masqués composent un panthéon éclectique dans lequel
le poète puise son inspiration et se délecte. Ce panthéon s’avère en effet
bien particulier où dérision rime avec émotion, gravité avec légèreté. Au
terme de ce trop court parcours sur terre, le poète notera en guise
d’épitaphe annonciatrice dans l’un de ses tout derniers poèmes : « Moi,
incapable de reculer – Capable de me faire tuer – Plutôt que de céder un
pouce – Pouce Pouce – Je ne joue plus »…
Une spontanéité réfléchie qui séduit et attire irrésistiblement, magie de
Desnos !
Philippe-Emmanuel Krautter
François Gibault : « Céline »,
Nouvelle édition revue et corrigée, Collection Bouquins, 2022.
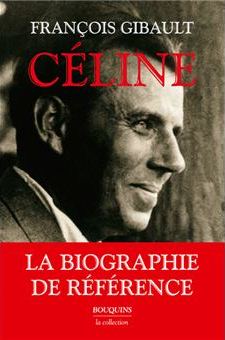
Les récents développements apportés par la redécouverte pour le moins
rocambolesque des manuscrits disparus de Louis-Ferdinand Céline ainsi que
le décès de Lucette Destouches son épouse en 2019 imposait assurément une
actualisation de la principale biographie parue à ce jour en langue
française et consacrée au célèbre écrivain. François Gibault proche de
Lucette Destouches et exécuteur testamentaire de l’écrivain était mieux
placé que quiconque pour présenter ce long parcours de Louis-Ferdinand
Destouches depuis son plus jeune âge au passage de Choisel jusqu’à ses
dernières années passées, reclus, sur les hauteurs de Meudon avec
perroquet, chiens et épouse…
C’est à un monstre sacré des lettres françaises auquel s’est attaché
Gibault dans cette nouvelle biographie revue et corrigée qui n’écarte
aucun sujet fâcheux comme les accusations de collaboration et autres
pamphlets antisémites que le biographe – avocat convaincu des causes
tendancieuses – souhaitait voir republier par les éditions Gallimard…
La documentation de première main en raison de sa proximité immédiate du
cercle de l’écrivain constitue en premier lieu l’intérêt de cette
biographie des plus complètes avec plus de 900 pages. Mais l’intérêt de ce
fort volume ne tient pas qu’à la qualité de ses sources tant le biographe
tente à faire ressortir toute la cohérence du parcours de Céline en
rapport avec son œuvre, et ce, malgré les impasses empruntées par
l’écrivain et ses contradictions. Souhaitant faire la part des choses
entre l’homme et l’écrivain, François Gibault dresse le portrait d’une
personnalité à la fois complexe et plus humaine que ne l’ont souvent
laissé les impressions rapides de ses caricatures. Resituant les outrances
de l’homme à son époque, Guibault tente d’esquisser la personnalité de
celui qui était à la fois capable de soigner les plus démunis sans
contrepartie financière tout en étant capable de verser dans les délires
antisémites les plus abjects. Céline dans ces pages apparaît avant tout
comme l’un des écrivains majeurs du XXe siècle, ses romans demeurant le
cœur névralgique de ces multiples développements biographiques auxquels
ils sont intimement entremêlés.
Philippe-Emmanuel Krautter
|
|
BEAUX
LIVRES
et CATALOGUES D'EXPOSITION
|
|
« Carnets de voyages au Maghreb et en Andalousie
– Eug.Delacroix » de Michèle Hannoosh, Editions Citadelles & Mazenod,
2025.
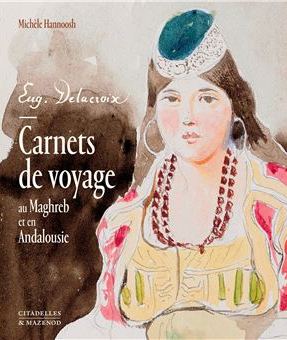
Les Carnets et albums de dessins de Delacroix ont toujours fasciné et
suscité intérêt et admiration tant de ses contemporains que des amoureux
et curieux d’aquarelles et de dessins. Aussi, ne peut-on que saluer la
publication aux éditions Citadelles & Mazenod sous l’égide de Michèle
Hannoosh (auteur à qui l’on doit déjà une édition du « Journal » commenté
de l’artiste en 2009) d’un riche ouvrage entièrement consacré au « Voyage
en Orient » que Delacroix réalisa de janvier à juin 1832 accompagnant la
mission diplomatique du comte de Mornay. Aujourd’hui, pour la présente
édition, ce ne sont pas moins de six carnets de voyage de l’artiste, au
Maghreb et en Andalousie, qui sont à la fois présentés et commentés avant
d’être reproduits dans leur intégralité.
Le lecteur pourra ainsi avec Michèle Hannoosh s’immerger et se laissé
guider, appuyé par une vaste iconographie, dans « L’Orient » de Delacroix
; cet Orient des Carnets dont seuls deux arts, celui de l’écriture et
celui du dessin, pouvaient transmettre toute la beauté et le charme si
suave. Mais, l’auteur a pris soin également de donner à son lecteur toutes
les précisions utiles pour une telle expédition enchanteresse, notamment
les circonstances politiques d’un tel voyage, avant de détailler avec un
rare bonheur, les mœurs et coutumes de cet Orient dont « La Beauté s’unit
à tout ce qu’ils font », ainsi que l’écrira Delacroix. Puis, viendra les
précisions concernant les étapes de l’expédition, Tanger avec ses hommes
assis, ses portes, ruelles et paysages… ; Mekhnès avec le sultan Moulay
Abd-er-Rahman ; l’Orient avec ses cavaliers et chevaux... Alors, et alors
seulement, telle une apothéose, le lecteur découvrira les couleurs des
aquarelles que l’artiste offrit à son compagnon de voyage, le comte de
Mornay, à son retour probablement à Toulon, et les six carnets connus de
Delacroix parvenus jusqu’à nous, fidèlement reproduits et transcrits :
Carnet de Tanger, Carnet de Mekhnès, du Louvre, de Chantilly… Six Carnets
de voyage, au Maghreb et en Andalousie, d’Eugène Delacroix, une merveille
!
« Napoléon ou l’Empire des Arts » de Jean-Michel
Leniaud, Place des Victoires Editions, 2025.

Voici un ouvrage attendu, réunissant différentes disciplines et approches
dues à la formation même de son auteur, Jean-Michel Leniaud, à la fois
juriste, historien et historien de l’art. Ce beau livre dresse une
synthèse éclairante de la politique culturelle de l’empereur au service de
son pouvoir, synthèse conjuguant rigueur et souci didactique. Le lecteur,
au fil des pages, réalisera en effet combien, à l’image de Louis XIV en
son siècle, Napoléon sut dès son accession au titre impérial affirmer un
pouvoir de plus en plus unitaire, tout en rattachant sa légitimité aux
références antiques et à l’Ancien Régime. Pour cela, et afin de ne point
rompre la ligne du temps, Napoléon 1er sut s’entourer de personnes
influentes telles Dominique Vivant Denon, sans oublier l’impératrice
Joséphine, afin d’organiser et mettre en œuvre une véritable production
artistique servant son image, ainsi qu’en témoignent les différentes
sections de cet ouvrage à l’iconographie abondante. Musées et académies
seront alors mis à contribution afin de répondre à cette « commande
publique ».
L’auteur montre combien en un temps record d’à peine 15 ans, l’ensemble
des arts fut renouvelé par les plus grands artistes au service de
l’empereur. On pense bien entendu notamment à Jacques Louis David, mais
aussi Antonio Canova ou encore Alexandre Théodore Brongniart. Jean-Michel
Leniaud nous permet ainsi d’appréhender cette vaste entreprise culturelle
en une vision d’ensemble, démêlant les liens ténus entre arts, politique
et institutions. L’ouvrage met en évidence l’action de mécénat de l’Etat
napoléonien, qui ne cessa d’instituer musées et académies, sans oublier
l’essor des Salons de peinture. Au fil des années, une véritable
esthétique impériale prendra forme, évoluant au fil du régime, une
esthétique laissant une large place à l’antique et aux évocations
guerrières. Qu’il s’agisse de la peinture, de la sculpture et de
l’architecture, ou encore du mobilier et des arts décoratifs, le court
laps de temps occupé par l’épisode napoléonien marquera l’histoire de
l’art de manière indélébile, ainsi qu’il ressort de cet ouvrage inspiré et
inspirant.
« Les Contemplations » de Victor Hugo illustrées
par les débuts de la photographie - 92 poèmes choisis des Contemplations
de Victor Hugo ; Introductions de Florence Naugrette et de Hélène Orain
Pascali ; 120 photographies réalisées entre 1826 et 1910, Editions Diane
de Selliers, 2025.
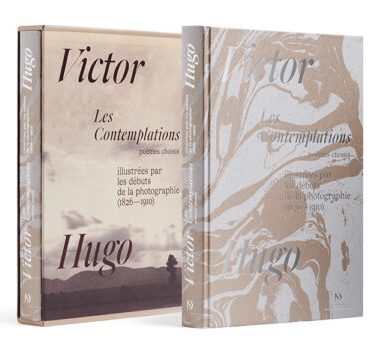
C’est sous l’angle original des débuts de la photographie que les éditions
Diane de Selliers nous proposent de relire la grande œuvre de Victor Hugo
Les Contemplations en une sélection de poèmes choisis. Par cette
parution inspirée, l’éditrice a souhaité ainsi rejoindre les vœux du grand
poète du XIXe siècle qui avait déjà formulé le désir d’accompagner
certaines de ses œuvres par cette nouvelle expression artistique encore en
ce tournant de siècle à ses balbutiements. « Nous avons même des
exemplaires des Contemplations entre les pages desquels des photographies
avaient été glissées, notamment celui ayant appartenu à Madame Hugo…»
rappelle l’éditrice.
En 2025, les souhaits de Victor Hugo se trouvent ainsi exaucés avec cette
parution d’envergure digne de l’auteur de ces 158 poèmes rédigés en exil
pour la plupart entre 1841 et 1855 et abordant les grands thèmes de la vie
et de la mort, mais aussi du sentiment amoureux, de la foi ou encore du
souvenir. Rompant quelque peu avec le lyrisme qui caractérisait son
inspiration première, Hugo, après la disparition tragique de sa fille
Léopoldine, évoque en effet des thèmes plus sombres dont les photographies
en noir et blanc, parfois floutées, viennent prolonger en des échos
particuliers ; on songe notamment aux parties VI et son épilogue.
La complexité et les tourments de l’âme du poète sont à l’image de cette
évocation de La Vague du photographe Gustave Le Gray, une épreuve à
l’albumine qui reflète les sentiments d’Hugo à Hauteville House dans l’île
de Guernesey :
Je ne vois que l’abîme, et la mer, et les cieux,
Et les nuages noirs qui vont silencieux ;
Mon toit, la nuit, frissonne, et l’ouragan le mêle
Aux souffles effrénés de l’onde et de la grêle.
« Écrit en 1855 », Jersey, janvier 1855.

Entre lyrisme et espérance, Les Contemplations regardent le siècle,
non sans des accents prophétiques, ainsi que le souligne Florence
Naugrette en son introduction. Entrecroisant évocations autobiographiques
et regard méditatif sur la nature humaine, ouvrant ainsi vers la
transcendance, Hugo scrute :
Le jour plonge au plus noir du gouffre, et va chercher
L’ombre, et la baise au front sous l’eau sombre
[et hagarde.
Tout est doux, calme, heureux, apaisé ; Dieu regarde.
« Éclaircie », Marine-Terrace, juillet 1855.

L’iconographie, loin d’occulter la beauté de la poésie d’Hugo, prolonge sa
sonorité et tisse un fil conducteur entre image et vers, au point parfois
de ne plus savoir si le vers est photographie ou bien l’inverse. Le
lecteur mesurera par ces pages combien le poète goûtait cet art naissant,
lui qui estimait que les images étaient « peintes par le soleil » au point
d’installer un atelier dans la serre de sa maison à Jersey où son fils
Charles avec son ami Auguste Vacquerie réaliseront environ 350 clichés,
témoignages uniques sur la famille en exil. Ainsi est-il possible, avec
Florence Naugrette, de concevoir Les Contemplations comme autant de
photographies immatérielles que viennent éclairer les clichés retenus pour
cette édition, renouvelant l’expérience de lecture de cette œuvre, ce qui
n’est pas le moindre de ses mérites si l’on songe que cette édition a
nécessité trois années de recherches explorant les collections tant
privées que publiques en Europe et aux États-unis, constituant ainsi une
somme inégalée sur l’histoire des débuts de la photographie.
« Japan 1900. A Portrait in Color » de Sebastian
Dobson (texte) & Sabine Arqué (photographies), couverture rigide, 25 × 34
cm, 536 pp., Editions Taschen, 2025.
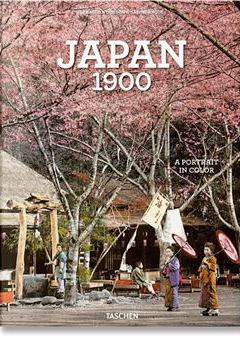
Voici un ouvrage remarquable à plus d’un titre, car il contribue à faire
revivre une période du Japon à la fois disparue et pourtant saisie sur la
pellicule au tournant du XXe siècle. Ce voyage vers l’orient extrême capte
tout d’abord le regard par ces exceptionnelles photographies japonaises
anciennes réunies par Sebastian Dobson et Sabine Arqué. Ce portrait au
sens propre du Japon s’organise autour de ses cinq grandes régions
emblématiques: Kyushu, de Kobe à Osaka, de Yokohama au Mont Fuji, Tokyo et
enfin le nord de Nikko à Hokkaido… Qu’il s’agisse de ces cérémonies du thé
saisies sur le vif, des fêtes colorées des enfants célébrées chaque année
ou encore de ces paysages montagneux vierges de toute habitation, tout
fait signe en ces pages riches de plus de 700 photographies d’époque
colorées à la main ou photochromes.
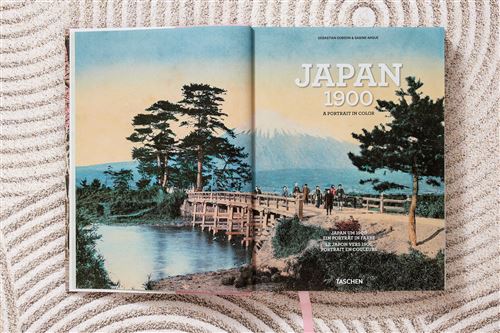
Au fil des textes éclairants signés Sebastian Dobson accompagnant cette
exceptionnelle iconographie, le lecteur prendra conscience de la
transformation du pays du Soleil Levant entamée après le tournant de l’ère
Meiji. La modernité s’introduit en effet subrepticement avec certains
véhicules motorisés et tenues occidentales, même si le contraste avec la
campagne plus préservée demeure encore important. Le grand format XL
participe à cet effet visuel impressionnant avec ces scènes prises sur le
vif d’un grand réalisme et ces témoignages émouvants d’une époque révolue.
Un voyage poétique et esthétique dans le Japon de l’aube de la modernité
qui ne pourra que séduire les passionnés de l’extrême Orient, mais aussi
tout amateur de beaux livres et photographies anciennes.
« HERBARIA Plantes, herbiers modernes et
florilèges » de Domitilla Dardi, Editions Infine, 2024.
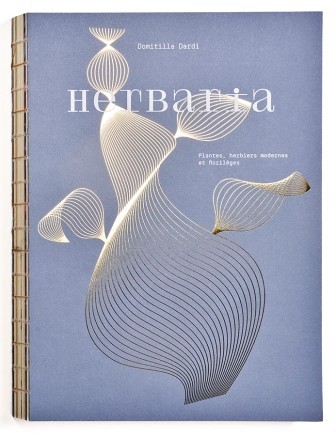
Envie d’évasion dans un monde aussi passionnant que fascinant, celui des
herbiers ? Le splendide ouvrage « Herbaria » signé Domitilla Dardi est dès
lors fait pour vous, celui-ci offrant au lecteur une longue et
enchanteresse balade au cœur même du végétal, saisi et immortalisé par les
artistes. Nul étonnement en découvrant ce livre d’art à la reliure
bodonienne, au format généreux (24 x 33 cm) et à la mise en page soignée
que l’homme ait très tôt ressenti le besoin de naturaliser ces plantes et
fleurs et d’en livrer les plus habiles variations en une quête artistique
évoquée dans ces pages.
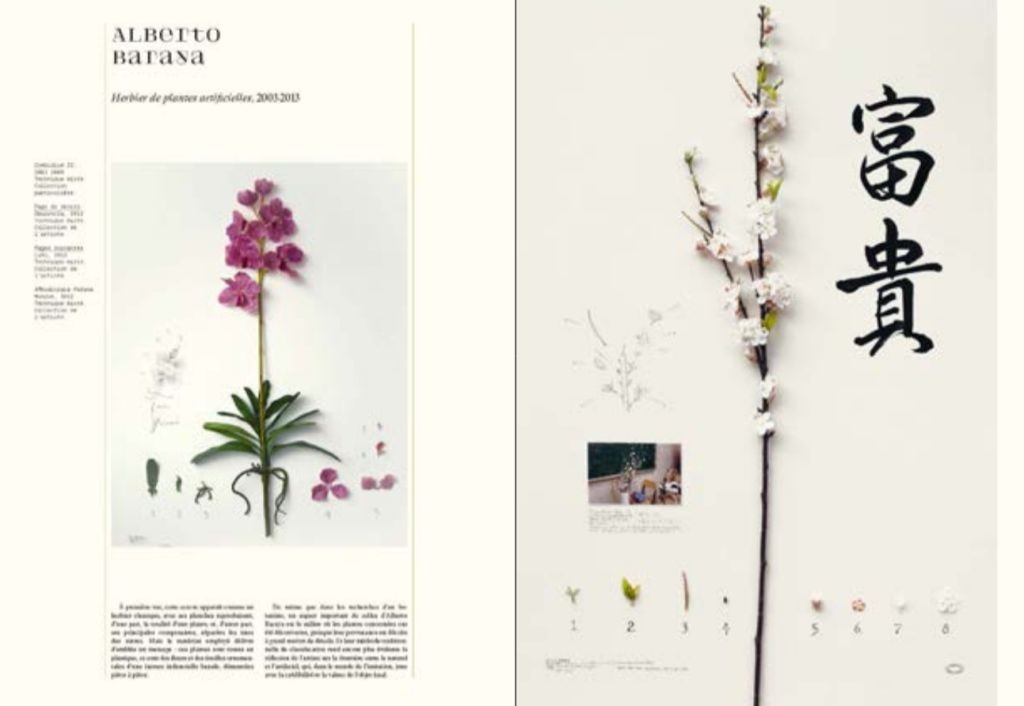
Domitilla Dardi, historienne de l’art, partage dans cette publication le
regard qu’elle porte sur cet univers singulier qui, au-delà d’une volonté
d’ordonner la diversité de la nature, ouvre sur des formes esthétiques qui
la transcendent. Cet ouvrage n’est point l’histoire des herbiers, mais
plutôt une digression artistique sur leur essence, une quête quasi
philosophique et esthétique sur notre rapport à la nature. À partir de
l’interrogation initiale : « D’où est né le désir de classer les plantes ?
», l’auteur traverse les époques et recueille, ici ou là, les bribes et
témoignages de ce rapport homme / végétal ayant donné lieu aux plus beaux
herbiers qui soient…
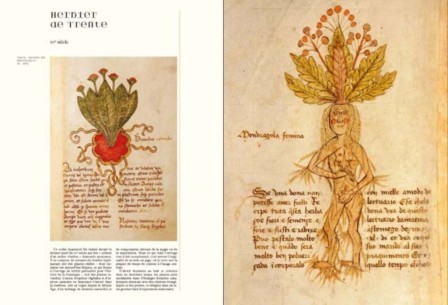
Herbiers
médiévaux distillant magie et superstition, élans scientifiques au Siècle
des Lumières pour ordonner la nature avec, notamment, Jean-Jacques
Rousseau, herbiers poétiques avec Emily Dickinson, plus que jamais le
terme florilège s’impose en ces pages. Le lecteur découvrira également le
foisonnement de l’herbier de Trente au XVe siècle mêlant plantes réelles
et nées de l’imagination, tout autant que la fascination japonaise pour la
nature révélée dans cette Encyclopédie de l’agriculture japonaise datant
de la fin du XVIIIe siècle.
L’art sublimant le végétal inspire une diversité étonnante d’artistes tels
William Morris au XIXe s. ou, plus proche de nous, Patricia Urquiola en
2021 avec « Hybrida » aux surprenantes fusions… Ce superbe ouvrage
emportera à n’en pas douter son lecteur dans l’un des plus fascinants
voyages, celui des plantes et herbiers revisités par l’art.
« BRONZES ROYAUX D’ANGKOR Un art du divin
», Catalogue d’exposition, collectif, Reliure Cartonnée contrecollée, ill.
274, 22 x 28,5 cm, 304 p., In Fine Editions, 2025.

Pour accompagner l’exposition actuellement au Musée Guimet de Paris,
exposition aussi essentielle quant à la thématique des bronzes khmers
d’Angkor, il fallait un catalogue d’envergure, ce qu’ont réalisé avec brio
les éditions In Fine et les auteurs de cette remarquable publication. Se
focalisant sur une problématique souvent négligée, parce que longtemps
ignorée, cette publication fait, en effet, la démonstration de la place
importante tenue par les bronzes et autres objets de culte fondus en
métaux précieux dans la civilisation de l’Empire khmer. Nous avons tous à
l’esprit les monumentales constructions enchâssées, et menacées, par la
végétation luxuriante de la forêt cambodgienne, mais qui connaît
véritablement la place et l’importance tenues par cet art du divin que
sont les bronzes royaux d’Angkor en dehors de quelques spécialistes ?
Cette publication fait la brillante démonstration, parallèlement à
l’exposition en la complétant idéalement, que le bronze est à l’origine au
Cambodge du développement d’un art de la statuaire à part entière
influencé essentiellement par l’hindouisme et le bouddhisme prédominants.
L’ouvrage s’attache ainsi à montrer comment cette activité s’est
rapidement spécialisée en tant que technique sacrée limitée à une petite
élite d’artisans dans les ateliers royaux. La publication souligne
également combien nos connaissances sur ce sujet resté longtemps
confidentiel ont fait l’objet d’avancées spectaculaires avec les fouilles
récentes rappelées en ces pages abondamment illustrées à travers 200
œuvres remarquables.
Le point d’orgue est bien entendu constitué par l’impressionnant Vishnou
couché du Mebon occidental, trésor national du Cambodge et plus grand
bronze jamais retrouvé à Angkor. Qu’il s’agisse des prémices de l’âge du
bronze à l’époque préangkorienne jusqu’à la description détaillée de la
fonderie royale d’Angkor, techniques et arts se conjuguent au service du
pouvoir afin d’en souligner la magnificence telle qu’il ressort de ces
somptueux chefs-d’œuvre de la statuaire de bronze dans l’art khmer.
« Nicolas-Guy Brenet 1728-1792 »
de Marie Fournier, Editions Arthena, 2023.

Voici un peintre injustement méconnu et pourtant emblématique de la
transition entre la fin de règne de Louis XV et la Révolution de 1789.
Cette période, bien que troublée sur un plan social et économique, fut
néanmoins l’occasion pour certains artistes de développer un style
néoclassique, souvent sous-estimé, malgré le rayonnement du peintre
Jacques-Louis David. Marie Fournier dans cette brillante monographie
établie à partir de sa thèse remarquée a décidé de sortir de l’ombre
Nicolas-Guy Brenet ; un peintre dont l’œuvre se dévoile par le truchement
de la peinture d’Histoire dans le style de l’Académie royale de peinture
et de sculpture qui contribua à former ce jeune artiste issu d’un milieu
modeste de graveurs. Ses prestigieux maîtres, Charles Antoine Coypel,
François Boucher et Carle Vanloo, contribueront à lui transmettre une
technique picturale irréprochable. Cette composition formelle rigoureuse
ouvre parfois même à certaines introspections étonnantes comme sur cette
solennelle toile « Honneurs rendus au connétable Du Guesclin » où un jeune
page laisse percevoir un touchant désarroi accentué par son habit
éclatant…
Brenet sera également un professeur éminent ainsi qu’un théoricien de
l’art apprécié. Le grand Diderot ne s’était pas trompé lorsqu’il avait dit
du peintre : « J’aime Brenet et je vous demande grâce pour lui ; il la
méritera peut-être un jour ». Et même si sa gloire ne rayonna pas autant
qu’il l’aurait mérité, le présent ouvrage démontre de très belle manière
que cet oubli peut être rattrapé. Il suffira pour cela de dépasser nos
réticences encore présentes à l’égard de la peinture historique, souvent
considérée comme trop figée et convenue, pour entrer dans l’œuvre de
Brener ainsi que nous y invite Marie Fournier. Le lecteur y découvrira une
profondeur certaine, qui s’exprime, certes, dans les conventions du style
classique, mais laisse également poindre, à travers quelques interstices
annonciateurs, le romantisme à venir. Certains regards dont la force
imprime non seulement le respect, mais également le doute, certaines
charges dramatiques où l’inquiétude se dispute à la foi comme pour ce
superbe « martyre de saint Denis et ses compagnons » (Basilique
Saint-Denys d’Argenteuil) attestent de la valeur du peintre. La puissance
évocatrice des grands mythes laisse également place à de charmantes
conversations entre Vénus et Amour.
Les éditions Arthena proposent avec cette monographie remarquable de
redécouvrir un peintre injustement méconnu et dont les illustrations de
qualité ainsi que les analyses de l’auteur achèveront de convaincre de
l’intérêt de redécouvrir Nicolas-Guy Brenet.
« Ikebana – L’art floral au Japon » de
Frédéric Girard, Editions Citadelles & Mazenod, 2024.

L’art de l’Ikebana directement venu du Japon a su ces dernières décennies
séduire l’occident au même titre que celui du bonsaï ou des arts martiaux
au point que, parfois, son essence et sa raison d’être a pu quelque peu se
diluer… C’est tout le mérite de ce beau livre de Frédéric Girard, grand
spécialiste du Japon, que de nous rappeler les origines de la doctrine de
l’ikebana qui trouve sa source dans le bouddhisme qu’il sublime.
98 planches d’arrangements floraux de style rikka datant du XVIIe siècle
et conservées à la New York Public Library servent d’illustration à cette
belle étude qui convie le lecteur à mieux connaître cette philosophie de
l’être où chaque composition répond à des équilibres précis. La citation
de Takada Anryubo Shugyoku placée en exergue de l’ouvrage résume bien
toute la complexité de l’art de l’ikebana : « S’emparer des mérites du
Ciel et, de la Terre dans ses mains et, dans son esprit, distinguer la
totalité des plantes et des arbres… Qui ne reçoit pas la tradition héritée
des maîtres, comment pourra-t-il connaître le principe selon lequel on
apprécie en l’affectionnant, une plante ou un arbre ? ».

Tout fait fleur dans la société japonaise, il suffira pour s’en convaincre
de se rendre au Pays du Soleil Levant au printemps à l’époque de la
floraison des cerisiers. Véritable engouement collectif, l’ikebana
participe de ce rapport étroit entre la pensée japonaise et le végétal,
végétal qui, il y a encore un siècle, était omniprésent dans le quotidien
de ses habitants. À l’heure où l’urbanisation s’est emparée plus que de
raison de l’île où 80% du territoire est occupé par des montagnes, la
place et le rôle de ces compositions florales sont plus que cruciales. La
pratique n’est cependant pas récente et puise ses racines entre le XIVe s.
et XVIIe s. À l’origine exclusivement le fait d’une aristocratie élitiste,
l’art de la composition florale s’étendra à la bourgeoise montante pour
finalement se généraliser au grand public.
Ainsi hier et aujourd’hui encore, assembler au Japon quelques branches et
fleurs dans un vase ne se réduit pas qu’à un seul souci esthétique, mais
constitue bien un art en tant que tel sur un fond bouddhique venant du Zen
ainsi que le rappelle l’auteur.
Le lecteur découvrira toute cette évolution avec ses règles rigoureuses et
ses différents styles institués en école, ce dont témoignent de manière
somptueuse les planches reproduites en première partie de l’ouvrage.
"Châteaux, villas et folies –
Villégiature en Île-de-France" de Marianne Métais et Roselyne Bussière ;
Photographies de Laurent Kruszyk, Stéphane Asseline et Philippe Ayrault ;
Lieux Dits Editions, 2024.

L’Île-de-France regorge de trésors, fruit de l’histoire ancienne de la
région et de sa richesse, qui, dès l’Antiquité, a su attirer les plus
belles villégiatures. L’ouvrage proposé aujourd’hui par les Éditions Lieux
Dits vient confirmer à merveille cet héritage foisonnant en dévoilant des
trésors souvent méconnus dans ces pages enchanteresses.
Les abords de la capitale furent, très tôt, prisés pour échapper à une
ville de plus en plus densément peuplée et générant des désagréments que
nous connaissons plus encore de nos jours… Verdure, air pur et
tranquillité devinrent alors des refuges privilégiés recherchés par
l’élite royale, l’aristocratique, puis la bourgeoise. De superbes «
Châteaux, villas et folies », ainsi que le souligne le titre même, virent
ainsi le jour, fruits de ces désirs d’évasion que cet ouvrage richement
illustré met en lumière.

La diversité et l’originalité des choix architecturaux s’invitent pour
séduire le lecteur. Il suffit, pour s’en convaincre, d’admirer le château
de Champs-sur-Marne ou celui d’Asnières-sur-Seine, véritables témoins du
goût français transmis à travers les siècles. La singularité s’invite
également avec des surprises inattendues : chalets pittoresques ou encore
la maison d’Émile Zola à Medan, qualifiée par l’écrivain lui-même de «
cabane à lapins ».
Les sites naturels rivalisent souvent de beauté avec ces édifices,
instaurant une véritable culture de la villégiature qui contribuera à
l’aura unique de ces résidences d’exception.
« France 1900 » de Marc Walter et
Sabine Arqué ; Version trilingue, français/anglais/allemand, 636 p., ill.
couleur, Editions Taschen, 2024.

C’est à une fabuleuse et bien douce escapade à laquelle nous invitent les
éditions Taschen avec cet ouvrage « France 1900 » sous la direction de
Marc Walter et Sabine Arqué. Dans son grand format XL, l’ouvrage livre, en
effet, au regard dès les premières pages la France de « La Belle Époque »,
cette France d’avant la Première Guerre mondiale et offrant au monde
entier le visage de la paix et de la prospérité. Par le filtre des
couleurs de photochromes, des affiches ou encore des cartes postales
recolorisées, le lecteur s’évade dans le bleu azur de la Côte d’Azur ou
dans les décors exotiques de l’Exposition universelle, sans oublier, bien
sûr, l’incontournable Dame de fer encore toute jeune en ces années et qui
allait devenir avec 330 mètres de hauteur l’emblème que l’on sait de la
capitale...

Région par région, Normandie, mais aussi la côte Atlantique ou encore la
Champagne, ce voyage dans cet espace- temps de la France enchante…
Anciennes affiches des Chemins de fer ou réclames pour de prisées stations
balnéaires, Trouville ou Biarritz, le voyageur est grisé… C’est toute
l’atmosphère de douceur et de joie, mais aussi d’espoir et de progrès de
la France et de son art de vivre au tournant du début du XXe siècle –
vacances, stations balnéaires et loisirs, art, gastronomie… - que le
lecteur ébloui ou nostalgique parcourt au fils de ces 636 pages et 800
illustrations. Véritable portrait tout en couleur d’une France
inoubliable, celle de 1900, il y a déjà certes plus d’un siècle, mais
encore si présente…
Un ouvrage XL aussi extraordinaire que son thème, celui de la « France
1900 ».
« Bonnard » d’Isabelle Kahn,
Citadelles & Mazenod, 2024.

L’historienne de l’art Isabelle Kahn avec cette monographie
consacrée au peintre Pierre Bonnard est parvenue à circonscrire l’art d’un
peintre souvent jugé comme paradoxal et insaisissable eu égard à l’extrême
subjectivité de son art. En retenant l’œuvre radieuse de « L’Atelier au
mimosa » pour la jaquette et le coffret de ce somptueux ouvrage paru aux
éditions Citadelles & Mazenod dans la collection Les Phares, l’auteur nous
introduit immédiatement dans le mystère de la lumière que l’artiste sut si
harmonieusement saisir par le truchement des couleurs de sa palette. La
spécialiste des Nabis et du postimpressionnisme souligne en effet dès son
introduction le caractère énigmatique du peintre, aussi discret que
célèbre de son vivant, âme réservée à l’abri des objectifs qui étaient
braquaient pourtant vers lui. C’est vers d’autres lumières que se tourna
Bonnard si inspiré par la peinture de Claude Monet.
Son rapport particulier au temps, ces césures initiatrices de nouvelles
révélations des beautés du monde, la fragilité des êtres et une
sensibilité exacerbée vont concourir à cet éventail de couleurs propres
aux lieux qu’il parcourra comme au temps qu’il décomposa. Ainsi que le
relève Isabelle Kahn : « Il choisit une troisième voie, celle de
l’abstraction décorative qui le conduit aux frontières de l’informel ». Ce
sont ces sensations que notera l’artiste toute sa vie en observateur
attentif de la réalité par le filtre de sa subjectivité. L’ouvrage débute
ainsi par la fameuse période des Nabis, essentielle à la naissance de
l’artiste qui sera surnommé le Nabi « très japonard » en référence à son
goût pour les estampes japonaises, suivant en cela l’exemple de Monet et
de Manet (cf « Paysage stylisé » musée d’Orsay, v. 1890). Puis viendront
d’autres expériences, celle de la lumière de Normandie, puis le triomphe
de la couleur avec la découverte du Sud de la France, ses premiers
paysages de Saint-Tropez, Grasse… qui le conduiront à ses « visions
arcadiennes » renouvelant l’héritage de Poussin.
Enfin, il n’était pas possible de retracer l’œuvre de Bonnard sans évoquer
sa passion pour le corps des femmes avec ces innombrables variations
d’études et de peintures représentant son épouse Marthe, une autre part
lumineuse de son œuvre mais qui se teintera progressivement de couleurs
plus froides laissant présager de plus sombres inspirations…
« Le Réalisme » de Bertrand
Tillier, Editions Citadelles & Mazenod, 2024.

S’il y avait bien un courant artistique qui manquait cruellement d’étude
de fond récente, c’est assurément le mouvement réaliste, demeuré souvent
parent pauvre dans l’histoire de la peinture. C’est aujourd’hui un manque
enfin comblé avec cette remarquable étude signée Bertrand Tillier,
historien d’art et professeur d’histoire contemporaine à l’université
Paris 1 Sorbonne-Panthéon, et publiée aux éditions Citadelles et Mazenod.
En huit grands thèmes majeurs, cette splendide parution tant par sa vaste
et incomparable iconographie que par la richesse de son analyse donne, en
effet, à voir et surtout à appréhender l’ensemble du « réalisme en son
histoire ». Comme souvent, et ainsi que le souligne d’emblée l’auteur en
son introduction, le « Réalisme » au titre de courant artistique puise ses
racines dans la critique d’art et la réception houleuse de la peinture de
Courbet, considéré de nos jours comme le père fondateur de ce mouvement
qui devait s’imposer au XIXe siècle. Que recouvre, cependant, ce terme
même de « Réalisme » ? Plus qu’une stricte définition, l’auteur insiste
sur « Les conditions du réalisme » entre le goût de la réalité, la
reproduction du réel et la quête de vérité. C’est dans la Révolution de
1848 que ce mouvement trouve un terreau plus que favorable, y puisant ses
« aspirations modernes » et « s’appuyant sur la vie ». Courbet et Millet
notamment furent alors « saisis par le spectacle de la vie contemporaine,
par sa rudesse pittoresque ou par sa bonhomie, par sa nouveauté, par les
grandeurs et les servitudes de la Plèbe » souligne Bertrand Tillier citant
Focillon.

À ces peintres incontournables peuvent être encore ajoutés
Géricault, Le Nain, La Tour… Présent dans bien des domaines que ce soit en
littérature, en sculpture ou encore en sociologie, le réalisme doit être
conjugué au pluriel. Mais, pour autant, il ne semble pas pouvoir être
délimité comme étant le successeur du romantisme préludant le naturalisme,
ainsi qu’en témoigne la subtile transition entre le réalisme et le
naturalisme de Zola, thème que développe l’ouvrage dans son chapitre
consacré « Aux mondes sociaux : du réalisme au nationalisme ». De même, le
réalisme ne saurait être délimité à la France du XIXe siècle, ce dernier
ayant su non seulement s’internationaliser avec nombre d’artistes dont
Adolph von Menzel ou Wilhelm Leibl pour l’Allemagne ou encore W.Homer (
qui illustre notamment une des faces du coffret) pour les États-Unis, mais
ayant su également largement déborder sur le XXe siècle. L’ouvrage se
referme ainsi sur cette toile d’André Fougeron « Retour du marché » de
1955 ou encore cette toile représentant « Louis Aragon et Elsa Triolet »
de Boris Taslitzky également de 1955.
C’est cette belle complexité et mise ne perspective que nous propose
justement de découvrir par cette captivante publication Bertrand Tillier.
« Marco Polo, Le Livre des
merveilles » ; Sous la direction de Marie-Thérèse Grousset, Marie Hélène
Tesnière et Jean Richard ; Cartonné, 24.5 x 32 cm, 240 p., 150 ill.,
Éditions In Fine, 2024.
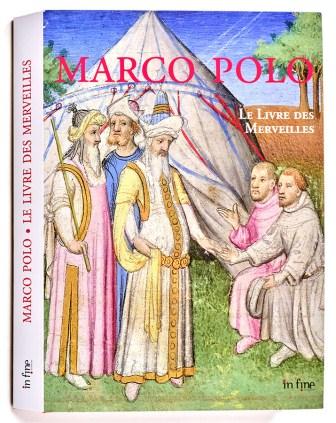
« Marco Polo, Le Livre des merveilles », un titre loin d’être usurpé car
c’est sans conteste un ouvrage aussi magnifique que passionnant qui vient
de paraître aux éditions In Fine à l’occasion du 700e anniversaire de la
mort du célèbre voyageur vénitien (1254-1324). Le lecteur y découvrira,
ainsi que l’annonce son titre, un des ouvrages enluminés les plus
merveilleux et célèbres du Moyen-Âge : Ce fabuleux livre (inséré dans le «
Livre des merveilles ») écrit et enluminé au XIIIe siècle et qui conte les
extraordinaires voyages et surtout découvertes de Marco Polo en Orient.
L’auteur, Rustichello da Pisa, compagnon de captivité du célèbre
explorateur, fut fait prisonnier par les Génois à la toute fin du XIIIe
siècle. Il est vrai que la vie du célèbre marchand et diplomate vénitien,
haute en couleur puisqu’il fut le premier à ouvrir la voie vers l’Asie
dans le dernier quart du XIIIe et première moitié du XIVe siècle, se prête
particulièrement bien tant au récit qu’à son illustration.
C’est la transcription intégrale de ce manuscrit avec ses enluminures
extrait du « Livre des Merveilles » dont l’original est conservé
actuellement à la BNF de Paris (Ms.fr.2810) que le lecteur pourra,
émerveillé, découvrir en ces pages dans une traduction de Marie-Hélène
Tesnière, conservateur général au département des Manuscrits de la
Bibliothèque nationale de France ; un récit captivant digne des plus
grandes épopées – mais pouvait-il en être autrement !, présenté, ici, par
Marie-Thérese Gousset, chargée de recherche au service des manuscrits
médiévaux du Département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de
France.
L’ouvrage publié aujourd’hui aux éditions In Fine offre également une
description des 84 scènes enluminées réalisées par le non moins célèbre
maître Boucicaut et son atelier, suivi d’un instructif essai de Jean
Richard, historien et archiviste paléologue, Professeur à l’Université de
Dijon. C’est donc un beau voyage que nous proposent avec cet ouvrage les
éditions In Fine car, ainsi que le souligne Jean Richard : « Marco Polo,
toutefois, ne propose pas seulement d’émerveiller ses lecteurs – ou
auditeurs – en les éblouissant par l’énumération de tout ce qui peut
paraître étonnant. Il veut aussi leur faire connaître la réalité du monde
qu’il a lui-même découvert. D’où le titre qu’il a donné à son livre : « le
Devisement du monde ».
Une belle initiative de publication qui enchantera bien des lecteurs et
qui ne peut qu’être saluée.
« Miró, un brasier de signes » ;
Catalogue officiel de l’exposition éponyme au musée de Grenoble en
partenariat avec le Centre Pompidou sous la direction de Sophie Bernard et
Aurélie Verdier, Éditions In Fine, 2024.

À retenir le riche catalogue officiel accompagnant l’exposition consacrée
à Joan Miró (1893-1983) au musée de Grenoble en partenariat avec le Centre
Pompidou. Intitulé à juste titre « Un brasier de signes », reprenant ainsi
l’expression de son biographe le poète Jacques Dupin, l’ouvrage sous la
direction des deux commissaires Sophie Bernard et Aurélie Verdier livre
tant au regard qu’à la lecture une très belle mise en perspective de
l’œuvre de l’artiste catalan. Jean-Christophe Bailly revient dès les
premières pages dans sa contribution sur cette origine : « Brève excursion
au Pays de Miro », avant qu’Aurélie Verdier ne s’attache, pour sa part, à
l’enfance de l’artiste et les premières années de son parcours artistique
entre Barcelone, Montroig et Paris.
Le lecteur découvrira, ainsi, au fil des chapitres et pages
l’extraordinaire liberté créatrice de l’artiste. C’est dans le milieu des
années 1920 que Joan Miró trouvera au contact des surréalistes notamment
Robert Desnos et Michel Leiris avec ses « Peintures de rêve » la
reconnaissance artistique et développera toute sa poétique avant le
tournant décisif de 1956 avec son installation à Palma de Majorque ;
Sophie Bernard retient notamment pour sa contribution cet angle original
et fécond du « Langage d’Éros – Surréalisme, inconscient, élan vital et
féminin dans l’œuvre de Miró », alors que Juan José Lahuerta offre, quant
à lui, un beau focus sur « « Anti-peinture et « danseuses espagnoles » de
Joan Miró ».
À partir de 1960, enfin installé dans son atelier de Majorque, Miró
renouvelle alors son langage plastique et poétique ; c’est dans ces années
1960-1961 que seront peints les trois grands « Bleu » I, II et III. Habité
d’une grande puissance intérieure créatrice, il n’aura alors de cesse de
créer, peindre, mais aussi sculpter, appréhendant la céramique, la résine
ou encore les vitraux, etc., avec cette extraordinaire énergie tellurique
ou cosmique, une énergie comme puisée de l’île… et qu’il le mènera à
enchaîner jusqu’à sa disparition à Palma de Majorque en 1983 les
expositions tant nationales qu’internationales.
L’ouvrage donne, enfin, à voir en seconde partie l’ensemble des œuvres de
Joan Miró provenant de la collection du Centre Pompidou, offrant ainsi au
regard et à l’analyse les grandes périodes et l’évolution créatrice de
l’artiste. Un catalogue aussi riche qu’incontournable.
« L’art des icônes » de Tania
Velmans, Citadelles & Mazenod éditions, 2023.

Un ouvrage incontournable signé de la spécialiste internationale de l’art
byzantin, Tania Velmans, vient de paraître aux éditions Citadelles &
Mazenod. Ce sera l’occasion de comprendre combien le mot icône se laisse
plus difficilement appréhender qu’il n’y paraît de prime abord. Son
orthographe, en premier, marque sa singularité par rapport à la peinture.
Ce substantif féminin peut revêtir un accent circonflexe lorsqu’il est
écrit par les académiciens, mais le perd aussi vite chez de nombreux
auteurs qui n’hésitent pas à l’omettre suivant en cela la réforme de
l’orthographe ! L’étymologie nous apprend, en revanche, sans équivoque que
le mot vient du grec eikôn qui renvoie à l’idée d’image, de statue ou de
portrait. L’icône est ainsi une représentation religieuse sous forme
picturale déposée sur un panneau de bois (ce qui la distingue des fresques
également peintes), représentation qui acquière alors une valeur
symbolique et sacrée.
Mais l’auteur dans cette somme didactique remarquable souligne dès les
débuts de son propos combien il est nécessaire d’entrer dans la
compréhension de cet art bien particulier au risque de perdre des pans
entiers de sa signification. Si au 1er siècle de notre ère, et
probablement à l’époque même de Jésus, des icônes auraient commencé à
circuler représentant le Christ et par la suite la Vierge, ces images ne
nous sont malheureusement pas parvenues, non seulement en raison de la
fragilité même de leur support, mais surtout en raison de l’iconoclasme.
Ainsi que le rappelle Tania Velmans dans un chapitre consacré à cette
question, cette doctrine s’opposera farouchement au culte des icônes aux
VIII° et IX° siècles et conduira à la destruction d’un très grand nombre
de peintures sacrées.

Ces pratiques iconophobes démontrent ainsi que cette
création laisse rarement indifférent. Ferveur pieuse devant laquelle le
croyant se signe, porte même parfois des gants pour la toucher, l’icône
est beaucoup plus qu’une représentation religieuse, attitude vénérée dans
la tradition orthodoxe, plus éloignée de la sensibilité catholique et
protestante.
L’auteur explore ainsi la sacralisation progressive de cette image mobile
byzantine tout en rappelant ses fonctions. Les plus anciennes icônes
parvenues jusqu’à nous remontent au VI° siècle, c'est-à-dire au Bas-Empire
et correspond à la fin de l’Empire romain. Les références littéraires que
l’on peut retrouver avant cette date semblent plus concerner des icônes «
descriptives » que réellement sacrées. C’est donc à partir du VI° siècle
que l’art de l’icône prend son essor avec un culte de plus en plus marqué.
Elles ne sont plus des objets de mémoire mais de véritables entités de
dévotion à part entière. Elles pourront même être miraculeuses dans
certains cas, notamment celles qui sont estimées comme n’étant pas faites
de la main de l’homme (acheiropoiètos). Le christ pantocrator
(tout puissant) ou encore la Vierge Hodigitria (qui montre le chemin)
entreront dans les canons les plus anciens de l’art de l’icône. Après la
période macédonienne caractérisée par des canons artistiques très stricts,
le XI° siècle va en effet glisser vers un style plus austère, chargé
d’accentuer l’aspect spirituel des représentations peintes. Le XII° siècle
infléchira cette évolution avec des représentations plus chaleureuses
telle la très belle Vierge Eléousa peinte à Constantinople, si célèbre par
les nombreuses reproductions qui en seront faites et qui évoque une mère
pleine de tendresse à l’égard de son petit enfant lové entre ses bras. La
solennité de la représentation s’efface en effet pour ouvrir à une
dimension de miséricorde particulièrement émouvante. Le styles des
Comnènes analysé par l’auteur souligne combien l’art des icônes en ce XIIe
s. connaît un style délicat et une force d’expression encore jamais
réalisés ainsi qu’il ressort de l’icône « Le Miracle de Chonae »
appartenant au monastère Sainte-Catherine du Mont Sinaï.
Au terme de cette somme remarquable, le dernier chapitre retrace le
rayonnement de l’icône non seulement dans l’espace mais aussi selon les
siècles, témoignant ainsi de l’importance de cet art trop souvent méconnu.
« Poésies d’Emily Dickinson –
Illustrées par la peinture moderniste américaine » ; Edition bilingue
anglais/français ; Traduction et notes de Françoise Delphy ; Préface de
Lou Doillon ; Direction scientifique de l’iconographie et introduction
d’Anna Hiddleston ; Relié sous coffret illustré, 412 pages, 24.5 x 33 cm,
Editions Diane de Selliers, 2023.
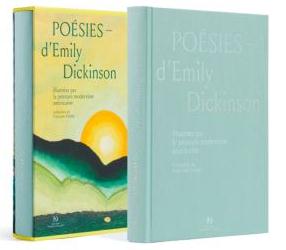
Quel plus grand plaisir que de retrouver la poésie d’Emily Dickinson dans
cette magnifique édition illustrée par les plus grands artistes de la
peinture moderniste américaine de la première moitié du XXe siècle. Quels
artistes pouvaient, en effet, mieux dialoguer avec l’une des plus grandes
poétesses américaines du XIXe siècle ? À cette poésie empreinte à la fois
de légèreté et de profondeur, d’audace et de mélancolie, d’irrévérence et
d’éternité, c’est effectivement avec la même musique, rythmes, mais aussi
silences que viennent répondre ces immenses paysages, l’éternité de ces
ciels et larges horizons dans ce bouleversement des couleurs… Des œuvres
signées, ici, par plus de 60 artistes américains dont Edward Hopper,
Charles Burchfield, Georgia O’Keeffe ou encore Charles Burchfield dont
l’aquarelle « Butterfly Festival » aux milles papillons multicolores
offrent un écrin de choix pour le coffret de cette édition d’exception : «
Au nom de l’Abeille – / Et du Papillon – / Et de la Brise – Amen ! ».

Rockwell Kent, « Azopardo River », 1922,
huile sur toile, 86,7 × 111,8 cm The Phillips Collection,
Washington
Une poésie de lumière et d’ombre, ainsi que le souligne dans son
avant-propos l’éditrice Diane de Selliers : « L’aube, le crépuscule, la
vie et la naissance, les saisons, les vagues de l’âme, la mort,
l’aspiration à l’éternité. » Le lecteur retrouvera, en effet, dans ce
dialogue œuvre / Poésie toute l’irrévérencieuse sensibilité et modernité
de la poésie d’Emily Dickinson dans un choix de pas moins de 162 poèmes
présentés en anglais et traduits pour cette édition avec cette même
sensibilité par Françoise Delphy, spécialiste d’Emily Dickinson. Un
merveilleux et fructueux dialogue que relève d’emblée Anna Hiddleston dans
son introduction « Des mots à la peinture : Emily Dickinson et le
modernisme américain ».

Georgia O'Keeffe, Grey Blue and Black - Pink Circle, 1929,
huile sur toile, 91.4x121.9 cm, Dallas museum of art,
Dallas
Au fil des pages, c’est en effet toute l’émotion de
l’univers d’Emily Dickinson que le lecteur ressentira ; cette étrange
intensité que traduisent les majuscules intempestives, les tirets et les
merveilleux vers courts mêlant légèreté et d’éternité de cette poétesse
dont nous connaissons en fait si peu de choses, relève encore Diane de
Selliers : « Tant de mystères planent sur la vie et la personnalité d’Emily
Dickinson, femme hors du commun recluse dans la petite ville de Amherst à
l’ouest de Boston, dans le Massachusetts, où elle mourut en 1886… ».

Edward Hopper, Railroad Sunset, 1929, huile sur toile,
74.5x122.2 cm, Whitney museum of American art, New York
C’est un monde singulier, une vision propre à elle seule
que nous offre, en effet, Emily Dickinson, mais qui paradoxalement résonne
et trouve cet étrange écho en chacun de nous… « C’est comme si je
demandais l’Aumône, / Et que dans ma main étonnée / Un Étranger mettait un
Royaume / et que j’en sois abasourdie - / C’est comme si je demandais à
l’Orient / s’il y avait un Matin pour moi / Et qu’il lève ses Digues de
pourpre / Et me fracasse l’Aube ! »
Ainsi que le note Lou Moillon en sa préface : « Lire Emily Dickinson,
c’est découvrir un monde auquel on n’a pas accès, qu’on a le sentiment
d’avoir connu, d’avoir perdu, un éden duquel nous avons été bannis. »
“ Werner Bischof - Unseen Colour »
; Edition établie par Ludovica Introini and Francesca Bernasconi; Version
anglaise, 184 p., 102 illus. couleur, 21 x 24 cm, en collaboration avec
MASI Lugano et Fotostiftung Schweiz, Winterthur, Scheidegger & Spiess,
2023.
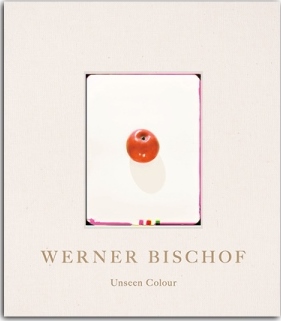
Les éditions Scheidegger & Spies offrent avec le présent volume consacré
au grand photographe suisse Werner Bischof (1916-1954) un aperçu
représentatif et complet de son travail allant de la photographie de mode
jusqu’aux prises de vue des plus déshérités, sans oublier ses fameux
reportages en noir et blanc d’après-guerre et guerre d’Indochine…
L’ouvrage réalisé avec soin met en avant ses premières photographies
couleur pour lesquelles le photographe aborde un autre aspect de son œuvre
où pointent les meurtrissures de l’après-guerre, mais aussi quelques
rayons de couleurs au détour d’un champ ou d’une encadrure de porte…
Bischof dans ses négatifs laisse percevoir à la fois un monde en
dévastation mais également toutes les espérances d’un lendemain meilleur.
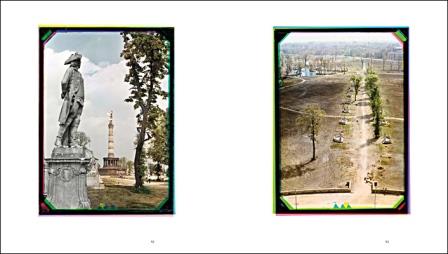
La photographie de mode, bien sûr, est annonciatrice d’un monde que le
photographe ne connaîtra pas (il disparaît en 1954) mais dont ses œuvres
sont la préfiguration en jouant des effets de cadrage et de luminosité
sortant du classicisme et saturant avant l’heure les couleurs. L’ouvrage
est éclairé par de passionnantes études signées Clara Bouveresse,
historienne de la photographie française, Peter Pfrunder, directeur du
Fotostiftung Schweiz à Winterthur, et Luc Debraine, directeur du Musée de
la caméra suisse à Vevey.
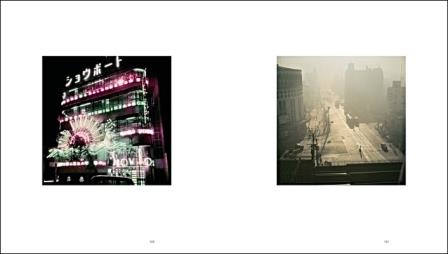
Le lecteur pourra ainsi découvrir la manière dont le
photographe avait recours à divers types d’appareils ainsi que leurs
différentes techniques. Mais l’ouvrage séduira également pour ces univers
à jamais révolus, des témoignages sensibles d’une époque en transition et
que Bischof sut saisir avec une rare acuité artistique à la fois
remarquable et inoubliable.
« Zao Wou-ki – Catalogue raisonné
des peintures – Volume II – 1959-1974 », Co-édition Fondation Zao Wou-ki /
Editions Flammarion, 2023.
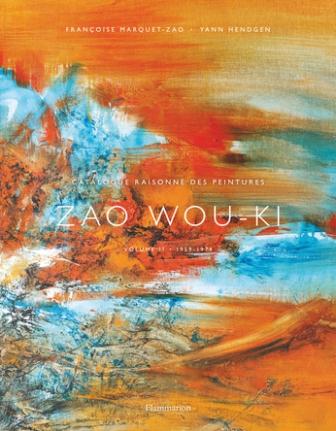
On ne peut que souligner et se réjouir de la parution du deuxième volume
du catalogue raisonné des peintures – 1959-1974 - de Zao Wou-ki sous la
direction de Françoise Marquet-Zao et Yann Hendgen. Un volume plus
qu’attendu depuis 2019, date de parution du premier volume couvrant les
années 1935 à 1958. Absolument splendide, avec une iconographie
exceptionnelle qu’exigeait assurément la création du célèbre artiste
chinois, ce beau livre offre en première partie un riche corpus des œuvres
de cette période accompagné de fructueuses contributions signées notamment
Melissa Walt, Yann Hendgen, directeur artistique de la Fondation Zao
Wou-Ki, ou encore Stephen Chao, neveu de l’artiste. Des textes offrant
pour chaque période de 1959-1974 des éclairages passionnants et parfois
inédits.
1959-1974, quinze années marquées par la reconnaissance internationale de
l’artiste et durant lesquelles « s’exprimant désormais dans un langage
pictural cohérent et mature, élaboré au cours des décennies précédentes,
il occupe une position stable sur la scène mondiale. », écrit Ankeney
Weitz dans sa préface. Âgé de 40 ans, marqué par la rupture avec sa
première femme et rentrant d’un tour du monde, c’est en effet la
reconnaissance qui désormais l’attend dans son nouvel atelier de Paris.
Ce sont des œuvres exceptionnelles que cet ouvrage donne à voir, souvent
sur de pleines pages ; des œuvres puissantes tels cet « Hommage à Henri
Michaux » de 1963 ou encore cette toile de 1973, « Hommage à René Char ».
Des toiles dans lesquelles l’énergie semble capturée non seulement à
jamais, mais à l’infini. Zao Wou-Ki dira n’avoir maîtrisé la peinture à
l’huile que dans ces années 1960… Reste que l’artiste n’aura eu de cesse
de chercher cette vision métaphysique du monde propre à lui, faite de
souffle, de vibrations et de poésie… Une œuvre qui fera de Zao Wou-Ki l’un
des plus grands représentants de l’abstraction.
« Louis Lagrenée (1725-1805) » de
Joseph Assémat-Tessandier, Editions Arthéna, 2023.
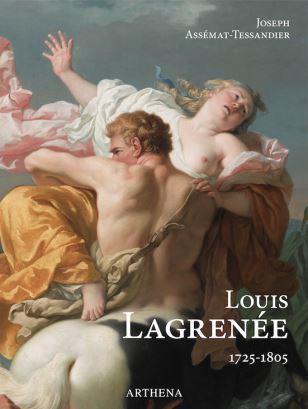
Le peintre français Louis Lagrenée couvrant de son art tout le XVIIIe
siècle fait l’objet d’une belle publication aux éditions Arthéna sous la
plume de Joseph Assémat-Tessandier, auteur lui ayant consacré une thèse
remarquée. Il fallait, il est vrai, une monographie captivante afin de
mieux faire connaître cet artiste souvent injustement méconnu et pourtant
à la belle carrière officielle, peintre d’Histoire, reçu à l’Académie
royale et directeur de l’Académie de France à Rome. C’est ainsi vœu exaucé
!
Louis Lagrenée connaîtra, en effet, un parcours « classique » avec un Prix
de Rome en 1749 et plus de 150 tableaux présentés au Salon du Louvre de
1755 à 1789. Cette carrière florissante en tant que peintre, mais aussi
décorateur et portraitiste s’inscrivit dans le mouvement rococo qui
s’imposa sous le règne Louis XV et qui se caractérise par son raffinement
et ses thèmes de prédilections pour les sujets galants et autres
évocations pastorales. Le classicisme et l’antique tiennent, cependant,
également une place importante dans l’œuvre de l’artiste où portraits,
scènes mythologiques et autres allégories sont l’occasion pour ce dernier
de déployer son art à la fois délicat et raffiné ainsi que le lecteur
pourra le constater et l’admirer dans ces pages avec des œuvres notables
telles « Les Amours de Psyché et de Cupidon » ou encore « Mars et Vénus ».
Soulignons encore que le rayonnement de Louis Lagrenée dépassera largement
les frontières du royaume pour s’élargir jusqu’à la Cour de Russie où
l’artiste connaîtra également la consécration en devenant le peintre
officiel de la tsarine Catherine II. Sa longévité le portera à peindre
jusqu’au terme de sa vie et à transmettre son art à de jeunes générations
d’artistes.
Surtout, et ainsi qu’il ressort de ce riche ouvrage exhaustif, de
nouvelles et belles découvertes ces dernières années d’œuvres considérées
comme perdues, mais aussi des études préparatoires et autres carnets de
croquis ont permis de préciser et d’augmenter encore l’ampleur de son
catalogue.
Artiste à la renommée internationale et emblématique du XVIIIe siècle,
Louis Lagrenée compte assurément parmi les artistes majeurs de ce siècle
et cet ouvrage permettra au lecteur d’en apprécier toute la richesse
notamment grâce à une iconographie remarquable accompagnant un catalogue
complet.
« Le Lin, fibre de civilisation(s)
» sous la direction d’Alain Camilleri, Editions Actes Sud, 2023.
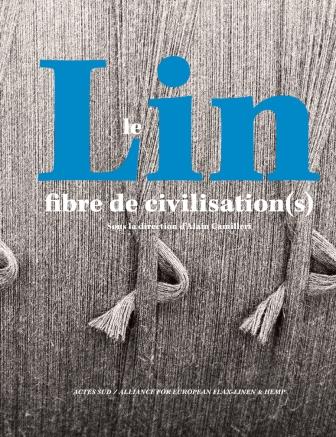
Voici un bel hommage rendu au lin, cette plante également synonyme du fil
et du tissu auxquels elle donne naissance après un long processus de
culture et de techniques. Comment cette frêle plante aux teintes bleutées
si caractéristiques en plein cœur de l’été dans nos campagnes a-t-elle
plus se frayer un tel chemin au fil des millénaires et des civilisations ?
C’est le sujet de ce livre aussi beau qu’informé grâce à la collaboration
des meilleurs spécialistes sur la question. À l’heure des multiples
questionnements sur une agriculture raisonnée, le lin occupe une place de
choix tant ses multiples vertus font de lui une plante d’avenir. Et
pourtant, son histoire ne date pas d’hier si l’on songe à son importance
déjà dans l’économie égyptienne pharaonique. Chaque pan de l’histoire a su
tisser un maillage séré avec le lin ainsi que le découvrira le lecteur
dans ces pages allant de la préhistoire jusqu’à nos jours. Mais cet
ouvrage ne se veut pas qu’une seule histoire du lin – ce qu’il offre déjà
avec réussite – mais entend aussi livrer une réflexion actuelle sur
l’engouement que le lin suscite auprès des créateurs, stylistes et
designers sans oublier l’art de vivre qu’il véhicule. Un bel ouvrage
informé et captivant retraçant les enjeux que cette petite plante dénommée
le lin n’a pas fini de susciter !
« Noël Coypel - Peintre du roi »
sous la direction de Guillaume Kazerouni & Béatrice Sarrazin, 28 X 24 CM,
352 p., Snoeck éditions, 2023.
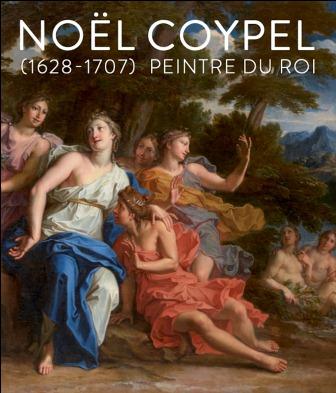
C’est au peintre du XVIIe siècle, quelque peu tombé dans l’oubli, Noël
Coypel qu’est consacrée cette vaste somme aux éditions Snoeck à l’occasion
des expositions qui lui sont consacrées au Château de Versailles et musée
des Beaux-Arts de Rennes. Ainsi que le relève en préface Laurent Salomé,
Directeur du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon : Si
Coypel fut négligé, ce n’est cependant ni en raison d’un talent médiocre,
ni d’un rôle secondaire dans les chantiers monumentaux entrepris durant le
règne du Louis XIV qu’il servit fidèlement. Il fut, il faut l’avouer,
injustement éclipsé par Le Brun et peu aimé de Mansard. Son style bien
différent de ses contemporains tout en s’inscrivant dans l’air du temps,
celui de à l’école de Bologne et de l’influence du grand maître Nicolas
Poussin, n’est pourtant pas dénué de paradoxes et de singularité, ainsi
qu’il ressort de la lecture de ce riche ouvrage collectif réalisé sous la
direction des spécialistes de Coypel, Bénédicte Sarrazin et Guillaume
Kazerouni, également co-commissaires des expositions.
En retraçant, en premier lieu, le cercle du peintre académique et ses
années de formation, le catalogue souligne l’héritage du paysage bolonais
– et ses couleurs – ainsi que l’influence de Charles Errard qui repèrera
rapidement le talent et la propension du jeune artiste à s’inscrire dans
la politique de grands décors du Grand Siècle. Ainsi vont se succéder de
grandes commandes auxquelles Coypel participera activement : le parlement
de Rennes avant de s’illustrer par les grandes réalisations des
différentes demeures royales (Tuileries, Versailles, Meudon…) que Béatrice
Sarrazin analyse dans le détail de ces pages.
La dimension religieuse fait l’objet également d’une section passionnante
sous la plume de Guillaume Kazerouni avec une impressionnante série
d’œuvres développant un traitement original de la transcendance tout en
s’inscrivant dans des critères formels traditionnels.
Le catalogue se termine par une section consacrée à une part méconnue et
néanmoins importante de l’artiste à la manufacture des Gobelins, Coypel
ayant également consacré son art à celui de la tapisserie avec des cartons
et maquettes somptueux analysés par Clara Terreaux et Arnaud Denis. Enfin,
Guillaume Kazerouni vient conclure cette somme indispensable à la
compréhension de Noël Coypel avec des pages dédiées aux dernières années
de sa vie, années qui malgré les relégations seront marquées par des
œuvres brillantes et loin d’être mineures faisant de cet artiste une
personnalité bien singulière et d’une longévité artistique exceptionnelle.
« Passion Partagée - Une
collection d’art africain constituée au XXIe siècle », Bruno Claessens,
Michel Vandenkerckhove , Didier Claes, Hughes Dubois (photography) ;
Relié, 384 p., 31 x 28 cm, Fonds Mercator, 2023.
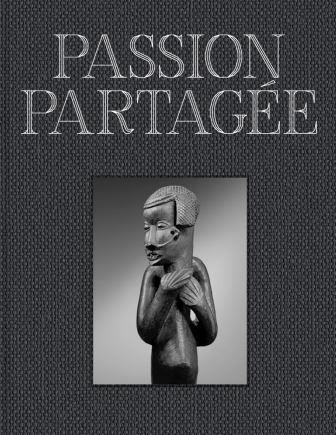
L’art africain fait l’objet ces dernières décennies d’une
exploration et belle mise en valeur tendant à lui restituer toute sa
richesse et ses multiples variations. Car l’appellation même au singulier
« d’art africain » demeure encore bien trop réductrice ainsi qu’en
témoigne ce somptueux livre d’art paru aux éditions Fonds Mercator et
réalisé par Bruno Claessens, Michel Vandenkerckhove , Didier Claes et
Hughes Dubois pour la photographie. La rencontre de passionnés, celle du
collectionneur Michel Vandenkerckhove et du marchand d’art Didier Claes, a
en effet donné naissance à cet ouvrage servi par une iconographie
remarquable signée en noir et blanc par Hughes Dubois. Les œuvres
dialoguent entre elles, une conversation qui n’aurait pas déplu à un
certain André Malraux…
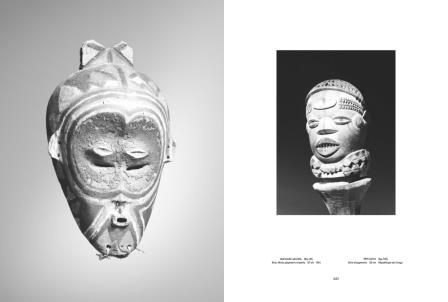
Si les traces écrites de la culture africaine font souvent défaut, les
multiples œuvres d’art ainsi présentées et qui ont su tant inspirer les
artistes au début du siècle passé forment le musée témoin de la grandeur
de ces civilisations pour nombre d’entre elles disparues. Ces quelque deux
cents objets réunis dans ce livre d’art révèlent en effet au-delà de la
collection d’Anne et Michel Vandenkerckhove les richesses encore
insoupçonnées du continent africain, au-delà des clichés encore trop
présents des arts dits « traditionnels ».
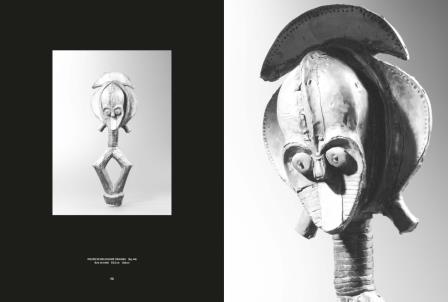
Cette statue Mumuye en bois du Nigeria à l’équilibre
parfait, cette figure de reliquaire Mahongwe en bois et métal du Gabon à
l’ovalité matricielle renvoient aux notions les plus sacrées de ces
civilisations dotées d’une si riche cosmographie. Les masques, les
fétiches sans oublier les sublimes sculptures des Lega de l’est de la
République du Congo manifestent non seulement la dextérité de leurs
artistes mais témoignent également de la richesse de la pensée symbolique
africaine. Raffinement artistique et mythologies constitutives se
conjuguent avec un rare bonheur au fil des pages de cette collection
inspirée.
« Portraits : architectural
parables » de François Charbonnet et Patrick Heiz, 656 pages, Editions
Park Book, 2023.
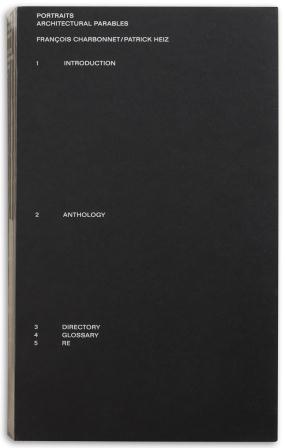
Première parution consacrée au célèbre cabinet d’architecture Mad In, cet
ouvrage signé François Charbonnet et Patrick Heiz, les fondateurs, devrait
être fortement salué, et ce à plus d’un titre !
En premier lieu, « Portraits : architectural parables » offre une mise en
perspective originale des idées et perceptions en matière d’architecture
et de design au fil du temps ayant influencé ou orienté les nombreux
projets et réalisations du célèbre cabinet d’architecture et design
suisse. L’ouvrage est, en effet, parti du postulat que tout projet repose
avant tout sur les pensées ou perceptions visuelles l’ayant précédé. Ce
sont ces extraordinaires métamorphoses qu’ont souhaité retracer les
auteurs et fondateurs, François Charbonnet et Patrick Heiz, au travers de
multiples et riches thèmes porteurs.
Aussi n’est-il pas étonnant, en deuxième lieu, que « Portraits :
architectural parables » offre une extraordinaire iconographie des plus
variées mariant plans, photographies et célèbres toiles en passant même
par des extraits de la Recherche ! L’ouvrage de plus de pages 650 fait
appel et s’appuie, en effet, sur une incroyable documentation et
information issues aussi bien de projets architecturaux, de l’histoire de
l’art, de la littérature ou encore de notre cadre vie au quotidien…
Surtout, à la lecture de ce fort volume, à la présentation, reliure et
format allongés, sobres et originaux, le lecteur découvrira l’ensemble ou
plutôt la méthodologie et process de penser protéiformes retenus par le
célèbre cabinet d’architecture et design suisse Made In. Refusant tout
système fermé et approche exhaustive, l’ouvrage a fait choix de donner à
lire une façon de penser et de concevoir foisonnante et des plus fécondes.
Une approche et méthodologie de conception que François Charbonnet et
Patrick Heiz ont su développer et transmettre dans leur enseignement au
Département d'architecture de l'ETH Zurich ainsi qu’à l'Accademia di
architettura de Mendrisio.
Pour toutes ces raisons, cet original, riche et fertile ouvrage devrait
retenir l’attention de plus d’un professionnel ou curieux et figurer au
titre de livre de référence dans toute bonne bibliothèque !
« Chess Design » de Romain
Morandi, Norma Editions, 2022.
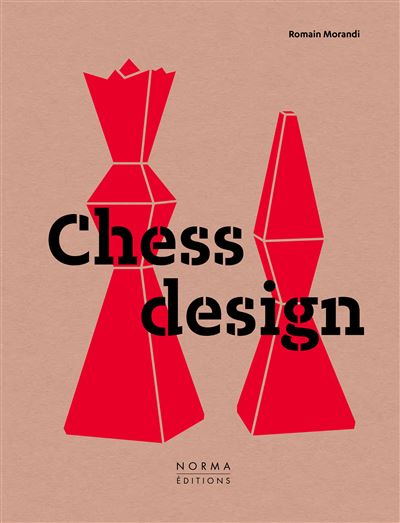
Véritable hommage esthétique au noble jeu dont les origines se perdent
dans la nuit de temps, « Chess design » présente une documentation
exceptionnelle sur le jeu d’échecs avec près de 300 échiquiers parmi les
plus précieux ou célèbres. En couvrant de manière exhaustive plus d’un
siècle de création de l’Art nouveau dès 1895 à l’an 2000, Romain Morandi,
historien de l’art et propriétaire de la galerie portant son nom, signe un
ouvrage que ne pourra que faire date. L’ouvrage présente en effet
l’évolution des formes et des designs de ce jeu réunissant un échiquier et
16 pièces par joueur de formes aussi variées que celle de la créativité
des artistes présentés en ces pages. Chess Design fait ainsi la preuve que
l’art a su s’inviter dans cette pratique souvent jugée élitiste jusqu’au
siècle dernier et qui par sa démocratisation a autorisé une multiplicité
des formes et même des couleurs dans un univers pourtant singulièrement
codifié. Ainsi que le relève Romain Morandi dans sa préface : «
l’échiquier symbolise la prise de contrôle, non seulement sur des
adversaires et sur un territoire mais aussi sur soi-même ».
Fort de ces enjeux, les plus grands artistes allaient s’emparer de cette
discipline mondialisée et souvent représentée par des personnalités qui
deviendront des stars. Bois, verre et céramique se verront compléter par
des matériaux inusuels en ce domaine tels l’acier, le plastique et même
des matériaux composites, sans parler bien entendu du numérique. Les plus
grands noms de l’art et du design laisseront le témoignage de leur
créativité, on pense bien entendu à Marcel Duchamp et Man Ray, mais aussi
Calder, Vasarely, et plus proche de nous Damian Hirst.
Les passionnés d’échecs ou amateurs de beaux objets jetteront assurément
leur dévolu sur cette mine d’information aussi plaisante à regarder grâce
à sa riche iconographie que passionnante à lire !
« HIROSHIGE - Les éventails d'Edo
- Estampes de la collection Georges Leskowicz » ; Textes de Christophe
Marquet avec la collaboration de Toshiko Kawakane ; Fondation Jerzy
Leskowicz ; 288 p., 198 illus., 35 x 24 cm ; Reproduction des estampes au
format d’origine, In Fine Éditions, 2022.
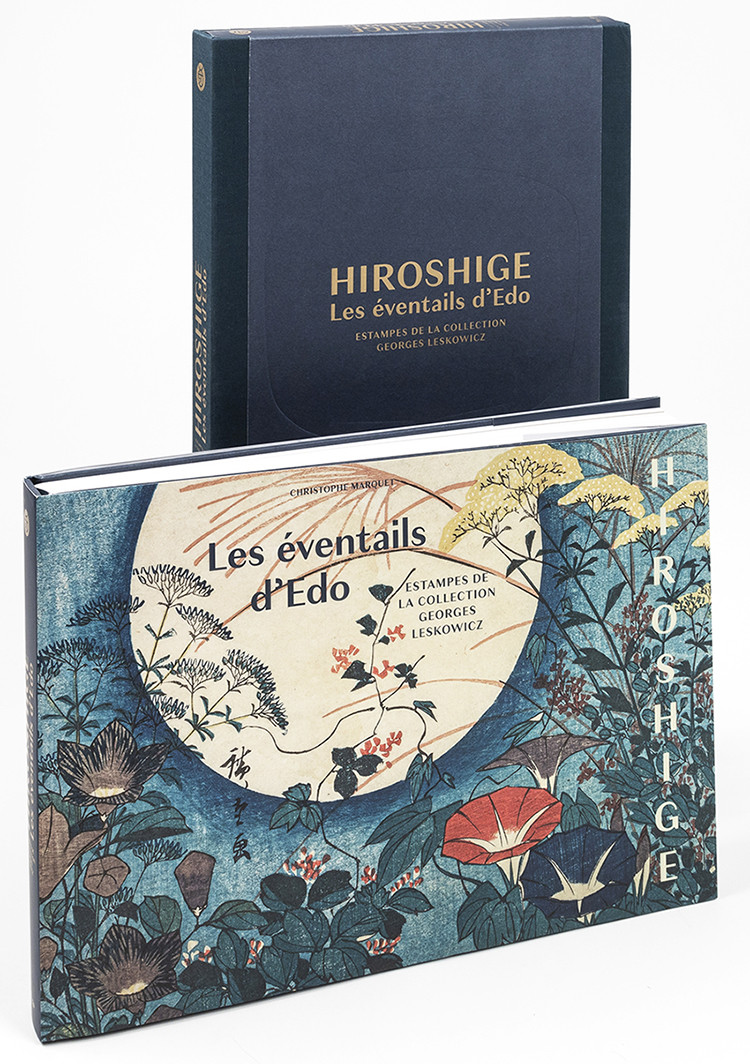
Le maître de l’estampe japonaise Hiroshige (1797-1858) est passé à
l’immortalité depuis le milieu du XIXe siècle pour son habileté à saisir
tout aussi bien des paysages qui l’ont rendu célèbre que de courtes scènes
que nul autre artiste ne réussira à concurrencer. Les estampes pour
éventails constituent une part souvent méconnue et plus rare de l’œuvre de
ce grand artiste. Aussi est-ce avec curiosité et plaisir que le lecteur
pourra découvrir cet ouvrage paru aux éditions In Fine consacré aux
éventails d’Hiroshige dits « d’Edo » offrant de magnifiques reproductions
d’estampes au format d’origine.
Ce livre d’art restitue toute la magie des éventails plats en bambou (uchiwa)
du dernier imagier d’Edo avec cette habileté à se saisir d’infimes scènes,
règne de l’éphémère si cher à l’esprit japonais. Ces estampes faisant
partie de la collection Georges Leskowicz sont présentées en ces pages
pour la première fois par Christophe Marquet et Toshiko Kawakane, ces
spécialistes replaçant ici ces œuvres précieuses et rares dans le contexte
de l’histoire de la gravure pour éventails au Japon.
Que l’on retienne la lecture savante proposée par ces auteurs ou bien une
découverte au fil des pages en un plaisir purement esthétique, le lecteur
appréciera le raffinement du trait, l’équilibre toujours saisissant des
couleurs, cette habileté à suggérer un quotidien transcendé par la beauté
de la nature en autant de scènes délicatement composées…
Si nous pensions bien connaître l’œuvre du grand maître de l’estampe
japonaise de la première moitié du XIXe s., cet ouvrage se chargera de
manière esthétique de nous faire la preuve du contraire !
« African Modernism - The
Architecture of Independence. Ghana, Senegal, Côte d'Ivoire, Kenya, Zambia
» ; Sous la direction de Manuel Herz avec Ingrid Schröder, Hans Focketyn
and Julia Jamrozik ; Photographies de Baan et Alexia Webster ; 640 pages,
23,5 x 32 cm, 2nd édition, Park Books 2022.

Rapidement épuisé après sa sortie en 2015, cet ouvrage consacré à la
modernité africaine fit l’objet d’un accueil unanime et reçut de
nombreuses récompenses : Lauréat du FILAF d'or, premier prix des meilleurs
livres sur l'art en 2015 au FILAF (Festival international du livre et du
film d'art), désigné également comme étant l’un des plus beaux livres
suisses de 2015, lauréat du DAM Architectural Book Award 2016… Cette
reconnaissance justifiait ainsi une nouvelle édition sur un sujet souvent
méconnu et donnant à lieu à bien des réductions postcoloniales. Car, ainsi
que le démontrent les auteurs de cette somme remarquable, le continent
africain recèle des trésors d’architecture des années 50 et 60, période
clé de son histoire caractérisée par l’accès à l’indépendance de la
plupart de ces États.
Contrairement à l’idée reçue, ces pays et notamment ceux faisant l’objet
de ces analyses – à savoir le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Kenya et la
Zambie – ont su exprimer leur identité par des créations architecturales
d’envergure. Ce modernisme africain s’est ainsi manifesté de la manière la
plus créative qui soit par des bâtiments aussi ambitieux que talentueux,
point de rencontre entre ce nouvel élan et les cultures locales. Les
auteurs présentent et analysent dans ces pages abondamment illustrées une
centaine de réalisations avec leur descriptif, images, plans de sites et
d’étage. Les prises de vue réalisées par Iwan Baan et Alexia Webster sont
pour la plupart d’entre elles récentes et permettent de se faire une idée
du projet initial sans pour autant en masquer leur état actuel, souffrant
souvent de l’épreuve des temps à l’image de biens de nos édifices
occidentaux…
Véritable somme consacrée à l’urbanisme et l’architecture postcoloniaux, «
African modernism » fait entrer de plain-pied le lecteur dans un univers
foisonnant de créativité ne donnant qu’une envie, celle de découvrir ces
réalisations sur site !
Les auteurs :
Manuel Herz dirige son propre studio de design et d'urbanisme à Bâle et
à Cologne. Il est professeur assistant à l'Université de Bâle. Ingrid
Schröder est architecte et directrice du programme MPhil en architecture
et design urbain à l'Université de Cambridge. Elle a été nommée directrice
de l'École d'architecture de l'Architectural Association à Londres en mai
2022 et assumera ce poste en août 2022. Hans Focketyn dirige sa propre
agence d'architecture à Bâle et enseigne en tant que professeur à l'école
d'architecture, de bois et de génie civil de l'Université des sciences
appliquées de Berne à Berthoud, en Suisse. Julia Jamrozik est architecte
et professeure adjointe à l'École d'architecture de l'Université de
Buffalo à Buffalo, NY. Conçu par Marie Lusa.
« Jean Bardin (1732-1809), le feu
sacré » ; Catalogue sous la direction d’Olivia Voisin, 304 p., Editions Le
Passage, 2022.
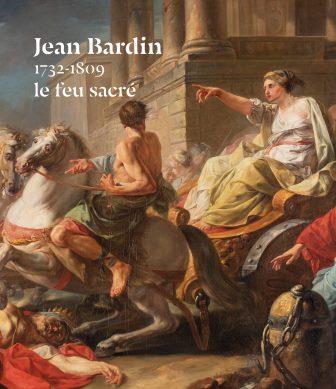
Le présent catalogue publié par les éditions Le Passage propose au lecteur
une découverte, celle d’un peintre du XVIIIe siècle trop souvent
injustement méconnu, et pourtant auteur de nombreuses œuvres d’art
déterminantes à la veille de la Révolution. Accompagnant l’exposition du
musée des Beaux-Arts d’Orléans, cet ouvrage nous fait entrer au cœur même
de la création artistique en cette fin du XVIIIe siècle dans le contexte
des Lumières et d’un Ancien Régime qui s’estompe. Jean Bardin, peintre de
talent et reconnu à son époque sait également dispenser son art au plus
grand nombre, notamment dans le cadre de l’École gratuite de dessin à
Orléans alors qu’il avait atteint l’âge de 53 ans. Ce pédagogue hors pair,
ainsi que le souligne les nombreuses études que le catalogue réunit, sut
en effet transmettre non seulement l’art de la peinture d’histoire que
nous retrouvons dans les nombreuses reproductions couleur qui ornent avec
bonheur cet ouvrage, mais également de magnifiques évocations d’art sacré
dans lequel le peintre excellera également. Remportant le prix de Rome,
Bardin dont le goût assuré correspond aux standards de son époque saura
aussi réaliser des toiles prestigieuses telle sa grande œuvre, le cycle
monumental des sept Sacrements pour la chartreuse de Valbonne, dans le
Gard. Virtuosité, précision du trait et magnificence de la couleur dans
l’esprit de Nicolas Poussin qu’il vénéra sa vie durant caractérisent l’art
de Bardin ainsi qu’il ressort de ce riche catalogue qui aura entre autres
mérites – et non des moindres - de rappeler la mémoire d’un peintre qui
inventa un nouveau langage préfigurant le siècle à venir.
Jean-David Jumeau-Lafond :
“Martine de Béhague, une esthète à la Belle Époque”, Flammarion, 2023.
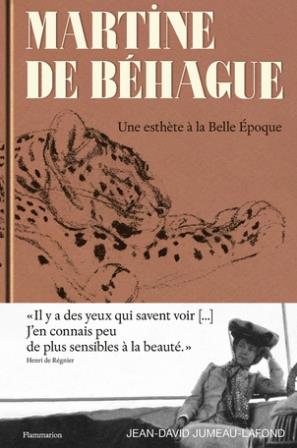
Le Nirvana, yacht privé de Martine de Béhague, 80 m de long, a sillonné
les mers lointaines afin d’assouvir cette soif d’absolu qui anima toute sa
vie cette richissime collectionneuse d’œuvres d’art. On prêtait à la
Comtesse Martine d’acquérir une œuvre d’art par jour au temps de la Belle
Époque… Cette passion remonte à loin, sa mère comme son père ayant eu
également un goût de la beauté, legs précieux pour leur enfant. Tout est
objet, pour cette femme curieuse et intrépide, de découvertes au fil de
ses multiples voyages : tableaux, archéologie, bibliophilie, architecture…
La Méditerranée formera notamment l’un de ses champs de recherche, avec
une attirance certaine pour l’antique. Tout en connaissant les grands de
ce monde, artistes et écrivains tels Henri de Régnier, Marcel Proust ou
encore Paul Verlaine, cette personnalité atypique cultivait les
contrastes. Éprise de beauté, elle aimait à préserver sa solitude et
appréciait par-dessus tout un cercle restreint d’habitués. Cette quête
d’esthète constituait la raison même de sa vie ainsi que le souligne
Jean-David Jumeau-Lafond. Peut-être a-t-elle recherché dans ces œuvres
d’art ce qu’elle n’avait su préserver de son mariage qui fut un échec ? Sa
fantaisie la poussait à chérir cette liberté qui devait primer sur tout,
et sa curiosité s’étendait à un large registre de créations, sans pour
autant être une collectionneuse invétérée. Son hôtel particulier rue
Saint-Dominique était le symbole de ses multiples attirances et abritait
différents salons consacrés à ses nombreuses passions où l’antique se
disputait aux beaux arts. Son rapport aux œuvres n’était pas celui du
spécialiste, mais relevait plus d’une quête d’absolu jamais atteint. Ainsi
que le relève Valentine de Ganay en préface, Martine de Béhague n’a jamais
cessé de faire des choix très personnels, qualifiés pour certains
d’éclectisme, choix qui pourtant ont composé un ensemble certes subjectif
mais qui a cependant rejoint celui des grands passionnés de l’art depuis
l’aube des temps. Cet ouvrage refait vivre cette véritable odyssée grâce
aux très nombreux documents inédits réunis par la sagacité de l’historien
de l’art Jean-David Jumeau-Lafond, une pérégrination aux multiples visages
qui ne pourra que susciter la curiosité et l’intérêt du lecteur.
« Martine Martine » Yves Gagneux –
Catalogue raisonné tome II, 24,5 x 31 cm, 280 pages, Éditions du Regard,
2022.
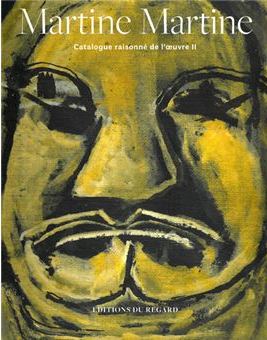
Avec ce deuxième tome paru aux éditions du Regard, Yves Gagneux,
conservateur général du patrimoine et directeur de la Maison Balzac, et
Guillaume Daban nous convient à cette belle découverte l’œuvre de
l’artiste Martine Lévy. Née à Troyes en 1932 dans une famille de
collectionneurs, c’est très tôt qu’elle se trouve initiée à l’art auquel
elle consacrera toute sa vie. Plus connue sous son nom d’artiste Martine
Martine, son œuvre sera protéiforme, qu’il s’agisse des médiums employés
allant du dessin au pastel, en passant par la gravure et l’huile sans
oublier la sculpture, des thèmes multiples qui inspireront un catalogue
impressionnant dont ce deuxième volume venant compléter l’inventaire.
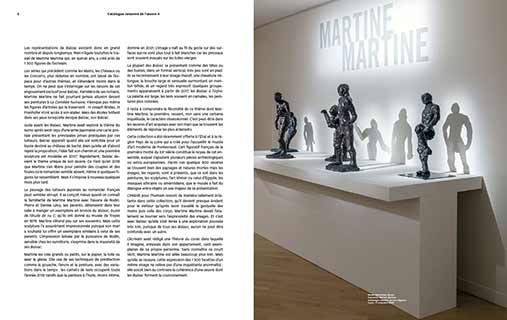
Comment caractériser le travail de Martine Martine avec ce deuxième opus
du Catalogue raisonné servi par une édition soignée et remarquable ? Par
delà la diversité des thèmes et des séries, Martine Martine appréhende ses
sujets dans sa globalité, avant d’en livrer par de multiples séries un
nombre impressionnant de facettes tel qu’il ressort de ces premiers
carnets traitant des portraits de sumotori dont la rondeur et la vigueur
des visages ont su capter l’œil de l’artiste.
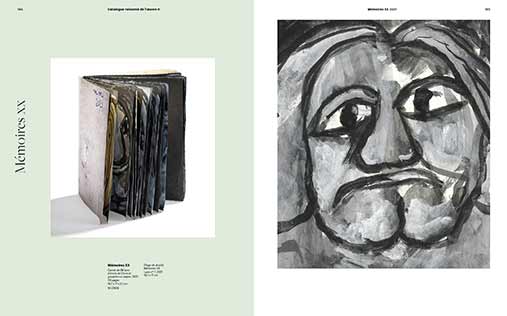
À la manière du théâtre kabuki, Martine Martine esquisse
quelques traits marquants qui parviennent à restituer la vitalité et la
profondeur de ces instants saisis presque sur le vif. En autant de petites
vignettes, ces carnets déstructurent le sujet afin de se l’approprier et
de donner vie à une nouvelle représentation. Les carnets III & Mémoires
III allant de 2003 à 2013 prolongent cette démarche et prennent comme
nouveau champ de recherche Balzac dont Martine Martine livre une multitude
de portraits et de lavis, répétant inlassablement cette exploration de la
physionomie, devenant elle-même œuvre d’art. Tenant presque de la démarche
initiatique, ce geste quasi obsessionnel envoûte le lecteur et le conduit
à une certaine extase, à l’image des compositions d’un Philip Glass ou de
Steve Reich. Au terme de ce parcours singulier et fascinant, le lecteur
aura le sentiment d’entrer dans l’intimité de la création de Martine
Martine, ce qui n’est pas le moindre des attraits de ce superbe Catalogue
raisonné.
« Maurice Calka – Le sculpteur du
design » de Xavier de Jarcy, Editions Albin Michel, 2022.
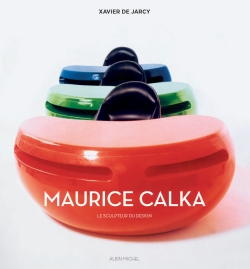
C’est avec un vif intérêt que le lecteur découvrira cette belle et
première monographie consacrée à Maurice Calka (1921–1999) et signée par
le journaliste Xavier de Jarcy aux éditions Albin Michel. De ce «
sculpteur de design » ayant marqué l’histoire de l’art de la deuxième
moitié du XXe siècle, chacun a bien entendu à l’esprit son fameux bureau «
boomerang », objet du design pop iconique des années 1969, tout en
couleurs et rondeurs et qui illustre la couverture de ce beau livre. Mais,
Maurice Calka est aussi et surtout un génial artiste pluridisciplinaire
donnant à voir une variété de réalisations et matériaux incroyables allant
de la sculpture au design urbain ou encore à l’architecture. Qui ne se
souvient également, à la simple évocation de son nom, de ces fameux
papillons géants de Vanves venus si agréablement égayer le « périph’ »
parisien en 1981 ?
Véritablement artiste inclassable, sculpteur, designer, dessinateur,
architecte et urbaniste, l’œuvre de Maurice Calka ne saurait laisser
indifférent. Aussi, est-ce avec bonheur que les amateurs de design, mais
aussi tout collectionneur ou curieux d’art découvriront cet ouvrage soigné
avec son format carré et ses couleurs acidulées. Devant tant
d’expériences, de matériaux et de réalisations, l’auteur, Xavier de Jarcy,
a fait choix d’une approche chronologique allant des jeunes années de
l’artiste à « L’école Calka »… Des places ou bâtiments publics aux
intérieurs plus intimistes, l’artiste n’a eu, en effet, de cesse d’innover
et de surprendre. Remportant le Premier Grand Prix de Rome de sculpture en
1950, Maurice Calka se fait connaître avec un nouvel art urbain dès les
années 60. Optant pour une « Sculpture pour tous », l’artiste saura
s’imposer avec des sculptures, bas-reliefs ou encore fresques que ce soit
à Clamart ou encore Reims. Les multiples places publiques réalisées par
l’artiste retiendront également, bien sûr, l’attention, tant ces dernières
s’enchaînent avec une diversité et couleurs à couper le souffle ; on songe
à Saint-Louis de La Réunion, à Paris, à la place des Gradins de Torcy en
1975… Et puis, comment oublier, Maurice Calka, architecte ou designer ?
Comment oublier cette fabuleuse Renault 5 Cacharel de la fin des années
1970 ?
Et, oui, Maurice Calka, c’est tout cela et il fallait assurément une telle
monographie complète et incontournable pour rendre hommage à ce grand
artiste de la deuxième moitié du XXe siècle.
« Proust, la fabrique de l'œuvre »
sous la direction d’Antoine Compagnon, Guillaume Fait et Nathalie Mauriac
Dyer, catalogue d’exposition BNF, 240 pages, Gallimard, 2022.
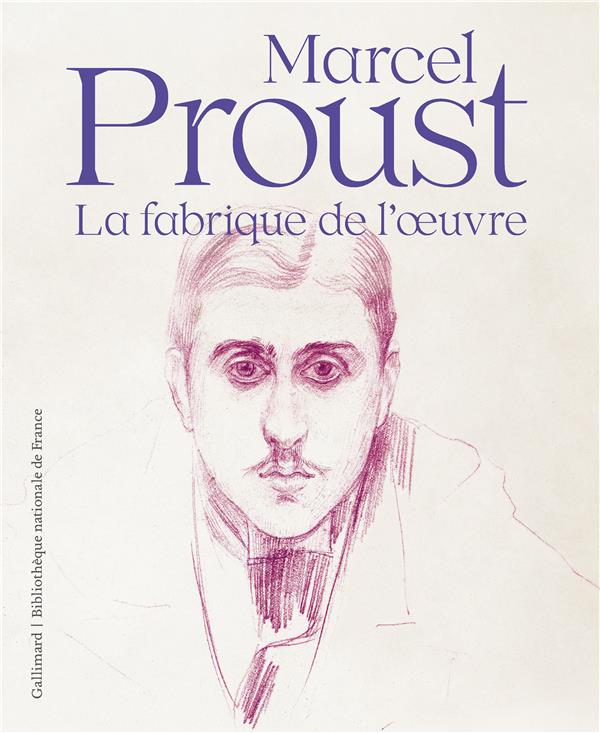
Vaste entreprise que d’explorer la fabrique de l’œuvre de Marcel Proust !
Mais, une heureuse initiative entreprise aujourd’hui sous la direction
d’Antoine Compagnon de l’Académie française à l’occasion de l’exposition
éponyme actuellement à la BnF. A l’image d’un abécédaire littéraire des
plus nourris, le présent catalogue présente de A à Z, la création
littéraire proustienne avec des entrées aussi variées et pittoresques que
« Water-closet », « Zut, zut, zut, zut » ou « Kapitalissime »… Derrière
l’apparent farfelu de certaines de ces thématiques se trouve cependant
développé avec brio et passion le véritable laboratoire d’écriture de
l’auteur de La Recherche. Ainsi que le relèvent Antoine Compagnon,
Guillaume Fait et Nathalie Mauriac Dyer « la vision de l’écrivain au
travail dans ses manuscrits s’impose aussitôt au lecteur », évoquant les
fameuses paperoles qui accompagnaient ce travail souvent long et répété de
rédaction se nourrissant de multiples références croisées. Comment
cependant recoller tous ces morceaux accumulés par ce long processus de
composition ? Quelle relation entretenait l’écrivain avec le temps, ce
fameux « Temps », tout au long de la genèse de l’œuvre à accomplir ?
Comment avons-nous reçu ce legs un siècle après et que faire de ces
multiples manuscrits constituant la création proustienne ? C’est à ces
questions auxquelles répond avec précision et clarté ce riche catalogue
illustré, bien sûr, par de nombreuses reproductions des manuscrits de
Marcel Proust, mais aussi de photographies d’époque et autres œuvres
d’art. Pour les amateurs du célèbre écrivain, mais aussi pour les esprits
curieux souhaitant vagabonder de page en page dans l’immense laboratoire
de la création littéraire d’A la recherche du temps perdu, cet abécédaire
réservera bien des agréments et exquises surprises.
« L’Épopée de Gilgamesh »
illustrée par l’art mésopotamien, direction scientifique de l’iconographie
et introduction d’Ariane Thomas, photographies de Jean-Christophe Ballot,
traduction de l’arabe d’Abed Azrié, volume relié sous coffret, 24,5 x 33
cm, 280 pages. Éditions Diane de Selliers, 2022.
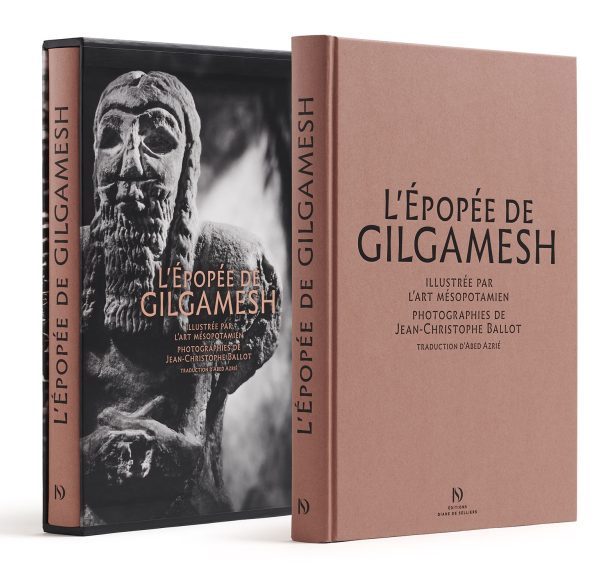
Les éditions Diane de Selliers offrent au lecteur l’un des plus anciens
témoignages de l’humanité avec « L’Épopée de Gilgamesh », une source
antique de plus de quatre mille ans et dont certains épisodes tel celui du
Déluge, du passeur ou encore celui du serpent ont été repris par nombre de
civilisations antérieures. Nous sommes en Mésopotamie, berceau de notre
humanité avec l’agriculture et l’écriture, et ce héros légendaire que fut
Gilgamesh, roi de la dynastie d’Ourouk, qui connaît par delà les multiples
aventures affrontées toutes les émotions d’un mortel aspirant à
l’immortalité…
Ainsi que le souligne la spécialiste Ariane Thomas, directrice du
département des Antiquités orientales du musée du Louvre, cette geste
remarquable se divise en deux parties, celle d’un roi jeune et intrépide,
ami indéfectible d’Enkidou, auquel arrivent toute sorte d’aventures, puis
une deuxième partie avec la mort de son ami, une période marquée par le
chagrin et les doutes avant de partir en quête de l’immortalité…
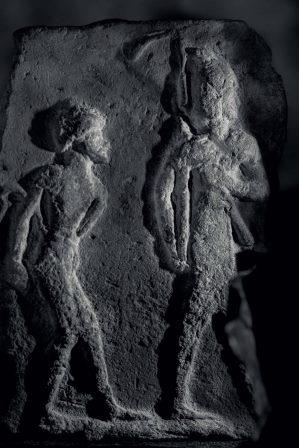
Cette épopée incroyable concentrant un éventail saisissant de sentiments,
reliant passé et présent, propose ainsi une lecture universelle du destin
humain et de la quête du sens de la vie. À la différence du mythe qui
développe le caractère surhumain de ses personnages, l’épopée retient
quant à elle le caractère humain – trop humain – du personnage de
Gilgamesh qui sera soumis à un parcours initiatique tel celui d’Ulysse
dans l’Odyssée. Véritable genèse de la philosophie dans ses derniers
développements, « L’Épopée de Gilgamesh » anticipe par certains de ses
aspects ce que les philosophies hellénistique et romaine développeront
notamment avec le stoïcisme.
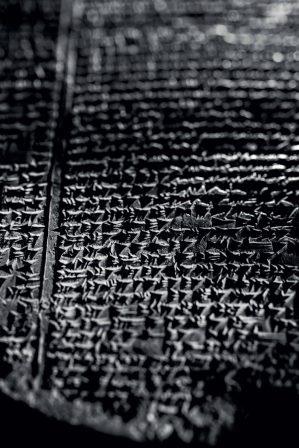
Au terme de son parcours, Gilgamesh atteint une certaine sérénité, celle
d’un homme qui a compris que le destin n’appartient pas aux rêves futurs
et incertains ainsi que le soulignera plus tard le philosophe Sénèque,
mais dans cette vie à l’instant présent dont il nous faut cueillir les
fruits, ici et maintenant…
Il fallait pour ce récit si précieux un écrin à la hauteur et, comme à
l’accoutumée, Diane de Selliers a réuni un trio de choix notamment en la
personne de Jean-Christophe Ballot qui livre en ces pages de véritables
œuvres d’art photographiques accompagnant le texte de l’Épopée. Ses prises
de vue en noir et blanc révèlent et accentuent la richesse des œuvres
millénaires des antiquités orientales notamment du musée du Louvre et
autres collections mondiales grâce au savant éclairage sur ces œuvres
apporté par Ariane Thomas. Gabriel Bauret, auteur de plusieurs livres sur
la photographie, souligne cette double richesse du texte et de l’image,
richesse qui peut s’apprécier simultanément ou bien successivement. Enfin,
palme doit être rendue à la belle traduction offerte par le poète et
chanteur Abed Azrié, né à Alep, qui a su se saisir à partir de traductions
arabes du souffle épique de ce texte immémorial.
Un voyage au long cours proposé par les éditions Diane de Selliers et dont
les étapes initiatiques ne manqueront pas de passionner les lecteurs de
cet ouvrage qui rend un bel hommage à cette civilisation qui inventa
l’écriture.
« Wang Keping » de Virginie
Perdrisot-Cassan, Aline Wang et Anne-Laure Buffard ; Relié, 224 pages, 23
x 30 cm, 250 illustrations, Editions Flammarion, 2002.
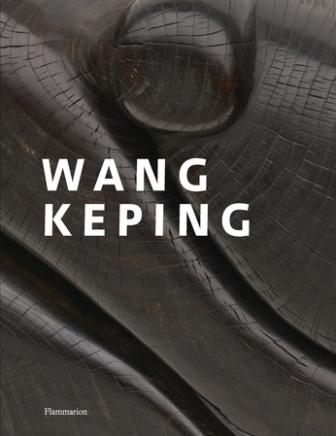
Beaucoup se réjouiront de cette première monographie en français consacrée
au sculpteur chinois Wang Keping. L’ouvrage co-écrit par Virginie
Perdrisot-Cassan, historienne de l’art, Aline Wang, directrice du studio
Wang Keping, et Anne-Laure Buffard, directrice adjointe de la galerie
Obadia, offre au regard et à l’analyse une riche et belle mise en
perspective de la carrière et de l’œuvre de Wang Keping avec un éclairage
en particulier sur ses œuvres de maturité.
Les sculptures de Wang Keping livrent un langage singulier autour de
thèmes et de formes qui se jouent, se nouent et s’enroulent tels ces «
couples » ou ces oiseaux aux formes épurées et arrondies. Mais, « Mes
oiseaux ne sont pas des oiseaux – souligne Wang Keping – se sont du bois,
des sculptures. Mes oiseaux sont des contes, de l’imagination.»
Affichant une nette préférence pour le bois, il fut très tôt surnommé « Le
Maître du bois ». Cette prédilection pour le bois, quelle que soit
l’essence, ne le quittera plus, et se retrouve encore dans ses œuvres de
maturité, des sculptures monumentales en bois, donc, mais également en
bronze telle cette sculpture « Lolo » en bronze pour la fondation Camignac
de 4 mètres de hauteur. L’ouvrage revient également sur ce choix du bronze
dès la fin des années quatre-vingt par l’artiste ; Wang Keping que le
lecteur retrouvera notamment dans la fonderie suisse en 2009.
Aujourd’hui internationalement reconnu, rappelons que Wang Keping fut un
des fondateurs du mouvement d’avant-garde chinois, The Stars Art Group, à
la fin des 1970. L’artiste, exilé politique, arrivé en France en 1984,
acceptant les influences respectives de Brancusi, de Zadkine mais aussi de
Zao Wou-Ki ou encore de Gao Xinglang, a su très tôt imposer son propre
style, cette profonde force de vie aux variations infinies.
« Monet » de Ségolène Le Men, 320
illustrations couleur, Relié sous jaquette et coffret illustrés, 29 x 33,5
cm, pages 456, Editions Mazenod & Citadelles, 2022.
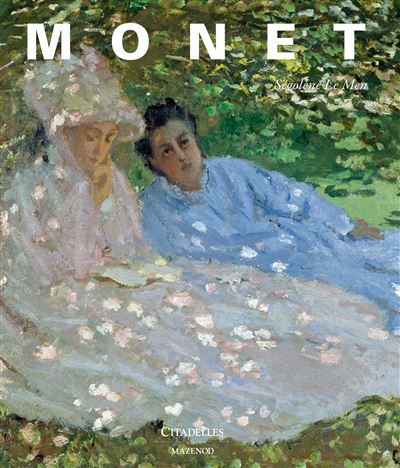
Cette somme unique en langue française consacrée à l’ambassadeur de
l’impressionnisme que fut Claude Monet ne pourra que réjouir les amateurs
d’art et amoureux du peintre de Giverny. Tout ou presque a été réuni en
cet ouvrage d’exception de taille imposante (456 pages) afin de retracer
la longue vie fertile de celui qui à juste titre a été présenté comme le
père de l’art moderne. En ces pages illustrées avec soin par une abondante
iconographie de plus trois cents illustrations couleur, Ségolène Le Men,
professeur émérite d'histoire de l'art a l'université Paris Nanterre et
membre senior de l'Institut universitaire de France, parvient à se saisir
de cette immense icône de la peinture en une approche renouvelée et
convaincante.
L’ouvrage retrace en effet les tout débuts du jeune artiste au Havre
lorsqu’il signait encore Oscar ses caricatures, pan méconnu de l’art du
futur maître et qui témoignait déjà de l’acuité de son regard… Ségolène Le
Men insiste justement sur ces premières années souvent passées sous
silence et qui ont eu pourtant leur importance pour l’évolution ultérieure
de l’artiste. Notamment les influences de Boudin et Jongkind, les
premières impressions laissées par la nature saisies dans ce dessin
annonciateur « Les Bords de la Lézarde » où le crayon noir sur papier gris
anticipe les futures inspirations du peintre dans son traitement des ondes
et du végétal. Les fameuses Marines de Boudin, ce jeu subtil des nuages et
de la mer concourront eux aussi à ce rapport unique que Monet entretiendra
entre sa main le paysage et la toile. Ces initiations tissent en effet
progressivement un maillage complexe de références que l’artiste usera à
l’envi dans de multiples séries passées à la postérité depuis : les
Meules, la gare Saint-Lazare, la cathédrale de Rouen avant les hypnotiques
variations de Giverny.
Ce regard formé aux multiples effets et impressions du plein air sera par
la suite enrichi d’autres rencontres et sources d’inspirations ainsi qu’il
ressort de son attrait irrépressible pour les arts de l’extrême orient
sans oublier la photographie et les premières heures du cinéma… Cet
ouvrage se trouve également éclairé par la confrontation de sources
multiples grâce à l’abondante correspondance du peintre, les témoignages
de ses contemporains, l’ami de toujours, Georges Clemenceau, sans oublier
Mirbeau, Zola, Proust.
Au final, c’est un Claude Monet plus familier que nous livre Ségolène Le
Men, mais aussi un artiste inaccessible lorsque son art le transporte en
d’infinies variations. Une somme indispensable pour mieux approcher non
seulement Claude Monet, mais également de manière plus générale
l’Impressionnisme auquel il a livré ses plus belles œuvres.
« Albrecht Dürer – Gravure et
Renaissance » ; Collectif, Château de Chantilly / BNF, Editions In f=Fine,
2022.
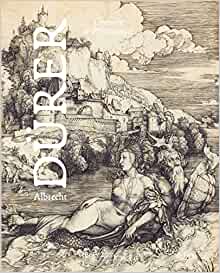
Le fort riche catalogue qui accompagne l’exposition consacrée à Albrecht
Dürer (1471-1528) au Jeu de Paume du Château de Chantilly entrainera son
lecteur non seulement dans l’immense œuvre de l’artiste, mais aussi sur
les routes de la Renaissance ; car, admirer l’œuvre gravée du Dürer qui
fut également orfèvre, dessinateur et peintre, c’est aussi parcourir
l’Europe de la Renaissance en ce tournant du XVe au XVIe siècle. L’artiste
dut, en effet, toute sa vie durant non seulement parcourir les chemins et
cours d’Europe pour trouver commanditaires et commandes, mais eut
également un goût personnel prononcé pour le voyage. C’est donc une belle
mise en perspective que livre l’ouvrage replaçant l’immense créativité de
l’artiste au cœur des échanges et changements, non seulement artistiques
mais aussi politiques et religieux, de son époque.
Ainsi, après les années de formation de l’artiste dans l’effervescence
artistique de Nuremberg - « La fabrique d’un artiste », à l’aube de 1500,
le lecteur découvrira-t-il un premier et long chapitre consacré à « Dürer
en Italie à l’heure de la gravure » : Dürer et l’artiste Jocopo de Barbari
qu’il admire et rencontrera probablement à plusieurs reprises. L’artiste
vénitien transmettra à Dürer la passion de l’étude des proportions, mais
aussi Dürer et Raphaël, Dürer et Leonard de Vinci, ou encore l’artiste à
Venise où il rencontra un véritable succès ; « Ici, je suis un prince »,
écrira-t-il… Venise marquera effectivement un tournant dans l’œuvre de
l’artiste avec des œuvres exceptionnelles telles « la Fête du Rosaire ou «
le retable Landauer »…
Dans un deuxième temps, le lecteur découvrira le graveur, « chez lui »
dans son atelier, une étape essentielle ouvrant sur les maîtres allemands
notamment Martin Schongauer mais aussi sur les artistes issus de son
atelier notamment Hans Baldung Grien, Hans Wechtlin ou encore Lucas
Cranach. Dürer maîtrisera toutes les techniques de la gravure (bois,
burin, eau-forte et pointe sèche).
Mais surtout, avant de se refermer sur l’artiste aux Pays-Bas notamment
lors de son établissement à Anvers, ce riche catalogue de plus de 280
pages et largement illustré s’arrête sur la reconnaissance du graveur de
son vivant - « Dürer à son sommet », avec cette représentation du monde
qui lui fut si chère ; Une représentation du monde qui fit de lui ce
graveur incomparable et universel et qui marqua à jamais non seulement son
époque mais sut rayonner jusqu’à nous…
« 6 Months in the fridge – Travels
throught Northern Europe » ; Photographie de Michael Königshofer ; Relié,
208 pages, Version anglaise, Éditions teNeues, 2021.
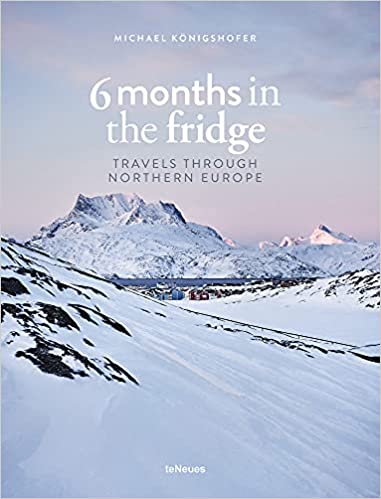
C’est à un fantastique voyage dans le Grand Nord de l’Europe, en
Scandinavie, auquel le photographe Michael Königshofer nous invite avec
bonheur. « 6 months in the fridge » précisément ! Une aventure avec pour
seule étoile, l'étoile Polaire et le cercle polaire de l’arctique…
Le lecteur suit ainsi avec plaisir et curiosité cet extraordinaire
photographe australien en Norvège, en Islande, en Écosse jusqu’au
Groenland. La splendeur des paysages émerveille, Michael Königshofer ayant
su, en effet, restituer par son objectif toute la beauté et magie de ces
somptueuses terres du nord de l’Europe.
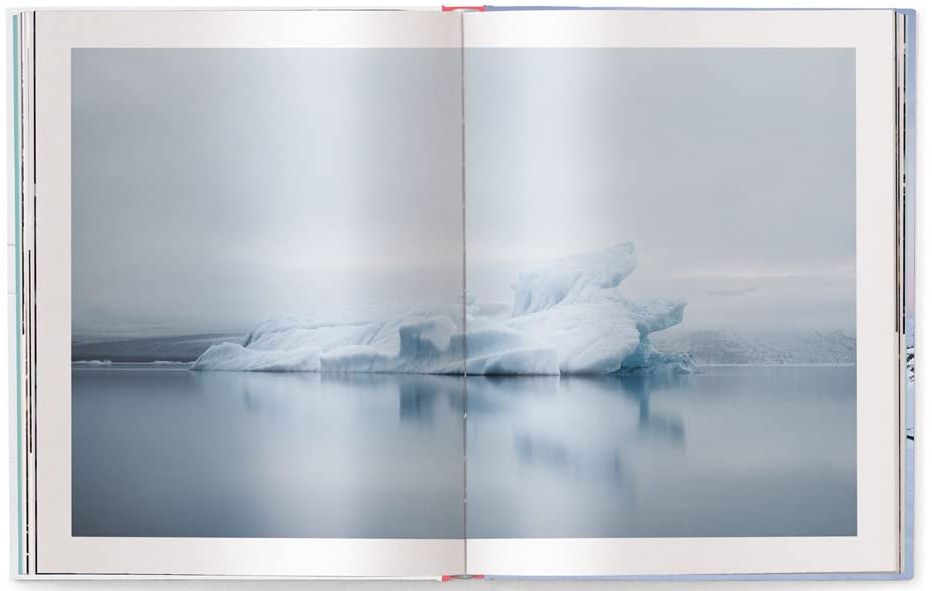
Pour Mikael Königshofer comme pour son lecteur, chaque jour ou page de ces
contrées lointaines enneigées et glacées offre son lot de découvertes et
surprises. Car au-delà de la beauté des paysages, c’est aussi un lointain
habité fait de rencontres que nous conte Mikael Königshofer. Habitants,
traditions et cultures y sont également capturés et racontés avec passion
par ce talentueux photographe qui avoue avec humour avoir toujours froid
même en Australie !
Appuyé par un riche texte et de cartes, pêcheurs, artisans ou encore
surfers, mais aussi art et architecture s’y dévoilent, parfois en de
saisissants contrastes, dans de grandioses et époustouflants paysages de
Scandinavie. Tout le talent du photographe Michael Königshofer au service
de la splendeur du grand froid du nord de l’Europe.
« Simon Hantaï » - Catalogue de
l'exposition Fondation Louis Vuitton sous la direction d’Anne Baldassari,
29 x 30.5, 370 pp., Fondation Louis Vuitton / Gallimard, 2022.
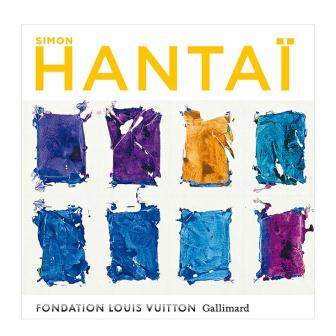
Avec cet impressionnant catalogue consacré à Simon Hantaï et publié à
l’occasion de l’exposition qui se tient à la Fondation Louis Vuitton, Anne
Baldassari offre une somme inégalée sur l’artiste dont nous fêtons cette
année le centenaire de la naissance. L’impressionnante rétrospective
qu’abrite la Fondation Vuitton méritait effectivement un tel hommage.
L’ouvrage au format généreux réunit non seulement deux entretiens précieux
pour entrer dans l’œuvre de l’artiste avec les témoignages de son épouse
Zsuzsa Hantaï et de Daniel Burren, mais aussi de nombreuses contributions
notamment de Jean-Luc Nancy, Georges Didi-Huberman, Jean Louis Schefer
ainsi qu'une chronologie de la vie de Simon Hantaï par Anne Baldassari.
Né en 1922 en Hongrie et naturalisé français, ce « Souabe errant » ainsi
qu’il se qualifie fréquemment n’aura de cesse de partir à la recherche de
significations, une errance toujours questionnée au fil de son riche
parcours évoqué en ces pages. C’est en France qu’il réalisera l’essentiel
de son oeuvre dont plus de 130 sont reproduites, ici, en un large format.
Suivant un parcours chronologique, l’ouvrage défile une à une les pages
des grandes évolutions marquant le travail de cet artiste insatiable et au
regard scrutateur. « On ne peint que pour Dieu » aimait à rappeler le
peintre d’origine catholique, une ferveur et un élan qui se matérialisera
par de larges aplats et « déplis » de couleurs profondes et éclatantes.
Ainsi que le souligne Georges Didi-Huberman, Hantaï déploie dans ses
œuvres une mémoire familiale profonde, élargie par le recours à la
couleur, anamnèse par des surfaces successives de couleurs.
Ce catalogue nous fait entrer de manière éclatante dans la richesse de
cette œuvre protéiforme, peintures à signes, monochromes, mariales,
Catamurons, Panses, Meuns, etc. Un véritable parcours initiatique éclairé
par des œuvres d’autres artistes ayant compté dans le développement de
Simon Hantaï tels Henri Matisse ou Jackson Pollock.
Nombreuses seront les découvertes à la lecture de ce précieux catalogue
qui complètera idéalement la remarquable exposition actuellement à la
Fondation Louis Vuitton Paris.
« Tokyo pourpre – Une nuit dans le
Tokyo undergroud » de Jean-Christophe Grangé avec les photographies de
Patrick Siboni, Éditions Albin Michel, 2021.
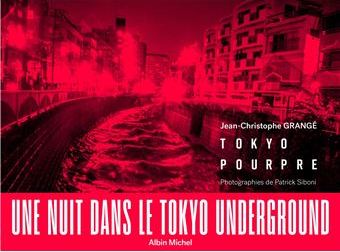
C’est une poésie pourpre et singulière qui est née de cette féconde
rencontre entre le célèbre auteur français de thriller Jean-Christophe
Grangé et le photographe Patrick Siboni. Cette étrange atmosphère pourpre
est celle d’un Tokyo underground que l’écrivain, passionné par le Japon, a
découvert lors de ses recherches pour la « La terre des morts ». « La
nuit, Tokyo est rouge » écrit l’auteur, et c’est ce Tokyo rouge, écarlate,
qu’arpentent chacun avec leur sensibilité Jean-Christophe Grangé avec sa
plume et Patrick Siboni avec son objectif.

C’est, en effet, à la rencontre d’un Tokyo moins connu auquel nous convie
tant l’écrivain que le photographe avec cet ouvrage. Tokyo de la fin de
journée lorsque la nuit s’avance doucement et offre les « Premières
rencontres », la femme japonaise, la table, etc. Puis, lorsque la nuit
d’Extrême-Orient enveloppe la ville, la pluie, les lumières qui s’allument
et le dernier train qui s’éloigne… Car Tokyo jamais ne dort et se révèle
encore tard dans la nuit au-delà des clichés ; lorsque s’ouvre un autre
monde, lorsque néons, enseignes, stations de métro s’illuminent tout de
rouge et se répondent tel « Un battement sourd, un murmure organique, un
magnétisme intime, qui vous attire et vous effraie à la fois » écrit
encore Jean-Christophe Grangé.
Un ouvrage livrant en un format à l’italienne un étrange Kaléidoscope de
Tokyo du crépuscule jusqu’à l’aube dans une envoûtante déclinaison du
rouge avec ses secrets et passions ; sourde alors le rouge écarlate, cogne
et bat le rouge sulfureux et éclate ce rouge d’un « Tokyo pourpre »
profond et secret, car « Tokyo la nuit recèle de milliers de secrets, et
parcourir ses rues, jusqu’au bout de l’aube, s’apparente à une quête de
tous les extrêmes, envoûtante, inouïe, inoubliable. » écrit
Jean-Christophe Grangé livrant un « Tokyo pourpre » underground jusqu’au
bout de la nuit.
« Modigliani »de Thierry Dufrêne ;
Relié sous coffret illustré, 330 illustrations, 29 x 42 cm, 324 pages,
Editions Citadelles & Mazenod, 2022.
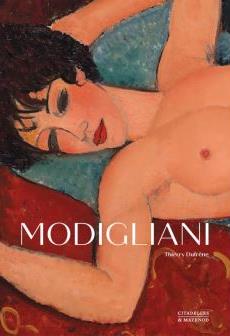
Les qualificatifs ne manqueront pas pour évoquer la toute dernière
parution « Modigliani » aux éditions Citadelles & Mazenod. Exceptionnelle,
cette biographie de Thierry Dufrêne l’est assurément à plus d’un titre, à
commencer pour son généreux format 29x42 et la richesse de l’iconographie
rassemblée. Mais l’ouvrage consacré à l’un des plus grands artistes du XXe
siècle apparaît, dès les premières pages, comme l’une des synthèses les
plus inspirées sur le peintre et le siècle dans lequel il s’est inscrit.
Thierry Dufrêne revisite le mythe de l’artiste maudit qui a longtemps
caractérisé le parcours et l’œuvre d’Amadeo Modigliani. Le biographe a
multiplié les questionnements sur la genèse de son œuvre, réinterrogeant
non seulement ses origines italiennes, mais également ses sources
d’inspirations allant de Michel-Ange aux masques africains.
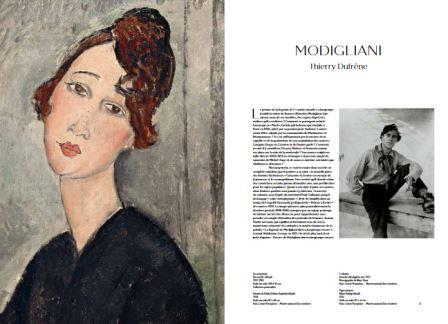
Si, bien entendu, la place et le rôle joués par les
artistes de Montmartre et de Montparnasse sur le jeune Amedeo seront
déterminants, l’admiration pour Toulouse-Lautrec mais aussi les approches
de Gauguin, Degas et encore Cézanne ne sauraient être négligés. Le lecteur
comprendra rapidement que le musée imaginaire de Modigliani est complexe
et touffu, à l’image de la société qui se dessine, progressivement sous
ses yeux, au tournant du siècle. Paris et les femmes resteront au cœur de
son œuvre, ses portraits « sculptées » sur la toile révélant – sans s’y
soumettre pour autant – toutes les influences artistiques de ses aînés,
Picasso en tête.
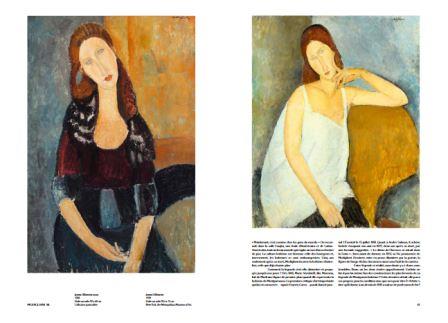
L’ouvrage parvient à force de démonstrations éclairantes appuyées par une
iconographie convaincante à faire surgir l’extrême originalité et
complexité de l’œuvre de Modigliani. Nombreux sont les courants de
l’histoire de l’art qui trouvent en l’artiste une convergence lumineuse,
renouvelant les thèmes abordés en de multiples inspirations. Tels ces
inoubliables portraits de femmes, Jeanne, Hanka ou encore Lunia dont les
reproductions en grand format soulignent la luminosité de la palette de
Modigliani. Les réalités sociales de son époque se trouvent ainsi
sublimées par le regard posé par l’artiste, un regard métamorphosé pour sa
dernière période (1918-1919) après un long séjour sur la Côte d’Azur…
Un ouvrage d’exception qui ne pourra que faire date dans la bibliographie
de Modigliani, autant pour la force rhétorique de ses développements que
pour sa beauté de livre d’art.
« Far Far East – A tribute
to faraway Asia”; Textes d’Alexandra Schels ; Photographies Patrick
Pichler ; 272 pages, Version : Anglais / Allemand, Éditions teNeues, 2021.
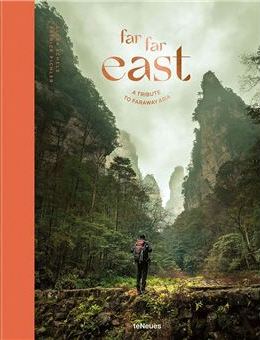
C’est une splendide invitation au voyage que nous proposent Alexandra
Schels et Patrick Pichler avec « Far Far East », un ouvrage nous
entraînant sur les chemins de huit pays d’Extrême-Orient : Sri Lanka,
Chine, Mongolie, Japon… Le lecteur parcourt ainsi en compagnie des auteurs
les nombreux chemins et paysages de l’Asie, chaque pays dévoilant ses
espaces, sa culture et ses traditions.
Que ce soit les textes d’Alexandra Schels ou les magnifiques photographies
de Patrick Pichler, chaque chapitre invite, en effet, à la découverte, à
la curiosité avec pour fil directeur cette « Ode au ralentissement ». Car,
en ces pages, aussi belles les unes que les autres, ce sont des traditions
différentes, des contrées lointaines, déserts ou métropoles que nous
découvrons avec émerveillement. Sur plus de 260 pages avec des
photographies souvent époustouflantes pleine-page ou double page, chaque
pays révèle ainsi sa singularité ; hautes montagnes du Népal, métropoles
de la Corée du Sud, nomades de Mongolie…
Que cela soit à pied ou par train, c’est l’Asie avec ses sentiers de
montages, ses rivages et baies, ses villes et habitants au travers huit
pays différents qui livre en ces pages toute sa beauté et ses secrets… Un
bel hommage à l’Asie.
« Beatriz Milhazes » ; Sous la
direction de Hans Werner Holzwarth ; Edition trilingue français/anglais
/allemand ; 26 x 34 cm, 580 pages, Éditions Taschen, 2021.
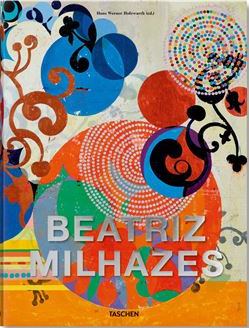
Comment résister à cet univers d’explosion de couleurs ? C’est, en effet,
une magnifique invitation à entrer dans cette fabuleuse galaxie de
couleurs brésiliennes que propose cette splendide monographie consacrée à
l’artiste Beatriz Milhazes et parue aux éditions Taschen. Cette somme de
plus de 500 pages sous la direction de Hans Werner Holzwarth offre au
regard toute la puissance de lumière et de couleurs du pays natal de cette
artiste brésilienne hors du commun.
Alternant entre abstraction et symboles ou scènes de vie brésiliennes, les
toiles de Beatriz Milhazes transmettent une énergie rare, une force de vie
incroyable qui la caractérise et a fait la signature de l’artiste. Nées
sous l’influence d’Henri Matisse ou encore de Bridget Riley, ces œuvres
livrent en effet une exubérante chorégraphie envoûtante de couleurs. Mais,
l’œuvre de Beatriz Milhazes sait aussi se faire plus musique et
s’assombrir sous le vent de la mélancolie. C’est cette richesse et
complexité que le lecteur découvrira dans ces merveilleuses pages,
l’ouvrage actualisé réunissant pas moins de 300 œuvres de l’artiste
jusqu’aux plus récentes. Explorant les différentes étapes de la carrière
de Beatriz Milhazes, les multiples motifs ou encore les matériaux auxquels
elle a eu recours, l’ouvrage propose une analyse approfondie de l’œuvre de
cette artiste brésilienne qui a su s’imposer dès les années 1980.
Un travail mis en perspective par de riches contributions, notamment celle
de l’historien d’art David Ebony, mais aussi par un entretien accordé par
l’artiste elle-même à Hans Werner Holzwarth, entretien dans lequel Beatriz
Mihlazes dévoile ses méthodes de travail ou revient sur le contexte
culturel de ses œuvres. Une belle analyse complétée par un dictionnaire
des principaux motifs de Beatriz Milhazes réalisé par Adriano Pedrosa
auquel vient s’ajouter une biographie complète et actualisée par Luiza
Interlenghi.
« Antoine Schneck » de Pierre Wat
; Relié cartonné, 25 x 32 cm, 180 illustrations, 292 pages, Éditions In
Fine, 2021.
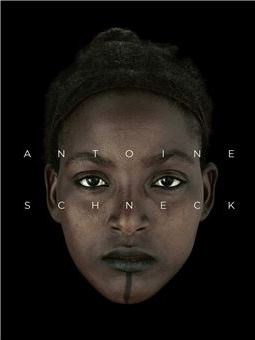
C’est un très bel ouvrage que consacrent les éditions In Fine à l’artiste
français Antoine Schneck. Signé de l’historien d’art Pierre Wat, également
critique d’art et professeur d’université, l’ouvrage tout de noir vêtu,
ainsi qu’il se devait pour Antoine Schneck, livre une splendide mise en
perspective de son travail et réalisations. Antoine Schneck, photographe
plasticien, a en effet toujours privilégié pour ses dernières à la fois
les fonds noirs et les séries. Ainsi concernant son travail sur les
portraits, ce dernier a-t-il toujours retenu au-delà du fond noir une
approche directe du visage lui permettant une extrême expressivité et une
parfaite mise en lumière. L’artiste avoue s’être souvent inspiré pour ses
techniques de l’histoire de l’art, et plus particulièrement de l’histoire
même de la peinture.
Mais, ses recherches ne se sont jamais enfermées dans le seul travail du
portrait, si expressif soit-il. Antoine Schneck a également, au gré de ses
voyages et pérégrinations, consacré de célèbres séries aux oliviers
millénaires, mais aussi aux fleurs, aux arbres ou encore aux carburants.
Pour son travail, l’artiste souligne avoir très tôt adopté le numérique
lui offrant à la fois un large potentiel et une grande qualité, n’hésitant
pas à retravailler la palette graphique. N’ayant de cesse de renouveler
recherches et trouvailles, Antoine Schneck a ainsi eu recours pour ses
derniers travaux notamment au collodion humide.
Et, c’est justement « A Rebours », d’aujourd'hui à 2006 que le plasticien
photographe a souhaité revisiter son travail. Un choix révélant, ainsi que
le souligne Pierre Wat dans son introduction, que « le fil directeur qui
unit tant de pratiques et de lieux, c’est Antoine Schneck lui-même,
autrement dit la vie d’un homme qui vient s’incarner en autant de
pratiques, des déplacements, et d’expériences vécues. » L’ouvrage s’ouvre
ainsi en 2021-2020 sur le studio de l’artiste et cette série de portraits
lors de son voyage au Kenya jusqu’à 2006. Plus de 15 ans d’un beau chemin
fait de rencontres, d’altérité et de photographies captivantes voire
fascinantes.
Les investigations de l’artiste et son chemin de vie de photographe
plasticien offrent, il est vrai, au regard une large et belle diversité de
séries – allant des chiens célèbres aux gisants de la Basilique
Saint-Denis en passant par les soldats de la Première Guerre mondiale du
sommet de l’arc de Triomphe. Portraits, animaux et objets se côtoient
ainsi dans cette splendide monographie dans un savant bonheur, celui des
rencontres, voyages et expériences de l’artiste, des séries toujours
marquées par la griffe même d’Antoine Schneck, par la force et l’acuité de
son regard.
|
“Goya - The Complete Prints “,
TASCHEN Editions, 2025.
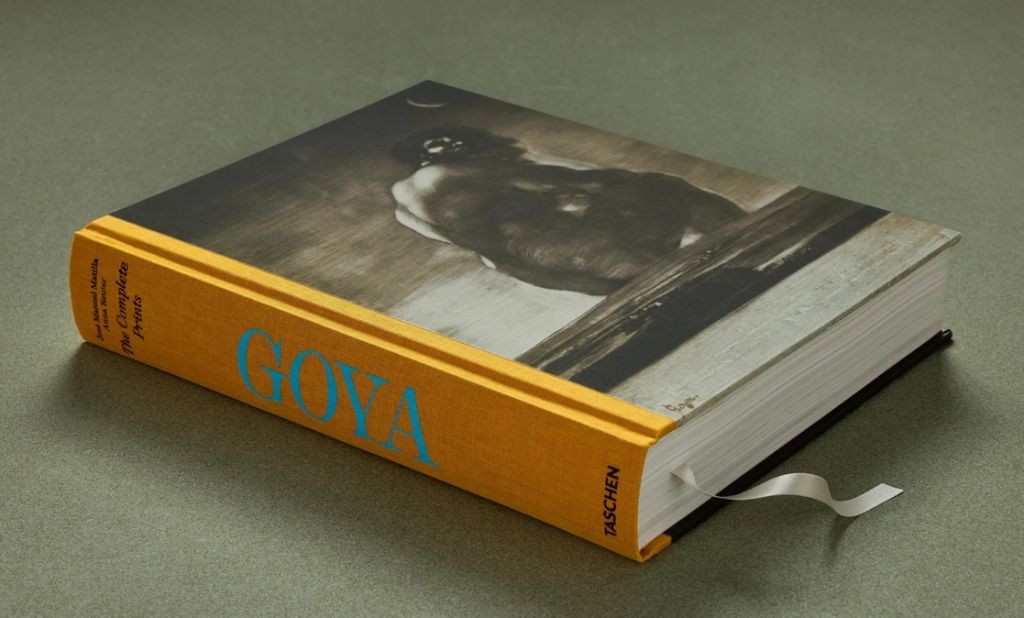
Francisco de Goya (1746-1828) fut perpétuellement animé par le regard
qu’il portait sur l’âme humaine, dans ses hauteurs, tout comme ses
bassesses. Que le brillant artiste agisse lors de commandes officielles
pour la cour royale d’Espagne ou à l’occasion des scènes de guerre
(Disparates) dont il rendit toutes les atrocités, Goya sut en effet
pénétrer au cœur de l’âme humaine, des tréfonds parfois guère reluisants
dont il traduisit pourtant l’effroyable réalité.

Conjuguant avec une rare virtuosité maîtrise formelle et acuité
d’observation singulière, l’artiste produisit une série d’eau-fortes et de
lithographies rassemblées et présentées pour la première fois dans ce bel
ouvrage paru aux éditions Taschen et signé Anna Reuter et José Manuel
Matilla, tous deux spécialistes de l’artiste espagnol. Associant avec un
rare bonheur les ombres et la lumière, Goya a su élever son art afin de
transcender les contradictions de son temps. Comptant parmi les plus
grands maîtres de l’estampe de son époque, il forgea ses premières armes
en Espagne avant de perfectionner son art en Italie, avant d’être engagé
comme Premier peintre à la cour de Charles IV.

Cette somme de 600 pages, reliée sous coffret réunit de manière
exceptionnelle l’ensemble des 287 eau-fortes et lithographies de
l’artiste. Le lecteur, éclairé par les textes et notes d’Anna Reuter et
José Manuel Matilla, pourra s’étonner et quelque peu sourire des fameuses
séries des Caprichos, mais aussi frissonner d’horreur avec les Désastres
de la Guerre et autres Disparates… Ces estampes souvent sombres et
inquiétantes ne se limitent pas un réalisme exacerbé des horreurs de la
guerre, elles invitent, bien au-delà, le lecteur à un questionnement
philosophique sur la nature humaine, les distinctions entre le bien et le
mal et les zones d’ombre de l’âme.
Le lecteur retrouvera, par le truchement et le génie de son art, une
Espagne en pleine mutation, conjuguant jusqu’au paradoxe liberté et
violence. Offrant différents niveaux de lecture et servie par une mise en
page luxueuse, cette nouvelle édition Taschen nous fait entrer au cœur de
l’atelier du peintre-graveur que fut Goya, mais aussi dans les tréfonds de
la société de son temps, du grand art !
"Égypte ancienne, l'Âme du Nil" de
Fabio Bourbon, 320 p., ill. 160, Editions Place de Victoires, 2025.
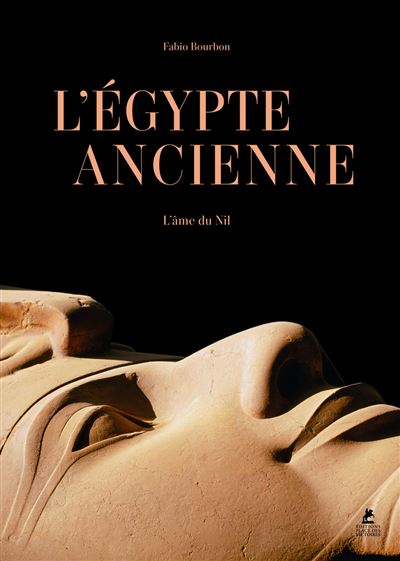
Fabio Bourbon, écrivain, essayiste et spécialiste des civilisations
antiques, partage dans ces pages à l’iconographie remarquable sa passion
pour l’Égypte ancienne. Retenant, en effet, pour cette somme présentée en
un généreux format (24 x 29cm) les photographies des maîtres en la matière
que sont Blaine Harrington et Kenneth Garrett, l’auteur a choisi de
plonger littéralement son lecteur au cœur même de la fascination exercée
depuis des millénaires par cette civilisation. Fabio Bourbon apostrophe
ainsi et à juste titre, dès l’introduction, le lecteur : « Qui,
honnêtement, peut déclarer n’avoir jamais été fasciné par l’Égypte antique
» ?! Fascination qui ne pourra que recueillir l’adhésion unanime au regard
de ces somptueuses pages.

L’attraction exercée par l’Égypte antique tient tout d’abord aux mystères
qui ont toujours accompagné ces dynasties. Afin de légitimer de manière
incontestable leur pouvoir, le recours au divin et au culte des divinités
légitimant ces derniers, les pharaons ont très tôt placé une distance
importante entre le peuple et le souverain. Par le truchement des images,
si importantes dans l’Égypte antique si l’on considère ne serait que
l’écriture hiéroglyphique, nous progresserons au fil des pages dans cette
« galerie émotionnelle » avec non seulement des images éblouissantes par
leur beauté intrinsèque, mais également porteuses d’une riche symbolique.

L’auteur a souhaité ainsi livrer un véritable voyage photographique
cherchant à approcher « l’âme » de l’Égypte pharaonique sous l’angle de sa
splendeur esthétique. Les multiples détails de la vie quotidienne nous
plongent au cœur même de la vie égyptienne, alors que les multiples
symboles des divinités et du pouvoir imposent une distance en raison de
leur richesse et de leur caractère précieux.

Ce sont toutes ces différentes facettes éclairées par un riche texte
didactique qui ouvrent au lecteur, telle une formule magique, une porte
originale sur la civilisation égyptienne antique.
« Le Symbolisme » sous la
direction de Jean-David Jumeau-Lafond et Pierre Pinchon avec les
contributions de Rossella Froissart, Laurent Houssais et Adriana Sotropa,
400 pages, 300 ill., 32,5 x 27,5 cm, Mazenod Editions, 2025.
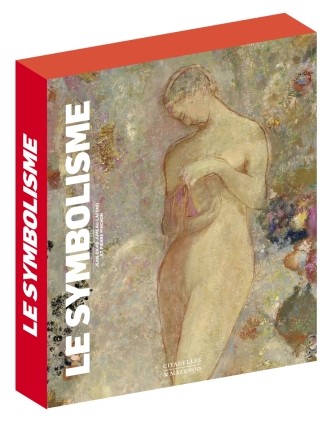
Les éditions Mazenod publient une importante contribution à l’histoire de
l’art en proposant une synthèse didactique sur un courant souvent méconnu
du XIXe siècle : le symbolisme. Jean-David Jumeau-Lafond et Pierre Pinchon
ont dirigé cette vaste somme avec des contributions de Rossella Froissart,
Laurent Houssais et Adriana Sotropa ; une collaboration fructueuse qui
permettra à un large public d’appréhender ce courant majeur de l’histoire
de l’art, né à la fin du XIXe siècle.
La fin du XIXe siècle connaît, en effet, bien des mutations suscitées par
la révolution industrielle et le développement du positivisme. Face à ce
matérialisme envahissant, certains artistes revendiqueront selon leur
sensibilité leur liberté en opposition aux injonctions de la science et
des techniques, une liberté qui prendra bien des formes ainsi que le
révèle cet ouvrage abondamment illustré par 300 œuvres remarquablement
reproduites. Les arts réunis en ces pages attestent de ce foisonnement et
convoquent littérature, peinture, sculpture, arts graphiques et décoratifs
sans oublier la musique.
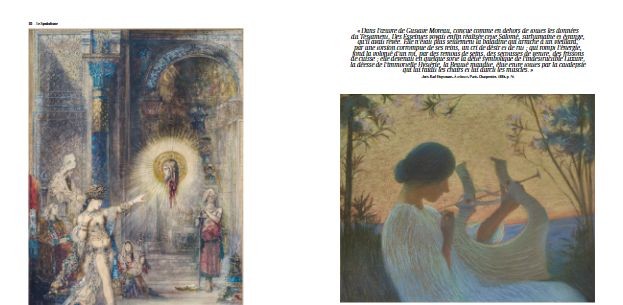
Questionnant les frontières du tangible pour franchir les
limites du sensible, les artistes ayant marqué le symbolisme révèlent une
extraordinaire diversité et cultivent tous cette intériorité propice aux
rêves et autres songes plus sombres… Que l’on considère la poésie mystique
d’un Baudelaire ou la force symbolique qui émane de la musique d’un
Wagner, nul étonnement alors que des peintres tels que Odilon Redon ou
Gustave Moreau s’autorisent eux aussi à faire courir sur leurs toiles des
formes évanescentes tout droit sorties d’un monde onirique. L’indicible,
l’invisible, l’imperceptible se voient appropriés par ces artistes prêts à
tout pour transgresser le réel et idéaliser le monde ainsi que le
soulignait en 1886 le poète symboliste Gustave Kahn : « Le but
essentiel de notre art est d’objectiver le subjectif (l’extériorisation de
l’Idée) au lieu de subjectiver l’objectif (la nature vue à travers un
tempérament) ».
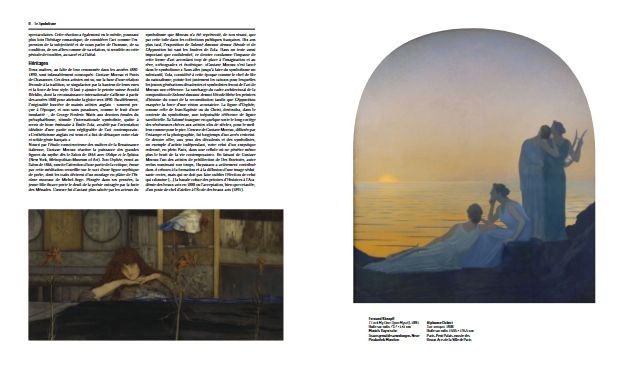
Cet ouvrage ambitieux expose très justement tous ces ressorts complexes :
questionnement sur la valeur de l’art comme ultime salut, place de
l’angoisse et de la souffrance dans le processus de la création, les
valeurs symbolistes qui en résultent ou encore l’art comme idéal… Cette
plongée érudite dans l’univers du Symbolisme dévoile au fil de ces pages
toute la complexité de cette transfiguration du réel qui aboutira à une
véritable esthétique de l’indicible. Les sources évoquées laissent une
impression de vertige tant la diversité des inspirations et les échanges
entretenus entre les arts nourrissent la richesse de ce courant aussi
intense que bref dans l’histoire de l’art. Les noms de Fernand Knopff,
Arnold Böcklin, Puvis de Chavanne, Max Klinger, Lucien Lévy-Dhurmer
deviendront ainsi familiers au lecteur de cet ouvrage dont l’iconographie
prolonge encore la fascination suscitée par le symbolisme. Un voyage dans
un univers tissé de nuances et de sensibilité dont notre époque moderne
aurait profit à méditer…
« Kaïdara » d’Amadou Hampâté Bâ
illustré par Omar Ba, notes d’Amadou Hampâté Bâ. Introduction de
Souleymane Bachir Diagne. Introductions de Christiane Seydou et de
Bérénice Geoffroy-Schneiter. 40 œuvres d’Omar Ba et 70 détails. Editions
Diane de Selliers, 2024.

Avec Kaïdara, les éditions Diane de Selliers convient ses lecteurs à un
heureux mariage des sagesses ancestrales héritées du patrimoine de
l’Afrique de l’Ouest subsaharien et des arts contemporains. Ainsi que le
souligne l’éditrice : « Kaïdara, le conte initiatique peul d’Amadou
Hampâté Bâ, que nous présentons dans sa version versifiée, est nourri de
cette tradition. Il appartient au genre littéraire des janti, histoires
orales dont la structure est immuable, qui se transmettent, se répètent,
s’adaptent selon le public qui les écoute ». Cette écriture vivante dans
ses plus infimes variations rejoint ainsi les traditions orales
constitutives de l’Occident dont les nombreux récits témoignaient
également de cette adaptation du discours à son récepteur. Ce conte
initiatique d'Amadou Hampâté Bâ dialogue dans ce bel ouvrage avec les
œuvres de l’artiste sénégalais Omar Ba, des œuvres d’un foisonnement
lyrique impressionnant, véritable contrepoint au récit.

Trois compagnons de voyage, Hammadi, Hamtoudo et Dembourou, partent en une
quête initiatique à la découverte de la source de la connaissance et de la
sagesse. Parvenus au pays souterrain des génies-nains, ils rencontrent la
divinité Kaïdara qui, elle-même, émane du dieu créateur Guéno. Cette
pensée symbolique pourra dès lors développer l’éventail de ses
représentations en questionnant les thèmes de l’identité et du sens de la
vie. Ces signes révélés formeront ainsi l’enseignement de ces trois
personnages qui ressortiront de cette épopée avec chacun trois bœufs
chargés d’or, à eux d’en faire bon usage. Le foisonnement qui égaie ces
pages superbement illustrées convie les personnages – et le lecteur – au
questionnement de ces signes qui se présentent à eux : le caméléon, la
chauve-souris, le scorpion, et autres émanations de la nature auront
chacun un message à transmettre, une leçon de vie à suivre ou à
méconnaître, et toujours ponctué par ce refrain :
Je suis le symbole du pays des génies-nains
et mon secret appartient à Kaïdara,
le lointain, le bien proche Kaïdara…
Quant à toi, fils d’Adam, va ton chemin.
Nous retrouvons la force et la beauté de la pensée symbolique si chère à
Claude Lévi-Strauss et dont les différents niveaux de lecture convergent
souvent avec nos propres mythes fondateurs. Cette ode africaine a non
seulement valeur initiatique, mais également valeur de transmission, celle
des enseignements légués par une tradition millénaire et que la modernité
pourrait bien balayer d’un seul vent de « modernité »…

Pour un tel texte, il fallait une collaboration artistique à la hauteur ;
aussi, les éditions Diane de Selliers ont-elles retenu pour cela l’artiste
sénégalais Omar Ba qui a signé une quarantaine d’œuvres tout spécialement
réalisées pour cet ouvrage. Associant techniques mixtes et virtuosité
foisonnante, Omar Ba s’est littéralement imprégné de l’univers de Kaïdara
parvenant ainsi à se faire l’écho de ces forces vives et sensibles
véhiculées tout au long de ce récit traditionnel alliant spiritualité,
poésie et art.
« L’art des jardins à travers
l’Europe au Siècle des Lumières » de Jean-Marc Schivo, Editions Dervy,
2024.

Avec ce splendide ouvrage, Jean-Marc Schivo nous propose de (re)découvrir
« L’art des jardins à travers l’Europe au Siècle des Lumières » en nous
ouvrant les portes de trente-cinq jardins emblématiques de cette époque.
Que cela soit, bien sûr, Versailles, mais aussi le Désert de Retz ou
encore Bagatelle, tous ces lieux, encore connus de nous, nous rappellent
qu’en ce siècle des Lumières, en ce XVIIIe siècle, les jardins deviennent
dans toute l’Europe de véritables carrefours de sciences, de philosophie
et de culture à ciel ouvert. A l’initiative de propriétaires fortunés et
des hommes qui les ont réalisés, on songe à Hubert Robert pour la France
ou le Prince de Ligne pour la Belgique, ces espaces privilégiés européens
laissent en effet transparaître toute la philosophie des Lumières,
s’enrichissant de symboles, d’allégories et d’innovations architecturales
; grottes, temples de l’amour, pyramides et obélisques marquent ainsi de
leur puissance évocatrice ces espaces naturels à l’instar des œuvres d’un
Jean-Jacques Rousseau. Mais sait-on encore les lire ou les décrypter
aujourd’hui ?
Magnifiquement illustré et commençant par « Une promenade initiatique »,
ce sont les clés et les secrets de ce symbolisme et philosophie traduisant
tout « L’art des jardins à travers l’Europe au Siècle des Lumières » que
nous transmet dans cet ouvrage de plus de 450 pages Jean-Marc Schivo. Nous
dévoilant ainsi toutes les subtilités des jardins et parcs du XVIIIe
siècle, entrelaçant alchimie, esthétique et nature, l’auteur nous invite
dès lors à franchir leur seuil et à parcourir , en second lieu, l’Europe,
de l’Angleterre avec des Jardins fabuleux tels que ceux du Castle Howard
ou encore de Stourhead… à l’Italie avec notamment Caserte en passant par
l’Allemagne, la Belgique, mais aussi la Pologne, la Suède ou encore la
Russie sans oublier, bien sûr, la France avec également Monceau ou
Ermenonville…
Mêlant lettres, arts et philosophies, la splendeur des jardins des
Lumières méritait assurément une telle somme à la fois riche et
parfaitement accessible.
« Artemisia Gentileschi » sous la
direction d’Asia Graziano, traduit de l’italien par Renaud Temperini et de
l’anglais par Jean-François Allain, Éditions Citadelles et Mazenod, 2025.

C’est une superbe monographie qui vient de paraître aux éditions
Citadelles et Mazenod consacrée à l’artiste peintre Artemisia Gentileschi
(1593- vers 1654) sous la direction d’Asia Graziano, historienne de l’art
et docteur de l’université de Pérouse. Artemisia, l’une des premières
femmes peintres célébrées de l’histoire de l’art, ainsi que le souligne
l’auteur, méritait une telle étude tant les découvertes et réattributions
quant à ses œuvres ont été nombreuses ces dernières décennies et ont
permis de redécouvrir tout son talent, audace et singularité. Asia
Graziano souligne dès les premières lignes de son introduction « la
personnalité aussi complexe que fascinante d’Artemisia Gentileschi » qui
demeure « un cas unique, inassimilable à celui de ses consœurs peintres,
Giovanna Garzoni, Lavinia Fontana, Elisabetta Sirani ou Fede Galizia, qui
lui sont souvent associées (…) ».
Née à Rome à la fin du XVIe siècle, fille du non moins célèbre peintre
Orazio Gentileschi, elle sera formée dans l’atelier de son père avant
d’être admise à l’Académie de dessin de Florence. Le talent précoce de la
jeune fille sera reconnu très tôt par son père admiratif. Asia Graziano
revient sur ces années décisives que ce soit sur « La formation romaine de
la peintre talentueuse » ou sur l’ « Affirmation et [sa] reconnaissance
dans la Florence des Médicis ». Artemisia sut relever, en effet, bien des
défis et sa vie fut marquée par des tragédies ; rappelons que la jeune
fille fut violée par un ami de son père et dut subir un procès
traumatisant puisqu’elle fut torturée pour savoir si elle disait la
vérité. À la suite de ce scandale, Artemisia quitta Rome pour Pise,
Florence, Venise ou encore Naples. Au cours de ces voyages et séjours qui
la menèrent jusqu’en Angleterre, Artemisia connut la reconnaissance des
plus grandes cours européennes avec de prestigieuses commandes
d’aristocrates et de collectionneurs. Nombre de ses toiles, pour certaines
de grands formats, d’inspiration notamment caravagesque, en témoignent : «
Judith décapitant Holopherne » ou encore « David et Goliath ».
Avec une iconographie remarquable, s’appuyant sur les archives (voir la
contribution de Sheila Barker) ou encore des lettres de l’artiste,
l’ouvrage revient longuement sur cette belle notoriété qu’Artemisia su
conquérir de son vivant dans « Ombres et lumières du séjour vénitien » ou
encore « La consécration napolitaine ». Mettant en avant de grandes
œuvres, pour certaines très récemment authentifiées, et même un inédit – «
La Charité romaine », l’amateur d’art découvrira en ces pages combien
cette femme artiste sut, en effet, faire preuve de courage et d’audace.
Gregory Buchakjian revient dans sa contribution – « Nos vies avec
Artemisia », sur cette singulière trajectoire artistique ; Que ce soit son
talent pour les portraits pour lesquels elle fut une des rares femmes
peintres à en recevoir officiellement commande, pour ses autoportraits,
mais aussi et surtout par la délicatesse et sensibilité de son art.
Artemisia n’hésita pas effectivement à peindre avec beaucoup de sensualité
le corps des femmes offrant ainsi à la postérité de véritables
chefs-d’œuvre. Claudio Strinati souligne : « Il ne fait aucun doute qu’Artemisia
Gentileschi fut l’une des premières artistes à avoir donné à ses créations
une signification ouvertement autobiographique ».
C’est cette audacieuse singularité de cette artiste du XVIIe siècle que
fut Artemisia Gentileschi que nous propose de découvrir cette riche et
somptueuse étude.
« Alpine Passes of Switzerland -
Journey to Modernity », Editions Scheidegger & Spies, 2024.

L’ouvrage Alpine Passes of Switzerland, paru aux éditions Scheidegger &
Spies nous invite à redécouvrir toute la majesté des Alpes suisses par le
truchement de photographies exceptionnelles. Véritable chant d’amour à la
splendeur de ces cols alpins, ce bel ouvrage atteste de la place et de
l’importance de ces témoins silencieux dans la culture et l’histoire du
pays. Page après page, le lecteur pourra ainsi arpenter ces chemins
sinueux, à l’ombre de ces cimes vertigineuses où la neige se dispute avec
les nuages pour envelopper les sommets.

La grandeur de ces paysages alpins a de tout temps inspiré
poètes, artistes et penseurs tel le penseur et philosophe Nietzche qui
leur vouait une admiration sans limites.
Les illustrations remarquables retenues pour ce beau livre témoignent de
la majesté de ces paysages, alternant clichés anciens et 80 photographies
contemporaines grand format de Richard von Tscharner d’une rare qualité,
et font idéalement écho aux nombreux textes explorant le lien intime
unissant les Suisses à leurs montagnes.

Pâturages alpins et cimes vertigineuses se succèdent dans
ce livre inspirant, laissant au lecteur le sentiment d’un paysage encore
préservé des ravages de la modernité. Entre éloge des pionniers des
générations précédentes qui permirent cette ouverture de la montagne au
plus grand nombre et réalités du présent, l’ouvrage n’écarte aucun sujet,
y compris celui du fameux tunnel du Gotthard.
Une somme indispensable à tous les amoureux de la Suisse et de la
montagne, synonyme de voyage sur les plus hauts sommets !
"Revoir Cimabue. Aux origines de
la peinture italienne", sous la direction de Thomas Bohl, Editions Silvana
Editoriale – Le Louvre, 2025.

Le catalogue paru aux éditions Silvana Editoriale/Musée du Louvre consacré
à Cimabue fera entrer le lecteur au cœur même d’une période cruciale dans
l’histoire de la peinture occidentale, à savoir le XIIIe s. florentin.
Accompagnant l’exposition éponyme actuellement au musée du Louvre du 22
janvier au 12 mai 2025, cette somme dirigée par Thomas Bohl, commissaire
de l’exposition et Conservateur au département des Peintures du musée du
Louvre, explore en effet les profonds changements introduits par
l’artiste, une évolution picturale qui aura une influence déterminante sur
ses contemporains, et surtout sur les siècles à venir.
Dès l’introduction, Thomas Bohl nous présente Cimabue – dont nous n’avons
guère d’informations biographiques – dans le contexte culturel et
religieux de l’Italie du XIIIe siècle, un contexte essentiel non seulement
à la compréhension de son œuvre, mais de manière plus générale pour
appréhender la société de cette époque. L’ouvrage, à défaut de nous faire
connaître qui était Cimabue, invite son lecteur à découvrir son œuvre au
travers notamment des nombreuses et riches contributions de spécialistes
réunis à l’occasion.
Ainsi, la « manière grecque » et la peinture sur bois au XIIIe s. dans la
Toscane de cette fin du XIIIe s font-elles l’objet d’analyses détaillées.
L’intérêt se portera bien sûr sur l’impressionnante restauration réalisée
sur la célèbre Maestà du Louvre, souvent présentée comme l’œuvre
emblématique de la naissance de la peinture occidentale, voie prolongée
par son élève Giotto, et plus tard par les artistes de la Renaissance.
Après avoir enquêté sur l’emplacement originel de la Maestà, les auteurs
décrivent comment ont été retrouvés les délicates couleurs originelles et
certains détails comme ces étonnantes inscriptions pseudo-arabes
jusqu’alors masquées par les vernis successifs. Un autre point
d’importance est également abordé dans le catalogue avec la récente
acquisition par le musée du Louvre de La Dérision du Christ, ce panneau
inédit redécouvert en France en 2019 et acquis en 2023 par le musée
parisien. Si l’on considère le peu d’œuvres connues de Cimabue, une
quinzaine seulement, cette acquisition exceptionnelle permettra d’enrichir
ce que nous savons de l’artiste et de son œuvre dans le conteste du
franciscanisme dans lequel il travaillait. Enfin, l’ouvrage explore en
conclusion les nombreuses novations apportées par Cimabue, innovations
picturales qui révèlent toute sa modernité et que Giotto et Duccio
développeront vers plus de naturalisme à l’aube d’un nouveau monde.
"Pierre Subleyras (1699–1749)" de
Nicolas Lesur ; Préface de Pierre Rosenberg de l'Académie française ;
Relié, 24 × 32 cm, 556 p., 889 ill., Editions ARTHENA, 2023.

Le nom de Pierre Subleyras – guère familier au grand public aujourd’hui –
renvoie pourtant à l’une des figures majeures de la peinture du XVIIIᵉ
siècle, un artiste au sommet de sa gloire à Rome, où il fut adoubé de son
vivant. Avec sa grâce singulière dans l’art du portrait, son aptitude à
exprimer avec justesse les émotions religieuses et son sens des couleurs à
la fois subtil et puissant, Subleyras s’inscrit en effet comme un artiste
incontournable de son époque. L’édition de la magistrale monographie de
Nicolas Lesur, parue aux éditions Arthéna, rend hommage à cet artiste, un
bel hommage à la hauteur de son talent.
L’ouvrage, préfacé par l’académicien Pierre Rosenberg, replace la carrière
de Subleyras dans une perspective historique et artistique ambitieuse.
Rosenberg n’hésite pas à comparer sa position à Rome à celle de Nicolas
Poussin un siècle auparavant : « La position de Subleyras à Rome est en
quelque sorte comparable à celle de Poussin un siècle plus tôt. Sans guère
de lien avec les peintres ses contemporains, mais protégé par un pape –
Benoît XIV (1675-1758), que l’on reconnaît sur L’Atelier –, Subleyras mena
la carrière qu’il voulut sans trop se soucier de ses rivaux. » Le soutien
de Benoît XIV s’avéra effectivement déterminant dans le rayonnement de
l’artiste, qui, à l’instar de Poussin, sut conjuguer indépendance créative
et reconnaissance institutionnelle.
Ce bel ouvrage n’est pas cependant qu’une pure réhabilitation ; il est
également une exploration d’un artiste dont la postérité, bien que plus
discrète, a toujours été vive parmi les amateurs et les collectionneurs
italiens. Nicolas Lesur souligne, dans une introduction rigoureuse, que
Subleyras ne saurait être considéré comme un peintre oublié, mais plutôt
comme une figure appréciée de son temps et au-delà. L’intérêt pour cet
artiste reçut une confirmation importante dans la grande rétrospective que
lui consacra le musée du Luxembourg en 1987, une exposition qui permit au
grand public de redécouvrir l’ampleur de son génie.
L’ouvrage de Lesur ne se contente pas, non plus, d’énumérer les
chefs-d’œuvre de Subleyras. Il en détaille aussi les nuances, en explorant
notamment les dimensions spirituelles et émotionnelles de ses œuvres
religieuses. Que ce soit dans Saint Camille de Lellis intercédant pour les
victimes de la peste ou dans ses portraits pleins de majesté et de
tendresse, le peintre excelle à traduire l’intensité des sentiments
humains. Sa maîtrise des textures et des jeux de lumière témoigne d’une
subtilité qui continue de fasciner les experts.
Cette monographie est également, enfin, une invitation à replacer
Subleyras dans le contexte plus large de l’histoire de l’art européen. En
rendant hommage à cet artiste franco-romain, l’ouvrage contribue en effet
à enrichir la perception d’un XVIIIᵉ siècle foisonnant où se croisent
influences et talents. Pierre Subleyras trouve ainsi toute sa place aux
côtés des plus grands, entre son héritage français et son rayonnement
italien.
Par la richesse de ses analyses, la beauté des illustrations, cette
monographie s’impose comme un hommage vibrant et nécessaire à un artiste
qui, comme Poussin avant lui, incarne l’un des plus beaux dialogues entre
la France et l’Italie.
« Mode et estampe japonaise »
d’Anna Jackson et Masami Yamada, Citadelles & Mazenod Editions, 2024.

Ce sont les trésors de la riche collection du Victoria and Albert Musuem
que nous propose de découvrir les éditions Citadelles & Mazenod avec ce
beau livre « Mode et estampe japonaise » signé par Anna Jackson et Masami
Yamada. Il est bien connu dorénavant en occident que l’univers chatoyant
de l’ukiyo-e s’est très tôt saisi des modes vestimentaires japonaises de
l’époque, motifs infinis des plus belles estampes réalisées par les grands
maîtres du genre, même si les riches collections du musée anglais
demeurent plus confidentielles. Aussi, le présent ouvrage lève-t-il le
voile sur les splendeurs conservées en ces lieux avec plus de 200 estampes
des grands maîtres tels Utamaro, Hiroshige, Kunisada, Kuniyoshi, Keisai
Eisen…
Après avoir rappelé en introduction l’émergence de l’ukiyo (monde
flottant) dans le milieu dynamique des citadins, Modes et estampe
japonaise explore le riche lien entre mode japonaise et art de l’estampe,
un lien essentiel dans la diffusion des styles et représentations de la
culture japonaise depuis le XVIIIe siècle. Par le truchement de l’estampe
et des maîtres de l’ukiyo-e (notamment Hokusai et Hiroshige), de nouvelles
tendances apparaissent et ces gravures colorées sur bois surent se saisir
des pratiques vestimentaires de l'époque. Parallèlement aux inoubliables
paysages ayant inspiré les plus grands maîtres, les vêtements font l’objet
de descriptions particulièrement détaillées et minutieusement colorées
ainsi qu’il ressort de cet ouvrage abondamment illustré.

Ces estampes sont les témoins privilégiés de l’évolution de la mode
japonaise au fil des époques Edo et Meiji, ainsi que le soulignent les
auteurs. Ces derniers insistent également sur l’influence internationale
de ces œuvres, notamment sur les artistes et créateurs européens à partir
du XIXe siècle, lorsque les estampes deviendront populaires en Occident et
contribueront notamment au mouvement du japonisme. Cette somme sur le
sujet explore encore les symboles, matériaux et techniques propres aux
vêtements et aux imprimés de cette époque. Le lecteur sera ainsi à même de
mieux en saisir leurs significations sociales et culturelles, qu’il
s’agisse du monde du théâtre essentiel pour l’estampe japonaise, mais
aussi dans la vie quotidienne.
« Venise vue d’en haut » de
Riccardo Roiter Rigoni et Debora Gusson,
Éditions Jonglez, 2023.

Si pour Casanova, « Venise n’était pas là-bas, mais là-haut ! », avec
Riccardo Roiter Rigoni et Debora Gusson, la Sérénissime est plus haute
encore puisque c’est vue des nuages, du ciel même, que ces auteurs nous
proposent de la découvrir ! Une découverte de Venise insolite d’autant
plus originale et plaisante que ce voyage de haut vol nous entraîne non
seulement à la rencontre de la célèbre cité, de ses toits et campaniles,
mais également de sa lagune et de ses si nombreuses îles, tel un astre
précieux et majestueux entouré de ses satellites. Des îles et îlots à
l’histoire, au passé et présent aussi divers que leur forme vue
d’hélicoptère. Bien sûr, nous avons tous en tête « San Michele, l’un des
plus beaux cimetières du monde », Le Lido avec son « Charme liberty de
l’Île d’or », Burano ou Murano ; mais de si haut que savons-nous vraiment
de ces îles ? Et que dire de ces îlots perdus ou esseulés parfois, on
songe à Madonna del Monte ou encore à Torcello, des îles souvent méconnues
voire négligées du tourisme et dont le temps semble s’être arrêté... Que
nous racontent encore, piqués par notre curiosité, Lio Piccolo au clocher
arménien ou La Salina, cet ancien archipel d’Ammiana ? Venise et sa lagune
sont inscrites depuis 1987 par l’UNESCO au patrimoine mondial et que de
beauté, curiosité et étonnements nous offre, tant par ses splendides
photographies signées Riccardo Roiter que par ses textes, cet ouvrage au
format italien. Comment, en effet, résister à un tel dépaysement, à un tel
vol d’oiseau ? Alors, et ainsi que nous y invitent Riccardo Roiter Rigoni
et Debora Gusson, « Prêts pour le décollage ? ».
Jean-Jacques Audubon : « Le Grand Livre
des Oiseaux », Sous la direction de Roger Tory Peterson et Virginia Marie
Peterson ; 30,5 x 38,1 cm, Éditions Citadelles & Mazenod, 2023.
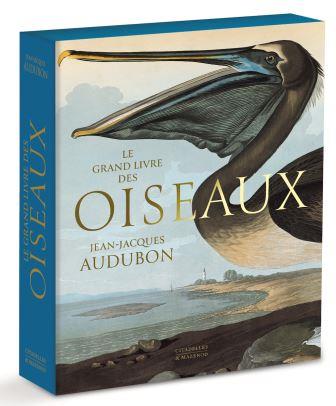
Lorsque l’on évoque les plus belles représentations des oiseaux du monde
au XIXe siècle, le nom de Jean-Jacques Audubon (1785-1851) vient
immédiatement à l’esprit, cet artiste français nous ayant laissé
d’admirables – et si reconnaissables – planches ornithologiques uniques en
leur genre. C’est à ce prestigieux legs que s’est attaché cette
publication monumentale des éditions Citadelles & Mazenod sous la
direction de deux spécialistes, Roger Tory Peterson et Virginia Marie
Peterson, avec cet ouvrage exceptionnel de près de 700 pages en un
généreux format XXL. Cette remarquable somme regroupe 554 illustrations
couleur sous étui illustré et est accompagnée d’un portfolio très soigné
de 5 reproductions d’Audubon.
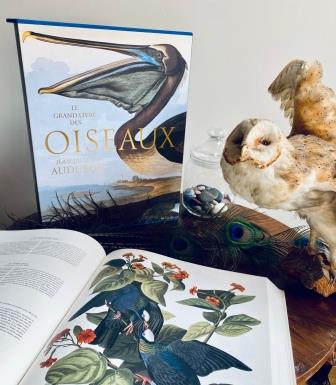
Les « Oiseaux d’Amérique », car tel est son titre, compte
parmi les fleurons du genre, l’artiste ayant de 1827 à 1838 publié ces 435
planches passées depuis à l’immortalité. Bien entendu, de nos jours, c’est
avant tout la qualité esthétique qui retiendra l’attention, avec des
planches d’une grande précision aux délicates couleurs chatoyantes, chaque
animal étant replacé dans son cadre naturel tel ce flamand rose
s’abreuvant au bord de l’eau ou encore ces chouettes Harfang perchées sur
leur arbre… La qualité d’exécution force l’admiration avec ce regard porté
notamment sur certaines espèces aujourd’hui disparues, rendant ce
témoignage encore plus précieux.
Audubon livre ainsi un somptueux ouvrage réunissant 1065 oiseaux de la
Floride à l’Arctique, oiseaux des mers comme des marais, impressionnants
ou très discrets. L’artiste a souhaité à l’époque qu’ils soient
représentés à taille réelle et ce souci d’exactitude confère à cet ouvrage
une dimension scientifique de premier plan pour cette époque où la
photographie n’existait pas encore, les premiers daguerréotypes n’étant
datés que 1839… Le lecteur découvrira également grâce aux nombreuses
notices préparées avec soin les habitudes de vie de ces oiseaux marins,
charognards et autres plongeurs des lacs, sans oublier les oiseaux des
forêts et prairies…
Une somme aussi belle à admirer que passionnante à lire.
« L’Olympisme. Une Invention
moderne, un héritage antique. », Collectif, catalogue Officiel de
l’exposition « L’Olympisme. Une Invention moderne, un héritage antique. »
au Musée du Louvre., Co-édition Musée du Louvre / Editions Hazan, 2024.

C’est un réel plaisir que de découvrir aux éditions Hazan « L’Olympisme –
Une Invention moderne, un héritage antique », le catalogue officiel de
l’exposition éponyme présentée au musée du Louvre jusqu’en septembre 24.
Cet ouvrage sous la direction des trois commissaires de l’exposition –
Christian Mitsopoulou, Alexandre Farnoux et Violaine Jeammet – offre, en
effet, un bel éclairage alliant histoire et enjeux de l’Olympisme
d’aujourd’hui, cette « invention moderne, un héritage antique », ainsi que
l’annonce son titre. Appuyé par une vaste iconographie, l’ouvrage de plus
de 300 pages livre une analyse moderne, dynamique et actualisée des Jeux
olympiques, une étude loin d’être dénuée d’intérêts notamment de par la
découverte d’archives inédites.
Le premier volet de l’ouvrage est consacré aux symboles des Jeux
(couronnes, anneaux, drapeaux…) et aux acteurs – comment ne pas rappeler,
en effet, la figure la plus emblématique des Jeux : Pierre de Coubertin ?
– Patrick Clastres revient avec passion dans une première contribution sur
cette « Genèse de l’idée olympique chez Pierre de Coubertin », suivent des
figures également incontournables telles que Michel Bréal pour le
marathon, Gilliéron ou encore D. Vikélas. Après avoir rappelé que Paris
fut trois fois capitale olympique en moins de 125 ans, Christian Le Bas
ferme ce tout premier chapitre en faisant de Paris, capitale des sports,
le berceau même de cet olympisme moderne avant que ne s’ouvre le deuxième
volet, cœur de cette riche étude : « Olympisme entre invention et héritage
».
Un chapitre majeur et captivant couvert par plus de vingt contributions et
abordant des thèmes aussi originaux que porteurs tels les timbres édités à
l’occasion des jeux, les affiches, cartes postales, mais aussi, bien sûr,
les trophées, médailles, les hymnes ou encore des sujets certes plus
classiques, mais tout aussi passionnants notamment l’ « Athlétisme et
entraînement militaire dans le monde grec : complémentaires ou
antagonistes ? » ou « Gestes antiques en scènes »… De riches contributions
que vient illustrer idéalement une iconographie des plus soignées et
choisie.
Le catalogue se referme sur un dernier chapitre consacré à l’ « olympisme
et politique » avec, bien sûr, « Berlin 1936 », mais également des
contributions venant souligner la place des femmes hier et aujourd’hui
dans les jeux Olympiques. Un ouvrage aussi riche que passionnant.
« Chagall – La Fontaine – Les
Fables » par Ambre Gauthier ; Relié, 26 x 31 cm, 240 pages, 100
illustrations, Editions Hazan, 2023.
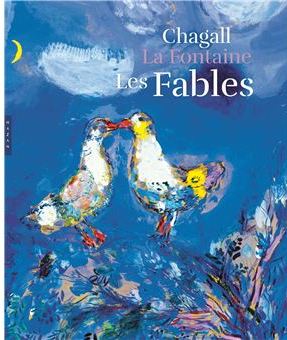
Comment ne pas succomber à cette belle publication en grand format parue
aux éditions Hazan des Fables de Jean de La Fontaine illustrées par Marc
Chagall ? Un bijou de l’édition que l’on doit initialement au célèbre
marchand d’art, Ambroise Vollard ; ce dernier réalisa, en effet, en 1926
l’une de ses « plus tenaces ambitions d’éditeur » en demandant au non
moins célèbre artiste russe d’illustrer ce monument du patrimoine
littéraire français, les Fables de La Fontaine. Pour cet ambitieux projet,
Marc Chagall réalisera alors plus d’une centaine de gouaches en couleurs
préparatoires au travail sur gravure, offrant ainsi un véritable et
incomparable dialogue inédit ! Car, il s’agit bien d’un magnifique
dialogue à nul autre pareil entre l’un de nos plus célèbres poètes et
fabulistes et le non moins reconnu artiste russe que fut Marc Chagall.
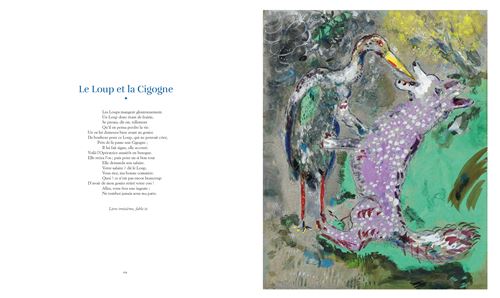
C’est cette fabuleuse rencontre que nous offrent aujourd’hui les éditions
Hazan au travers de gouaches, gouaches et crayons, gouaches et aquarelle,
avec pour certaines, et ce pour la première fois, leur correspondance en
gravure. Comment en lisant chaque fable ne pas, dès lors, laisser son
imagination s’envoler vers ces ciels d’un bleu infini avec ces animaux
multicolores, ce « Coq et le Renard » tout de couleur ou encore ce loup
rose à pois blancs du « Loup et la Cigogne » ? Des couleurs qui éclatent
comme pour ce « Lion amoureux » et que les aplats gris griffés des
gravures viennent rehausser plus encore. Les Fables trouvent un écrin
fabuleux à leur dimension dans cette nature singulière et omniprésente.
Une nature qui « unifie les compositions, légère et subtile comme l’air
ambiant, permettant aux espaces et aux temps de fusionner, de glisser
paisiblement d’un tableau à l’autre, d’un univers à l’autre » note en son
introduction « Les vibrations multicolores du noir et blanc » Ambre
Gauthier, spécialiste de Marc Chagall.
Une splendide publication qui se veut, à juste titre, un très bel hommage
à cette rencontre.
« Jean Delpech – L’œuvre de guerre
» sous la direction d’Hélène Boudou-Reuzé ; Préface d’Arianne
James-Sarazin ; 28 x 22 cm, 328 p., Editions InFine, 2023.
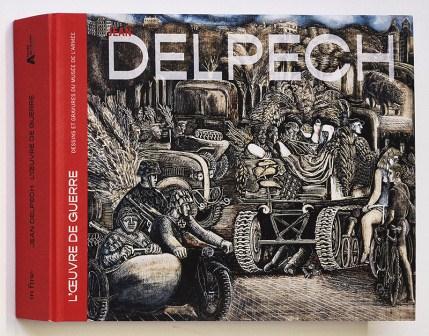
C’est un bel ouvrage dédié à l’œuvre de guerre de Jean Delpech (1916-1945)
que nous proposent les éditions InFine. Un ouvrage long format
exceptionnel réunissant l’ensemble de ses gravures et dessins consacrés à
la Seconde Guerre mondiale. Jean Delpech, graveur de renom, a en effet
représenté de manière quasi-obsessionnelle de 1938 à 1945 toutes les
images de guerre, mais aussi d’occupation et de libération qui se sont
imposées à lui durant ces années de conflit. Delpech observe tout, regarde
et regarde encore... C’est un véritable témoignage d’une époque sombre et
déchirée qu’a entendu laisser par une œuvre atypique l’auteur, Jean
Delpech, et sur laquelle reviennent dans de riches contributions Hélène
Boudou-Reuzé, assistante de conservation et chef de projet au musée de
l’Armée, et Laétitia Desserière, chargée des collections de dessins au
département iconographie du musée de l’Armée. Foisonnement de détails,
mais aussi d’associations et de traumatismes, ces œuvres retiennent
indéniablement longuement l’attention… Une « Obsession du dessin » et un «
infatigable graveur », des thèmes incontournables pour appréhender l’œuvre
de guerre de Jean Delpech que développe également dans deux essais
Laétitia Desserrière.
Né au Viêtnam au début du siècle dernier, les œuvres de Jean Delpech
retracent ses années où il sera, d’abord, lors de son service militaire,
soldat dans le 15e bataillon de chasseurs alpins de 1938 à 1939, puis
soldat dans l’armée française durant la guerre, avant de devenir
correspondant de guerre en Allemagne en 1945 ; une personnalité complexe
et un parcours sur lesquels revient Brigitte Delpech.
Le lecteur découvrira, en seconde partie de l’ouvrage, un catalogue de
l’ensemble de cette œuvre graphique de guerre – plus de 700 estampes et
dessins conservés au musée de l’Armée. Un catalogue ordonné de manière
thématique et qu’accompagnent encore de nombreux textes dont « La guerre
imaginée », « Trophées et monuments », « Delpech reporter de guerre » ou
encore « œuvres d’après-guerre » ...
« L’Album de Marie-Antoinette –
Recueil des vues et plans du Petit Trianon – 1781 », « Étude et
commentaires » par Elisabeth Maissonier, coédition Château de Versailles /
Éditions In fine , 2023.
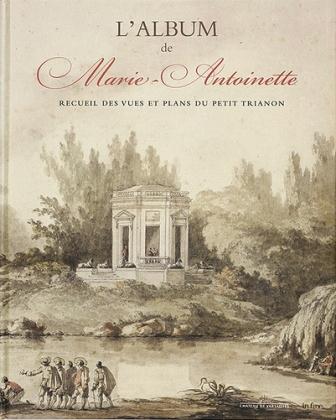
Quelle plus belle présentation pouvait-on souhaiter pour ce merveilleux «
Album de Marie-Antoinette » dédié aux Petit Trianon et à ses jardins que
celle des éditions In Fine !
Parcourant du regard, le coffret cartonné de cet « Album de
Marie-Antoinette » orné d’un dessin représentant le belvédère du Petit
Trianon et la grotte du jardin anglais, le lecteur songe déjà… avant
d’ouvrir et de découvrir d’un côté le « Recueil des vues et plans du Petit
Trianon » de 1781, et de l’autre, à droite, une « Étude et commentaires »
réalisés par Elisabeth Maisonnier.
Rappelons que c’est en 1774 que Louis XVI devenu alors roi de France offre
à Marie Antoinette le Petit Trianon commandé par son grand-père Louis XV
et achevé moins de dix années auparavant en 1768. Marie-Antoinette
entreprendra de suite d’en redessiner les jardins. Ce sera alors une
succession de véritables décors végétaux dans l’air de la Cour qu’elle
fera exécuter ; des jardins dans le style « anglo-chinois » dans lesquels
prendront vie grottes, temples, belvédère et l’émerveillement des fêtes
royales… Marie-Antoinette commandera à Richard Mique, son architecte,
plusieurs grands recueils. C’est la splendide reproduction de l’un de ces
recueils aquarellés et illustrés par les aquarelles de l’artiste Claude
Louis Châtelet, celui précisément personnel de Marie-Antoinette, que le
lecteur aura le plaisir de parcourir …
Un voyage dans le temps, au Petit Trianon, à Versailles et même au-delà
dont Elisabeth Maissonier, conservatrice au Château de Versailles, nous
livre une étude aussi riche et passionnante que merveilleuse par sa vaste
iconographie. Aquarelles, dessins, plans et œuvres peintes viennent
continuer le plaisir des yeux. Une étude, plus-value indéniable et des
plus fructueuses, permettant au lecteur de comprendre et d’appréhender
pleinement tout le symbolisme et la place du Petit Trianon et de ses
jardins en cette fin de XVIIIe siècle.
« Peintures chinoises » de Xinmiao
Zheng et Hongxing Zhang, 32 x 42 cm, 210 illustrations, 272 pages,
Editions Citadelles & Mazenod, 2023.
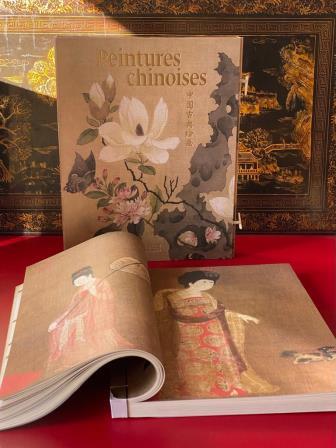
Rares sont les beaux livres sur la peinture chinoise en langue française,
les estampes japonaises accaparant souvent plus l’attention. Et pourtant,
la présente publication aux éditions Citadelles & Mazenod, « Peintures
chinoises », offre une splendide démonstration de la préciosité et
somptuosité millénaire de cet art trop souvent ignoré des occidentaux. Un
de ses meilleurs spécialistes, Xinmiao Zheng, directeur du musée du Palais
à Pékin, accompagné de Hongxing Zhang, signe cet ouvrage exceptionnel tant
par son iconographie que sa mise en page avec pas moins de 210
illustrations, sans oublier le large éventail couvert allant du début de
notre ère jusqu’au XIXe s.
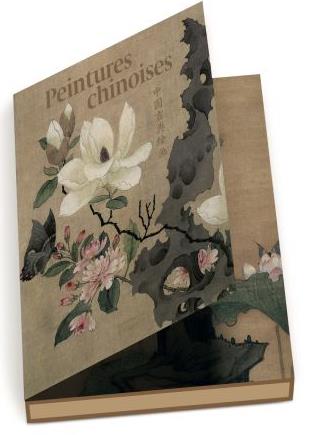
Monde lettré et artistes noueront rapidement au cours de cette longue de
l’histoire des liens si étroits qu’ils influenceront la réalisation même
de ces œuvres raffinées où chaque détail fait signe. Véritable cheminement
intérieur et spirituel, ces peintures manifesteront ainsi très tôt les
traits caractéristiques de la peinture chinoise où calme et sérénité
s’immiscent au sein même de la nature en de multiples symboles. Le pin,
les montagnes, les barques esseulées sur un lac prendront ainsi autant de
valeur, si ce n’est plus, que la représentation souvent discrète de
personnages, exception faite des peintures de personnage et hauts
dignitaires de la cour.
Avec un généreux format et sa somptueuse présentation, cet ouvrage en
reliure chinoise et sous coffret satin illustré convie le lecteur à entrer
dans un monde feutré et délicat à nul autre pareil où l’art de la peinture
suggère également un art de vivre.
« Le Nu » d’Alexis Merle du Bourg
; 26 x 37,5 cm, 320 ill., 352 p., Editions Citadelles & Mazenod, 2023.
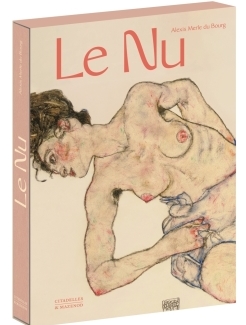
Le nu compte assurément comme l’une des représentations les plus anciennes
dans l’histoire – et même de la préhistoire - de l’art. Parfois privilégié
au dépend du paysage et de la nature, d’autres fois vilipendé au nom de
valeurs s’y opposant, le nu laisse rarement indifférent, suscitant
convoitises, passions, haine ou encore détestations… Sujet passionnant
auquel est justement consacré ce monumental ouvrage tant par ses
dimensions que par l’impressionnant grand angle retenu.
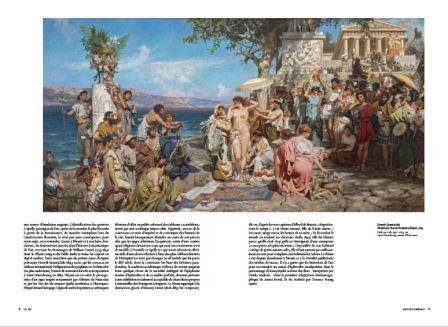
Cette somme remarquable signée par l’historien de l’art
Alexis Merle du Bourg étudie en effet les origines de cet art et ses
mythes fondateurs, la nudité de l’Eden et celle prisée des Grecs venant en
premier à l’esprit. Formes originelles encore pures mais déjà non dénuées
d’enjeux comme pour Aphrodite et Phryné, sans oublier le fameux Jugement
de Pâris… Chaque époque antique porte un nouveau regard sur la nudité,
qu’il s’agisse de la période hellénistique, bientôt touchée par les
influences de l’orient ou de celle du christianisme et des ambivalences
dans la représentation du corps dans la Bible.
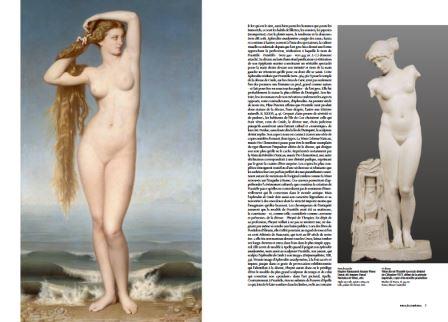
L’ouvrage somptueux par le choix de sa riche iconographie offre un
dialogue toujours renouvelé entre le texte d’une clarté lumineuse et les
plus belles œuvres d’art retenues par l’auteur, qu’il s’agisse de la
sculpture ou de la peinture. Chaque période ouvre sur une réflexion
portant sur l’homme, les artistes traduisant la plupart du temps l’esprit
qui prévalait en leur temps ainsi qu’il ressort de cette renaissance
humaniste ou encore de ce baroque revisitant l’antique en d’incroyables
audaces. Les pages consacrées à Rubens et à Poussin passionneront
également le lecteur tant l’interprétation de l’auteur concourt sans
hésitation à ce que le lecteur redécouvre ces œuvres. Nombreuses seront
encore les découvertes avec cet ouvrage passionnant tel le Nu à l’épreuve
de la modernité qui témoigne de la richesse de ce sujet qu’explore avec
brio cet ouvrage de référence.
« L’art des jardins en Europe » de
Yves-Marie Allain et Janine Christiany, 24,5 x 31 cm, Ouvrage broché avec
rabats, 632 pages, 544 illustrations, Citadelles & Mazenod, 2023.
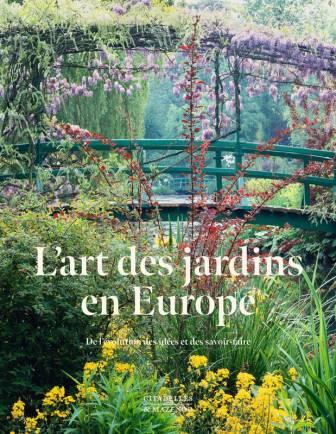
C’est une véritable somme sur l’art des jardins en Europe que nous
proposent Yves-Marie Allain et Janine Christiany avec cette publication
exceptionnelle de plus de 600 pages. L’ensemble du continent européen se
trouve appréhendé en un seul ouvrage à la riche iconographie (544
illustrations) par ces deux spécialistes offrant chacun une analyse propre
à leur parcours professionnel. Le jardin est depuis la nuit des temps
l’objet d’une riche symbolique – le fameux jardin d’Eden – et n’a cessé
depuis ses origines d’être l’objet de réflexions, passions et pouvoirs… Ce
sont ces intrications complexes qu’analysent les auteurs du présent
ouvrage aussi beau qu’instructif sur cet art des jardins que l’on pensait
à tort bien connaître et qui, après lecture, révèlera bien des facettes
méconnues. L’histoire, la philosophie, la religion tout autant que les
sciences ont été depuis longtemps convoquées parallèlement aux
connaissances scientifiques requises pour concevoir un jardin. Cette
symbolique manifeste dans bien des jardins de l’Ancien Régime tel celui
incontournable du Château de Versailles traduit les enjeux réunis dans un
grand nombre de conception de jardins en Europe. L’ouvrage aborde en
premier lieu l’ensemble de ces aspects de l’art du jardin où architectes,
jardiniers, pépiniéristes, horticulteurs mais aussi théoriciens sont
convoqués par les commanditaires, qu’ils soient officiels ou privés.
Quelle évolution peut ainsi être soulignée entre les jardins de la
Renaissance et ceux des années 1930 ! Car il est possible de parler de
style ainsi que le soulignent les auteurs à l’image de la mode
vestimentaire ou alimentaire. Le jardin forme un univers éphémère qui
demeure rarement identique quelques décennies après sa création, s’il ne
disparaît pas peu après… Aussi, ce tour d’Europe des 170 jardins
d’exception qui ont bravé le temps apparaîtra pour le lecteur qu’il soit
amateur ou professionnel un témoignage rare et précieux, des fameux
jardins d’Alhambra au non moins fabuleux de Claude Monet à Giverny, sans
oublier bien entendu Versailles, Lisbonne et le palais Fronteira, la villa
Borghèse à Rome et bien d’autres écrins uniques et oubliables qu’il sera
loisible de visiter en feuilletant les pages de ce remarquable et
inspirant ouvrage.
« Turner » de John Gage, traduit
de l’anglais par Hélène Tronc et Odile Menegaux, Coll. « Les Phares »,
Editions Citadelles et Mazenod, 2023.
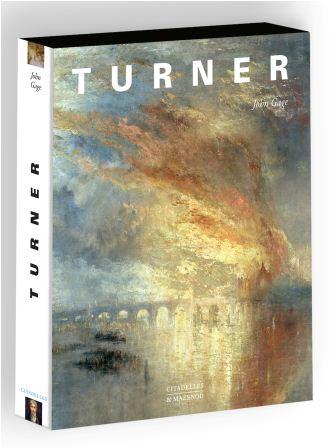
Sublime, tel est incontestablement le qualificatif qui
convient !
Sublime, bien sûr, par son sujet, puisque entièrement consacré à l’un des
plus grands artistes anglais du XIXe siècle, le peintre, aquarelliste,
dessinateur et graveur, J.M.W Turner.
Sublime, également, par la qualité de l’ouvrage lui-même, tant par sa
remarquable iconographie que par sa mise en page avec son grand format et
ses multiples et appréciables pleines voire doubles-pages.
Sublime, enfin, par la qualité du texte de cette monographie signée John
Gage et traduite de l’anglais par Hélène Trone et Odile Menegaux.
Comment, en effet, ne pas succomber à la beauté et richesse de l’œuvre de
Turner ? Comment, face à des toiles telles que « Fusées et signaux de
détresse pour prévenir les vapeurs des bas-fonds » de 1840 ou encore «
L’incendie des Chambres des Lords et des Communes » de 1834, ne pas
ressentir ce sentiment d’infinité ?
L’auteur a retenu pour cet ouvrage une approche thématique permettant de
cerner, mieux qu’une stricte chronologie ou biographie, les traits
marquants révélant tant l’évolution de l’œuvre que le caractère même du
peintre anglais. Le lecteur découvrira ainsi un Turner paysagiste et
théoricien de la couleur incontestable, une spécificité que le peintre a
développée tout au long de sa vie au travers de ses nombreux voyages, mais
qu’il a également su imposer à la Royal Academy. Turner, largement
soutenu par son père, fut introduit très jeune, en effet, dans les cercles
influents de la peinture anglaise et entra à un âge précoce dans cette
haute institution. Appuyé par de nombreux mécènes, cela lui valut une
réputation largement saluée de son vivant notamment par le célèbre
critique d’art Ruskin, mais aussi, ainsi que le souligne J. Gage, enviée
en retour par de nombreux rivaux.
Il en fallait, cependant, plus pour décourager ce peintre au caractère
certes introverti mais trempé, surtout doué d’un sens de l’observation
rare et d’une curiosité insatiable, « Un esprit merveilleusement divers »,
selon les mots de son contemporain Contestable et titre du dernier
chapitre de cette dynamique monographie. La richesse de l’œuvre de Turner
est, il est vrai, incomparable, lui qui sa vie durant n’eut de cesse de
rendre au mieux la lumière et l’atmosphère, une quête de liberté qui
marqua par son œuvre autant le romantisme qu’il annoncera
l’impressionnisme ou encore l’abstraction. Cependant, à ce constat, J.Gage
ajoute malicieusement et à juste titre : « L’interprétation moderniste
de Turner est devenue courante et même une tradition bien établie. Elle
est pourtant bien insuffisante pour saisir l’ampleur et l’originalité de
son art ». Que dire de plus ?
« Histoire & médecine » d’Alexis
Drahos, relié sous coffret, 352 p., Editions Citadelles & Mazenod, 2022.
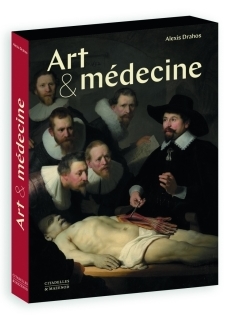
Livre d’art ? Livre de sciences ? Le dernier ouvrage paru aux éditions
Citadelles & Mazenod conjugue avec un rare bonheur et sous la plume
d’Alexis Drahos les deux approches en une synthèse des plus éclairantes
sur les origines de la médecine depuis l’Antiquité vue par l’art. En un
véritable parcours au fil des siècles illustré par les plus grandes œuvres
d’art, « Art & médecine » explore en effet pour la première fois en langue
française les liens entretenus entre les deux arts. Le corps humain, tour
à tour secret puis dévoilé au gré des découvertes anatomiques, n’a cessé
de fasciner les artistes qui ont cherché à en capter les mystères dans
leurs créations. Le lecteur apprendra ainsi que des scènes de dissection
avaient déjà été saisies par des artistes dès l’Antiquité et bien avant
les fameuses études de Léonard de Vinci…
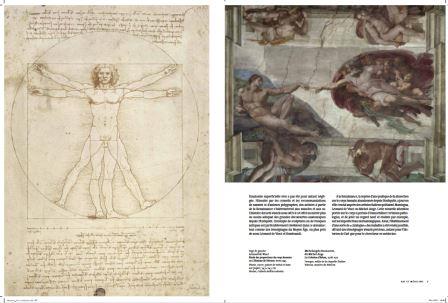
L’œuvre d’art n’a pas qu’une fonction esthétique dans ses
rapports à la médecine et bien souvent elle a été un moyen de consigner
les connaissances et d’en diffuser les savoirs. Rivalisant de dextérité
avec les médecins, ces artistes œuvrent, pour certains d’entre eux, selon
une véritable démarche scientifique dans leurs représentations du corps
humain, même si les sciences invalideront seulement ultérieurement
certaines de leurs conclusions. Ce sont toutes les disciplines médicales
dont nous pouvons ainsi suivre les évolutions au fil des dessins,
gravures, peintures et autres écorchés en cire… Les pathologies s’invitent
également en ces pages parfois dérangeantes, mais révélant les progrès des
sciences. Que de chemin parcouru en effet entre les redoutables saignées
de l’Ancien Régime et nos transplantations cardiaques !
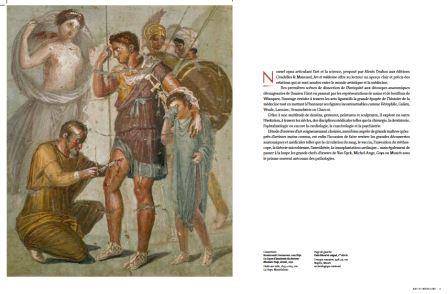
L’un des multiples intérêts de cet ouvrage passionnant sera d’offrir une
sélection des plus inspirées des œuvres maîtresses de l’histoire de l’art,
l’auteur étant sur le sujet intarissable qu’il s’agisse de Léonard de
Vinci ou de Damien Hirst, d’Erasistrate de l’école d’Alexandrie ou des
leçons d’anatomie sous le pinceau de Rembrandt. Chaque siècle témoigne de
son rapport au corps et à ses pathologies – une mise à jour des plus
actuelles inclut même la terrible Covid-19, l’acuité du regard de
l’artiste n’étant souvent pas moindre que celui de l’homme de sciences
ainsi qu’en témoigne ce bel et riche ouvrage qui n’aurait probablement pas
déplu à Nicolas Bouvier, fasciné par de telles représentations, ni au
grand historien de la pensée, Jean Starobinski, qui sut si brillamment
lier les arts.
« The Magic of Japanese Zen
Gardens » de Thomas Kierok ; Avant propos de Shunmyo Masuno ; 160 p., 110
Illustrations, 23,5 x 23,5 cm, Editions Benteli, 2022.
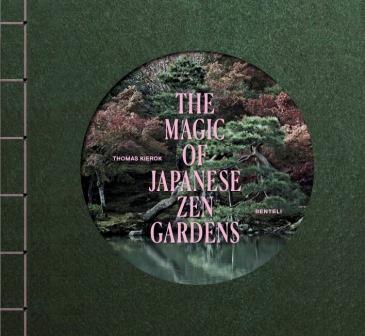
C’est bien de « magie », de notre point de vue occidental, dont il s’agit
lorsque nous contemplons la perfection d’un jardin zen japonais. Cette
harmonie conjuguée à une précision infaillible de chaque détail conduit à
une sérénité difficilement comparable aux créations paysagistes
occidentales. Il est vrai que vu d’un esprit japonais, tel celui du grand
moine bouddhiste zen japonais Shunmyo Masuno qui signe la préface de ce
bel ouvrage, il ne suffit pas de dresser quelques pierres entourées de
sable ratissé et bordées d’érables pour parler de jardin zen… Cela demeure
plus complexe que cela et c’est tout le mérite de cet ouvrage et de son
auteur, le photographe Thomas Kierok d’avoir perçu cette dimension
spirituelle et d’avoir su la restituer avec bonheur et beaucoup de talent
sur la pellicule.
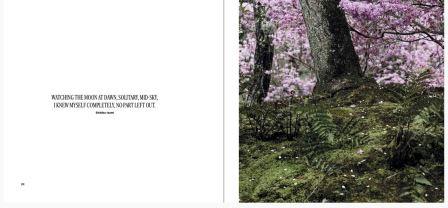
En conjuguant philosophie japonaise et aménagement paysager, le jardin zen
cherche à atteindre cette pleine conscience et accomplissement que l’on
retrouve dans la méditation zen sur un zafu. Au fil des saisons, Thomas
Kierok s’est imprégné de ces véritables jardins zen à Kyoto pour en
suggérer les impermanences et variations subtiles chères à tout méditant
zen. La nature pour le bouddhisme est censée contenir Bouddha lui-même
ainsi que ses enseignements, ce qui laisse une petite idée de l’importance
de leur ordonnancement… En rapprochant ces photographies des plus
inspirantes d’un florilège délicat de la poésie zen, et grâce à une
conception tout autant irréprochable du livre relié japonais, Thomas
Kierok parvient à nous faire partager cette « magie » des jardins zen
d’une splendide manière !
« Textiles africains » de Duncan
Clarke, Vanessa Drake Moraga et Sarah Fee, traduit de l’anglais par
Jean-François Allain et Christian Vair, Éditions Citadelles & Mazenod,
2022.
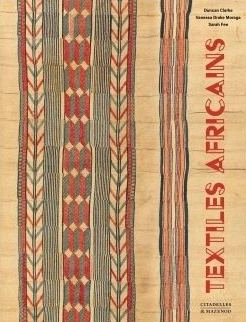
Absolument magnifique ! Tel est ce superbe volume consacré aux « Textiles
africains » paru aux éditions Citadelles et Mazenod. Avec son large
format, ses plus de 440 pages et ses 300 illustrations pour beaucoup
pleines pages, l’ouvrage sous la direction de Duncan Clarke avec Vanessa
Drake Moraga et Sarah Fee offre une réelle mise en lumière de cet art du
textile inégalé. Une mise en lumière inédite et de toute beauté qui ne
pourra que réjouir et combler collectionneurs et curieux. Des textiles
présentés géographiquement tous plus époustouflants les uns que les autres
issus de collections publiques ou privées et pour beaucoup d’entre eux
jamais montrés. On s’émerveille de tant de couleurs si chatoyantes, de
tant de motifs, de variété de matières et de techniques…
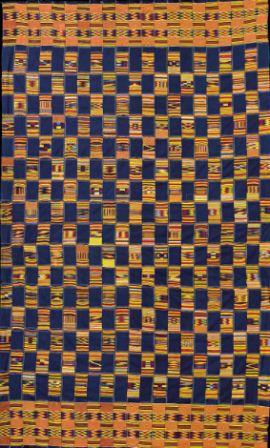
Mais cet ouvrage à nul autre pareil ne se limite pas par son incomparable
iconographie à flatter l’œil et les sens, il livre aussi au lecteur une
belle analyse appuyée par des notices, photographies et cartes, que ces
textiles soient anciens, de collection ou plus récents, que ce soient des
vêtements du quotidien, des parures talismaniques ou encore des tentures
nuptiales… Parcourant l’Afrique d’ouest en est jusqu’à Madagascar, ce sont
les particularités de tissage de chaque région, de chaque peuple, qui y
sont ainsi, page après page, dans toute leur beauté déployées.
Coton, laine, soie, mais aussi perles ou écorces, couleurs et matières les
plus diverses se font, ici, tableaux. Une créativité ayant influencé bien
des artistes peintres ou plasticiens - on songe à Klee, bien sûr, ou
encore à Matisse, mais aussi et surtout aux plus grands couturiers…
Un art du tissage africain unique et éblouissant que l’on parcourt et
découvre émerveillé de tant de créativité, de couleurs et de motifs.
« Poussin & l’amour - PICASSO |
bacchanales | POUSSIN » ; Catalogue sous la direction de Nicolas
Milovanovic, Mickaël Szanto, et Ludmila Virassamynaïken, In Fine Editions,
2022.
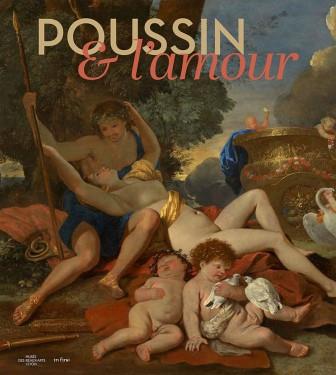
Le catalogue « Poussin & l’amour » paru aux éditions In Fine est
assurément à la hauteur du peintre et de l’exposition qui lui est
actuellement consacrée au musée des Beaux-Arts de Lyon. Cette monumentale
somme dirigée par les trois commissaires fait, en effet, l’objet d’une
présentation originale avec sa conception recto verso.
D’un côté, le lecteur découvrira la remarquable exposition « Poussin &
l’amour », exposition qui a retenu un angle original et pourtant
omniprésent dans l’œuvre du peintre français. En effet, dès son arrivée à
Rome en 1624 - et même quelques années auparavant – Poussin vouera une
part importante de son art à de majestueuses toiles développant tous les
thèmes possibles de l’amour, certains dépassant largement les standards de
la morale de l’époque au lendemain de la Contre-Réforme. Nicolas
Milovanovic, Mickaël Szanto, et Ludmila Virassamynaïken, les auteurs de ce
riche catalogue et commissaires de l’exposition ont entendu retracer de
manière éclairante toutes ces facettes méconnues et sous-estimées du
peintre souvent présenté comme le peintre philosophe. Si cette dimension
initiale ne saurait lui être enlevée, il s’avère à la lecture des
captivantes contributions réunies en ces pages que Nicolas Poussin tout en
approfondissant œuvre après œuvre l’analyse de ses sujets a su également
se saisir d’une certaine légèreté appréciée de ses richissimes clients
romains dont certains d’entre eux comptaient de prestigieux princes de
l’Église… C’est ainsi un Poussin dévoilé que Pierre Rosenberg commente
dans sa contribution soulignant qu’avec cette dimension méconnue le
peintre entendait tout de même renouer avec le monde du passé, mythologie
et éros réunis ! Cette toute puissance de l’amour intègre ainsi une
palette étendue d’affects allant de l’érotisme des corps lascifs livrés au
regard jusqu’à la passion folle conduisant à la mort. Le catalogue analyse
tour à tour ces multiples facettes de l’œuvre de Poussin avec ces corps
désirés, l’ivresse dionysiaque, l’amour et la mort, un voyage étonnant et
palpitant au cœur même de l’atelier de l’un des plus grands peintres dont
ce remarquable ouvrage dévoile un pan méconnu de la créativité.
Le revers de ce monumental catalogue, comme un « autre côté du miroir »,
est consacré à la seconde exposition du musée des Beaux-Arts de Lyon , «
PICASSO | bacchanales | POUSSIN ». Un regard mettant en lumière
l’influence majeure qu’eut le peintre du XVIIe siècle, Poussin, sur le
peintre espagnol du XXe s. Un prolongement offrant une belle ouverture et
réflexion.
« Raphaël. L’œuvre complet.
Peintures, fresques, tapisseries, architecture » de Michael Rohlmann,
Frank Zöllner, Rudolf Hiller, Georg Satzinger ; Relié, avec pages
dépliantes, 29 x 39,5 cm, 720 pages, Editions Taschen, 2023.
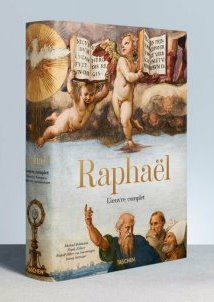
Raphaël (1483-1520), surnommé le « Prince des peintres » par Giorgio
Vasari, fait l’objet d’une exceptionnelle parution dans la collection XXL
des éditions Taschen. Il fallait en effet une publication de taille pour
rendre le plus bel hommage qui soit à cet artiste italien réputé pour le
raffinement de son trait et la précision de ses dessins. Après avoir
bénéficié de l’apprentissage de deux maîtres de choix, Le Pérugin et
Pinturricchio, ainsi que de son propre père Giovanni Santi, le jeune
Raphaël, disparu trop tôt à l’âge de 37 ans, allait participer à la
transformation de l’art de la Renaissance par des œuvres éclatantes. Très
rapidement, Raphaël saura, en effet, se distinguer de ses sources
d’inspiration notamment de son maître Le Pérugin, mais aussi de Léonard de
Vinci et de Pinturicchio, pour être la source première de lignes
harmonieuses d’inoubliables « Vierge à l’enfant », et ce dès son séjour
florentin ; Des représentations qui contribueront à bâtir sa réputation.
Le génie de Raphaël allait s’exprimer en effet durant toute sa vie
d’artistes auprès des plus grands mécènes et protecteurs avec cette quête
incessante de perfection de dessins soignés ce dont témoignent les œuvres
réunies par cette exceptionnelle édition grand format.
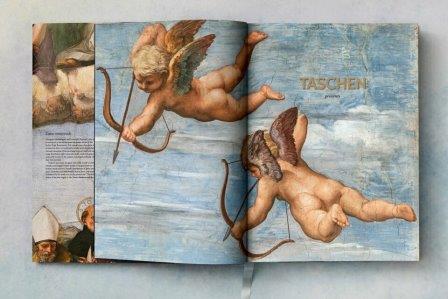
Des plus grands formats avec ses immenses décors romains
pour le pape Jules II, puis Léon X, dans les chambres du Vatican réalisées
à la fin de sa vie jusqu’au plus petit tableau tel les « Les Trois Grâces
» (17 x 17 cm) du musée Condé de Chantilly, chaque création de l’artiste
met en œuvre un processus inlassable d’essais successifs pour parvenir à
la composition future. Pour ces raisons, Raphaël gagnera la réputation
d’être le peintre du détail par excellence dont le génie resplendira par
cette harmonie irréprochable née de cette combinaison du trait, de la
géométrie, de l’espace et de la lumière.
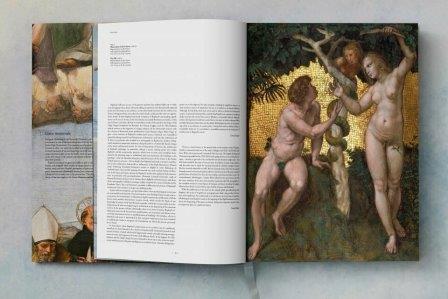
Cet équilibre caractérise cette grâce inimitable et ce
style Raphaël identifiable immédiatement, et qui devait à jamais marquer
l’histoire de l’art. Incontestablement l’un des artistes majeurs de la
Renaissance italienne, Raphaël fait ainsi l’objet d’une parution tout
aussi exceptionnelle qui fera date avec la réunion en un seul volume de
toutes ses peintures, fresques, projets architecturaux et tapisseries.
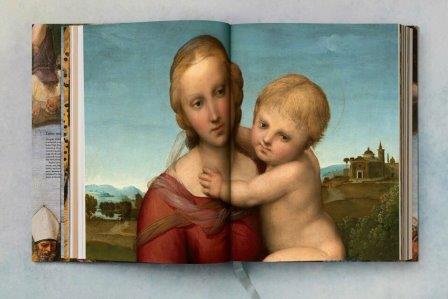
Cet ouvrage XXL, rend ainsi hommage au créateur de la
fameuse Madone Sixtine, et autres inoubliables fresques du Vatican, un
catalogue raisonné établi par une équipe d’experts de l’œuvre de l’artiste
replacé dans le contexte de la Renaissance italienne. Incontournable !
« Intérieurs : chez les plus
grands décorateurs et architectes d’intérieur » ; Collectif sous la
direction de William Norwich ; Relié, 250 ill. couleur, 25 x 29 cm, 272
pages, Editions Phaidon, 2022.
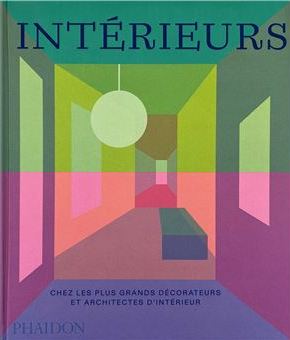
Passionnant ! Qui n’a jamais, en effet, rêvé d’entrer subrepticement chez
les plus grands décorateurs et architectes d’intérieur de notre époque? Ce
souhait, c’est William Norwich qui l’exhausse en dirigeant cet ouvrage
dénommé « Intérieurs » aux éditions Phaidon. Sous sa direction et
introduction, ce sont, en effet, pas moins de soixante intimités de
décorateurs ou architectes d’intérieurs contemporains réputés
internationalement qui sont dévoilés ainsi au lecteur.
De Jacques Garcia, chez lui, à Paris, à Teo Yang en passant par Charlotte
Moss ou encore Joy Moyler ou Joseph Dirand, que d’idées, créations et
inventivité ! Une diversité de personnalités et de lieux inouïs propices
assurément à l’inspiration que l’on soit professionnel, amateur de
décoration ou tout simplement curieux… Avec plus de 250 illustrations
couleur, c’est en effet une multitude d’art de vivre, d’élégance et
d’intimité que ce bel ouvrage livre au regard indiscret du lecteur.
Camaïeux et foisonnement d’objets à Los Angeles chez Jeef Andrews,
foisonnement de matières chez Paola Navone à Milan, matériaux nobles et
style épuré chez Teo Yang ou à Milan encore chez Vincenzo de Cotiis…
Maisons de rêve ou rêvées telle celle de Michèle Nussbaumer, chaque
découverte d’intérieur s’accompagne pour plus de précisions d’opportuns
éléments biographiques, d’analyses ou commentaires. Qu’il s’agisse
d’appartements ou de Palazzo, de lofts ou vieilles bâtisses, chaque
intérieur offre en ces pages curieuses et indiscrètes son intimité et ses
secrets… Styles, couleurs et goûts se côtoient dans une impressionnante et
passionnante palette. Monocouleur, blanc pour Will Cooper (ASH NYC), noir
chez William Sofield à New York, ou chatoiement des couleurs chez Laura
Sartori Rimini à Londres. Lieu secret ou ouvert, expérimental, laboratoire
ou strictement privés, surprenants ou prévisibles, chaque personnalité,
chaque architecte et décorateur de notre siècle se révèle au travers de
ses choix de style, de couleurs, d’objets et associations.
Un réel régal d'intimité !
Meret Oppenheim : « Mein Album", broché, 324
pages, 22 x 33 cm, Version All. /Anglais, Editions Scheidegger, 2022.
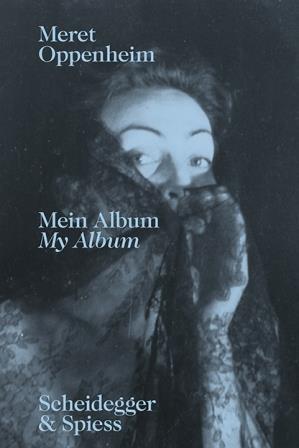
Si l’artiste suisse-allemande Meret Elisabeth Oppenheim (1913- 1985) est
mondialement connue pour ses œuvres créées à partir de détournement
d’objets, sa vie et intériorité – pourtant d’une richesse incroyable –
sont demeurées plus secrètes jusqu’à la publication de ce bel ouvrage par
les éditions Scheidegger à partir d’un album que tint l’artiste intitulé «
Depuis l’enfance jusqu’à 1943 » ainsi que de quelques notes privées.
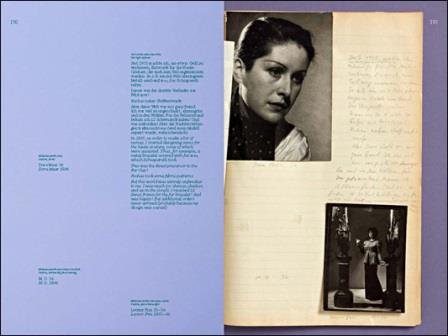
Ce document
exceptionnel reproduit avec soin pour cette édition permet d’entrer dans
le laboratoire de la création d’Oppenheim, cette plasticienne issue du
mouvement surréaliste aux côtés d’André Breton à partir des années 1920 ;
un laboratoire composé de situations du quotidien tel « Le déjeuner en
fourrure », fameuse sculpture surréaliste passée à la postérité. La
présente publication tient à la fois du journal et de l’œuvre d’art en
tant que telle. En ces pages labyrinthiques, l’artiste réunit
photographies, objets et notes en compagnie de pensées et de concepts qui
préluderont à de nouvelles créations. Cet atelier en album permet d’entrer
pleinement dans la pensée créatrice de cette femme hors du commun.
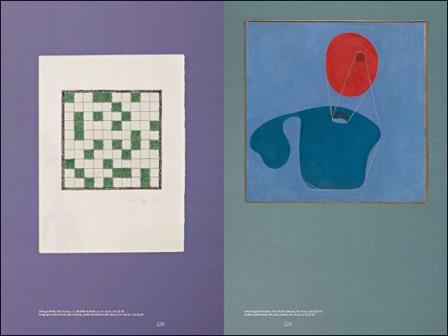
Reproduit dans son intégralité et dans son format original, cet album a
fait l’objet d’une traduction en langue anglaise pour cette édition. De
touchantes évocations des premières années de jeunesse, les premiers
dessins enfantins avant ceux d’une artiste en devenir, et déjà cette
propension à questionner les formes et à remettre en question les
conventions… Puis viennent les premières rencontres à Paris avec André
Breton, Max Ernst avec qui elle entretiendra une liaison pendant une
année, la découverte du haschich et de la vie d’artiste durant son séjour
à l’hôtel d’Odessa…
Chaque page remarquablement reproduite en fac-similé redonne vie à ces
années de créativité sans limites, un document vibrant et essentiel à la
compréhension de cette artiste jusqu’alors secrète.
Leonhart Fuchs : « Le Nouvel Herbier » ; Relié
avec livret, 23 x 37 cm, 892 pages, Editions Taschen, 2022.
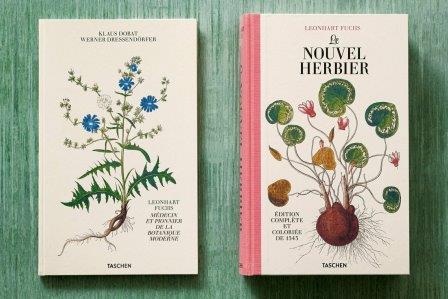
Exceptionnelle que cette nouvelle édition du mythique Herbier de Leonhart
Fuchs en un impressionnant format (23 x 37) livrée par les éditions
Taschen ! Le célèbre botaniste bavarois avait en effet réalisé une
véritable somme en réunissant pas moins de 1543 plantes décrites par le
détail et illustrées par des planches inoubliables, aujourd’hui
disponibles grâce à cette édition de près de 900 pages. Soulignons encore
que cette luxueuse réédition à partir de l’original possédé par Fuchs en
personne et mis en couleurs à la main réunit plus de 500 illustrations,
unique témoignage de cet inventaire fabuleux réalisé par le botaniste
présentant notamment des plantes et fleurs encore inconnues du Nouveau
Monde tel le fameux tabac appelé à un avenir certain en occident…
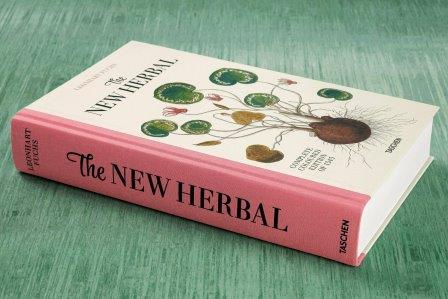
Dans un opuscule joint au fac-similé du Nouvel Herbier, Klaus Dobat
introduit l’apport de Fuchs pour la science en montrant combien son
travail méticuleux fait de lui le précurseur de la botanique moderne tout
en soulignant son rôle essentiel pour la médecine de son temps, Fuchs
ayant été un professeur de médecine réputé. Gagné aux thèses de la
Réforme, il dut quitter la ville de Munich où il exerçait pour se réfugier
à Ingolstadt. Son œuvre maîtresse, Das Kraüterbuch, conjugue botanique et
médecine, les deux disciples étant considérées alors comme proches.
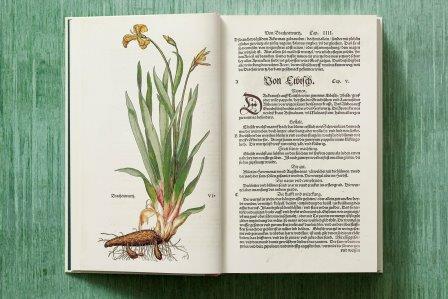
Werner
Dressendörfer analyse quant à lui l’apport des plantes médicinales
décrites par Fuchs au regard de la médecine des plantes modernes. Mais le
plaisir le plus manifeste résidera sans conteste pour le néophyte à
feuilleter page après page cette somme incomparable pour la beauté de ses
planches, l’harmonie des couleurs apposées par la main de l’auteur et le
soin apporté à chaque infime détail des plantes décrites, faisant de cet
Herbier non seulement l’auguste témoin d’une époque mais également une
œuvre d’art à part entière…
Stephane Mirkine : « Mirkine par Mirkine -
Photographes de cinéma », 400 pages, 251 x 317 mm, Editions Flammarion,
2022.
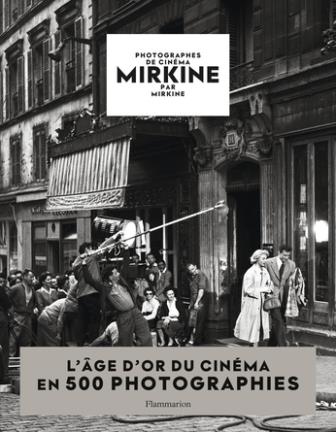
Lorsque le 7e art rencontre l’art de la photographie, cela donne un beau
livre, celui de Stéphane Mirkine parti à la redécouverte de son grand-père
Léo, le photographe des stars, sans oublier son père Yves ayant repris
lui-même l’héritage de Léo en poursuivant son travail. C’est cette belle
affaire de famille qui se trouve à la une d’une exposition au Musée
Masséna de Nice et de cette œuvre unique élaborée à partir de près de 200
films des années 30 aux années 80.
Les portraits des stars les plus en vue pris sur le vif comme sur les
plateaux font revivre les grandes heures du cinéma au XXe siècle. Après
avoir rappelé le parcours de cet émigré russe parvenu en France à l’âge de
9 ans, ce sont les années 30 qui verront les débuts de la carrière de Léo
Mirkine avec Abel Gance, Autant-Lara, Duvivier et autres Jean Renoir. Les
grands noms du cinéma commencent à imprimer sa pellicule à un rythme
effréné, von Stroheim, Michel Simon, Mistinguett… Chaque décennie
apportera son lot de clichés de légende, le photographe ayant une capacité
à saisir non seulement la beauté rayonnante de nombre de ses actrices et
acteurs mais surtout d’en révéler les multiples facettes qui inscriront
leur nom en lettre d’or au grand écran.
Ce beau livre de 400 pages réserve ainsi d’inoubliables pleines pages avec
des photographies remarquables pour leur maîtrise du noir et blanc et des
contrastes. Qu’il s’agisse de portraits étudiés ou de clichés pris sur le
vif, l’art des Mirkine, père et fils, rayonne tout au long de ces pages
dont leur descendant peut s’enorgueillir d’avoir honoré la mémoire !
« Face au soleil – Un astre dans les arts » ;
Collectif, catalogue officiel de l’exposition « Face au soleil » du 14
septembre au 29 janvier 2023 au musée Marmottan Monet, Paris ; Relié, 22 x
25.5 cm, 140 ill., 240 pages, Editions hazan, 2022.
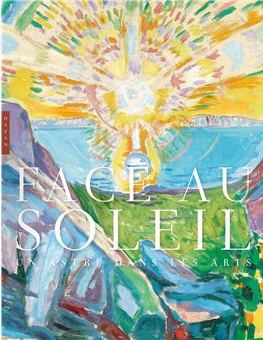
Voilà un bel ouvrage d’art propice à illuminer et réchauffer notre hiver !
Le catalogue « Face au soleil – un astre dans les arts » paru aux éditions
Hazan et qui accompagne l’exposition éponyme actuellement au musée
Marmottan Monet propose, en effet, ainsi que son titre le suggère, de
contempler le soleil dans la vaste galaxie des arts. Un programme
ambitieux remontant le temps depuis l’antiquité jusqu’à nos jours et
livrant les multiples représentations de cet astre à nul autre pareil.
Avec une présentation d’Érik Desmazières, directeur du musée Marmottan
Monet, et sous la direction de Marianne Mathieu, directrice scientifique
du musée Marmottan Monet de Paris, et de Michael Philippe, conservateur en
chef du musée Barberini de Posdam, l’ouvrage collectif nous entraîne dans
un voyage interstellaire inédit. Marianne Mathieu retrace cette
représentation dans le cours du temps et des siècles de l’art et souligne
combien c’est une « longue histoire qui lie les artistes à l’astre qu’ils
n’ont cessé de représenter, pour de multiples raisons depuis la plus haute
antiquité. » Et effectivement, de l’Égypte au XXIe siècle que
d’années-lumière parcourues !
Mikael Philipp s’arrête en introduction précisément sur cette «
Physionomie du soleil de l’antiquité au XVIIIe siècle ». Proposant de
riches contributions et analyses, l’ouvrage souligne également, sous la
plume d’Hendrik Ziegler, combien la métaphore solaire a pu revêtir bien
des dimensions politiques avant que Michael F. Zimmermann laisse le
lecteur voir tout de face le soleil avec pour point d’orgue, bien sûr, la
célèbre et incontournable toile de Monet, « Impression, soleil levant »
datée de 1872. Un tournant majeur dans l’histoire de l’art et du soleil
que Marianne Mathieu approfondira également avec cette approche spécifique
- « Monet / Fromanger, poétique de la couleur » - ou encore Marianne
Alphan avec un focus tout particulier sur l’artiste contemporaine
américaine Vicky Colombet.
L’ouvrage offre ainsi une belle place à la représentation du soleil au XXe
siècle. Un éblouissement notamment au tournant du XXe siècle que le
lecteur retrouvera développé sous la plume d’Oliver Schuwer, mais aussi
sous celle de Sarah Wilson avec des noms aussi prestigieux que Signac,
Derain, Maurice Denis, Munch, Miro, mais aussi Kupka, Sonia Delaunay,
Calder…
Un beau et riche catalogue d’art complété par des pages consacrées à «
L’évolution de l’astronomie et système solaire du XVIe siècle à nos jours
» signées Donald W. Olson et Marilynn Olson.
« Faces Of Africa », Photographies de Mario
Marino ; 27.5 x 34 cm, Editions teNeues, 2021.
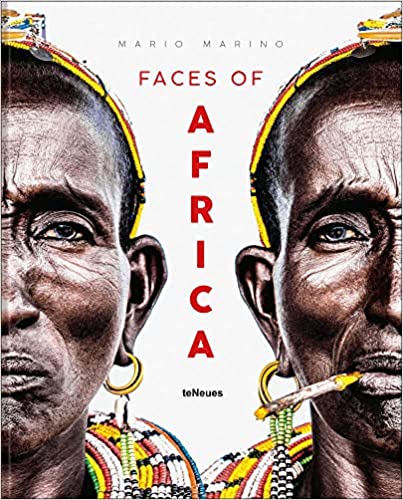
Avec ce dernier ouvrage, le photographe Mario Marino, internationalement
primé, livre au plaisir du regard de splendides et époustouflants visages
de l’Afrique. Non un visage, mais bien des visages au pluriel, « Faces of
Africa », révélant toute la spécificité et beauté de régions reculées de
l’Afrique, d'Éthiopie, de Tanzanie, du Soudan et du Kenya. Des corps
magnifiques ornés de bijoux, habillés de peintures, des visages aux
regards saisissants… C’est un travail de longue haleine que nous offre
Mario Marino avec cet ouvrage ayant exigé de nombreux voyages sur plus de
huit ans ; Chaque peuple que ce soit d’Ethiopie, du Kenya, qu’il s’agisse
des Karo, des Arbore ou encore des Borana, offre à chaque fois pour le
photographe une véritable rencontre, une rencontre singulière avec
l’Afrique.
Pas moins de 200 photographies, couleurs ou en noir et blanc ainsi
rassemblées viennent souligner de la plus belle manière les traditions et
cultures de ces peuples et tribus d’Afrique aujourd’hui toujours plus
menacés par le tourisme et le monde moderne. Des portraits pour la
majorité pleine page et révèlant cette beauté altière à nulle autre
pareille. On y retrouve ce merveilleux dialogue entre cette Afrique,
berceau de l’humanité, et le photographe Mario Marino ; L’objectif de ce
photographe hors pair sachant mieux que quiconque capter ces sourires,
regards, visages, corps et silhouettes de cette Afrique encore vivante. Un
dialogue, érigé en signature, et que le talentueux photographe entend en
ces magnifiques pages partager. Un plaisir inégalé.
« Fernand Léger ; La vie à bras-le-corps » » ;
Collectif, Catalogue officiel de l’exposition éponyme du musée Soulages
Rodez, Editions Gallimard, 2022.

Avec sa couverture jaune, le catalogue d’exposition consacré à Fernand
Léger (1881-1955) attire immanquablement et à juste titre l’attention! En
effet, c’est un beau et riche catalogue qui accompagne en cette année 2022
l’exposition consacrée à ce grand peintre de la révolution cubiste par le
musée Soulages à Rodez. Divisé en trois judicieuses et porteuses
thématiques, l’ouvrage offre une belle mise en perspective de l’œuvre
peint de cet artiste hors-norme ayant marqué le XXe siècle.
En premier lieu, « La ville moderne » avec son machinisme retiendra, bien
sûr, l’attention avec ces grandes toiles incontournables du peintre des
années 20, lui qui découvrit la capitale en pleine effervescence de ce
début de siècle. Un attrait et une époque analysés par Julie Guttierez. Le
deuxième volet de ce catalogue largement illustré de reproductions et
photographies revient sur les liens rattachant Fernand Léger au « Monde du
travail » et à son engagement. « Mécanicien », ainsi que le souligne
Ariane de Coulondre dans sa contribution en référence à la célèbre toile
du peintre de 1918 ; « Un chef d’œuvre de composition synthétique, buste
arrondi et tubulaire, géométries en aplats de couleurs, expression
décomplexée du travailleur de force » écrit dans sa préface Alfred Pacquement, Président du musée Soulages. Fernand Léger est effectivement
avant tout le peintre de son temps, lui qui réalise la célèbre affiche de
l’exposition de 1951 au musée d’Art moderne de la Ville de Paris, « Les
constructeurs ».
Le troisième tempo du catalogue est, quant à lui, consacré aux loisirs, «
Au temps des loisirs » pour reprendre le titre de l’écrit de Maurice
Fréchuret, un riche chapitre très largement appuyé par les œuvres de
l’artiste avec notamment le thème récurrent du cirque ou encore celui des
cyclistes…
Enfin, cette riche étude se poursuit avec une analyse signée Benoit Decron
et mettant judicieusement en parallèle les œuvres de Fernand Léger et de
Pierre Soulages. Deux artistes majeurs qui se sont rencontrés à la sortie
de la Seconde Guerre mondiale et dont les œuvres – ainsi qu’en témoigne ce
catalogue, traversent le temps, nous étonnant toujours par leur force et
leur modernité. Une belle mise en perspective qui se referme sur la vie et
le parcours du peintre normand qui gagna la capitale à dix-neuf ans,
s’exilera aux États-Unis avant de revenir en France… Une vie aux «
Couleurs de la vie », ainsi que le souligne Nelly Maillard, ou « La vie à
bras-le-corps », titre évocateur de ce riche catalogue.
Jacques Mercier : « L'Art de l'Éthiopie » ; 334
pages, 26,5 x 31,2 cm, Editions Place des Victoires, 2021.
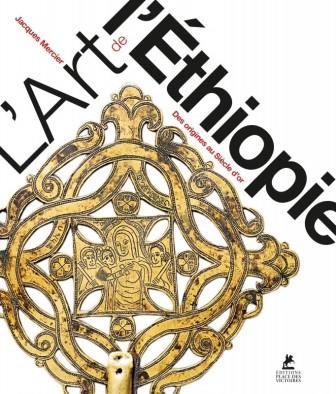
Alors qu’ils sont incontournables et remontent à l’aube du christianisme,
les arts de l’Éthiopie ne disposaient curieusement pas de monographie
retraçant de manière exhaustive leur importance. C’est chose faite – et
bien faite – dorénavant avec l’ouvrage réalisé par Jacques Mercier.Ce
spécialiste a en effet mené depuis plus d’un demi-siècle des études sur
plus de 350 églises, sans oublier les riches collections de ce pays
souvent méconnues de l’occident. Le résultat s’avère éblouissant dans tous
les sens du terme et étonnera très certainement plus d’un lecteur. Toute
personne ayant eu la chance de se rendre dans ce beau pays a pu se re
rendre compte de la prégnance et de la force du christianisme dans cette
société.
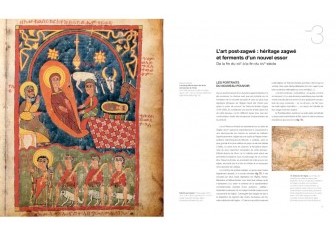
Associant origines légendaires et avérées, cette riche histoire se
conjugue à une foi toujours aussi fervente puisant à des racines
millénaires notamment celles de la légendaire reine de Saba à la source de
la Bible éthiopienne. Entre légende et histoire, l’Ancien Testament évoque
ainsi le fameux épisode de la reine de Saba, nommée Melket Hava (1 Roi 10,
1-13), Reine de Midi dans l’Évangile de Luc (11, 31), et Balkis dans le
Coran. Conquise par la sagesse du légendaire roi Salomon, cette reine
décida d’abandonner les dieux qu’elle vénérait jusqu’alors et rapportera
dans son pays, la future Éthiopie, le culte du Dieu d’Israël et peut-être
même l’Arche de l’Alliance. La légende veut, par ailleurs, qu’elle eut un
enfant de Salomon nommé Ménélik 1er, premier empereur d’une longue
dynastie qui ne s’éteindra qu’au XXe s.
Mais, c’est véritablement au IVe siècle de notre ère que le christianisme
deviendra en cette contrée africaine la religion prédominante. Au milieu
du IVe siècle, l’empereur Constance II demanda, en effet, aux rois d’Axoum
de présenter officiellement leur évêque nommé Frumentius à Alexandrie afin
de vérifier que leur foi était bien conforme au reste de l’Empire romain.
Le royaume d’Axoum se situait sur les hautes terres du plateau abyssin, à
la croisée des riches routes commerciales entre l’Inde et la Méditerranée.
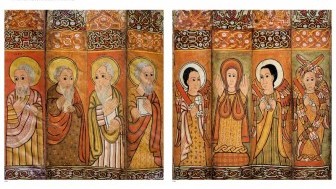
L’hellénisme et
la langue grecque étaient parvenus jusqu’en ces lieux au sud de l’Égypte
et des croix retrouvées datant du IVe siècle confirment le développement
de la religion chrétienne en ces terres reculées, même si les divinités
traditionnelles resteront cependant toujours présentes, soit concurremment
ou le plus souvent associées à la nouvelle religion. Depuis cette époque,
bien que l’histoire du développement du christianisme en Éthiopie demeure
quelque peu méconnue, l’Église chrétienne éthiopienne fut rattachée à
l’Église d’Alexandrie, un rattachement qui perdurera jusqu’au XXe s. La
langue éthiopienne conservera jusqu’à nos jours cette mémoire biblique et
sera souvent à l’origine de nombreux traits culturels de ce pays africain
riche de légendes et d’histoire en nourrissant largement l’inspiration
d’artistes offrant de splendides peintures religieuses abondamment
illustrées dans cet ouvrage d’art (la période couverte allant des origines
jusqu’au Siècle d’or). De nos jours encore, le christianisme en Éthiopie
demeure très actif, particulièrement depuis la fin de la dictature
militaire en 1991, et représente 60 % de la population. À ce titre seul et
sans oublier la remarquable somme réunie par Jacques Mercier, cet ouvrage
ne peut que prendre place parmi les sources de référence sur l’Éthiopie.
« The Jaguar Book » de René Staud ; 304 pages,
Editions teNeues Verlag, 2022.
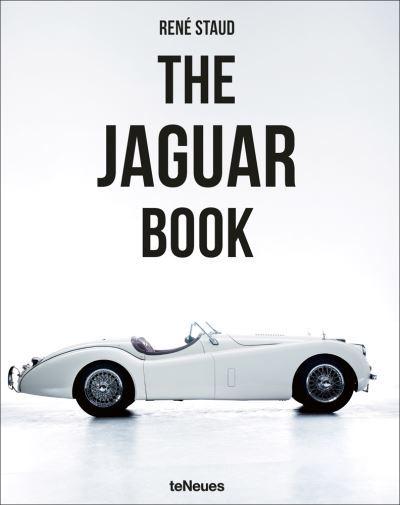
C’est un hommage mérité adressé à l’une des marques iconiques des voitures
de luxe que publient les éditions teNeues avec cet ouvrage somptueux. Le
seul nom de Jaguar évoque, en effet, instantanément des carrosseries
rutilantes, des intérieurs feutrés aux fragrances de cuir… Depuis cent
ans, la marque britannique est synonyme d’élégance et de raffinement, un
raffinement discret et non ostentatoire.
Le photographe René Staud retrace ainsi cette incroyable histoire marquée
par des dates clés avec la fameuse Type E des années 30 sans oublier
d’autres voitures toutes aussi réputées que la XK 140 ou encore la SS90.
Cette aventure relatée par ce passionné de voitures de luxe se trouve mise
en scène de manière époustouflante par 175 illustrations aussi somptueuses
les unes que les autres, faisant participer le lecteur à cette fascination
toujours renouvelée pour la marque Jaguar jusqu’à notre époque
contemporaine avec le dernier modèle tout électrique. Dimension sportive
et univers du luxe se côtoient dans ces pages de rêves où les fameuses
icônes du grand écran avec James Bond viennent encore ajouter au mythe
Jaguar.
C’est toute l’aventure de la marque au fameux félin qui se trouve ainsi
racontée dans ce livre d’art qui marquera l’histoire de l’édition
consacrée au monde automobile.
Texte en anglais et allemand.
« Emma Kunz Cosmos - A Visionary in Dialogue with
Contemporary Art » de Yasmin Afschar; Version Anglais / Allemand ; Relié,
248 pages, en collaboration avec the Aargauer Kunsthaus, Aarau, Editions
Scheidegger & Spiess, 2021.
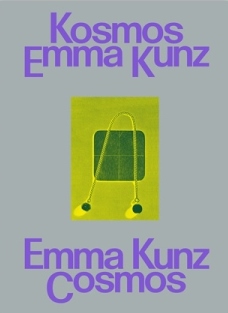
C’est à l’univers fascinant de l’artiste suisse Emma Kunz (1892-1963)
auquel convie ce remarquable ouvrage paru aux éditions Scheidegger &
Spiess et qui a reçu le prix récompensant le plus beau livre allemand de
2021. Ce personnage singulier fut à la fois une artiste et une guérisseuse
reconnue pour ses dons de télépathie en Suisse. Cette singularité l’a
conduite à exprimer sa sensibilité en d’étonnants dessins géométriques, à
l’architecture envoutante et conduisant à une vision dépassant celle du
monde sensible. Aux frontières des mandalas ayant inspiré son compatriote
et psychanalyste Carl Gustav Jung, son travail ne saurait laisser
indifférent. L’iconographie soignée pour ce beau livre réalisé à
l’occasion de la grande exposition qui lui a été consacrée à l’Aargauer
Kunsthaus en Suisse met en rapport le travail d’Emma Kunz avec celui de
nombreux artistes contemporains livrant parallèlement leurs propres
créations. Le personnage, secret et vivant retiré à l’écart de la scène
artistique a ainsi exploré de multiples sujets dont la médecine, la
nature, le surnaturel, l’animisme… Cet intérêt décloisonné l’a conduit à
élargir encore ses perceptions et à les traduire en d’étonnantes
architectures renvoyant à l’organisation du cosmos tout autant qu’aux
méandres de nos cerveaux.
L’ouvrage propose un véritable dialogue entre le travail de l’artiste et
celui d’artistes contemporains réunis pour l’occasion tels Agnieszka
Brzezan´ska, Joachim Koester, Goshka Macuga, Shana Moulton, Rivane
Neuenschwander et Mai-Thu Perret. Accompagné d’essais sur l’ésotérisme
dans l’art contemporain, cet ouvrage ouvrira assurément de nouveaux
horizons pour le lecteur dans cette remarquable publication.
« Pierre Decker – Médecin et collectionneur » de
Gilles Money, Camille Noverraz et Vincent Barras, Édition BHMS, 2021.

C’est un splendide ouvrage – entre biographie, monographie et catalogue –
consacré au célèbre collectionneur d’art suisse Pierre Decker (1892-1967)
qui vient de paraître aux éditions BHMS. Pierre Decker, chirurgien et
professeur d’université de renom qui donna et donne encore aujourd’hui son
nom à de nombreux hôpitaux, sût, également et parallèlement à sa carrière,
réunir avec passion et un goût très sûr une prestigieuse collection
essentiellement constituée d’estampes de Dürer et de Rembrandt. Léguée à
sa mort à la Faculté de médecine, cette exceptionnelle collection a été
transférée et est aujourd’hui au Cabinet cantonal des estampes de Vevey.
Réalisé par des historiens, Gilles Monney, historien d’art, Camille
Noverraz, historienne de l’art et Vincent Barras, historien et médecin,
l’ouvrage livre non seulement un catalogue inédit et complet des estampes
de cette fabuleuse collection, mais donne aussi un beau portrait de ce
personnage hors pair, élégant aux petites lunettes rondes. Ainsi, après
avoir fait « Entrer dans la collection », confiant au lecteur notamment la
conception de l’art de Decker, une conception inséparable de la beauté, le
lecteur pourra-t-il découvrir au travers de nombreux documents pour
certains inédits l’extraordinaire fonds Pierre Decker. Car, le
collectionneur ne réunit pas seulement de son vivant des œuvres de Dürer
et de Rembrandt, mais aussi des artistes contemporains. Cependant, c’est
l’ensemble des estampes que le lecteur pourra surtout en ces pages
découvrir et admirer en leur format original.
Appuyé également par de riches analyses allant de l’histoire de l’art à
l’histoire de la médecine, des études transversales qui assurément
n’auraient pas déplu au célèbre et regretté historien de la pensée que fut
Jean Starobinski, l’ouvrage offre parallèlement une belle mise en
perspective des relations étroites que peut entretenir la médecine avec
les collectionneurs et inversement.
Ce sont ainsi de riches et captivants thèmes - « Philosophie de la
chirurgie », « La chirurgie, art ou science ? » ou encore « La culture
fondement d’un humanisme médical » - que cet ouvrage propose à la
curiosité et à la réflexion.
Une analyse faisant de ce bel ouvrage, bien plus qu’un catalogue des
estampes de la collection Pierre Decker. Au-delà de cette riche et
passionnante étude, l’ouvrage constitue assurément l’un des plus beaux
hommages qui puissent être rendus à ce grand homme d’art et de sciences.
« Vincent Peters – Selected works » ; Relié, 160
pages, 177 photographies noir et blanc, Éditions teNeues, 2021.
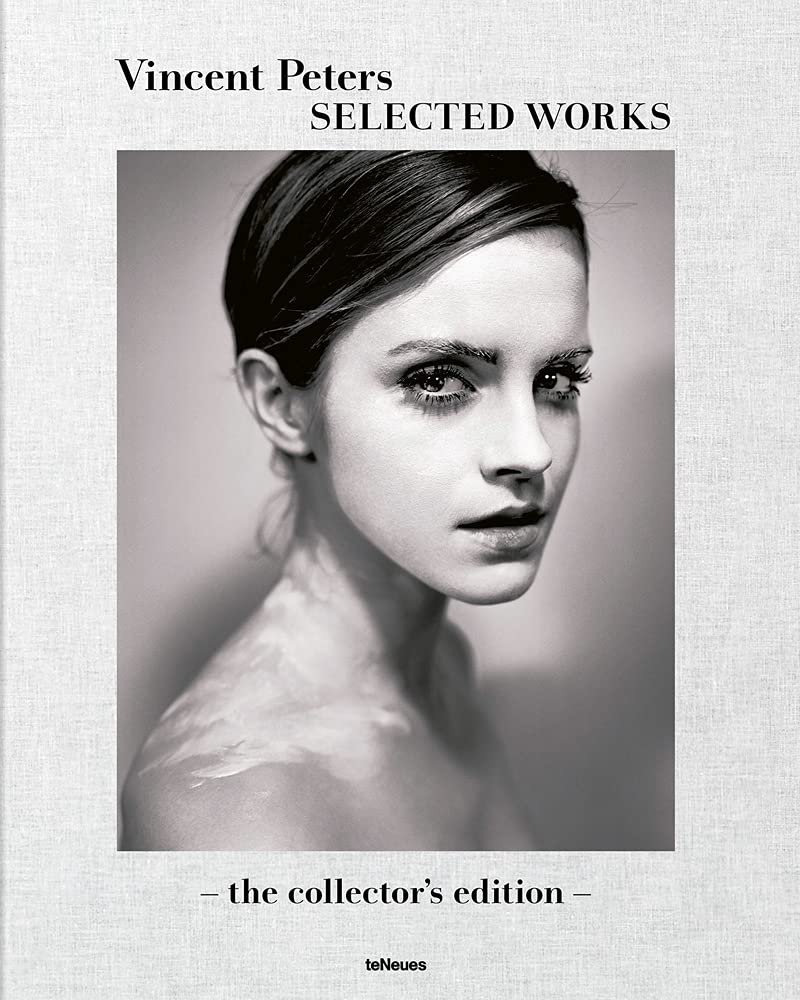
On ne présente plus le célèbre photographe de mode Vincent Peters. Ses
photographies pour Vogue, Dior, Yves Saint-Laurent, Glamour, etc., ont
fait depuis longtemps sa renommée. Aussi faut-il saluer l’initiative des
éditions teNeues de publier ce splendide ouvrage réunissant une sélection
des meilleurs travaux de Vincent Peters. C’est avec un souci méticuleux du
détail, de la précision et de l’éclairage que ses photographies ont su non
seulement séduire, mais également s’imposer sur la scène internationale.
Photographiant les plus grandes stars dont Monica Bellucci, Scarlett
Johansson ou Penélope Cruz, recourant parfois à la photographie
analogique, ses réalisations sont aujourd’hui incontournables et présentes
sur le marché de l’art.
Mais, au-delà de la diversité de ses réalisations, l’intemporel est
probablement ce qui caractérise le mieux l’œuvre du photographe. Aussi
n’est-ce pas un hasard si ce magnifique et unique volume regroupe des
clichés en noir et blanc, un choix de sélection qui vient accentuer plus
encore la signature du photographe Vincent Peters. On songe notamment aux
portraits de Laetitia Casta ou d’Emma Watson... Des portraits grand
format, dont certains ont marqué les mémoires à jamais. Rien de répétitif,
mais une recherche toujours renouvelée pour chaque star avec cette
distance intimiste, cet éclairage choisi qui ont fait ses meilleurs
clichés. Charlize Theron, Carolyn Murphy quelques portraits d’hommes
aussi, dont John Malkovich ou encore Edward Burns, un choix de portraits
noir et blanc qui témoignent de l’immense talent du photographe Vincent
Peters.
C’est une réelle splendide mise en perspective, un angle par lequel le
photographe Vincent Peters se révèle dans toute son exigence et rigueur de
travail qu’offre cet album. Cette œuvre où « L’inconscient rencontre la
conscience dans l’acte même de photographier » souligne Vincent Peters en
exergue de cet exceptionnel ouvrage.
« Les Toits de Paris » du photographe Laurent
Dequick, 32 x 25 cm, 120 pages, Éditions Chêne, 2021.
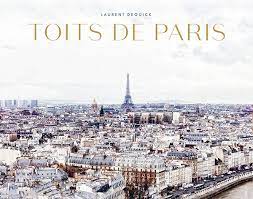
On ne résiste pas à ce superbe livre dans son coffret aux pages pliées en
accordéon et offrant au regard les plus belles vues sur les « Toits de
Paris ». On pourrait passer des heures à les observer, les détailler, les
scruter. Entre ciel et terre, « Les toits de Paris » sont inimitables et
le photographe Laurent Dequick dans des panoramas grandioses et
époustouflants nous les laisse admirer de l’aurore au crépuscule. Des
toits bleu-gris, en zinc faisant miroiter leurs reflets sous la pluie ou
le soleil, en ardoise se confondant avec l’horizon, les « Toits de Paris »
ont inspiré les plus belles chansons et poésies… Il est vrai que « Les
Toits de Paris » sont si reconnaissables sans jamais pourtant être tout à
fait les mêmes, laissant deviner, çà et là les monuments incontournables
de la capitale. Un régal !
« Antoine Coysevox – Le sculpteur du Grand Siècle
» d’Alexandre Maral et Valérie Carpentier-Vanhaverbeke ; Relié, 24 × 32
cm, 580 pages, 976 illustrations, Arthena Éditions, 2021.
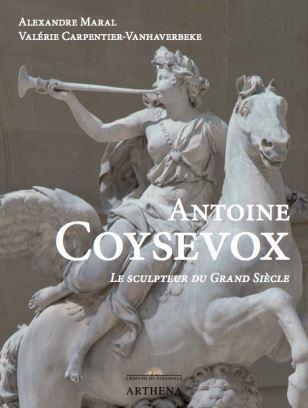
Antoine Coysevox (1640-1720), d’origine lyonnaise, compte assurément parmi
les plus grands noms de la sculpture française du Grand Siècle. À la tête
de l’Académie royale de peinture et de sculpture dès 1703, son riche
parcours émaillera de ses inoubliables créations les célèbres châteaux de
Versailles et de Marly. Au service du roi Louis XIV dont il contribuera à
célébrer l’aura par le truchement des arts, Coysevox fait aujourd’hui
l’objet d’une superbe monographie sous la plume d’Alexandre Maral et
Valérie Carpentier-Vanhaverbeke aux éditions Arthena.
L’ouvrage est en effet à la hauteur de l’artiste avec ses 580 pages et 976
illustrations, pour nombre d’entre elles pleine page. Ainsi que le relève
Laurent Salomé en avant-propos, cet ouvrage magistral qui célèbre le trois
centième anniversaire de la disparition du sculpteur réussit le tour de
force de présenter à la fois l’artiste de la Cour et de la ville, le
monumental et le portrait intime. Car Coysevox excelle dans cette
diversité, son art ne se limitant pas aux fastes de la couronne et du
pouvoir dont il parvient même dans cette magnificence à capter
subrepticement certains instants d’intimité (Louis XIV agenouillé à
Notre-Dame portant sa main devant son cœur en signe de piété). Geneviève
Bresc-Bautier, directrice honoraire du département des Sculptures du musée
du Louvre, met en avant dans sa préface cette propension de Coysevox à
être le sculpteur de l’art officiel, mais non pas un « sculpteur officiel
». Après François Girardon, c’est ainsi au tour d’Antoine Coysevox de
bénéficier d’une étude non seulement exhaustive, mais également
passionnante, les auteurs réussissant à saisir et à exposer cette latitude
qu’eut le sculpteur à développer son génie tout en s’insérant dans des
cadres classiques. Cette liberté étonnante pour l’époque et encouragée par
le monarque se développera notamment par le truchement des nymphes et
autres faunes de Marly, ces portraits intimes que l’on jugerait animés
d’un souffle encore perceptible. Coysevox sait rendre la grandeur du faste
royal et des puissants de son temps, mais il parvient aussi à se saisir de
ce « je-ne-sais-quoi » qui insuffle vie à ses créations.
« La
Genèse de la Genèse », Illustrée par l’abstraction, de la création du monde
à la tour de Babel ; Les onze premiers chapitres de la Genèse présentés en
français, en hébreu et en translittération. Nouvelle traduction de l’hébreu,
notes et commentaires de Marc-Alain Ouaknin ; Introduction de Marc-Alain
Ouaknin ; Préface de Valère Novarina, 1 volume relié, 384 pages, 19 x 26 cm,
La Petite Collection, Éditions Diane de Selliers, 2022.
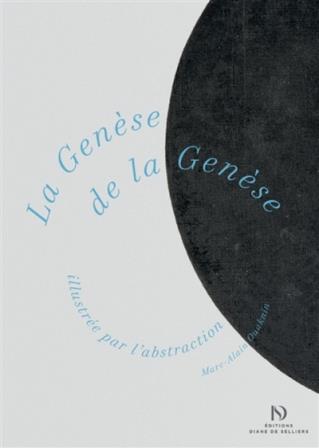
Le livre de la Genèse, primus inter pares, jouit depuis les temps les plus
anciens de cette importance, prééminence constitutive de la naissance de
l’univers, une naissance ou Genèse qu’évoquent en une beauté inouïe ces
pages. Premier livre de la Torah et de la Bible, sa poésie n’a d’égale que
ses principes qui pendant longtemps ont pris une valeur littérale
d’explication du monde. Si, cette conception n’est, certes, plus prise à la
lettre (à l’exception de certains regrettables mouvements contemporains
créationnistes), ses récits et enseignements demeurent néanmoins enracinés
dans l’inconscient collectif de nos contemporains et la source d’eau vive de
millions de croyants, Juifs, Chrétiens d’occident et d’orient. Il suffira
pour s’en convaincre de revenir à l’étymologie même du mot Genèse, Beréshit
ou « Entête » pour les Hébreux, et que saint Jérôme traduira, pour sa part,
par « In principio ». Le monde ne se conçoit que par ces principes premiers
« à la tête » de toute autre chose ou être…
Aussi, quelle belle et heureuse idée de faire dialoguer ce mystère,
inexplicable pour la raison, avec la peinture abstraite, un choix inspiré
retenu pour cette exceptionnelle édition de la Genèse à partir d’une
nouvelle traduction de l’hébreu signée Marc-Alain Ouaknin.

Ce splendide livre d’art et de foi maintenant disponible
dans La Petite Collection des éditions Diane de Selliers rend témoignage à la magnificence du récit
unique de La Genèse. La Genèse, texte fondateur des traditions juives et
chrétiennes, comprend précisément sept jours pour la création du monde. Si
le style et la diversité de ces chapitres laissent plutôt penser à une
pluralité de rédacteurs s’échelonnant du VIIIe s. au IIe siècle av. J.-C.,
la tradition aime à en attribuer la paternité à Moïse… La présente édition a
retenu les onze premiers chapitres, un choix judicieux dans la mesure où la
composition comme souvent dans la littérature hébraïque part du général vers
le particulier avec la création de l’univers, l’humanité, les luttes
fratricides, le déluge et le recommencement… Les influences culturelles ont
été fort grandes pour la genèse de cette Genèse, s’inspirant de sa proximité
avec la culture du Proche-Orient, et dont la Bible recueillera de nombreux
traits revisités par l’inspiration de ses rédacteurs, on songe notamment au
Déluge trouvant leur antériorité dans la culture sumérienne et l’épopée d'Atrahasis
reprise par celle de Gilgamesh.
Fort de cet héritage immémorial, Marc-Alain Ouaknin, philosophe et rabbin,
propose pour cette publication d’exception une nouvelle traduction à partir
de la langue hébraïque en associant rigueur de la langue et poésie, syntaxe
hébraïque et authenticité de la langue biblique.

Cette poésie biblique est encore accentuée par la mise en
page retenue et la reproduction du texte hébreu et de la translittération au
regard du texte français. Une présentation pensée et des plus soignées
offrant une nouvelle poésie, celle de la lettre et de sa graphie, les plus
grands calligraphes témoignant qu’il n’est pas nécessaire de connaître une
langue pour en apprécier sa poésie… L’impression de dialogues et de liens
inextricables qui dépassent leurs auteurs se trouve enfin sublimée par les
choix au soin tout aussi méticuleux d’œuvres de l’abstraction, telles ces
Constellations de Picasso, Une courbe libre vers un point de Kandinsky,
Braque et L’oiseau noir et l’oiseau blanc, Mondrian, Poliakoff et bien
d’autres dont, étrangement, les œuvres semblent être « éclairées » par le
texte de la Genèse « révélant » ainsi un dialogue des plus féconds .
Régulièrement, s’imposent aussi dans cette belle partition des « silences »
avec des textes non moins inspirants de philosophes ou d’artistes dont,
notamment, Vladimir Jankélévitch ou encore Marcel Duchamp ; Des « reprises
de souffle » venant approfondir encore l’appréhension et la lecture du Livre
de la Genèse ouvrant ainsi à une des plus belles méditations…
Une « Symphonie biblique », ainsi que la nommait autrefois le grand André
Chouraqui et qu’introduit Valère Novarina dès sa préface. Amoureux du mot et
de la langue, Valère Novarina explore avec le lecteur ces intrications
secrètes qui nourrissent le premier des premiers livres de la Bible. Une
lecture par une autre porte, celle de la Parole comme rythme, pulsation
universelle qui irradie ce texte premier. Un ravissement !
Philippe-Emmanuel Krautter |
|
Architecture, Urbanisme |
 |
«
Italie abandonnée » de Robin Brinaert, Éditions Jonglez.
Aux éternels amoureux de l’Italie, cet ouvrage singulier signé Robin
Brinaert aux éditions Jonglez est assurément destiné. Par le regard que
l’auteur porte sur les palais en ruines et autres villas thermales
délaissées, Robin Brinaert s’éloigne des chemins touristiques pour
privilégier un autre angle plus original, celui de notre rapport aux lieux
et aux demeures du temps passé. La mélancolie pointe souvent dans ces
superbes photographies encore habitées de la présence des hôtes qui furent
les leurs. Le photographe belge sait plus que quiconque se saisir de cette
absence pour suggérer une présence presque irréelle de l’âme de ces
demeures, oubliées du temps présent. Véritable carnet patrimonial de
l’intime, chaque espace possède une histoire à raconter et que les images du
photographe suggèrent… C’est presque une décennie de travail et de
recherches qui a conduit à cette admirable synthèse où pavillons de chasse,
asiles psychiatriques, studios et autres discothèques retrouvent en quelque
sorte vie… Une belle promenade inhabituelle dans une Italie plus méconnue. |
| |
 |
«
Fontainebleau, portraits d’un château », éditions In Fine, 2024.
C’est un autre regard porté sur le château de Fontainebleau que nous livre
l’ouvrage paru aux éditions In Fine au titre évocateur : « Fontainebleau,
portraits d’un château ». En dressant en effet le tableau saisissant de l’un
des monuments les plus emblématiques du patrimoine français par le
truchement des plus belles œuvres graphiques, cette somme associe des textes
signés par les meilleurs spécialistes et une iconographie remarquable. Le
lecteur entrera ainsi dans l’histoire aussi riche que complexe de ce
château, lieu de résidence des rois et empereurs depuis le Moyen Âge jusqu’à
la chute du Second Empire. Les auteurs proposent en effet de retracer de
manière à la fois accessible et complète huit siècles d’histoire française
en évoquant les différentes transformations du bâtiment depuis sa création
sous les Capétiens jusqu’aux modifications ordonnées par Napoléon III. Ce
livre développe notamment le rôle joué par François 1er à Fontainebleau, un
château qui lui sera intimement associé avec la Renaissance et les arts qui
y rayonneront avec entre autres Rosso Fiorentino et le Primatice. Les
auteurs insistent également en ces pages sur un aspect plus méconnu avec les
grandes heures du Second Empire qui, à l’image de Compiègne, verront le
faste des réceptions impériales offrir encore un dernier éclat à cette riche
histoire. Servi par une impressionnante iconographie, notamment une
profusion de reproductions de gravures, peintures et croquis d’époque jamais
réunies jusqu’à cette édition, cet ouvrage renouvelle l’histoire du Château
de Fontainebleau. |
| |
 |
« A
House to live with- 16 variations by Dom Hans Van der Laan and his
compagions » de Caroline Voet et Hans W. van der Laan, Editions Park Books,
2024.
C’est un riche et incontournable ouvrage consacré aux maisons résidentielles
réalisées par l’architecte Dom Hans Van der Laan (1904-1991) que publient
aujourd’hui les éditions Park Books. Ouvrage attendu et inédit, ce dernier
expose avec de multiples plans et photographies à l’appui, les différentes
études réalisées par le célèbre moine architecte néerlandais et son équipe
dans le cadre de ses cours d’architecture ecclésiastique entre 1946- à 1973
à Bois-le-Duc. Figure majeure de l’architecture européenne de la seconde
moitié du XXe siècle, ce bénédictin influencé par l’Antique n’a eu de cesse
en effet de mener des études et recherches sur les relations ténues
entretenues entre l’architecture et les mathématiques, des analyses devenues
incontournables dans le domaine de la théorie architecturale.
Ce ne sont ainsi pas moins de 16 projets et réalisations qui sont donnés à
voir, et analysés grâce à de riches contributions sur plus de 400 pages. Des
analyses indispensables pour appréhender l’ensemble du travail de Van der
Laan, de la « Rector’s house de 1978 à Waasmuster jusqu’à « House Schure » à
Sin-Michielsgestel » en 1974. Le lecteur professionnel ou féru
d’architecture résidentielle y retrouvera ses grands principes de
conception, ceux ayant notamment fait sa renommée internationale :
l’importance et le rôle accordés à la grande table à manger comme cœur ou
centre de la maison ; l’interaction entre l’intérieur et l’extérieur, entre
le jardin, la terrasse et la maison sans oublier, bien sûr, l’influence de
la lumière notamment dans la réalisation de la « House Tom Senders » ou
encore de la « House Pieter Buys ».
Grâce aux photographies et aux précisions de plans spécialement retravaillés
pour cette publication inédite, le lecteur ne pourra qu’apprécier ces lignes
épurées mettant en valeur toute la conception et fonctionnalité des
réalisations de Van der Laan, s’appuyant notamment sur une extrême rigueur
mathématique entre les nombres, les espaces et volumes ; on songe notamment
à la fameuse maison sur plusieurs niveaux, la « House Wolters-Schweitzer » à
Bilthoven… Mais combien d’autres réalisations, toutes plus instructives les
unes que les autres, signées de Dom Hans der Laan à découvrir et étudier en
ces pages richement illustrées ! |
| |
 |
Mirella
Di Giovine : « Il paesaggio identitario. Roma, l’altra città », (langue :
italien) Quodlibet Editrice, 2024.
Avec Il paesaggio identitario. Roma, l’altra città, Mirella Di Giovine
nous invite à une redécouverte de la Ville éternelle, non pas sous l’angle
de clichés monumentaux, mais à travers un prisme inédit, celui de son
identité paysagère. Publié par les éditions Quodlibet, cet ouvrage se
présente comme une exploration sensible et érudite des lieux et récits qui
composent une Rome parallèle, méconnue et pourtant profondément ancrée dans
l’imaginaire collectif. L’auteur, architecte et chercheur, estompe l’image
figée d’une capitale dominée par ses ruines antiques et ses palais baroques.
Elle s’attache au contraire à révéler l’autre facette de la ville : celle
des espaces marginaux, des périphéries et des interstices où se jouent les
dialogues silencieux entre histoire et modernité, entre abandon et
réinvention. À travers une approche pluridisciplinaire mêlant urbanisme,
sociologie et histoire culturelle, Mirella Di Giovine esquisse un portrait
de Rome qui interpelle autant qu’il fascine. La force du livre réside dans
son écriture fluide et imagée, qui parvient à conjuguer rigueur scientifique
et sensibilité poétique. Chaque chapitre dévoile des lieux emblématiques
d’une Rome alternative : les quartiers populaires oubliés, les jardins
secrets, les friches industrielles réappropriées par les habitants ; ces
lieux devenant alors les témoins privilégiés d’un paysage identitaire en
constante mutation, où cohabitent mémoire collective et aspirations
contemporaines.
Loin d’être une simple étude académique, Il paesaggio identitario se lit
comme un véritable manifeste pour une approche plus inclusive et humaine du
paysage urbain. Di Giovine milite pour une reconnaissance des richesses
cachées de la ville et appelle à une réévaluation de ce que nous considérons
comme patrimoine. Ce livre offre ainsi une vision rafraîchissante et
résolument moderne de Rome, en résonance avec les enjeux actuels de
durabilité et d’intégration. Que l’on soit passionné d’urbanisme, amateur
d’histoire ou simple amoureux de la capitale italienne, cet ouvrage ouvre
une fenêtre sur une Rome vibrante et complexe, où chaque espace, même le
plus humble, contribue à forger une identité urbaine singulière. |
| |
 |
“Shigeru Ban. Complete Works 1985 –Today” de Philip Jodidio, édition:
Multilingue (Allemand, Anglais, Français) ; Relié, 30.8 x 39 cm, 696 p.,
Editions Taschen, 2024.
L’architecte japonais Shigeru Ban est connu internationalement pour ses
créations originales à base de carton permettant la réalisation
d’habitations d’urgence destinées notamment aux réfugiés de catastrophes
(Fukushima, Ukraine…). Alliant engagement certain et véritable implication
dans l’architecture urbaine contemporaine, le travail de Shigeru Ban dépasse
très largement ces quelques clichés réducteurs de son immense création ainsi
qu’en témoigne cette somme inédite qui vient de lui être consacrée. Les
éditions Taschen sous la plume de Philip Jodidio rendent hommage en effet au
grand architecte avec un ouvrage aussi imposant qu’inspirant. Couvrant tous
les travaux de Shigeru Ban de 1985 à nos jours, cet ouvrage explore cette
pensée altruiste récompensée par le Pritzker Prize pour «sa curiosité, son
engagement, son esprit infiniment novateur, son œil infaillible et sa
sensibilité aiguë.»

Car, en effet, l’architecte japonais parvient à entrecroiser beauté et
nécessités essentielles, fait rare dans le domaine de l’architecture où les
ego prennent souvent le dessus. Shigeru Ban depuis ses premiers travaux
parvient à se saisir de l’essence des matériaux pour en restituer non
seulement les lignes primordiales mais également essentielles à la vie
souvent malmenée par la modernité. Il suffit pour s’en convaincre d’admirer
ces vues imprenables sur la nature, ses architectures alliant bois et
carton, l’omniprésence des lignes primordiales à toute vie… À la fois solide
comme un chêne et souple comme le roseau, chaque structure d’une
architecture signée Shigeru Ban manifeste cette adaptation au réel,
l’architecture redonnant souvent vie à des matériaux jusqu’alors dédaignés
par ses pairs.

En feuilletant les pages de cette remarquable édition, nous découvrons alors
un univers fascinant composé de transparences, de constructions en tubes de
papier, de maisons dont les structures traditionnelles s’estompent à l’image
de la Curtain Wall House à Tokyo et la Wall-Less House dans la campagne de
Nagano… L’ouvrage met en évidence cette extrême créativité au fil des années
allant du Campus Swatch-Omega en Suisse à l’Île Séguin en France sans
oublier Haesley Hamlet en Corée du Sud et surtout ces toilettes
transparentes de Tokyo rendue célèbres par le film Perfect Days ( film
chroniqué dans ces colonnes). Shigeru Ban transcende les éléments pour mieux
en sublimer leur essence en harmonie avec l’espèce humaine notamment les
plus fragiles d’entre eux. Une démarche rare, un esprit inspiré…

À noter le 10 juillet 2024 la venue exceptionnelle de
l’architecte Shigeru Ban au Taschen Store de Paris pour la signature de son
livre de 18h30 à 19h30 au 2 rue de Buci 75006 Paris. |
| |
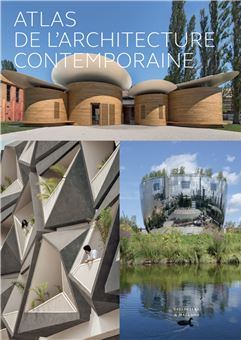 |
« Atlas de l’Architecture
contemporaine » sous la direction de Chris van Uffelen ; Traduit de
l’anglais par Jean-François Cornu ; Editions Citadelles & Mazenod, 2022.
Splendide et impressionnant ! Tels sont assurément les meilleurs
qualitatifs pour cet « Atlas de l’architecture contemporaine » paru aux
éditions Citadelles et Mazenod. Une nouvelle édition, dix ans après la
première, toujours plus attendue dans le domaine tant de l’architecture
que de l’édition et qu’il convient de saluer.
Couvrant les cinq continents regroupés, ici, en trois grands chapitres, de
l’Europe-Afrique aux Amériques en passant par l’Asie et l’Australie, cette
cartographie de l’architecture contemporaine offre non seulement une vue
d’ensemble mais aussi et surtout une riche réflexion sur l’évolution en
une décennie de la manière dont l’homme moderne entend habiter la planète
terre. « On y retrouve une même diversité de projets et de techniques mais
on y retrouve aussi les questions essentielles qui se posent actuellement
» souligne Chris van Uffelen en sa préface.
Avec une extraordinaire iconographie, photos, plans et pas moins de 280
projets, ce sont ainsi l’évolution, centres d’intérêt, matériaux de nos
habitats, lieux publics, religieux ou culturels, mais aussi espaces de
travail qui sont, en ces chapitres, exposés et analysés. Soulignons
notamment le « 175 Haussmann », cet impressionnant complexe réunissant
derrière une façade Haussmann deux immeubles des plus modernes, et ce, à
quelques mètres de l’Étoile à Paris. Des réalisations architecturales à la
fois spectaculaires, étonnantes ou déroutantes mais reflétant également
notre environnement et notre quotidien. Un panorama instructif et
époustouflant ! On songe à l’Arena d’Aix-en-Provence, au nouveau campus
urbain de l’Université Bocconi à Milan ou encore au Centre culturel de
Kadokawa au Japon… (Pour une fonctionnalité optimale, outre un index des
architectes en fin d’ouvrage, sont précisés pour chaque réalisation, en
haut de page, l’architecte ou bureau d’étude, sa destination, son année de
réalisation, ville et pays.)
Parcourant ainsi la planète monde et offrant au regard sous la direction
de Chris van Uffelen les plus splendides réalisations architecturales de
ces dix dernières années, cet « Atlas de l’architecture contemporaine »
dans sa nouvelle parution constitue indéniablement une somme
incontournable, un ouvrage de référence qui réserve aux lecteurs,
professionnels, amateurs, passionnés ou tout simplement curieux de notre
monde de bien belles découvertes et surprises.
|
| |
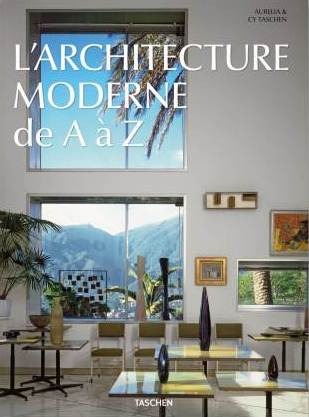 |
« L’architecture moderne de A à Z » ; 696 pages,
version française, Editions Taschen, 2022.
Incontournable ! Tel est assurément le qualificatif qui sied le mieux à ce
fort ouvrage entièrement consacré à l’architecture moderne et paru aux
éditions Taschen. Appuyé par une splendide iconographie, l’ouvrage offre
aux architectes, professionnels, mais aussi à tout passionné ou amateur
d’architecture une vaste connaissance de l’architecture des XIX et XXe
siècles.
Avec plus de 300 entrées, ce sont en effet à la fois les plus grands
mouvements de l’architecture moderne, mais aussi les plus grands
architectes des deux derniers siècles que le lecteur retrouvera ou
découvrira en ces pages rangés pour une efficacité accrue selon un ordre
alphabétique. Et que de découvertes tant pour les yeux que l’esprit !
Cette somme offre, ainsi, pour chacune des figures majeures de
l’architecture, une brève biographie et surtout une description des œuvres
emblématiques. Des noms internationalement reconnus, mais aussi parfois
injustement moins connus. On y découvre aussi avec curiosité pour nombre
d’entre eux leur photographie ou portrait. C’est l’architecte Aalto qui
ouvre cette bible se refermant presque 700 pages plus loin avec Zumthor
Peter. Chaque nom nous entraîne de par ses réalisations d’une capitale
l’autre ou encore vers une autre région du monde…
Mais le lecteur pourra également se référer selon les différentes entrées
aux nombreux courants ou styles ayant marqué l’histoire de l’architecture
durant ces deux derniers siècles. Bâtiments publics, institutions, églises
ou encore résidences privées cohabitent, ici, soulignant l’extraordinaire
essor et dynamisme de l’architecture moderne. Art nouveau,
constructivisme, expressionnisme…
Des pages magnifiques présentant le plus souvent sur de pleines pages les
plus grandes créations architecturales modernes de notre monde.
Extraordinaire !
Un ouvrage aussi splendide que complet qui ne pourra que trouver sa place
dans toute bonne bibliothèque.
|
| |
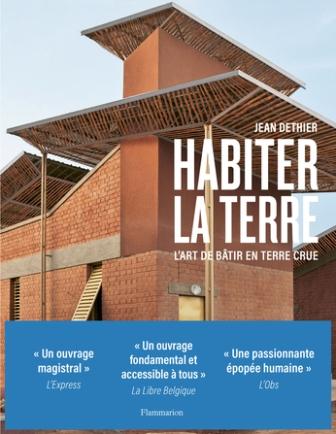 |
Jean Dethier et Jean-Louis Cohen : « Habiter la
terre L'art de bâtir en terre crue : traditions, modernité et avenir »,
Nouvelle édition compact - 512 pages, 216 x 279 mm, Couleur, Flammarion, 2022.
Le retour à la terre pour la construction de nos habitats ne relève plus
d’espoirs, de doux rêveurs et autres post-soixante-huitards en mal
d’écologie… Ces aspirations naguère moquées se trouvent fort heureusement
depuis plusieurs années enfin prises au sérieux en raison de la prise de
conscience des réalités écologiques qui s’imposent, avec plus de nécessité
et d’urgence que jamais, à notre époque.
Il s’agit toujours d’une action militante qui anime les auteurs Jean
Dethier, essayiste, architecte et activiste, et Jean-Louis Cohen,
historien de l’architecture, professeur au Collège de France et à la New
York University. Certains lecteurs se souviendront de l’impressionnante
exposition que Jean Dethier avait consacrée à ce thème en 1981 au Centre
Pompidou, mais pour les plus jeunes et curieux ou convaincus, c’est une
admirable synthèse de référence qui est aujourd’hui proposée avec ce livre
d’art de plus de 500 pages et 800 photos et dessin au format généreux 24 x
31 cm.
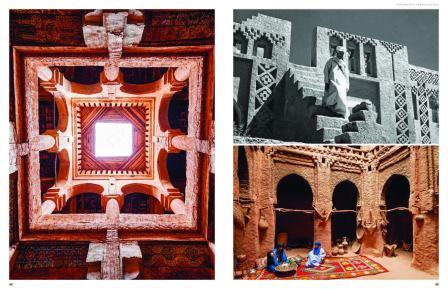
Le propos est décloisonné, si l’on peut dire, aux cinq continents et à
travers les temps puisqu’un chapitre entier est consacré à l’histoire des
logiques constructives au fil des siècles. C’est un véritable plaidoyer
qui est en ces pages inspirantes ainsi proposé au lecteur, une réflexion
qui ne fait pas pour autant l’impasse des difficultés et limites de cet
art traditionnel. Car nous réalisons bien rapidement en découvrant ces
réflexions que notre époque « moderne » a étonnamment fait l’impasse d’une
des techniques les plus anciennes de l’homme pour édifier son habitat,
suivant en cela le modèle laissé par un grand nombre d’espèces du monde
animal.
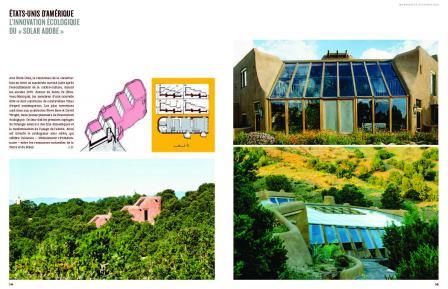
Or, nos deux
auteurs entendent bien réconcilier nos contemporains avec ce génie créatif
qui outre ses qualités techniques, esthétiques et économiques, témoigne
d’une approche écologique incontestable pour celles et ceux en ayant fait
l’expérience.
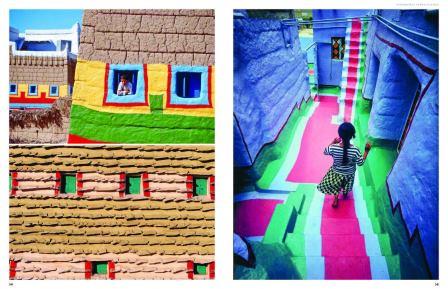
Il suffira pour
s’en convaincre d’avoir un jour édifié un mur en torchis au lieu et place
de parpaings… Isolant, respirant, recyclable et solide, la terre ne se
limite pas à des architectures « frustes » et sommaires, mais s’offre à la
créativité des architectes qui ont fait la preuve de leurs créativités
contemporaines rappelées dans ces pages superbement illustrées.
|
| |
 |
« Carlo Mollino - Architect and
Storyteller » ; 24 x 32 cm, 456 pages, 502 color and 45 b/w illustrations,
Park Books, 2021.
Designer d’intérieur, photographe et architecte réputé, Carlo Mollino a
inscrit son nom en lettres d’or dans le design du siècle passé. Le fort et
riche volume publié par les éditions Park Books présente la synthèse de
son travail en tant qu’architecte sous la plume de Napoleone Ferrari et
Michelangelo Sabatino. Enrichi de contributions par Guy Nordenson et
Sergio Pace, ce beau livre se veut non seulement instructif sur cette
personnalité légendaire mais également des plus esthétiques grâce aux
photographies inspirées de Pino Musi.
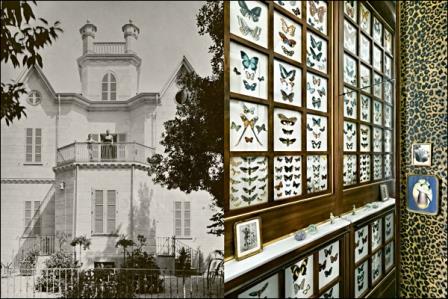
Né en Italie avec le début du siècle en 1905, Carlo Mollino a laissé son
nom à la postérité grâce à ses nombreuses créations de meubles de nos
jours très recherchées. Ses polaroïds aux photos osées pour l’époque
constituent également une autre facette du personnage… Mais le présent
ouvrage s’attache à un aspect de la production du designer plus méconnu
avec ses multiples contributions à l’architecture. Si l’homme n’a réalisé
que peu de projets, ses idées sur l’architecture et ses nombreuses œuvres
sur papier laissent imaginer la fertilité de sa pensée créatrice.
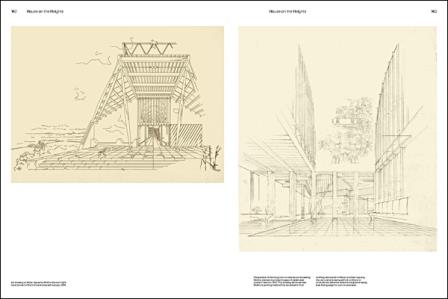
Grâce à une superbe mise en page et une iconographie impressionnante, la
créativité Mollino se dessine page après page et laissera pantois tout
amoureux d’architecture. Que dire en effet sinon son admiration pour le
fameux Teatro Regio et la Chambre de commerce de Turin ? Mais aussi le
Torino Horse Riding Club sans oublier la station Lago Negro dans les Alpes
italiennes ? Toutes ces novations surprennent non seulement pour leur
modernité, l’architecte appartenant manifestement au courant moderniste,
mais aussi pour leurs prouesses témoignant des affinités de Mollino avec
le surréalisme. Le lecteur se délectera de ces créations toutes plus
étonnantes les unes que les autres si l’on songe aux époques qui les
virent naître. À la découverte de ces admirables créations, on ne pourra
regretter qu’une chose, que bien de ces projets soient restés à l’état de
croquis et de papiers si prometteurs…
|
| |
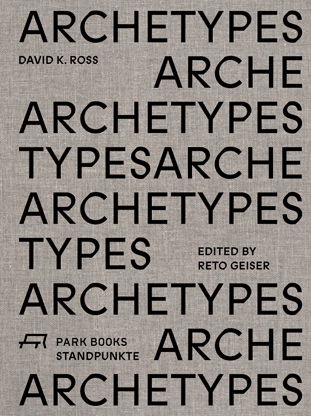 |
"Archetypes" de David K. Ross ;
Photographies de David K. Ross, Sous la direction de Reto Geiser avec les
contributions de Reto Geiser, Sky Goodden, Ted Kesik et Peter Sealy ;
Relié, 120 pages, 21 x 28 cm, Éditions Park Books, 2021.
Les archétypes ne sont plus l’apanage de la psychologie et de la pensée
jungienne ainsi que le démontre ce brillant ouvrage réalisé par l’artiste
canadien David K. Ross et agrémenté de superbes photographies de l’auteur.
Au croisement de la photographie, du film et de l’installation, son
travail conduit en effet à la création d’étonnantes maquettes
architecturales sublimées par un éclairage nocturne des plus
spectaculaires… La pénombre révèle en effet les détails des structures,
souligne les effets de matière pour en dégager des signes infimes
conduisant à une autre vision primordiale de l’architecture.

Ce travail passionnant se trouve ainsi présenté en ces pages étonnantes,
des pages qui suscitent l’envie de découvrir ces créations dans la réalité
de leur installation. Ces fragments architecturaux constituent dès lors un
véritable laboratoire de proto-architecture, témoins silencieux mais
néanmoins évocateurs de tout ce que l’homme a su mettre en œuvre dans
l’édification de bâtiments liés à son environnement.
De manière plus pragmatique, ce travail créatif offre également l’avantage
de pouvoir isoler une part infime d’une future réalisation architecturale
et d’en présenter les grandes lignes avant sa mise en œuvre. Ces
instantanés architecturaux deviennent ainsi autant de réalités en devenir,
en alternative aux créations virtuelles qui dominent de nos jours les
cabinets d’architecture. Aux confins de l’art et de l’architecture, ces
maquettes en préludant aux réalisations à venir constituent de véritables
objets de création à part entière, à découvrir dans cet ouvrage assurément
novateur.
|
| |
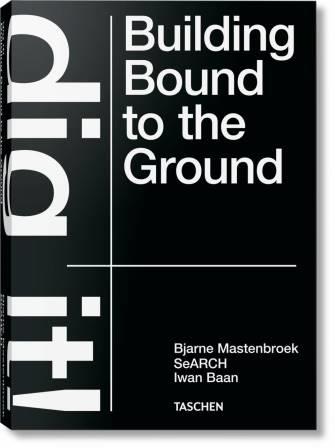 |
Bjarne Mastenbroek : « Dig it!
Building Bound to the Ground » ; Relié, 19,3 x 27,1 cm, 1390 pages,
Éditions Taschen, 2021.
Le rapport étroit et presque intime entretenu entre le sol, les fondations
et l’édifice architectural fait l’objet d’une publication remarquable de
la part des éditions Taschen sous la plume de l’architecte néerlandais
Bjarne Mastenbroek explorant au sens propre et figuré les liens unissant
l’architecture et le site qui l’accueille.
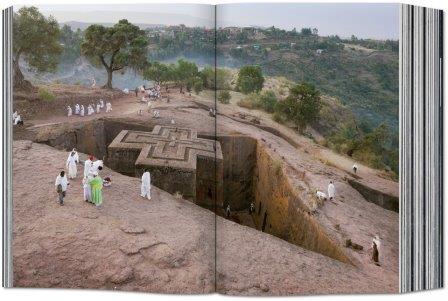
Partant du principe fondamental de la rareté de la terre, ce dernier
demeure persuadé que l’avenir passera par une conception et gestion plus
éclairées de cette ressource limitée pour l’avenir de l’humanité. Cette
dimension rarement abordée avec une telle acuité conduit ainsi cet esprit
résolument tourné vers une architecture écologique à une approche fine et
sensible non seulement du sol, mais aussi de son environnement, sa
configuration et ses interactions avec le milieu.
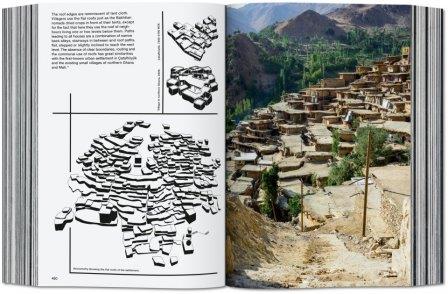
C’est son riche parcours qui a ainsi conduit Bjarne Mastenbroek à
l’écriture de cette somme impressionnante de 1390 pages et 2,5 kg,
véritable roc sur lequel l’auteur développe son approche à partir des
origines de la construction dans l’humanité. Appuyé par une iconographie
tout aussi exceptionnelle grâce aux photographies d’Iwan Baan, cet ouvrage
accompagne le lecteur dans cette compréhension globale de l’acte d’édifier
que l’homme a depuis l’aube des civilisations initié dans des
environnements parfois hostiles ou singuliers.
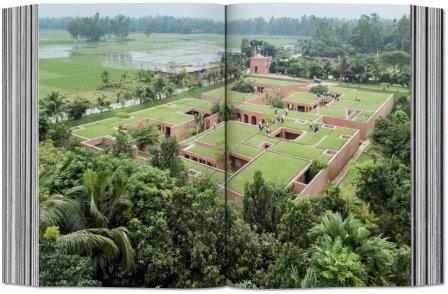
Au fil des pages, quelle que soit la configuration du sol et des lieux,
nous réalisons que les architectures du passé ont rarement fait l’impasse
de ces « fondations » naturelles que représente l’environnement, tirant
parfois profit de situations naturelles défavorables. C’est certainement
là, l’apport de cet ouvrage essentiel que de montrer au lecteur du XXIe s.
combien l’histoire récente des dernières décennies semble prouver qu’en
occultant ou ignorant cette dimension incontournable, l’architecture peut
conduire aux pires impasses, si ce n’est à des désastres. En renouant avec
cette harmonie des sols et environnements, Bjarne Mastenbroek démontre
ainsi avec maestria comment l’architecture de demain pourra renouveler ce
lien toujours ténu entre l’homme, son habitat et la terre qui les abrite.
|
| |
 |
« Duplex Architects - Rethinking
housing » ; 416 pages, Park Books Éditions, 2021.
À souligner, en matière d’architecture, la parution d’une riche
monographie entièrement consacrée aux conceptions et réalisations des
bureaux d’études « Duplex Architects » situés en Suisse et en Allemagne.
L’ouvrage sous la plume de Nele Dechmann offre un focus des plus
intéressants sur le projet de cinq logements en Suisse, allant du « Studen
Housing » au « Living at the Edge of Town » de Limmatfeld en passant par «
Vivre avec le Bruit » dans le quartier de Buchegg ou encore « Bien plus
que le logement » de l’aire Hunziker. L’approche et la conception
particulières propres au bureau d’études « Duplex Architects » créé en
2007 initialement à Zurich sont ainsi, en ces pages, au travers de ces
cinq réalisations, largement exposées et détaillées.
Appuyée par de nombreuses photographies dont celles de Ludovic Balland
auxquelles s’ajoutent de multiples plans et visualisations, l’étude livre
au lecteur à la fois une vision globale, précise et innovante de
l’approche urbanistique retenue par « Duplex Architects ».
À cette approche première de développement urbain, « Duplex Architects »
apporte également une forte attention et exigence aux nouvelles formes de
vie en commun. Importance de la communauté, importance des lieux de
collaborations et de partages jalonnent ainsi les conceptions
architecturales résidentielles.
Des exigences de conception que viennent avec pertinence souligner de
nombreuses contributions d’experts et architectes, dont celles des
associés fondateurs du cabinet Anne Kaestle et Dan Schürch. Un ouvrage qui
ne peut que retenir l’attention.
|
| |
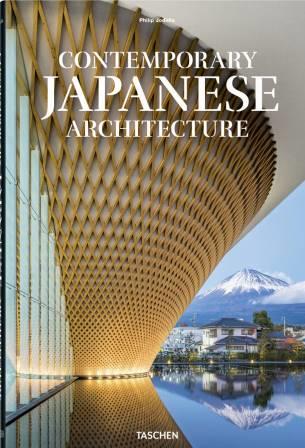 |
« Contemporary Japanese Architecture » de Philip
Jodidio Relié, Édition multilingue: allemand, anglais, français, 24,6 x
37,2 cm, 448 pages, Éditions Taschen, 2021.
Le pays du Soleil Levant a démontré depuis plus d’un demi-siècle que son
architecture avait su suivre et anticiper les tendances les plus
contemporaines de l’architecture moderne. Si l’Exposition universelle
d’Osaka en 1970 a en quelque sorte accéléré ce processus, on ne compte
plus depuis le nombre d’architectes majeurs japonais ayant signé les plus
belles créations tels Tadao Ando, Shigeru Ban, Kengo Kuma ou encore Junya
Ishigami… Pas moins de sept architectes japonais ont remporté le Pritzker
Prize, signe de la vitalité de l’architecture japonaise contemporaine.
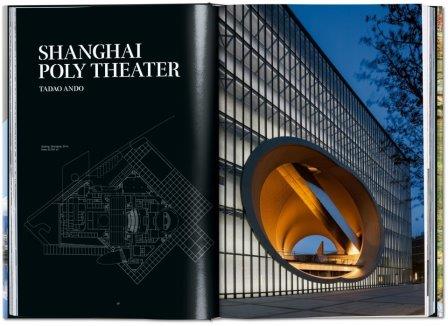
Les
éditions Taschen publient aujourd’hui un splendide ouvrage signé Philip
Jodidio, ouvrage à la hauteur de ces réalisations ambitieuses, véritables
traits d’union entre passé et modernité, nouvelles technologies et
écologie. Riche d’une créativité qui surprend à chaque réalisation, le
Japon fascine toujours autant lorsque l’on fait défiler les pages de ce
livre d’art aux généreuses dimensions. Philip Jodidio rappelle les grandes
lignes artistiques qui caractérisent les créations de Tadao Ando,
appréciées dans le monde entier pour leur synthèse réussie entre orient et
occident, de Kengo Kuma (Stade national du Japon pour les derniers JO),
Kazuyo Sejima (Musée Kanazawa d’art contemporain du 21e siècle) et bien
d’autres jeunes architectes associant avec une créativité désarmante
virtuosité et écoresponsabilité.
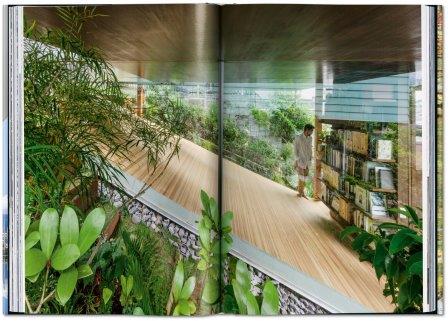
Trouver et exploiter l’espace au Japon, pays dont la majeure partie du
territoire est occupé par les montagnes, a toujours été un défi lancé par
l’homme. A l’heure de la mondialisation et de la crise écologique, ce
questionnement est plus que jamais au cœur de la réflexion des architectes
japonais. Une interrogation redoublée par les nombreux désastres qu’a
connu le Japon ces dernières décennies, qu’il s’agisse sur le plan
sismique tout autant que nucléaire. Comment concevoir de nouvelles
architectures en un pays si densément peuplé et touché par la force des
éléments ? Tel est le défi relevé avec intelligence et art par ces
créateurs des temps modernes et que ce magnifique livre d’art à
l’iconographie soignée célèbre de la plus belle manière !
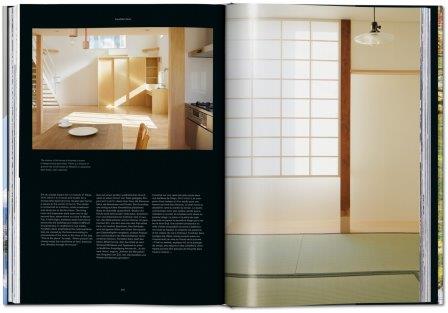
|
|
PHILOSOPHIE - SOCIETE - ESSAIS - PSYCHANALYSE |
 |
«
Cicéron - Œuvres philosophiques complètes » ; Traduction de Charles Appuhn ;
Edition revue et complétée par Maxence Caron ; Préface : Frédéric Albert
Lévy, 1 376 pp., Coll. Bouquins, Editions Robert Laffont, 2025.
Cet ouvrage mérite sans aucun doute le qualificatif de fort volume si l’on
considère ses 1 376 pages consacrées à l’intégralité des textes
philosophiques de Cicéron réunies, ici, en un seul volume. Il n’en fallait
pas moins pour honorer la mémoire de celui qui ne souhaitait guère être
réduit au statut de seul brillant orateur… ce qu’il était, certes,
assurément, mais pas seulement ! Il suffira pour le lecteur avisé ou pour le
plus grand public de considérer ne serait-ce que la liste des titres
rassemblés par le philosophe Charles Appuhn (1862-1942), et complétée par
l’écrivain et philosophe Maxence Caron, pour s’en convaincre. Des titres
passés à la postérité des humanités tels « De la République », « Des lois »,
« Hortensius » ou encore de « De l’amitié », des titres qui comptent parmi
les trésors de la pensée latine et méritant une telle publication. Ainsi que
le souligne Frédéric Albert Lévy dans sa préface, la connaissance des
conditions de rédaction des textes philosophiques de Cicéron contribue à
mieux comprendre leur nature et leur portée. Marcus Tullius Cicero avait, en
effet, pris dès 47 le parti de Pompée contre César… ce qui fut un mauvais
choix selon l’Histoire qui connut l’écrasement définitif des troupes
pompéiennes ! Se retirant par prudence des affaires, Cicéron quitta alors
Rome pour sa propriété de Tusculum où il dut encore affronter de nouvelles
épreuves avec la mort de sa fille tant chérie, Tullia. Eloigné à tout point
de vue du faste oratoire, c’est le temps du recueillement et de la
réflexion, ce que traduisent la plupart des œuvres réunies dans ce volume.
Si l’appareil critique impressionnant – près de 300 pages – comblera
chercheurs et passionnés, la « simple » lecture de ces œuvres grâce à une
traduction fidèle à l’esprit et à la lettre du latin de Cicéron, permettra
de mieux se familiariser avec cette pensée exigeante. Elle offrira également
des pages mémorables de réflexions politiques et philosophiques mais aussi
plus personnelles, qui révèlent l’idéal cicéronien : considérer la
philosophie, la poésie, les lettres et les arts comme les seuls garants
d’une République en crise…
Philippe-Emmanuel Krautter |
| |
 |
Emmanuel Tresmontant « CLAUDE TRESMONTANT- Un ouvrier dans la vigne »,
ARCADES AMBO Editions, 2024.
Si le nom de Claude Tresmontant n’est guère connu du grand public, les
passionnés de philosophie des sciences et d’histoire de la pensée chrétienne
conservent encore, à n’en pas douter, le souvenir de cet esprit exigeant.
Les éditions Arcades Ambo ont souhaité perpétuer cette mémoire menacée par
les oublis de la « modernité » en recueillant les souvenirs de son fils
Emmanuel Tresmontant, journaliste ayant embrassé une autre voie que celle de
son père, même si le sous-titre de l’ouvrage rapproche les deux hommes…
Souvenirs familiaux et lignes majeures de la pensée de Claude Tresmontant
tissent le corps de cet ouvrage à la fois spontané et livrant un témoignage
original sur une rare intelligence, reconnue par ses pairs. Sa connaissance
intime et déterminante de la Bible hébraïque et sa vision métaphysique
influenceront ses ouvrages Les Métaphysiques principales, Science de
l’univers et problèmes métaphysiques, Le problème de l’âme, ou encore
Comment se pose aujourd’hui le problème de l’existence de Dieu. Ses
nombreuses recherches le porteront à analyser les rapports entre foi et
raison, en digne héritier de Teilhard de Chardin.
Ce philosophe de la métaphysique et de la science, professeur à la Sorbonne,
n’hésitait pas à soutenir qu’une approche rationnelle pouvait légitimement
appréhender la connaissance de Dieu. En alliant, pour cette quête,
découvertes scientifiques et héritage médiéval de la pensée thomiste,
Tresmontant a mis en œuvre, ainsi que le rappelle son fils, une pensée à la
fois exigeante et accessible, à la croisée des disciplines dans lesquelles
cet esprit curieux excellait.
Ce philosophe de la Création, comme le souligne encore Emmanuel Tresmontant,
partait du concept d’information primordiale, une information initiale
allant en complexité, pour parvenir à la complexité même de l’univers.
Réconciliant l’héritage hébraïque et la théologie chrétienne, cet
infatigable chercheur a su poser un regard nouveau sur le christianisme.
En filigrane de cette réflexion philosophique, le témoignage d’Emmanuel
Tresmontant dévoile aussi un parcours plus personnel, marqué par une
relation complexe entre père et fils… Ce qui aurait pu n’être qu’un récit
hagiographique de plus prend ainsi une autre couleur avec cette relation
singulière qui « unit » ce père ayant quitté le foyer familial et son fils…
Face à ce grand vide, le destin va cependant tisser de longs fils et
rapprocher ces deux êtres que la vie avait séparés, dont le touchant récit
est évoqué pudiquement en ces pages.
Entremêlant souvenirs personnels et évocation de la pensée de Claude
Tresmontant, cet ouvrage aussi original que sensible retient le lecteur en
le faisant entrer dans cette féconde richesse de pensée.
Philippe-Emmanuel Krautter |
| |
 |
« Grand
Atlas 2025 » de Cécile Marin et Frank Tétart, Éditions Autrement, 2025.
Le Grand Atlas 2025 réalisé sous la direction de Cécile Marin et Frank
Tétart apportera bien des éclaircissements et réponses aux grandes questions
posées par les relations internationales, les sujets sensibles ne manquant
pas ces derniers mois… À l’aide de plus de 100 cartes inédites et mises à
jour, 50 infographies et documents pour comprendre le monde, ce Grand Atlas
va au-delà des ouvrages de ce genre en ajoutant une dimension analytique
indéniable afin de mieux discerner les tensions, enjeux et défis
internationaux.
Réalisé en partenariat avec Franceinfo, ce Grand Atlas permet non seulement
de comprendre le monde du XXIe siècle avec un dossier spécial
Israël-Palestine posant l’alternative « conflit régional, enjeu mondial »,
mais offre également des rappels précieux sur l’Histoire telle cette
rubrique consacrée aux «150 ans de la conférence de Berli ».
Réunissant les analyses des meilleurs spécialistes français (géographes,
économistes, politologues…), cet ouvrage abondamment illustré par de
remarquables cartes adaptées par Cécile Marin conjugue graphisme didactique
et développements analytiques afin de mieux comprendre le monde
d’aujourd’hui et celui qui sera le notre demain |
| |
 |
«
Contre-offensive - Agir et résister dans la complexité » de Miguel Benasayag
et Bastien Cany, Le Pommier éditions, 2024.
Comment agir dans la complexité ? Résister lorsque les fondements des
sociétés dans lesquelles nous avons eu l’habitude de vivre longtemps sans
orages vacillent ? C’est à ces questions et à bien d’autres encore
auxquelles cet ouvrage tente d’apporter sinon des réponses définitives –
impossibles à poser – tout au moins des pistes d’engagement. Le philosophe
et psychanalyste Miguel Benasayag avec Bastien Cany montre combien notre
époque se trouve marquée par une complexité qui ne parvient plus à reposer
sur le seul postulat du progrès mis à mal ces dernières années. Le chaos
tente de se substituer au toujours plus, et le relativisme ambiant ne
propose plus de solutions… « La solution devient partie intégrante du
problème » soulignent les auteurs alors que l’humanisme hérité de la
Renaissance occidentale bute sur de nouvelles concurrences : monde animal,
nature, migrations, etc. Face aux relectures souvent masquées d’un
capitalisme vertueux épris soudainement d’écologie, une radicalité nouvelle
défend une vision plus complexe dans laquelle l’individu ne peut plus être
conçu sans les liens dont il dépend.
En partant de la proposition du philosophe Rodolfo Kusch sur la manière d’«
habiter le présent » ou Estar siendo, l’ouvrage pose la question «
Au nom de quoi résister ? », non point dans l’optique d’une
contre-offensive révolutionnaire de plus ayant montré ses limites - Miguel Benasayag est bien placé pour les avoir vécues dans sa chair (lire
nos entretiens) – mais plutôt d’un « décentrage » sans recherche d’une
justice finale. Écartant les courants militants depuis les campus américains
pour une déconstruction de l’universalisme colonial, posant ainsi un
relativisme culturel caricatural de plus, Benasayag cherche ailleurs les
voies de l’agir qui abandonneraient le mythe de l’homme « normal » dont le
désir est continuellement marqué par le manque. Son regard le conduit alors
à s’écarter de cette pensée de l’ingénieur omnipotent créant encore de nos
jours les prisons « sans barreaux » dans lesquelles nous nous jetons
volontairement (I.A, smartphones, algorithmes, etc.) pour leur préférer une
puissance des savoirs et des expériences situées, à savoir une pensée locale
et un agir également local. Nous retrouvons ainsi ce thème fertile chez le
philosophe de l’Agir dans la complexité qui écarte toute pensée globale au
profit d’une territorialisation des savoirs et des situations concrètes
alors que « le scientisme prétend faire de la science une dimension
abstraite et déterritorialisée ».
Sans adhérer pour autant au mythe du « bon sauvage », Miguel Benasayag
souligne combien la situation est beaucoup plus complexe que cette vision
béate réductrice. Le cœur de l’action s’articule à partir de micro-résistances au caractère restreint et sans programme global, « ce qui
signifie concrètement lutter contre la destruction, sans recours à
l’imaginaire d’un modèle alternatif et sans tomber dans l’illusion de
vouloir maîtriser le devenir des situations » (p. 141). Se décentrer
afin de tenir compte de l’altérité du réel – sans pour autant suivre des
cours de chamanisme en 10 leçons – la véritable puissance résidant sur le
plan horizontal de la base, à partir d’expériences et projets ainsi que le
démontrent le vécu des occupations des terres au Brésil et en Argentine ou
encore le troc en pleine crise argentine de 2001. Faire l’expérience
d’autres rapports au monde, ici et maintenant, plutôt que de s’enfermer dans
les tours de cristal de l’analyse rationnelle, telles sont les pistes de
réflexion avancées par cet ouvrage qui propose de « s’engager sans y croire
» pour un réel engagement, une « Contre-offensive » et un « Agir dans la
complexité »…
Philippe-Emmanuel Krautter |
| |

 |
Carl
Gustav Jung : « Sur l’interprétation des rêves » et « Rêves d’enfants –
Séminaire de 1936-1941 », Collection « Espaces libres », Editions Albin
Michel, 2024.
A noter dans la collection « Espaces libres » aux éditions Albin Michel ces
deux ouvrages consacrés à l’interprétation des rêves issus de séminaires
dirigés par Carl Gustav Jung (1875-1961) dans les années 1936-1941 à Zurich.
Dans le premier volume présenté par le regretté Michel Cazenave, dénommé «
Sur l’interprétation des rêves », l’analyste suisse revient lors de ces
séminaires sur l’importance des symboles et des mythes pour l’interprétation
des rêves, mais aussi sur sa divergence de méthode d’interprétation quant à
celle de Freud. Sans jamais, cependant, rejeter la méthode freudienne qu’il
connaissait particulièrement bien pour avoir été le disciple de l’analyste
autrichien, ni même celle de son confrère Adler, C. G. Jung précise la
sienne en termes de méthode concentrique et par « amplificatio ». Le
lecteur retrouvera dans ce volume des parties de séminaires consacrés plus
particulièrement aux rêves de personnages antiques dont nous avons encore
traces notamment « Le commentaire sur le songe de Scipion » de Macrobe, mais
aussi ceux du savant italien Jérôme Cardan à la Renaissance ou encore de la
martyre sainte Perpétue. Dans un fructueux dialogue entre ses meilleurs
élèves dont Madame Marie-Louise von Franz, le grand analyste affine sa
réflexion et méthode tout en constatant et soulignant l’importance déjà
également accordée aux mythes et symboles dans l’antiquité jusqu’au XIXe et
début XXe siècle pour interpréter des rêves et visions. C’est donc autant
une riche étude comparative des méthodes qu’une féconde histoire de
l’interprétation des rêves que le lecteur pourra découvrir dans ce volume.
Le second volume, également présenté par Michel Cazenave, est quant à lui
plus particulièrement centré, ainsi que l’annonce son titre, sur
l’interprétation des rêves d’enfants. Réuni pour la première fois en un seul
et même volume, l’ouvrage offre une réflexion et analyse également menées
par Carl Gustav Jung durant ses séminaires à Zurich de 1936-1941 et mettant
en évidence l’importance dès le plus jeune âge des mécanismes et dynamisme
de l’inconscient et de l’imagination dans les rêves d’enfant. Le lecteur y
retrouvera ainsi analysée selon l’approche jungienne toute la puissance de
l’inconscient et des rêves. Un ouvrage ouvrant bien des portes et battant en
brèche le présupposé et malentendu selon lequel l’analyste suisse ne se
serait occupé que très peu des enfants.
L.B.K. |
| |
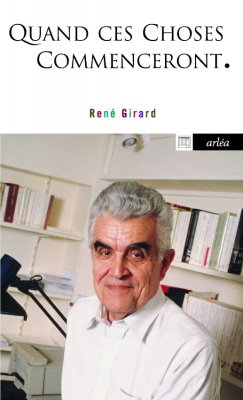 |
« René
Girard – Quand les Choses commenceront… » - Entretiens avec Michel Treguer,
Editions Arléa, 2023.
C’est à un riche, passionnant et long dialogue avec l’un des plus grands
penseurs, René Girard (1923-2015), auquel nous convie Michel Treguer. Un
ouvrage dans lequel le lecteur retrouvera, certes, les thèses majeures du
penseur, sa théorie du mimétisme ou celle du bouc émissaire, bien sûr, mais
aussi et surtout René Girard en tant qu’homme et croyant. Michel Treger mène
à bâtons rompus cette rencontre unique réunissant pour cela deux entretiens
qu’il avait lui-même réalisés du vivant du philosophe et qu’il a pour
l’occasion récrits, entretiens auxquels ont été ajoutés « d’autres
conversations entre René Girard et Jean-Claude Guillebaud » et pour plus de
lisibilité encore « des textes (reformulés) anciens ou récents » de René
Girard.
Au fils des pages, presque trois cents, René Girard accepte volontiers de
préciser, nuancer ou encore d’affiner sa pensée, et par là même de se
dévoiler – avec, cependant, toujours cette retenue et cet humour qui le
caractérisent. Ainsi, revient-il sur les mythes fondateurs, sur le
christianisme, le religieux, la transcendance ou la foi, mais aussi sur les
victimes, la victimisation, le racisme, etc., explicitant ou ajustant ses
thèses au plus près de notre siècle et de l’actualité. Car, Michel Treger,
avec courtoisie mais aussi persévérance, le pousse parfois dans ses
retranchements… Ainsi, ose-t-il lui demander : « J’insiste : pourquoi votre
thèse demande-t-elle l’hypothèse de Dieu ? Je ne suis pas loin de penser
qu’elle l’affaiblit ! » Et René Girard s’excusant presque d’avoir peut-être
mal formulé sa pensée, reprenant et poursuivant inlassablement son
raisonnement, expliquant notamment sa position quant à la Révélation et sa
croyance en tant que chrétien catholique… Et c’est bien, au-delà du grand
penseur, un René Girard intime, que le lecteur découvrira ; un René Girard
acceptant d’éclairer et d’exposer au plus près de sa pensée ses thèses et
positions et, plus que tout, de proposer une lecture qui « pourrait se
révéler utile le jour où se dissiperont les malentendus dont elle fait
l’objet. » ; ce que tente assurément d’atteindre ou de provoquer ce
captivant ouvrage, fruit de longs entretiens menés avec René Girard.
L.B.K. |
| |
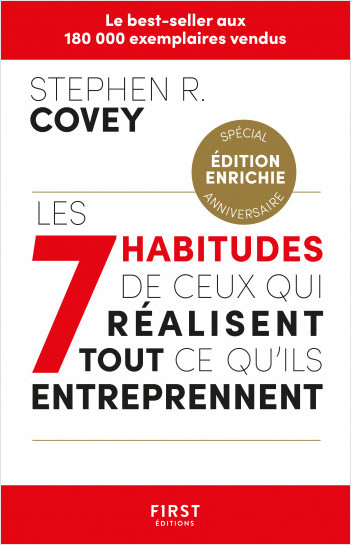 |
Stephen
R. Covey : « Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu’ils
entreprennent », édition enrichie, First Éditions, 2024.
Est-il encore besoin de présenter « Les 7 habitudes » de
Stephen R. Covey, cet ouvrage best-seller avec plus de 40 millions de
lecteurs et qui compte parmi les livres les plus vendus au monde ? Au-delà
du succès éditorial et de la reconnaissance internationale de l’auteur, il
peut sembler néanmoins nécessaire, voire urgent, de se replonger au cœur de
la pensée de Stephen Covey à l’occasion de cette édition anniversaire –
trente années déjà ! - enrichie de textes inédits de son fils Sean Covey qui
a eu à cœur de prolonger le travail de son père.
L’ouvrage part du postulat que nous pouvons en partie diriger notre vie et
rendre celle des autres meilleures à partir de la fameuse approche
gagnant/gagnant, une approche pas toujours facile à mettre en œuvre, surtout
de ce côté-ci de l’Atlantique… Comment se concentrer sur ce qui importe le
plus à toute vie ? De quelle manière mener une vie de services tant sur le
plan professionnel que privé ? Comment gérer l’adversité sans pour autant
perdre sa propre identité ? Toutes ces questions trouvent réponses dans cet
ouvrage qui offre une synthèse de pensées souvent millénaires, laïques et
religieuses, à partir desquelles l’auteur a proposé une démarche positive et
exigeante sur la construction de soi.
Tout commence par la détermination de sa mission (le but de chaque vie), la
détermination de ses rôles et la conduite de ses priorités en une approche
gagnant/gagnant, afin de passer de la dépendance à l’indépendance pour
finalement atteindre l’interdépendance. L’auteur nous explique chacune de
ces étapes, conciliables avec n’importe quelle conviction religieuse ou
laïque, nous offrant de nombreux exemples sur la manière de contrôler notre
vie tout en laissant place à la fantaisie et aux découvertes non
programmées.
Une démarche rigoureuse, certes, mais indispensable à une pleine liberté
retrouvée, celle de notre vie… |
| |
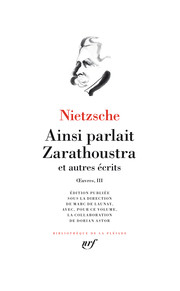 |
«
Friedrich Nietzsche - Œuvres - Tome III - Ainsi parlait Zarathoustra et
autres récits" ; Édition publiée sous la direction de Marc de Launay avec la
collaboration de Dorian Astor ; Bibliothèque de la Pléiade, n° 668, 1376
pages, rel. Peau, 104 x 169 mm, Editions Gallimard, 2023.
Il faut (re)découvrir la pensée de Friedrich Nietzsche (1883-1885), ce
philosophe trop souvent incompris – voire trahi, cette pensée complexe
reposant sur les origines tout en souhaitant se départir des carcans de
l’Histoire. Considéré souvent comme antisémite en raison de sa récupération
posthume par le régime nazi et des torts causés par sa sœur cédant à ces
sirènes brunes, Nietzsche ne cessa pourtant de s’opposer aux ennemis du
peuple juif, sa rupture avec Wagner en témoigne ainsi que cette analyse
d’une lucidité impressionnante en 1878 : « dans presque toutes les
nations actuelles – et cela d’autant plus qu’elles adoptent à leur tour une
attitude plus nationaliste – se propage cette odieuse littérature qui entend
mener les Juifs à l’abattoir, en boucs émissaires de tout ce qui peut aller
mal dans les affaires publiques et intérieures » (Humain, trop humain).
Le philosophe est de tous les combats : contre l’héritage platonicien tout
en étant un farouche opposant au christianisme et plaidant la « mort de Dieu
»… Nous le voyons, cette pensée originale ne se laisse pas appréhender
facilement au risque de passer à côté de sa richesse ; c’est justement tout
le mérite de ce troisième et dernier volume des œuvres de Nietzsche de la
collection La Pléiade sous la direction de Marc de Launay avec la
collaboration de Dorian Astor que de nous inviter à ce trésor plus souvent
cité que lu.
C’est un héritage dont nous n’avons pas encore fini d’apprécier la
profondeur ainsi que le souligne Marc de Launay qui dirige cette édition : «
Ainsi parlait Zarathoustra inaugure la dernière période de l’évolution
philosophique de Nietzsche, et entend être l’amorce d’un nouveau style où
l’exposé théorique ne rechigne plus à s’acquitter d’une dette enfin reconnue
à l’égard de l’élément poétique qui fait la substance même du langage ».
C’est, en effet, le célèbre ouvrage « Zarathoustra » qui ouvre ce volume, un
texte majeur du philosophe dont les origines remontent à l’époque de son
séjour à Bâle au début des années 1870 avant sa conception dix ans plus tard
de 1883 à 1885 après avoir conclu Le Gai Savoir où l’auteur avait
pris date avec ses lecteurs sur cet énigmatique Zarathoustra et le concept
de l’Éternel retour. Ce texte jugé comme essentiel par Nietzsche lui-même
avait été longuement mûri lors de marches interminables, même si sa
rédaction témoigne d’une tension et d’une force qui ne pourront que
surprendre alors même que ce livre sortit quasiment dans l’anonymat lors de
sa parution. Le très vif succès rencontré par « Ainsi parlait Zarathoustra »
ne surviendra, en effet, qu’après la mort du philosophe allemand (un texte
qui inspirera d’ailleurs Richard Strauss pour son sublime poème
symphonique). Anecdote surprenante, Nietzsche aurait achevé sa première
partie alors même que son ancien ami avec qu’il s’était violemment brouillé,
Richard Wagner, rendit son dernier souffle à Venise… Le présent volume
inclut, par ailleurs, concernant cette relation passionnelle deux écrits de
Nietzsche : « Le Cas Wagner » et « Nietzsche contre Wagner ».
Le « poète-prophète » qu’il souhaitait établir avec le personnage de
Zarathoustra fruit d’une « pensée la plus abyssale » selon les termes de
Nietzsche fut malgré tout un échec malgré les concepts essentiels qu’il
lèguera du « Surhomme », tristement détourné et de l’ « Éternel retour »,
souvent incompris.
Un volume essentiel mettant en valeur toute la richesse des œuvres du
philosophe allemand comprenant également : « Par-delà bien et mal », « Pour
la généalogie de la morale », le « Crépuscule des idoles », « L’Antéchrist
», « Ecce homo ». |
|
|
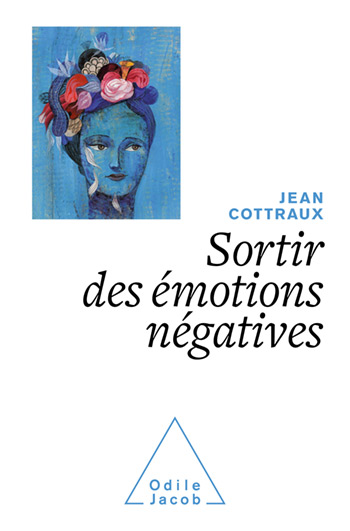 |
Jean
Cottraux : « Sortir des émotions négatives », Editions Odile Jacob, 2023.
C’est un véritable et redoutable vadémécum que nous propose Jean Cottraux,
auteur déjà d’une vingtaine ouvrages dont le fameux « La force avec toi »,
avec cette dernière parution « Sortir des émotions négatives » aux éditions
Odile Jacob. Dans un premier temps, Jean Cottraux distingue pour plus de
clarté et compréhension les émotions des sentiments ; une distinction
souvent négligée et qui lui permet de préciser que « le côté obscur des
émotions est celui où sont tapis les mauvais sentiments : ceux qui
pourrissent la vie et que l’on préfère cacher (…) ». Après avoir ainsi
rappelé ce que sont les émotions, les sentiments, passions et humeurs,
l’auteur livre au lecteur un réel programme en huit points de gestion des
émotions négatives. Dénommé PAEN, ce dernier opte pour une approche
dynamique en proposant un programme d’autogestion de nos émotions négatives.
Appuyé par de nombreux tableaux clairs et précis, Jean Cottraux précise que
ce programme « vise à ce que chacun d’entre vous puisse devenir son propre
thérapeute en puisant dans les méthodes bien validées de la thérapie
cognitive et comportementale. »
Jean Cottraux prend soin de compléter et d’illustrer ce programme par deux
autres chapitres, tout aussi majeurs et d’une efficacité certaine exposant,
une à une, « les émotions destructrices pour soi » (angoisse, culpabilité,
la tristesse, etc.) , ainsi que « les émotions négatives pour les autres »
(la colère, l’envie, le mépris, etc.), une approche non autocentrée, donc,
et des plus appréciables distinguant notamment l’envie de la jalousie. Dans
un style clair et concis et au gré de ces chapitres, le lecteur pourra ainsi
pour chaque situation négative envisagée appréhender pleinement point par
point la force de celle-ci, son origine, ses conséquences, et surtout les
solutions et conseils pratiques et efficients pour y faire face. Car, c’est
bien de « Sortir des émotions négatives » dont il s’agit pour pouvoir enfin
se tourner et développer de réelles émotions positives telles que la joie,
le bien-être, la sérénité, mais aussi la créativité...
Un ouvrage qui permettra à chacun de comprendre ses propres émotions
négatives - que celles-ci soient strictement personnelles ou suggérées
collectivement par des jeux de pouvoir et de manipulation - afin de trouver
de nouveaux ancrages, socles d’émotions positives. |
| |
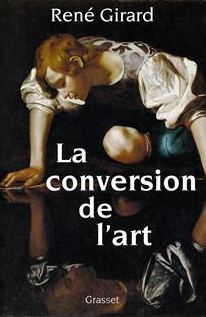
|
René
Girard : « La Conversion de l’art » ; Préface de Benoît Chantre et Trevor
Cribben Merril ; Editions Grasset, 2023.
Cet ouvrage regroupe des textes du grand et regretté penseur Renée Girard
disparu en 2015 ; Huit textes précisément - dont cinq de jeunesse, allant de
1950 à 1980 complétés par deux entretiens (extraits) qu’il accorda.
Initialement ce recueil dont R. Girard signa l’avant-propos en 2008
accompagnait une conversation filmée avec Benoît Chantre – « Le sens de
l’histoire », réalisée à l’occasion de l’exposition « Traces du sacré » au
centre-Pompidou de Paris et envers laquelle l’auteur de « Mensonge
romantique et vérité romanesque » entendait se démarquer et opposer une
forte réserve. R. Girard souhaitait par cet ouvrage faire entendre, et
surtout, comprendre « sa méfiance originaire à l’égard de l’art moderne »
dont l’épuisement reposait, selon lui, sur la violence du sacrifice, à
l’instar du religieux archaïque. Pour cela, il retint ces huit textes
marquant la progression de sa pensée, des écrits pour la majeure partie
consacrés à la littérature et allant de son départ d’Europe en 1947 et son
arrivée aux États-Unis jusqu’à la fin des années 80.
Si avec le texte « Où va le roman ? » publié en 1957, R. Girard semble
encore croire à un renouvellement du roman, et au-delà des textes de 1953
consacrés à Saint-John Perse qu’il admire et comprend en arrivant aux
États-Unis ou encore celui consacré à André Malraux, le lecteur retrouvera
déjà en germe dans ces écrits toute la puissance de sa pensée et de sa
théorie mimétique. En ce sens est évocateur ce texte de 1957 consacré à Paul
Valéry et à Stendhal dans lequel le penseur souligne déjà ce « Moi-pur » de
Valéry et sa préférence pour l’égotisme stendhalien.
Girard refuse tout snobisme littéraire ou artistique et, pour l’auteur de «
La violence et le sacré », l’artiste moderne est rongé par la rivalité.
L’article de 1978 consacré à Proust en fait l’éclatante illustration tant
l’auteur de la Recherche est pour Girard « le plus grand théoricien des
miroitements du Moi ». Narcissisme, désir et rivalité imprègnent ces pages,
mais ce sera, surtout, avec des études consacrées à Hölderlin, à Nietzsche
ou encore à Wagner que le penseur confirmera ses intuitions et affirmera sa
théorie. « Leur instabilité - étant selon R. Girard, symptomatique de la
conscience moderne dans son rapport ambivalent au sacré. » On songe, ici, à
l’article de 1986 « Nietzsche et la contradiction ».
La littérature romanesque suppose, pour Girard, afin de se détacher de
l’esthétique, une « conversion romanesque ». Cette dernière étant, dira R.
Girard en 1998, « au cœur de son parcours intellectuel et spirituel ».
Celui-ci avait d’ailleurs tenu à refermer son avant-propos en 2008 en ces
termes : « Je ne voudrais pas qu’on prenne ce livre pour un simple essai
d’esthétique. Cette jouissance m’est étrangère. » Car, ce qui importe à
l’auteur de « Mensonge romantique et vérité romanesque », c’est bien cette «
conversion de l’art », et ce dernier ajoutera : « L’art ne m’intéresse en
effet que dans la mesure où il intensifie l’angoisse de l’époque. Ainsi,
seulement il accomplit sa fonction qui est de révéler. » Un propos qui
structure toute sa pensée et par lequel Bernard Chantre et Trevor-Cribben
Merril ouvrent aujourd’hui la riche préface de cet ouvrage indispensable à
la compréhension de l’élaboration et formation de la pensée de ce grand
penseur que fut René Girard.L.B.K. |
| |
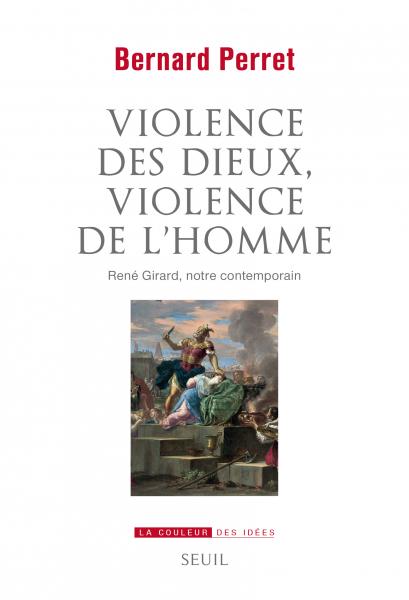 |
Bernard
Perret : « Violence des dieux, violence de l’homme ; René Girard, notre
contemporain », Coll. Seuil La couleur des idées, 368 p., 2023.
Un ouvrage incontournable aux éditions du Seuil, tel est assurément
l’ouvrage de Bernard Perret, « Violence des dieux, violence de l’homme »,
consacré au grand penseur Français René Girard (1923-2015), ainsi que
l’indique son sous-titre « René Girard, notre contemporain ». L’auteur,
auteur déjà de « Penser la foi chrétienne après Girard » (Ad Solem ),
conscient de l’immense apport de René Girard, mais aussi de ses limites, n’a
nullement souhaité par cette parution proposer une pure synthèse ou même un
essai consacré à l’œuvre du penseur, mais bien une réelle mise en perceptive
des apports majeurs de Girard que ce soit sa thèse centrale de la théorie du
désir mimétique, de la rivalité, de la violence ou encore du sacré… Bernard
Perret a opté pour cela pour une approche dynamique par le prisme de la
violence en cinq parties, la première étant consacrée, comme il se devait
pour une telle étude, à un rappel clair et concis d’une centaine de pages à
la progression de la pensée de Renée Girard. Une évolution mise en lumière
suivant la chronologie des publications majeures du penseur, allant de «
Mensonge romantique et vérité romanesque » (1961) au « Bouc émissaire » de
1982 ou de « Les origines de la culture » de 2015 en passant, bien sûr, par
« La violence et le Sacré (1972) ou encore « Des choses cachées depuis la
fondation du monde » de 1978 ; Une première approche qui n’entend nullement
être une simple brève synthèse des théories girardiennes, mais qui en
souligne d’ores et déjà les avancées, revirements ou rejets mais aussi les
zones d’ombre ou se prêtant à la critique.
Ce n’est qu’après ces mises au point que l’auteur revient sur les points de
contact de la pensée de Girard avec d’autres domaines ou sciences, relevant
autant les influences du penseur, ses refus ou ses distorsions. Une nouvelle
approche avec pour axe la violence et permettant à Bernard Perret
d’approfondir ou de préciser certaines prises de position ou nuances de
Girard face au jeu des questionnements ou critiques et de proposer une «
anthropologie de la théorie mimétique au-delà de Girard ». Balayant les
neurosciences avec notamment les neurones miroirs, la psychanalyse et le
rejet de la conception objectale du désir de Freud, ou encore la sexualité,
l’auteur s’arrête plus spécifiquement sur les grands thèmes girardiens :
Ainsi, de la violence du Sacré et de la culture ouvrant un riche dossier
ethnologique, « Girard contre le structuralisme » ou encore de la
transformation du sacré violent en valeurs transcendantes, un thème
également cher à Girard, qui le conduira à souligner toute « la singularité
judéo-chrétienne » et à adopter une pensée apocalyptique ; une conversion,
critiquée ou dénoncée, mais parfaitement assumée par le penseur, et qu’il
convient d’apprécier dans toutes ses acceptions.
L’ouvrage se « referme », enfin, sur un dernier et cinquième chapitre
soulignant l’actualité et portée de la théorie mimétique girardienne tant
pour aujourd’hui que pour demain ; Un chapitre conclusif des plus porteurs….
L.B.K. |
| |
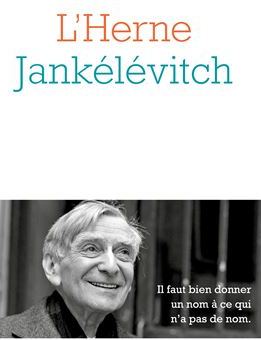 |
«
Jankélévitch », Cahier de L’Herne dirigé par Françoise Schwab, Pierre-Alban
Gutkin-Guinfolleau et Jean-François Rey, Editions L’Herne, 2023.
C’est un dense et captivant Cahier que nous proposent les éditions de
L’Herne avec cette dernière livraison consacrée au philosophe Vladimir
Jankélévitch (1903-1985). On y retrouve dès les premières pages un beau
portrait « grandeur nature » de celui que ses intimes appelaient « Janké »,
cet homme à la mèche folle et au timbre de voix si inimitable ; un portrait
appuyé par des textes évocateurs signés notamment Mauriac, Françoise Schwab,
Pascal Bruckner ou encore Edgar Morin, mais aussi des écrits du philosophe
lui-même ou entretiens que viennent également appuyer de nombreuses lettres.
Indissociable de l’homme, le lecteur y redécouvrira également le professeur
de philosophie qu’il fut et qui marqua cette génération qui aimera tant
l’appeler « Maître » ; on songe avec délices au regretté Lucien Jerphagnon
dont quelques lettres, aussi courtes que savoureuses, viennent témoigner de
ce mélange de respect, de fidélité et de malice qu’ils partageaient…
Homme, Professeur, ami, et bien sûr, philosophe : philosophe « des marges ou
des à-côtés » ainsi qu’il le soulignait lui-même, parfois donné pour
initiés, mais devenu aujourd’hui incontournable tant son absence désole et
laisse un vide irrémédiable. Découvrir ou relire Jankélévitch demeure
toujours un plaisir inépuisable dont ce Cahier de l’Herne témoigne. C’est ce
philosophe de morale aux mille paradoxes, ce philosophe de l’insaisissable,
de l’ineffable, du « Je ne sais quoi » et du « Presque rien » que le lecteur
découvrira par le prisme de ses thèmes majeurs et privilégiés : la musique,
« la moitié de ma vie » dira-t-il – et comment ne pas citer son « Fauré »,
son « Liszt » ?, mais aussi le temps, l’irrévocable et irrémédiable,
l’ironie, la mort, le pardon sans oublier, surtout, l’amour… Des thèmes
forts ayant marqué cette vie faite de convictions, de mémoire, de «
conscience juive » et d’engagement.
Un Cahier de L’Herne qui se laisse dévorer de A à Z ou picorer telle une
gourmandise au grès de ses attentes, questionnements ou humeurs. Lui, qui
aimait à rappeler que « la vérité est équivoque, contradictoire, elle se
dément elle-même. On ne peut l’atteindre, très partiellement, fugitivement,
qu’à demi-mot, grâce à une illusion, à une influence de la voix. » Et
comment ignorer ou manquer, justement, cette voix inoubliable ?
L.B.K. |
| |
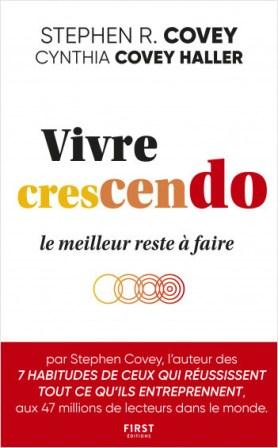 |
« Vivre
crescendo » de Stephen R. Covey et Cynthia Covey Haller, First éditions, 2023.
Le parcours de Stephen R. Covey peut être synonyme de son approche
gagnant/gagnant qu’il a contribué à diffuser dans le monde entier. Sa vie
professionnelle tant que personnelle repose en effet sur cette idée que nous
pouvons en partie diriger notre vie et rendre celle des autres meilleures. À
la fin de sa vie, cet auteur prolifique et mondialement reconnu (lire notre
interview) souhaitait parfaire encore sa pensée en abordant quelques
questions qui lui tenaient à cœur. C’est le résultat de ces interrogations
menées par Stephen R. Covey et complété aujourd’hui par sa fille Cynthia dans «
Vivre crescendo ».
Un ouvrage comportant de nouveaux paradigmes sur notre retraite de la vie
professionnelle qui ne doit jamais être synonyme d’un retrait de la vie.
Comme à son habitude, l’auteur part de cas concrets qu’il soumet dans ces
pages à notre analyse, des cas qui permettent de se concentrer sur ce qui
nous importe le plus à toute vie, à savoir mener une vie de service de la
même manière, avec la même implication que celle menée dans une vie
professionnelle. Cela ne va pas de soi à l’heure où de nombreux salariés se
trouvent « débarqués » la cinquantaine atteinte, engendrant ainsi le
sentiment de ne plus servir à rien. Comme à l’accoutumée, Stephen R. Covey
nous enseigne qu’il faut avoir une nouvelle vision que l’auteur décrit pour
chaque âge et étape de la vie.
Le titre même de l’ouvrage est d’ailleurs dérivé de son propre énoncé de
mission : « Live Life in Crescendo » c’est-à-dire vivre pleinement sa vie,
rejoignant ainsi en quelque sorte le précepte phare des stoïciens. Cette
idée de crescendo s’oppose à la tendance commune de repli et d’égoïsme
souvent constatée l’âge venant. À l’image des sociétés traditionnelles, les
années passant deviennent alors une richesse à faire partager au plus grand
nombre. Quels que soient nos compétences et savoir-faire, il est toujours
loisible et souhaitable, selon l’auteur, de les partager au plus grand
nombre, dans son environnement familial, personnel ou professionnel. C’est à
un véritable plaidoyer pour la vie auquel se livre dans ce dernier ouvrage
posthume Stephen R. Covey (ici, avec sa fille Cynthia Covey Haller), une
belle leçon de vie à partager au plus grand nombre ! |
| |
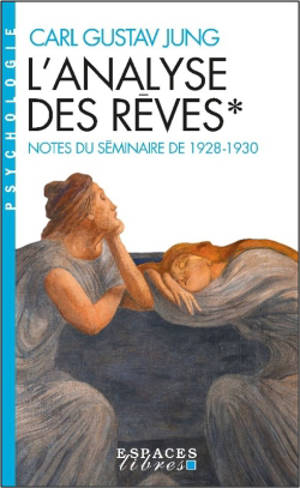
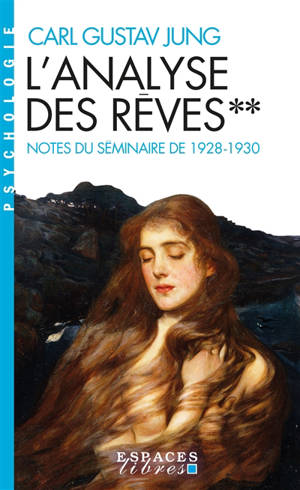 |
«
L'analyse des rêves : notes du séminaire de 1928-1930. Vol. 1 & 2 » de Carl
Gustav Jung, collection poche Espaces libres, Albin Michel, 2022.
Un petit trésor - étonnement indisponible en français jusqu’à la présente
édition - vient de paraître chez Albin Michel : « L’analyse des rêves »
notes du séminaire de 1928-1930 » de Carl Gustav Jung. Dans cette somme en
deux volumes réunis ici, préfacée et traduite de l’anglais par Jean-Pierre
Cahen, la matière vivante du grand psychiatre suisse sur les rêves se trouve
livrée sans retenue grâce aux notes réunies et rassemblées par les
participants lors de ce séminaire ; notes que Jung accepta de voir
reproduites dans un premier temps dans le cercle restreint du Club
psychologique qu’il avait créé à Zurich.
Alors que le célèbre psychiatre suisse était au fait de sa maturité à l’âge
de 53 ans en 1928, ce séminaire fait à la fois figure d’une réflexion « sur
le vif » - le grand analyste encourageant son auditoire à s’impliquer dans
les commentaires et à apporter à son propre témoignage – mais aussi très
aboutie. Aboutie car, une fois de plus, Jung témoigne dans ces pages de sa
grande perspicacité et culture dans la manière d’aborder l’analyse des
rêves, et ce d’une autre manière que celle qui était jusqu’alors menée sous
l’angle freudien.
Avec ces deux volumes, le lecteur comprendra progressivement, page après
page, la valeur non seulement intrinsèque de chaque rêve, mais surtout sa
mise en rapport avec son symbolisme, ses liens avec la mythologie et les
religions. Il s’agit, ainsi que le souligne Jean-Pierre Cahen dans
l’introduction, « d’un enseignement clinique, pratique, concert, continu,
d’une densité exceptionnelle ». Les maladresses des participants, les
hésitations et parfois même les impasses ne sont pas expurgées de son
contenu, témoignant ainsi de la confiance en soi du grand penseur qui
n’avait pas souhaité reprendre la rédaction de ces pages spontanément
réunies.
Les pages et les pensées défilent ainsi à partir de l’analyse « en direct »
des rêves successifs d’un patient suisse que Jung suivait. Se profile alors
une évolution, non seulement chez ce même patient, mais également chez les
participants du séminaire, preuve s’il en était besoin du bien-fondé de la
démarche jungienne démontrée en ces pages de la plus éclairante manière. Une
lecture stimulante et déterminante pour toute réflexion sur les fonctions du
rêve. |
| |
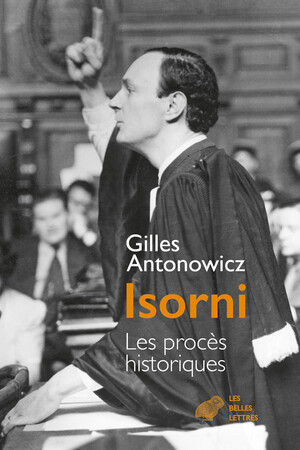 |
Gilles
Antonowicz : "Isorni - Les procès historiques », 208 pages, Éditions Les
Belles Lettres, 2021.
Si le nom d’Isorni est quelque peu sorti de la mémoire collective en France,
ce défenseur des causes politiques et avocat des communistes sous
l’Occupation a pourtant tenu une place privilégiée dans l’univers judiciaire
de notre pays. Gilles Antonowicz, lui-même avocat réputé, a su se saisir de
cette personnalité hors normes qui accepta tout aussi bien de défendre un
personnage comme Brasillach ou Pétain à la Libération que les causes perdues
d’avance des minorités pendant la Seconde Guerre mondiale.
Jacques Isorni n’a pas cherché le sensationnel en défendant les causes
impossibles, mais s’est surtout attaché à se placer « du côté des
prisonniers ». Après Maurice Garçon à qui l’auteur a consacré une biographie
remarquée en 2019, c’est au tour d’un autre ténor du barreau en la personne
d’Isorni de nourrir cet essai haut en couleur qui transportera le lecteur
dès les premières pages aux heures sombres de l’Occupation… Au lendemain de
la guerre, les difficultés sont loin d’être terminées et le brillant avocat
déplacera son champ d’action « de l’autre côté » en prenant la défense de
personnalités jusqu’alors victorieuses et soudainement placées au rang
d’accusés présumés coupables. Une fois cette période trouble passée, la
tension ne se relâchera pas avec les années de décolonisation et la guerre
d’Algérie. Chaque décennie offre à Jacques Isorni de plaider les causes
impossibles grâce à ses plaidoiries inoubliables et cette conviction
indéfectible soulignée même par ses détracteurs. Ce sont ces grandes heures
du barreau que Gilles Antonowicz nous fait revivre de manière passionnante,
lui qui les connaît de l’intérieur et parvient à les éclairer d’une plume
captivante.Philippe-Emmanuel Krautter |
| |
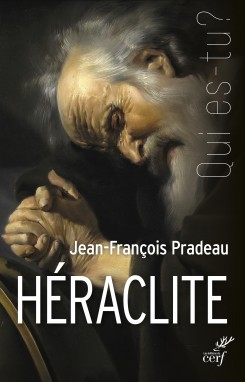 |
« Héraclite »
de Jean-François Pradeau, Collection Qui es-tu ? 136 pages, Éditions du
Cerf, 2022. La didactique collection « Qui es-tu
? » des éditions du Cerf parvient à faire revivre en à peine plus d’une
centaine de pages Héraclite, un des philosophes antiques dont la pensée ne
nous est parvenue que sous forme fragmentaire. L’auteur, spécialiste
incontesté du philosophe présocratique, nous fait remonter le temps à une
vitesse vertigineuse, près de vingt-six siècles, afin de mieux découvrir ce
« marginal illustre » ainsi qu’il le nomme en introduction.
Si seule une centaine de phrases d’Héraclite ont pu parvenir jusqu’à nous,
ses contemporains, puis les auteurs anciens qui transmettront par la suite
son oeuvre, soulignaient déjà la force de sa pensée mais également la
complexité de certains de ses discours. Les quelques rares informations dont
nous disposions encore de nos jours sur Héraclite proviennent de Diogène
Laërce dans ses « Vies et doctrines des philosophes illustres » et qui ouvre
ce petit ouvrage d’une clarté remarquable, l’auteur étant professeur de
philosophie ancienne à l’université Jean-Moulin de Lyon (Lyon-3) et ayant
publié une trentaine de traductions commentées et une dizaine de
monographies savantes sur le sujet. Mais que le béotien se rassure, avec ce
petit ouvrage, nul hermétisme universitaire, mais une présentation aussi
claire que possible sur la nature de l’âme et du primat du feu, essentiel
dans la pensée du philosophe ermite, guère compris de ses contemporains.
Au terme de cette riche évocation de la pensée d’Héraclite, le lecteur
s’approchera au plus près de cette tentative de connaissance totale de la
réalité qu’avait recherchée toute sa vie le philosophe, une fin en soi, mais
également un moyen à garder tout au long de sa vie afin de vivre au sens
plein du terme. Une belle initiation à la sagesse antique ! |
| |
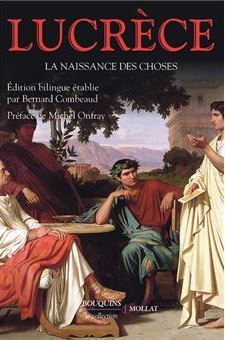 |
«
Lucrèce ; La naissance des choses » ; Edition bilingue établie par Bernard
Combeaud ; Préface de Michel Onfray ; Editions Mollat / Bouquins, 2021.
Plaisir que de lire « La Naissance des choses » ou « De rerum natura » du
poète Lucrèce dans cette édition bilingue établie par le regretté Bernard
Combeaud (1948-2018) et parue aujourd’hui dans la collection Bouquins. Texte
majeur de la littérature antique, Bernard Combeaud a souhaité pour cette
édition revenir à sa version originelle et retenir la rigueur de traduction
de la métrique latine. Un choix tout à son honneur et qui a reçu le prix
Jules-Janin de l’Académie française en 2016. « La Naissance des choses » ou
« De la Nature des choses », seul et unique livre connu du poète latin
comporte plus de sept milles vers. Bernard Combeaud, bien que reconnaissant
qu’il existe de très talentueuses traductions, avoue cependant que « fasciné
depuis longtemps par ce génie si proche de Dante ou d’Hugo, j’avais caressé
l’idée de traduire sur frais le poème de La Nature », ajoutant : « Rendre en
prose un poème étranger est une opération du même ordre qu’adapter un roman
pour le cinéma ou que transposer une partition pour un autre instrument que
celui pour lequel elle avait d’abord été composée : dans les deux cas, on
change alors non de langue seulement, mais bien de langage ». Comment ne pas
acquiescer ?
De Lucrèce, lui-même, poète-philosophe du 1er siècle avant notre ère, on ne
connaît que très peu de choses, si ce n’est qu’il eut pour maître Épicure et
que cela est donc toujours une réjouissance extrême que de lire et relire en
ces vers les principes d’un monde épicurien selon le poète latin. Une
philosophie « praticable » ainsi qu’aime à le rappeler Michel Onfray qui
signe, ici, la présentation de cette édition. Une présentation sous forme
d’un échange « A bâtons rompus » entre le philosophe normand et Bernard
Combeaud, mais interrompu malheureusement par la disparition de ce dernier.
Un échange fécond revenant sur les sources, sur Epicure et Lucrèce, sur le
poète et les Dieux…
Un seul, long et inachevé, poème condamné par saint Jérôme et autres pères
de l’Eglise mais qui fut, souligne Bernard Combeaud en son avant-propos,
célébré par Cicéron lui-même : « Les poèmes de Lucrèce sont bien ce que tu
m’écris : ils brillent de toutes les lumières du génie, sans que l’art y
perde, tant s’en faut » écrivait l’orateur romain à son frère. Ce qui
conduit Michel Onfray à penser que « La volonté de recourir au miel du vers
pour faire passer le vinaigre de la sagesse épicurienne fait
philosophiquement sens : Lucrèce s’adresse au plus grand nombre, ce faisant,
il élargit avec bonheur le public de la philosophie. » Un bonheur que
Bernard Combeaud a par cette traduction su si bien renouveler. Bernard
Combeaud a qui nous devons également les « Œuvres complètes » du poète
Ausone.L.B.K. |
| |
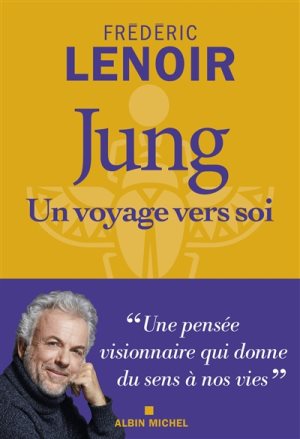 |
Frédéric Lenoir « Jung – Un voyage vers soi »,
Albin Michel, 2021.
Frédéric Lenoir signe chez Albin Michel une biographie consacrée au célèbre
psychanalyste suisse Carl Gustav Jung (1875-1961) alerte, informée, et
surtout, bien venue en France, pays longtemps dominé par le courant freudien
grâce notamment à Marie Bonaparte, puis majoritairement lacanien. Au-delà
des prises de position, malentendus – et bien qu’un vaste travail d’édition
ait été entrepris par le regretté Michel Cazenave, il est heureux que
Frédéric Lenoir offre de nouveau aujourd’hui les clés d’entrée nécessaires à
l’œuvre de Jung. Car si certains apports du psychanalyste sont connus – on
pense notamment aux archétypes, à l’inconscient collectif, son legs demeure
cependant riche et complexe, voire ésotérique. C’est là, cependant,
confondre ses recherches personnelles et ses découvertes et apports en
matière de psychanalyse, alors que le célèbre psychanalyste fut ainsi que
l’écrit l’auteur dès son introduction un fantastique « éveilleur et
visionnaire », soulignant que « Jung n’a cessé de rappeler que c’est de
l’intérieur de la psyché humaine que se trouvent à la fois les solutions
d’un avenir meilleur et les pires dangers pour l’humanité et la planète ».
Or, en notre période troublée par tant de crises sanitaire, économique,
sociale…, les apports et découvertes du célèbre psychanalyste gardent sur
nombre de points toute leur pertinence et actualité.
Frédéric Lenoir livre, ici, une biographie didactique, distinguant selon les
parties et les chapitres les grandes périodes de la vie du psychanalyste, sa
rencontre et rupture avec Freud, ses voyages, amours et amitiés, et les
points sensibles ou grandes notions de la psychologie analytique : Le Moi et
le Soi, l’individuation, l’homo religiosus, synchronicité, des
notions également chères à Mircea Eliade. Jung en consommant sa rupture avec
Freud fut l’un des premiers psychanalystes à prendre en compte la dimension
spirituelle. Cependant, bien que renonçant à être le dauphin de Freud,
considérant que la libido ne saurait être réduite à la sexualité, Jung ne
reniera jamais – contrairement à ce que l’on pense souvent, pour autant
l’apport du père de la psychanalyse.
Qui plus est, Frédéric Lenoir n’élude en ces pages aucun point délicat
notamment la question de la position de Jung durant la Seconde Guerre
mondiale et plus particulièrement durant les années 1933-1939 ; une position
demeurée floue et ayant conduit nombre d’analystes à écarter l’apport et
l’œuvre de Jung. Indéniablement, Frédéric Lenoir a entendu s’impliquer dans
cette biographie n’hésitant pas à plusieurs reprises à donner son opinion et
à utiliser le « je ». Tant l’œuvre du psychanalyste que l’homme – et ses
indissociables lieux de prédilection, Küsnacht, Bolligen, y sont présentés
avec un réel intérêt et une jolie affinité.
Un ouvrage plaisant et didactique offrant les clés indispensables pour
aborder la pensée du grand psychanalyste Carl Gustav Jung et proposant,
ainsi que l’indique son titre, « Un voyage vers le soi ».

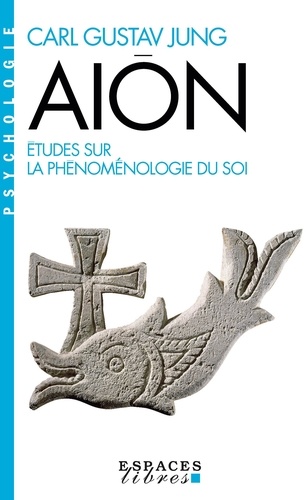
Parallèlement à cette publication, deux œuvres de Carl Gustav Jung
paraissent dans la collection de poche Espaces libres Psychologie des
éditions Albin Michel « L’Âme et le soi – Renaissance et individuation »
ainsi que « Aiôn – Etudes sur la phénoménologie du soi ».
L.B.K. |
| |
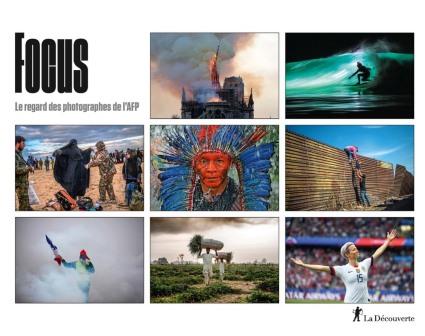 |
Focus
Le regard des photographes de l'AFP édition spéciale 2020, La Découverte,
2021.
Chaque année l’Agence France Presse rassemble ses photographies les plus
marquantes afin de résumer une année. Mais cette année passée n’est
assurément pas à l’image des autres années puisque 2020 a connu l’incroyable
pandémie du Coronavirus qui sévit encore aujourd’hui.
Aussi n’est-il pas étonnant que les premiers clichés marquants soient
consacrés à ce qui allait mobiliser la planète entière. Un homme en train
d’agoniser sur un trottoir en Chine alors que personne ne souhaite le
toucher du fait du virus, le marché « maudit » de Wuhan d’où tout serait
parti, un hôpital de campagne « sorti de terre » en quelques jours comme
seul peut le faire le pouvoir chinois…
Dans ces photos des plus grands photographes de l’AFP, c’est le tragique qui
se dispute à la démesure ; des barricades tentent, en vain, de confiner les
quartiers, une autre vie s’organise, de manière futuriste sur une planète en
apnée, mais devenue pourtant notre quotidien depuis… Alors que se comptent
les morts et destins tragiques, la vie continue néanmoins avec parfois ses
représentations théâtrales presque surréalistes dans une maison de retraite,
des balcons qui dans le monde entier deviennent des lieux de sociabilisation…
Esthétiques, éloquentes, étonnantes, stupéfiantes, les qualificatifs pour
ces clichés pris par les plus grands photographes de l’AFP ne manquent pas
pour cette information en images de tout premier plan d’une année qui aura
marqué la planète entière. |
| |
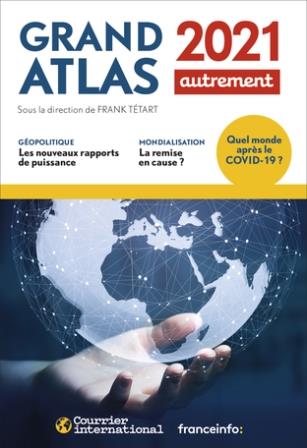 |
Grand
Atlas 2021 sous la direction de Frank Tétart, cartographie : Cécile Marin,
éditions Autrement, 2020.
Impression d’être perdu dans la multitude des rapports de puissance au
niveau planétaire ? Sensation de ne plus percevoir les enjeux de la
mondialisation à l’heure du COVID-19 ? Ce Grand Atlas réalisé sous la
direction de Frank Tétart apportera bien des éclaircissements et réponses à
ces questions légitimes. Avec l’aide de plus de 100 cartes, 50 infographies
et documents pour comprendre le monde, ce Grand Atlas va au-delà des
ouvrages de ce genre en ajoutant une dimension analytique indéniable afin de
mieux discerner les tensions, enjeux et défis internationaux. Réalisé en
partenariat avec Courrier international et franceinfo, ce Grand Atlas permet
non seulement de comprendre le monde du XXIe siècle mais offre également des
rappels précieux sur l’Histoire telle cette rubrique consacrée à la peste
noire qui toucha l’Europe au XVe siècle, la guerre de Sécession, la
naissance de l’État libre d’Irlande, de l’Europe ou encore la construction
du mur de Berlin… Réunissant les analyses des meilleurs spécialistes
français dans diverses disciplines (géographes, économistes, politologues…),
ce livre abondamment illustré par de remarquables cartes adaptées par Cécile
Marin conjugue graphisme didactique et développements analytiques afin de
mieux comprendre le monde d’aujourd’hui et de demain. |
| |
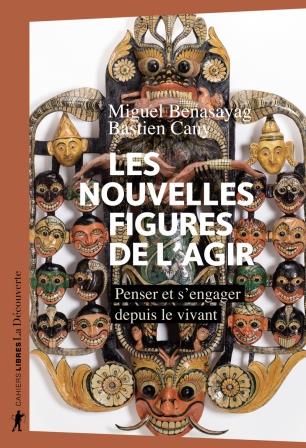 |
« Les
nouvelles figures de l'agir - Penser et s'engager depuis le vivant » Miguel
BENASAYAG, Bastien CANY, Editions La Découverte, 2021.
Le philosophe et psychanalyste Miguel Benasayag vient de publier avec le
journaliste Bastien Cany un ouvrage sur « Les nouvelles figures de l’agir »
à l’heure des biotechnologies et autres pandémies. Ce thème de l’agir occupe
le philosophe depuis longtemps déjà, mais cette notion délicate se trouve
posée de nouveau à l’acmé d’un environnement conflictuel. Paradoxalement,
alors que les situations qui nous entourent obscurcissent notre ciel de
menaçants nuages, nos contemporains semblent pris d’un vent de panique qui
les conduit à une paralysie certaine empêchant toute action. Ce n’est
pourtant pas les informations – la surinformation même – qui manquent pour
éclairer tant soit peu notre entendement. Alors quelle sorte d’entrave
retient l’action ? C’est à cette question à laquelle s’attache cet ouvrage
exigeant et stimulant, une réflexion qui implique notre manière de percevoir
le monde et nos représentations de la réalité, souvent masquées au profit
d’une prétendue connaissance technologique et omnisciente. Ni technophobes
ni technophiles, c’est une voie médiane pensée que nous suggèrent les
auteurs. La voie, non point d’une issue, illusoire, mais d’une réaction à
cette paralysie passe par notre rapport aux autres, à la nature et à la
culture afin d’accepter la complexité pour mieux composer à partir d’elles.
Les liens tissés dans ce paysage sont la plupart du temps ignorés, si ce
n’est niés par nos contemporains. Allant au-delà de l’universalisme, mais
aussi de tout relativisme, il y urgence à excentrer l’humain ; il y a
urgence selon Miguel Benasayag et Bastien Cany à s’engager dans cette
démarche au risque de passer à côté de l’humain dans les années à venir.
Replaçant sa philosophie de la situation et de l’action dans le contexte
exacerbé que nous connaissons ces dernières années, les auteurs démontrent
la différence que nous ne faisons pas toujours au quotidien entre
information et compréhension, cette dernière impliquant le corps entier,
avec toutes ses fragilités. Passant allègrement de la philosophie à la
neurobiologie, deux disciplines dans lesquelles l’auteur offre depuis
longtemps des analyses aussi vivifiantes que stimulantes, Miguel Benasayag
n’est jamais là où on l’attend. Et nous devrions peut-être retenir cette
agilité de dépasser les paradoxes pour atteindre cette flexibilité évitant
la résignation actuelle. Le progrès n’est plus le maître mot de nos sociétés
contrairement à ce que les intégristes des technologies clament de leurs
chapelles… Entre catastrophisme convaincu et foi aveugle en un avenir
improbable, il existe une voie médiane, transversale, qui passe par une
nouvelle prise de conscience de nos corps, avec toutes leurs imperfections,
non point par une pleine conscience illusoire, mais en conciliant toutes nos
contradictions en une puissance d’agir. Afin d’éviter la dislocation de
l’humain, l’écrasement du présent par la tyrannie du smartphone,
l’infatuation du je en d’infinis selfies, la voie est loin
d’être rectiligne, mais l’incertitude omniprésente de nos quotidiens vaut
bien ces stimulants détours !
Philippe-Emmanuel Krautter |
| |
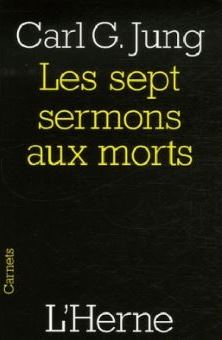 |
Carl G.
Jung : « Les sept sermons aux morts », Coll. Carnets, Éditions de l’Herne.
Cet opuscule, « Les sept sermons aux morts », du psychanalyste suisse Carl
G. Jung est un écrit personnel s’inscrivant « en marge » de ses ouvrages
théoriques sur la psychanalyse. Daté de 1916 et rédigé en trois nuits dans
un état extatique, le psychanalyste y décrit ou consigne pour lui-même une
expérience intérieure qui fut pour lui d’une force inouïe et qu’il gardera
secrète. C. G. Jung écrira à son sujet dans sa biographie « Ma vie » : « Il
faut prendre cette expérience comme elle a été ou semble avoir été. Elle
était probablement liée à l’état d’émotion dans lequel je me trouvais alors
et au cours duquel des phénomènes parapsychologiques peuvent intervenir. Il
s’agissait d’une constellation inconsciente et je connaissais bien
l’atmosphère singulière d’une telle constellation en tant que numen d’un
archétype (…) »
Cette expérience d’une force intérieure particulière intervint deux ans
après la rupture de Jung avec Freud qui l’amena à faire un important et
profond retour sur lui-même et à affronter rêves et inconscient. Dans « Les
sept sermons aux morts », Jung relate une vision qu’il eut par le biais d’un
philosophe du IIe siècle, Basilide, lui révélant ce qu’est le plérôme ou
monde céleste.
« Les sept sermons aux morts » peuvent donc apparaître extrêmement étranges
et déroutants à celui qui découvre l’œuvre du psychanalyste par ce texte.
Ainsi que le souligne l’avant-propos, « De fait, on ne saurait nier qu’ils
posent à la compréhension maintes énigmes. » Pourtant, nul doute que cette
expérience intérieure, si étrange soit-elle, fut l’une des pierres
angulaires de l’élaboration de la psychanalyse analytique.
Ce texte fut longtemps considéré à tort comme un écrit d’inspiration
purement gnostique. Or, s’il est vrai que C. G. Jung s’intéressera de près
aux sources gnostiques (comme à de nombreuses autres sources), cette
expérience intime marquera bien au-delà tant l’homme que le théoricien et
père de la psychanalyse analytique. En témoigne ce qu’écrivit Jung lui-même
au sujet des « Sept sermons aux morts » dans « ma vie » : « Car les
questions auxquelles, de par mon destin, je devais donner réponse, les
exigences auxquelles j’étais confronté, ne m’abordaient pas par l’extérieur
mais provenait précisément du monde intérieur. C’est pourquoi les
conversations avec les morts, les « Sept sermons aux morts », forment une
sorte de prélude à ce que j’avais à communiquer au monde sur l’inconscient ;
ils sont une sorte de schéma ordonnateur et une interprétation des contenus
généraux de l’inconscient ».
A ce titre, cet écrit personnel ne saurait être aujourd’hui, 60 ans après la
mort de Carl G. Jung, occulté de toute approche de la psychanalyse
analytique, et il faut saluer les éditions de l’Herne d’avoir eu
l’initiative de publier cet écrit. Un texte comportant par ailleurs deux
autres écrits « Le problème du quatrième » et « La psychanalyse analytique
est-elle une religion ? » également insérés dans cette nouvelle édition.
L.B.K. |
| |
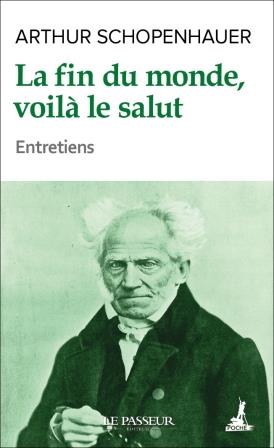 |
«
Arthur Schopenhauer – La fin du monde, voilà mon salut. – entretiens » ;
Coll. Du côté des auteurs, Editions établie et présentée par Didier Raymond,
Editions Le Passeur, 2021.
Schopenhauer au faîte de sa notoriété accorda un certain nombre
d’interviews. Certes, si elles demeurent moins connues que ses œuvres
majeures – « Le monde comme volonté et comme représentation », elles
méritent pourtant qu’on s’y arrête. À ce titre, il faut saluer l’initiative
des éditions Le Passeur d’avoir publié dans sa collection « Du côté des
auteurs » ces savoureux entretiens augmentés de mémoires ou souvenir
rapportés par ses disciples ou admirateurs. Ces entretiens et portraits sont
d’autant plus intéressants qu’ils offrent au lecteur un autre éclairage,
parfois très inattendu, sur la personnalité du philosophe. En ces pages,
transparait en effet plus l’homme que le philosophe. Or, ainsi que le
souligne Didier Raymond dans sa préface : « Tout ce que l’on peut apprendre
sur la personnalité de Schopenhauer peut éclairer certains aspects de son
œuvre ». Un point de vue que partageait le philosophe lui-même, la
biographie ne pouvant être, selon lui, séparée d’une œuvre. Ainsi, ce
dernier écrira-t-il notamment « On peut tout oublier excepté soit même,
excepté son propre être. En effet, le caractère est incorrigible. » Un
jugement qui influencera Nietzsche, mais que Schopenhauer ne s’appliquera
cependant guère à lui-même. Or, ce sont justement des portraits, attitudes
et postures au travers d’entretiens et souvenirs rassemblés et révélant
chacun à leur façon la personnalité et certains traits de caractère de
Schopenhauer que nous donne à découvrir cet ouvrage.
Schopenhauer, la célébrité enfin venue, accorda volontiers des interviews et
y prit même un certain plaisir. Étudiant ses gestes et effets, il prenait un
malin plaisir parfois à effrayer ou choquer ses interlocuteurs. Des postures
et prises de position que le lecteur retrouvera dans trois entretiens,
accordés deux ans avant sa mort, en 1858. Celui avec C. Challemel-Lacour,
tout d’abord, professeur, d’un pessimiste tout schopenhauerien, lors d’une
rencontre avec le philosophe à Zurich, suivi de ceux accordés à Fréderic
Morin et au conte L.-A. Foucher de Careil. Schopenhauer s’y montre
volontiers loquace, alternant entre séduction et provocation et livrant des
réponses parfois cocasses ou inattendues.
À ces trois entretiens, le lecteur pourra également retrouver avec bonheur,
en seconde partie, les mémoires concernant le philosophe de son principal
disciple, Frauenstoedt. Ce dernier fut très proche de Schopenhauer,
entretient avec lui une correspondance suivie jusqu’à la mort du maître, fit
connaître et divulgua largement sa pensée avant que Schopenhauer ne lui
lègue l’ensemble de ses manuscrits et lui donne tout pouvoir sur les
éditions à avenir. Viennent s’ajouter à ces souvenirs ceux de Karl Boehr,
fils d’un ami du philosophe, qui le rencontra à deux reprises en 1856 et 58,
et ceux d’un étudiant – Beck – lui ayant rendu visite en 1857.
Enfin, des vers inédits du philosophe viennent clore cet ouvrage offrant
ainsi bien des facettes, parfois fort méconnues ou inattendues, du célèbre
philosophe.L.B.K. |
| |
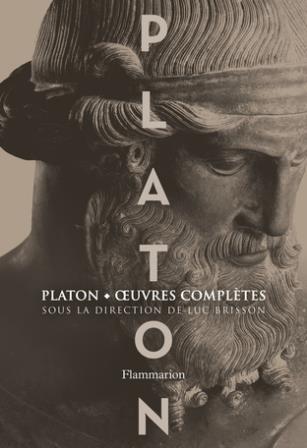 |
Platon
: « Œuvres complètes » ; Edition sous la direction de Luc Brisson, 2200 p.,
168 x 245 mm, Broché, Éditions Flammarion, 2020.
Proposer une édition réunissant la totalité des dialogues de Platon est une
entreprise suffisamment audacieuse et rare pour être soulignée. Lorsqu’en
plus, ces sources essentielles de l’Antiquité et de la culture classique se
trouvent être introduites et commentées par un appareil critique de toute
première qualité, c’est alors un argument supplémentaire pour faire de cette
édition le texte de référence qui fera assurément date en français.
Luc Brisson, directeur de recherche au CNRS n’est plus à présenter et ses
travaux sur Platon ont contribué à mieux faire connaître le grand philosophe
de l’antiquité souvent plus cité que lu… Or, justement, grâce à cette
monumentale édition des œuvres complètes de Platon, c’est le geste
philosophique par excellence qui se trouve au cœur de ces 2200 pages, à
savoir le questionnement incessant sur ce qui constitue l’homme et la cité,
ainsi que l’abandon de toutes idées reçues et une critique de la
sophistique.
À partir de la figure centrale de Socrate qui le conduira à la philosophie -
notamment avec son dernier geste face à ses accusateurs - Platon encourage
son lecteur à la méthode dialectique, une interrogation et un dialogue
ininterrompus sur ce qui semble être acquis. Ainsi que le souligne Luc
Brisson en introduction, Platon est « le philosophe par excellence » celui
qui donna au terme « philosophie » le sens qu’il a encore de nos jours.
L’autonomie de la pensée, l’amour de la sagesse comme quête essentielle de
l’individu et fondement de la cité, le dualisme de l’âme et du corps… autant
d’idées essentielles parvenues jusqu’à nous et qui trouvent leurs fondements
dans la pensée platonicienne.
Cette édition réunit non seulement la totalité des dialogues de Platon, mais
a également intégré la traduction inédite des œuvres apocryphes et
douteuses, des sources également précieuses afin de mieux comprendre comment
s’est constituée la tradition platonicienne après la disparition du
philosophe en 348/7 alors qu’il travaillait à la rédaction des « Lois ».
Soulignons, enfin, que cette édition, loin d’être réservée aux seuls érudits
et spécialistes de la philosophie antique, a été conçue, grâce aux
introductions à chacune des œuvres, pour s’adresser également à nos
contemporains, celles et ceux pour qui l’interrogation sur l’homme et la
cité demeure au cœur de leurs préoccupations, une question toujours
d’actualité !
Philippe-Emmanuel Krautter |
| |
 |
Jacques
Attali : « L’économie de la vie », Éditions Fayard, 2020.
C’est un ouvrage d’actualité, comme toujours très informé, des plus
instructifs et d’une urgente nécessité que nous propose Jacques Attali avec
« L’économie de la vie ». Un ouvrage pour comprendre non seulement le monde
d’aujourd’hui, ce qui nous est arrivé, mais aussi et surtout celui de
demain, celui encore envisageable ou ceux malheureusement également
probables si…
Après avoir dressé, de manière concise, l’histoire des épidémies et
pandémies d’hier à nos jours, et souligné la multiplication croissante de
celles-ci ces dernières décennies faisant non présager, mais bien prévoir
une pandémie mondiale – ce que l’auteur avec d’autres n’avait précédemment
pas manqué d’avertir – Jacques Attali revient sur ce que l’humanité entière
en cette année 2020 a vécu ; sur ce que nous avons réellement vécu, la crise
sanitaire, le confinement, et sur un plan économique, cet arrêt brutal et
décidé quasi mondial de l’économie et qui aurait pu être selon lui évité à
l’exemple de la Corée du Sud, si nombre de gouvernants n’avaient, avec plus
ou moins de sincérité, opté pour suivre celui de la Chine.
Mais après ? C’est à cette interrogation essentielle, celle du choix encore
possible du monde de demain, celui de nos enfants, qui demeure au cœur de
cet ouvrage et des préoccupations de l’auteur. Car, s’il est nécessaire de
tirer les leçons de cette pandémie ayant bouleversé nos vies, écrit-il,
encore faut-il également comprendre ce qui nous attend ; « Une crise
économique, philosophique, idéologique, sociale, politique, écologique,
stupéfiante, presque inimaginable ; plus grave en tout cas qu’aucune autre
depuis deux siècles », souligne Jacques Attali.
Il y a dès lors plus que jamais urgence à comprendre les enjeux de ce qu’il
nomme « L’économie de la vie ». Ces enjeux qu’impose et imposera le choix –
peut-être encore possible - d’un monde vivable ou du moins plus vivable que
d’autres. Livrant une vue d’ensemble, il y développe les multiples défis et
choix - santé, eau, éducation, choix écologiques… - que suppose dès
maintenant ce passage d’une « économie de survie » à une « économie de la
vie », de l’économie au social, de l’éducation à la culture, de la
nourriture à l’habitat, peu de points essentiels n’échappent à l’acuité de
l’auteur. À défaut, ce sont d’autres mondes qui malheureusement sauront
inexorablement s’imposer. Jacques Attali n’ignore pas, en effet, ni ne cache
ou sous-estime, ce qui nous attend si nous ne prenons conscience de
l’extrême urgence de ces choix vitaux, climatiques, économiques, sanitaires
et sociaux… de cette « Économie de la vie ».
Et « Se préparer à ce qui vient », annonce le bandeau de l’ouvrage, qui
peut, en effet, sciemment y renoncer ?
L.B.K. |
| |
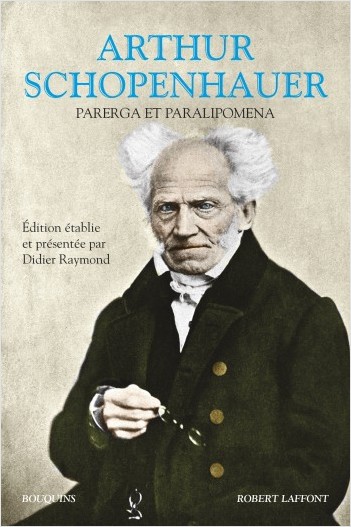 |
«
Arthur Schopenhauer – Parerga et Paralipomena » ; Edition établie et
présentée par Didier Raymond ; Traduction de l’Allemand par Auguste Dietrich
et Jean Bourdeau, 1088 p., Collection Bouquins, Éditions Robert Laffont, 2020.
S’il y a bien un philosophe qui bouscule, c’est assurément Arthur
Schopenhauer. Rares sont ceux qui n’y ont trouvé réponses, échos,
oppositions ou franches réfutations à leurs pensées, doutes ou
questionnements. Pourtant, la renommée de ce grand philosophe allemand qui
ne saurait laisser indifférent, fut, de son vivant, bien tardive. Il lui
faudra, en effet, affronter une longue traversée du désert, bien qu’ayant
déjà publié la majorité de ses grands ouvrages, avant que le succès ne soit
au rendez-vous. Celui-ci lui sera donné, moins d’une dizaine d’années avant
sa disparition survenue en 1860, lors de la parution de «Parerga et
Paralipomena », soit plus de trente ans après celle sans succès du « Monde
comme volonté et représentation ». Ce ne sera, en effet, qu’en 1851, avec la
publication de ces deux volumes, sa dernière œuvre, qu’Arthur Schopenhauer
sera enfin salué et reconnu à sa juste valeur par ses contemporains. Or,
c’est justement cette œuvre foisonnante aux multiples thèmes que nous donne
aujourd’hui à lire la Collection Bouquins dans cette édition établie et
présentée par Didier Raymond, professeur à l’Université Paris VIII et
spécialiste de Schopenhauer. Et si la traduction littérale du titre grec
signifie « Accessoires et Restes », il faut avouer qu’il s’agit là de très
savoureux suppléments venant compléter son œuvre maîtresse !
« Parerga » s’ouvre par trois livres majeurs – « Les écrivains et le style »
; « La langue et les mots » ; « La lecture et les livres ». D. Raymond
souligne combien ces textes « ont exercé une énorme influence sur des
auteurs aussi différents que Nietzsche, Proust ou Wittgenstein. ». Suivent
les grands thèmes schopenhaueriens, la religion, la philosophie, le droit et
la politique, la métaphysique, le beau et l’esthétique… Une philosophie à la
fois éthique et métaphysique, « deux choses que l’on a à tort – pour le
philosophe – séparées jusqu’ici… » Des thèmes dans lesquels se glissent
pêle-mêle des considérations sur le suicide ou sur l’éducation, des pages
parfois surprenantes notamment sur le bruit qui lui était insupportable ou
encore ce bref « Essai sur les apparitions et les faits qui s’y rattachent
».
C’est une philosophie qui se veut praticable – « pour bien s’en tirer »
aimait-il à écrire - exposée dans un style clair et accessible que nous
propose en ces pages, comme toujours, Schopenhauer en opposition avec les
philosophies conceptuelles de ses prédécesseurs. Une philosophie de la vie
comme subsistance ou survie pour ce philosophe d’un pessimisme radical et
ayant fait sienne la célèbre phrase de Bichat « La vie est l’ensemble des
forces qui résistent à la mort ». Schopenhauer offre cette pensée mûrement
réfléchie, ne craignant ni les critiques ni les oppositions, en témoignent
ces « Remarques de Schopenhauer sur lui-même ». Bataillant contre la haine,
la bêtise, l’égoïsme, le désir ou encore la vengeance source d’une plus
grande souffrance que celle du repentir, des thèmes forts que l’on
retrouvera au XXe siècle brillamment développés par Vladimir Jankélévitch.
Certes, si certaines de ses positions peuvent susciter opposition, voire
indignation, tel son « Essai sur les femmes », d’une misogynie peu
acceptable de nos jours, bien d’autres de ses réflexions demeurent, en
revanche, pour cet homme né à la fin du XVIIIe siècle (1788), d’une profonde
pertinence, notamment ses prises de position contre l’esclavage et la traite
des Noirs ou encore contre la maltraitance des enfants. Rien n’interdit au
lecteur, selon les fragments, de hurler, sourire ou de rire aux éclats. Si
Schopenhauer est un philosophe génial, nul n’a dit pour autant « parfait » !
Misanthrope à l’excès – il est vrai – (pour qui « l’homme n’est pas
seulement un animal méchant par excellence », mais bien une espèce non
seulement bestiale mais démoniaque), mais aussi colérique, pessimiste à
souhait, intransigeant, méfiant à l’extrême… il a surtout pour lui, en
contre point, cette curiosité insatiable et cette fantastique énergie
intellectuelle qui en font son charme et en fondent toute sa valeur ; Cette
lucidité implacable et sans concessions, fruit d’une féconde réflexion
soumise jusqu’à la limite de la contradictio. D’une lucidité tragique mais
ne se complaisant nullement dans le malheur, sa philosophie est comme sa «
vie dans le monde réel – écrira-t-il – une boisson douce-amère ».
Schopenhauer était conscient de sa valeur, celle-là même que nul ne lui
conteste aujourd’hui, celle d’être un des plus grands philosophes. Surtout,
Arthur Schopenhauer demeure de par la réflexion et les confrontations qu’il
peut susciter, un des philosophes les plus stimulants. Comment, dès lors, en
ces temps de confinement, y résister ?!
L.B.K. |
|
|
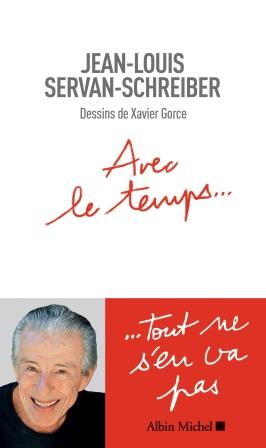 |
Jean-Louis Servan-Schreiber : « Avec le temps… », Dessins de Xavier Gorce,
Éditions Albin Michel, 2020.
Le temps aura toujours été une composante importante dans la vie du patron
de presse et essayiste Jean-Louis Servan-Schreiber et, ses 80 ans dépassés,
cette acuité ne s’est pas estompée mais affinée. À l’heure où les projets
d’avenir ne sont plus la priorité, c’est la vie dans l’instant présent qui
compte maintenant dans le quotidien de l’auteur. Cette vie a d’ailleurs
toujours été au centre des priorités de Jean-Louis Servan-Schreiber, lui
conférant une certaine sacralité et lui faisant détester tout ce qui est
susceptibilité de la menacer, ou pire, de la nier. À défaut d’embrasser une
transcendance qui lui a semblé toujours lointaine, l’auteur a donc tout misé
sur la vie et son pari, c’est de la vivre jusqu’à son terme, bel impératif
philosophique ! Pour mener cette mission de tous les instants, rigueur et
discipline sont au programme, une exigence que certains pourront trouver
certes peut-être trop contraignante, c’est une question de priorités… Car en
lisant « Avec le temps… », le lecteur comprendra qu’il faut s’exercer à
vivre de peur de laisser ces instants filer inexorablement, sans s’en rendre
compte. Or cette leçon ne s’apprend guère sur les bancs de l’école ni dans
les universités, mais au quotidien, démarche philosophique s’il en faut.
L’injonction socratique « Connais-toi toi-même » invite à prendre le temps
de ce discernement. Sénèque ne dit pas autre chose lorsqu’il rappelle : «
Être heureux, c'est apprendre à choisir. Non seulement les plaisirs
appropriés, mais aussi sa voie, son métier, sa manière de vivre et d'aimer
». Jean-Louis Servan-Schreiber n’a pas oublié ces leçons du passé, tout en
s’imposant de vivre au présent, aujourd’hui encore plus qu’auparavant. Face
au relativisme ambiant amplifié par les réseaux sociaux et les réactivités
de tout bord, et aux processus de déconstruction sapant toutes les repères
jugés intangibles jusqu’à récemment, il importe de se retrouver, cultiver
cette intimité avec soi-même pour mieux se comprendre ainsi que nos
semblables. Distance avec tout ce qui trouble la vie et proximité avec tout
ce qui la nourrit, telle est l’attitude encouragée par Jean-Louis
Servan-Schreiber à la veille du grand âge, une réflexion livrée avec
humilité et qui pourra retenir l’attention de celles et ceux qui n’auront
pas encore atteint ce stade de la vie.
Philippe-Emmanuel Krautter |
| |
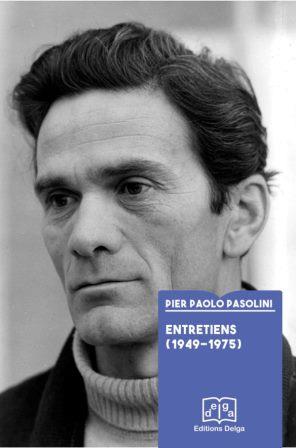 |
Pier
Paolo Pasolini : « Entretiens (1949-1975) », Édition établie par Maria
Grazia Chiarcossi, traduit de l’italien par Marie-Ange Patrizio,
présentation éditoriale par Aymeric Monville, Éditions Delga, 2019.
Les passionnés de l’écrivain Pier Paolo Pasolini se réjouiront de découvrir
cette sélection d’entretiens pour la plupart inédits en français dans cette
édition établie par Maria Grazia Chiarcossi, grande spécialiste de
l’écrivain, ayant notamment préparé son œuvre complète en Italie. Mais ce
livre pourra également être une belle porte d’entrée dans l’univers
pasolinien pour les néophytes, ces pages abordant les très nombreux thèmes
récurrents de son œuvre. Car Pasolini, et c’est un aspect souvent méconnu en
France, était très attaché à son statut de journaliste, il contribua
d’ailleurs jusqu’à la veille de son assassinat en 1975 à collaborer à de
nombreux journaux et revues culturelles, n’hésitant pas à prolonger dans ces
articles sa vision engagée du monde et de la société, allant jusqu’à la
polémique si nécessaire. Le cinéma sera bien entendu omniprésent dans la
première partie, ce qui permettra au lecteur français de placer quelques
jalons supplémentaires dans sa connaissance du cinéaste. Mais la politique,
sans oublier la poésie, constituent les fils directeurs de sa pensée, une
action militante et de résistance face au rouleau compresseur de la pensée
unique consumériste qu’il ne cessa sa vie durant de dénoncer et qui lui
coûta peut-être la vie. Contrairement à ce qui a souvent été avancé, le
polémiste fait preuve d’un grand respect pour son contradicteur, allant même
jusqu’à accepter de se mettre à sa place, Pasolini ayant toujours reconnu
qu’il était issu d’un milieu petit-bourgeois bien différent des petites gens
qu’il décrivit dans ses films et romans. Pasolini surprend, choque, et
surtout bouscule nos idées reçues, n’hésitant pas à se placer là où on ne
l’attendait guère comme lorsqu’il défendit les policiers d’origine
prolétaire agressés par les étudiants bourgeois en 1968… Marxiste et
parallèlement fasciné par une certaine transcendance diluée dans les milieux
pauvres qu’il décrivit, amoureux du verbe et de la poésie et apôtre de
l’argot le plus rude des banlieues romaines, Pasolini suggère une attitude
face à ce « rouleau compresseur impérialiste », des interrogations trouvant
une actualité la plus sensible aujourd’hui encore, plus de 45 ans après,
ainsi que le souligne Aymeric Monville dans sa présentation de l’ouvrage.
Philippe-Emmanuel Krautter |
| |
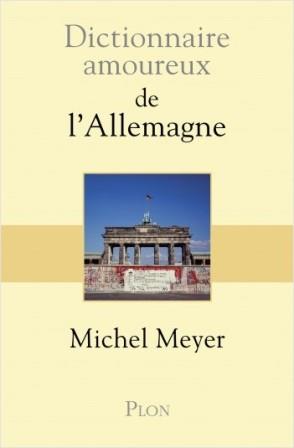 |
"Dictionnaire amoureux de l'Allemagne" de Michel MEYER, format : 132 x 201
mm, 880 p., Plon éditions, 2019.
À l’heure du trentième anniversaire de la chute du Mur de Berlin, il
manquait assurément un Dictionnaire amoureux de l’Allemagne. C’est chose
faite sous la plume inspirée de l’écrivain et journaliste Michel Meyer.
Auteur de nombreux ouvrages sur un pays souvent plus méconnu que réellement
familier, Michel Meyer suggère de découvrir « son » Allemagne, celle qu’il a
eu l’occasion tout au long de sa riche carrière de parcourir, commenter,
dialoguer ; Une Allemagne avec laquelle il a su nouer une histoire de cœur
qui débute non loin de ses frontières en France à Schirmeck, petite ville de
la vallée vosgienne où il naquit en 1942. Hölderlin et Goethe sont cités en
exergue, comme invitation inspirée pour découvrir cette nation à la croisée
des chemins depuis la plus haute antiquité. Une Allemagne plurielle,
assurément, par ses nombreuses identités remontant bien au-delà des peuples
germaniques décrits par Tacite, mais aussi par ses paradoxes et les
tourments de sa longue Histoire. Impossible d’échapper aux repères initiaux
de l’auteur notamment la Seconde Guerre mondiale vécue en un espace
géographique plus que sensible à quelques kilomètres d’un camp de
concentration visité quelques années après la chute du nazisme. Malgré cela,
l’attraction est intacte. Car même si Michel Meyer s’est posé la question au
tournant du dernier millénaire « le démon est-il allemand ? », la sirène de
la Lorelei continue à fasciner et à attirer inexorablement vers elle, tous
ceux qui cèdent à son chant… Alors consentons sans entraves à découvrir en
amoureux cette Allemagne suggérée par Michel Meyer, en commençant cette
escapade par l’entrée « Adenauer », premier chancelier d’après-guerre, une
lourde responsabilité si l’on songe à ce que l’Europe avait subi du fait de
son sinistre prédécesseur. Suivent les fameuses « Affinités électives »
chères à tous les lecteurs de Goethe qui sut saisir comme nul autre ce qui
fait et défait les unions entre les êtres, des liens ténus et
indéfinissables et qu’il parvint pourtant à si bien évoquer. Le lecteur
pourra, selon son humeur, poursuivre page après page, avec les « Allemandes
» célèbres comme Gretchen, singulière comme Lou Andreas von Salomé. Il
pourra aussi ouvrir ce volumineux dictionnaire au gré de son inspiration ou
du hasard, et redécouvrir cette incroyable « Chute du Mur » vécue en direct
par le journaliste dans la nuit du 9 novembre 1989… Le Dictionnaire amoureux
de Michel Meyer réserve également de beaux développements aux artistes,
poètes et écrivains qu’il chérit : Hölderlin, Goethe – nous l’avons
souligné, mais aussi Rilke ou encore des noms plus proches de nous comme
Karl Lagerfeld récemment disparu. Chaque entrée peut être considérée comme
une proposition d’appréhender une nation, une civilisation, une culture,
avec avant tout cet esprit allemand que ce Dictionnaire amoureux célèbre
avec passion.Philippe-Emmanuel
Krautter |
| |
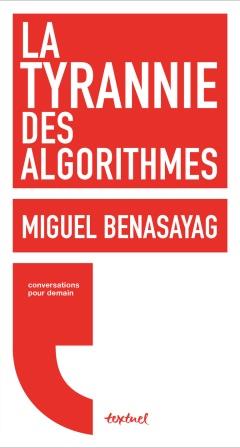 |
Miguel
Benasayag « La théorie des algorithmes » conversation avec Régis Meyran,
Éditions Textuel, 2019.
Ainsi que le souligne Régis Meyran en ouverture de cette conversation avec
le philosophe et psychanalyste Miguel Benasayag (voir
notre entretien), il existe une autre alternative au « pour » ou «
contre » la machine infernale qui s’introduit, aujourd’hui, de plus en plus
dans le discours actuel. C’est cette direction d’une autre alternative vers
laquelle le philosophe s’oriente, une autre direction, plus urgente encore
et sans concessions sur les risques encourus par l’aveuglement du tout
technologique, le nouvel âge de l’IA, l’Intelligence Artificielle. Préférant
la pensée rhysomique chère à Deleuze et Guattari et les chemins de traverse
pour aborder ces questions essentielles, l’entretien part du postulat
qu’être pour ou contre est déjà dépassé, les algorithmes étant déjà
omniprésents aujourd’hui dans notre quotidien et dictent déjà, moins
sournoisement qu’impérieusement, un grand nombre de traits de notre vie…
Miguel Benasayag n’hésite pas à rappeler que des études scientifiques ont
déjà démontré une « atrophie » de la zone du cerveau correspondant à
l’orientation du fait de l’usage intensif du GPS par des chauffeurs de taxi
! La question serait plutôt : que devons-nous faire, à partir de cette
réalité, pour préserver notre dimension humaine et celle des générations à
venir dans les prochaines années ? Comment ne pas perdre ce qui fait
l’humain, fonctionner ou exister ?
Le philosophe avertit tout d’abord le lecteur de l’inanité de considérer «
intelligent » ce qui n’est que le fruit de calculs programmés. La complexité
humaine est ailleurs que dans cette « puissance » élevée au rang de la
performance, alors que le propre de l’humain (et du vivant) se situe bien
au-delà, avec le désir, l’erreur, les hésitations, passions, sans oublier la
conscience et l’inconscience, tout cela s’inscrivant dans un corps, notre
corps. « C’est le vivant qui crée du sens, pas le calcul », rappelle Miguel
Benasayag. Cette mathématisation du monde est, certes, ancienne dans nos
sociétés et s’est introduite avec le rationalisme et les mathématiques
concurrençant à l’époque le projet divin. Le philosophe avertit cependant
que la complexité du vivant ne saurait être réductible au plus complexe des
calculs. Aussi savants et perfectionnés que soient ces algorithmes, il leur
manquera toujours une dimension masquée qui leur résistera, cette dimension
humaine, singulièrement humaine ; Ce que démontrent et confirment dès à
présent déjà un grand nombre d’erreurs reconnues par la médecine moderne
notamment dans le domaine des antibiotiques. « Ne pas confondre la carte
avec le territoire ! », souligne Miguel Benasayag et jeter à la poubelle 90
% de l’ADN considéré comme inutile car non réductible ou résistant au
codage, tel que le souhaitent un grand nombre de biologistes aujourd’hui. Au
risque, un jour, de se réveiller et de comprendre (trop tard ?) que cette
part « irréductible » de notre ADN avait une utilité, son utilité…
Loin de toute pensée organiciste, le lien, la relation et l’interaction sont
au cœur du vivant, cette « singularité du vivant » chère à Miguel Benasayag
et que n’appréhende pas l’IA aujourd’hui. « Nous sommes les contemporains de
la centralité de la complexité […] il nous est impossible de prétendre à une
prévision complète », souligne-t-il.
Or, aujourd’hui, des responsables de tout bord (économie, science, finance,
politique…) sont sur le chemin de déléguer consciemment les fonctions de
toute décision à la machine. Or, le présent immédiat n’occupe qu’à peine 10
à 15 % de nos pensées (une latitude qui laisse une grande place au passé et
à l’avenir), alors que l’IA promet une efficacité de présence à 100 %, une
performance qui ne peut que plaire aux marchés boursiers et aux partisans de
l’efficacité à tout prix. Le corps se trouve dès lors pris dans l’engrenage
d’un régime immatériel qui lui dicte et impose ses règles. Celles d’un
individualisme exacerbé et de relativisme reposant sur l’idée de plaisir
poussé à l’extrême. Le danger ne concerne pas seulement que le corps et le
vivant, mais aussi le politique et le social, ces domaines étant désormais
de plus en plus soumis aux diktats des algorithmes à la disposition du
politique et des décisionnaires. À terme, la démocratie se retrouve remise
en cause par ce schéma algorithmique donné pour infaillible au profit d’une
tyrannie résultante de ce tout pouvoir algorithmique.
Les prochains combats à mener par des multiplicités agissantes ne seront
peut-être plus sur les barricades, mais dans les arcanes des
microprocesseurs de nos ordinateurs…
Philippe-Emmanuel Krautter |
| |
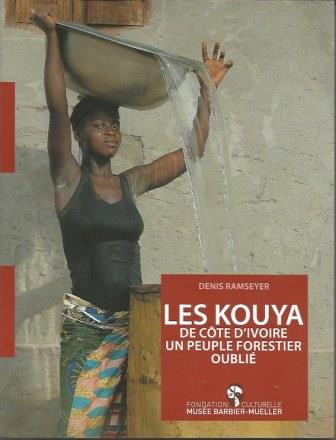 |
Denis
Ramseyer : « Les Kouya de Côte d’Ivoire, un peuple forestier oublié. »,
Co-édition Musée Barbier-Mueller / Editions Ides et Calendes, 2019.
C’est au cœur de la forêt ivoirienne à la rencontre du peuple Kouya que nous
entraîne avec cet ouvrage enrichissant, et présentant un intérêt
ethnologique des plus vifs et urgent, Denis Ramseyer, ethnologue-archéologue
et historien, chargé d’enseignement à l’Université de Neuchâtel.
Le peuple Kouya est un petit peuple forestier de Côte d’Ivoire. Petit par sa
taille, car il ne comporte que vingt milles individus et encore. Mais, petit
que par sa taille seulement ! Car s’il demeure peu connu du reste du monde,
cette ethnie de Côte d’Ivoire mérite pourtant de l’être tant ses modes de
vie, croyances et traditions offrent une belle découverte et étude
ethnologique. Fiers de leurs traditions, les Kouya sont avant tout un peuple
de forestiers, un peuple parlant une langue comptant parmi les plus
menacées, et à ce titre déclarée telle en 2001.
Car, l’alerte est donnée. En effet, si le monde fascinant des Kouya a déjà
malheureusement en grande partie disparu, ce dernier est aujourd’hui plus
encore menacé. Confronté à de nombreuses situations inextricables, ce peuple
risque, si nous n’y prenons garde, non plus seulement d’être oubliés, mais
bel et bien de disparaître à jamais…
Après avoir, en effet, subi l’arrivée des missionnaires chrétiens, les Kouya
doivent depuis le début du XXIe siècle, affronter les changements
climatiques. À ces changements viennent s’ajouter les nombreux conflits
ayant marqué, chaque décennie de notre siècle, la Côte d’Ivoire et plus
particulièrement la région au cœur de laquelle vivent les Kouya. À tout
cela, s’ajoute, qui plus est, une déforestation dévastatrice due au
développement de la culture du cacao, elle-même s’accompagnant de l’arrivée
de migrants bouleversant l’équilibre social déjà fragile. Ethnie de
forestiers menacée de toute part pour laquelle l’auteur tire depuis de
nombreuses années déjà la sonnette d’alarme. Depuis 1971, en effet, année
lors de laquelle Denis Ramseyer découvre ébahi la Côte- Ivoire et cet
attachant peuple Kouya, ce dernier n’a cessé de réunir, assembler notes,
enquêtes, reportages photographiques, des travaux que ce dernier ouvrage
donne largement à voir et à découvrir. Aussi, est-ce à une enrichissante,
mais aussi urgente rencontre ethnologique à laquelle nous invite l’auteur.
Une étude approfondie, richement étayée et illustrée de 150 illustrations
couleur, qui ne pourra qu’intéresser ethnologues ou spécialistes de
l’Afrique, mais aussi séduire tout amoureux de Côte-d'Ivoire, des Kouya… ou
de la terre et de ses habitants tout simplement !
À noter que ce dernier ouvrage vient compléter les précédents travaux de
Denis Ramseyer : Reportage photographique en 1972, enquête ethnologique en
1975, étude ethnoarchéologique 1998, étude sur la transformation de la
société et de son environnement en 2016.
L.B.K. |
| |
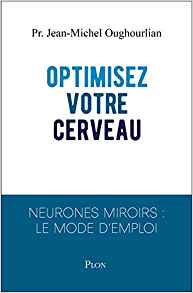 |
Jean-Michel Oughourlian : « Optimisez votre cerveau ! ; Neurones miroirs :
le mode d’emploi », Edition Plon, 2019.
Un livre instructif, accessible et passionnant, pour ne pas dire
indispensable !, sur nos relations personnelles, familiales ou
professionnelles, écrit par le Professeur Oughourlain, neuropsychiatre et
professeur de psychologie à la Sorbonne.
Dans ce livre, tout part du mimétisme. Rien d’étonnant à cela lorsqu’on sait
que le Professeur Oughourlian est spécialisé dans la psychologie mimétique.
Collège et ami de René Girard, il nous explique dans un langage clair le
rôle déterminant du mimétisme (notre cerveau reptilien) en son rapport avec
nos deux autres cerveaux, que sont le cerveau émotionnel et le cerveau
cognitif.
Le cerveau mimétique par un automatisme déconcertant n’a de cesse d’imiter –
modèle/rival /rival-obstacle. Qui plus est, ce cerveau mimétique se met en
branle au moindre signal perçu, des neurones-miroirs infaillibles et
incessants, donc, qui ne nous quittent pas d’un pouce avec plus ou moins
d’heureux bonheurs. Une imitation à laquelle notre deuxième cerveau
émotionnel, par une impressionnante fidélité, viendra au plus vite emboiter
le pas, et renforcer en ajustant notre humeur, nos sentiments et émotions.
Notre cerveau cognitif, ce troisième cerveau, viendra, enfin, coiffer le
tout. C’est simple.
C’est simple, mais n’allons pas si vite pour autant ! Et si on
court-circuitait ce processus de base ? Le Professeur Oughourlian nous
explique, en effet, que s’il est certes difficile de déconnecter
l’automatisme mimétique de notre premier cerveau, reste que « l’on peut
toujours choisir le chapeau que prend notre cerveau cognitif ! » ; Haut de
forme, casquette de hooligan ou chapeau du rire ? Tel est l’enjeu de cet
ouvrage plus que passionnant et que clôt une poste-face d’Emmanuel Gavache
tout aussi convaincante…
C’est, en effet, par une meilleure compréhension du mimétisme et de son
ressort sur l’inter-individualité que l’auteur, en sa qualité de
neuropsychiatre, nous explique comment fonctionne le cerveau lors des crises
et conflits qu’ils soient familiaux ou professionnels, individuels ou de
groupe. Le premier pas consistera à comprendre et démêler ce mimétisme ayant
déterminé en quelque sorte les cartes et règles avec lesquelles chacun de
nous avance ; Sachant que tout mimétisme ne saurait être, bien sûr, négatif
et que les exemples positifs ne manquent heureusement pas.
A la base de tout, on l’aura compris, il y a le désir, ce désir mimétique de
ce que l’autre a, possède, est, ou même et surtout de ce que l’autre désir.
Dans la lignée de René Girard qu’il aime à citer ou de Jean-Pierre Dupuy («
La jalousie ; une géométrie du désir », Seuil, 2016), Jean-Michel
Oughourlian nous démêle, de chapitre en chapitre, cet impressionnant
écheveau tissé de liens mimétiques. Pouvoir, influence, suggestion, pub,
réseaux sociaux, etc., et même mimétisme inversé, jalonnent cet essai. Des
mimétismes positifs ou négatifs auxquels personne n’échappe, certes, mais
que l’on peut approcher et quelque peu appréhender afin de « supprimer la
suggestion, l’asservissement au mimétisme rival », souligne l’auteur.
Cela passe avant tout par accepter l’idée que les conflits, maladies,
névroses, proviennent de ce mimétisme /rivalité directe ou inavouée avec «
son rival », ce modèle inversé qu’il convient de démasquer, et qui n’est pas
pour autant et toujours en tant que tel un « ennemi ». Le mimétisme le plus
universel engendre, quoique certain en dise, la jalousie avec pour
pathologie l’envie lorsque « le rival devient ennemi », suivie de sa mise à
mort dans son exacerbation extrême, souligne encore Jean-Michel Oughourlian.
Notre cerveau mimétique est, en effet, imperméable, et seule l’intervention
raisonnée de notre cerveau cognitif ralliant à lui le cerveau émotionnel
parviendra à le canaliser. De là, l’apport essentiel de cet ouvrage : rendre
accessible une meilleure compréhension de ce processus mimétique et de ce
qui se joue, permettant de dompter ou d’apprivoiser ce fameux cerveau
mimétique.
Un ouvrage qui se lit d’un trait, et auquel on ne peut souhaiter qu’un
mimétisme de bon aloi ; Alors, bonne lecture !
L.B.K. |
| |
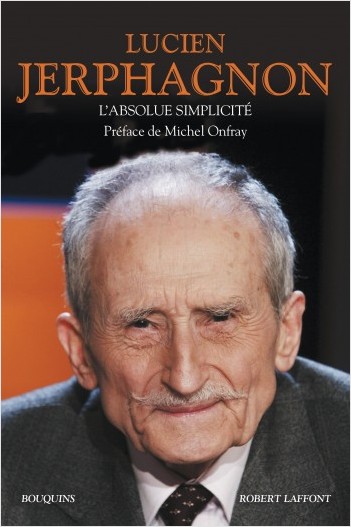 |
«
L'Absolue Simplicité » Lucien JERPHAGNON, Michel ONFRAY (Préface),
Collection : Bouquins, Robert Laffont éditions, 2019.
Faisant suite aux deux précédents volumes parus dans la collection Bouquins,
« L’absolue simplicité » offre au lecteur quelques-uns des autres
plus beaux livres de l’historien de la philosophie (lire
notre interview) bien connu pour la fulgurance de ses analyses et la
vivacité de son jugement. Michel Onfray livre en ouverture à ce troisième
volume un témoignage sensible et poignant sur son « vieux maître » et sur la
magie des enseignements dont il reçut chaque parole comme un legs précieux.
La fausse désinvolture des cours de ce grand maître permettait, en effet, de
toucher à cœur de jeunes âmes peu versées sur l’Antiquité et ses leçons.
C’est ainsi que cette magie Jerphagnon opéra chez tous celles et ceux qui
ont eu le privilège de rencontrer ce bel esprit – un brin malicieux parfois
!, et que Michel Onfray évoque avec émotion en ouverture à ce beau et riche
nouveau volume de la collection Bouquins. La diversité de ses enseignements
ne changea en rien la limpidité de ces changements, les saillies de ses
analyses et la sagacité de ses témoignages sur cette Antiquité qu’il
chérissait tant, jusqu’à ses péplums qui le faisaient éclater d’un rire
complice…
« L’absolue simplicité » regroupe certains des titres incontournables
de Lucien Jerphagnon, tels Julien dit l’Apostat, Les Dieux ne sont
jamais loin, Augustin et la sagesse, mais aussi des textes moins
connus comme ces transcriptions de certains de ses cours, notamment au Grand
Séminaire de Meaux ou encore des conférences ou émissions de radio qui
témoignent de l’absence de frontières dans les domaines appréhendés par
cette pensée fertile. Sa fidélité indéfectible à son maître le philosophe
Vladimir Jankélévitch force également le respect dans ces pages d’«
Entrevoir et vouloir » réunies en 1969 et augmentées en 2008 ; des pages
magnifiques révélant, à elles seules, tout l’art de son auteur de « livrer »
sans altérer une pensée dans toute sa richesse et complexité comme pouvait
l’être celle de Vladimir Jankélévitch ; Ce « métaphysicien mystique,
comme je suis devenu un agnostique mystique ! » - souligne Lucien
Jerphagnon, et de poursuivre : « Peut-être était-ce pour cela que j'avais
énormément apprécié « Janké » comme nous l'appelions ! » (entretiens
Lexnews)…
Peut-on encore être surpris par cette pensée hors-norme et fulgurante de
Lucien Jerphagnon ? Une telle question se pose-t-elle en ces décennies d’un
nouveau siècle, d’un nouveau tournant ? Les lecteurs de ses chroniques
politiques pour la Revue des Deux-Mondes des années 1990 ne pourront, en
effet, que retrouver ce rare bonheur de percevoir de nouveau ce léger accent
que ce Bordelais impénitent aimait à accentuer d’un clin d’œil complice. Une
complicité offerte au lecteur entre deux jugements assénés toujours avec
justesse, s’amusant des galipettes de Greenpeace, des gamineries de la
presse, et des impôts que le penseur n’a jamais vu baisser de toute sa
longue vie… sans oublier cette interminable nuit dont parlait Catulle et que
nous fait revivre ce grand maître que fut Lucien Jerphagnon; Un esprit
toujours sur la brèche qui poursuit sa quête, ne cessant de susciter de
nouvelles interrogations chez ses lecteurs, des questionnement toujours
aussi actuels, nécessaires, et peut-être plus urgents que jamais.
Philippe-Emmanuel Krautter |
|
Histoire, Ethnologie,
Essais... |
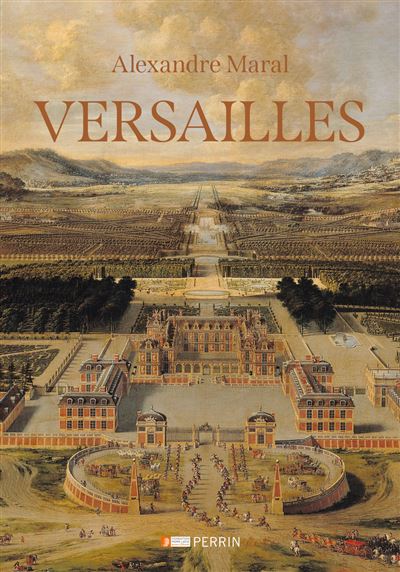 |
«
Versailles » d’Alexandre Maral, 1536 pages, Perrin Editions, 2025.
A un château comme celui de Versailles, il fallait un ouvrage de référence,
ce qui est dorénavant chose faite avec cette somme signée Alexandre Maral et
parue aux éditions Perrin. Avec plus de 1500 pages, l’ouvrage parvient en
effet à embrasser la longue histoire et la complexité de ce lieu royal qui
fut non seulement objet de plaisirs, mais aussi une formidable entreprise
rhétorique servant l’absolutisme du Roi Soleil. L’auteur, ancien
conservateur au château de Versailles, dépasse la narration habituellement
établie sur ce patrimoine national mondialement connu, pour adopter une
démarche plus globale, incluant notamment d’importants développements sur la
genèse de ce domaine royal avant Louis XIV, et qui éclaire parfaitement, de
ce fait, ce qu’en fera le monarque absolu parvenu au faîte de son pouvoir.
Partant de la monographie de Pierre Verlet parue en 1961, Alexandre Maral a
élargi son étude en incluant la documentation volumineuse et les dernières
recherches parues sur ce sujet, mais aussi en croisant les nombreuses
disciplines dorénavant convoquées : histoire de l’art et histoire politique,
sciences et institutions, art des jardins, peinture et gravures, musique…
L’histoire du lieu débute par une étude longtemps négligée, à savoir celle
de « Versailles avant Versailles », allant du domaine antique jusqu’au rôle
important de Louis XIII et de son lieu de prédilection afin d’y établir ses
parties de chasse, si essentielles pour ce monarque. Ce sera ainsi le point
de départ de l’édification d’un petit quadrilatère entourant une cour,
accompagné de trois hectares ceints d’un mur… Autant avouer que cette
modeste construction qui ressemblait plus à un pavillon de chasse qu’à un
château royal ne fit pas grande impression, au point que l’ambassadeur de
Venise et futur doge n’hésita pas à la qualifier de « piccola casa » pour
les plaisirs du roi. Mais, là réside justement le fondement même de
Versailles, un lieu initialement discret et guère étendu, afin d’y inviter
un nombre restreint de proches du roi avec un protocole allégé.
Louis XIV, une fois accédé au trône et cherchant à fuir les mauvais
souvenirs qu’il pouvait avoir de la Fronde, se réfugiera plus d’une fois à
Versailles ; En ce lieu, il imaginera alors, progressivement, tout un
programme architectural et artistique avec les plus grands maîtres de chaque
discipline afin de concrétiser son rêve : faire de Versailles un lieu de
rayonnement et de puissance, tout en le conjuguant avec ses priorités, à
savoir la danse, les arts, la chasse sans oublier ses amours… Alexandre
Maral approfondit avec un rare talent et une plume des plus alertes chacun
de ces aspects en présentant dans le détail ce Versailles, lieu de fêtes,
mais aussi lieu de pouvoir, faisant du château un palais d’Etat au
rayonnement dépassant les frontières du royaume selon le souhait royal.
L’auteur nous montre ainsi que chaque bâtiment, chaque sculpture, chaque
appartement répond à un ordonnancement savant et s’inscrit dans une logique
d’ensemble qu’aucun monarque auparavant n’avait su atteindre. Il suffira
pour s’en convaincre de lire avec attention la passionnante section réservée
aux « jardins du pouvoir », ainsi que les nomme l’auteur, pour réaliser que
rien n’est dû au hasard à Versailles.
Cette somme se trouve complétée par d’importantes parties réservées au rôle
joué par les deux monarques succédant à Louis XIV, Louis XV et Louis XVI,
mais aussi le Versailles « après Versailles » lorsque l’Ancien Régime aura
rendu son dernier soupir et que le domaine abordera une nouvelle vie avec un
domaine devenu dorénavant national… |
| |
 |
« Guide de
l'Égypte ancienne » de Jean-Claude Golvin et Aude Gros de Beler, 3e édition,
Editions Actes Sud, 2025.
Le remarquable travail de Jean-Claude Golvin sur l’antiquité est bien connu
et a fait l’objet de nombreuses chroniques dans ces colonnes, aussi la
parution de ce « Guide de l’Égypte ancienne » ne pourra que retenir de
nouveau l’attention. Avec cet ouvrage en format poche abondamment illustré
par les superbes reconstitutions à l’aquarelle de l’auteur lui-même,
architecte et directeur de recherche au CNRS Jean-Claude Golvin, le lecteur
entrera littéralement au cœur de l’Égypte antique, de ses temples, pyramides
et cités.
Alliant avec un rare équilibre texte et image, l’égyptologue Aude Gros de
Beler dialogue, ici, avec Jean-Claude Golvin par le truchement de cette
belle synthèse restituant en 300 pages cet univers fascinant de l’Égypte
ancienne. Mythes et vie politique sont abordés et contribuent par cette
synthèse érudite, mais accessible, à dresser en quelques chapitres serrés un
panorama complet et éclairant sur les longs siècles ayant vu se succéder
tant de dynasties prestigieuses…
Grâce à son format maniable, l’ouvrage pourra être le compagnon idéal lors
d’une visite au musée ou encore lors d’un voyage en Égypte à l’occasion de
l’ouverture du Grand Musée Égyptien du Caire !
|
| |
 |
«
Lettres égyptiennes V - La littérature du Nouvel Empire » de Michel
DESSOUDEIX, 800 p., Actes Sud Editions, 2025.
Voici, avec le tome V des « Lettres égyptiennes », la suite – vivement
attendue !, d’une formidable aventure menée par Michel Dessoudeix, ce
passionné d’égyptologie ayant patiemment étudié les sources épigraphiques et
la chronologie pharaonique. Avec ce nouveau et fort volume de 800 pages, le
lecteur entre au cœur de la littérature du Nouvel Empire (1539-1069 av.
J.-C.), cette période d’or couvrant les règnes prestigieux des pharaons
Thoutmôsis, Amenhotep, Ramsès… Page après page, le lecteur est introduit
ainsi dans l’intimité des textes littéraires essentiels de cette période
fertile, des textes déterminants permettant de mieux appréhender et cerner
la société égyptienne ramesside.
Michel Dessoudeix a décidé de présenter ces précieux documents sous leur
forme originale, à savoir en hiéroglyphique et/ou en démotique, un parti
pris cher à l’auteur pour qui l’accès direct à la langue antique demeure
indissociable de la pleine compréhension de cette civilisation. Chaque
texte, qu’il s’agisse de mythes, romans, poésie, religion ou administration,
est traduit et présenté avec sa translittération, des notes grammaticales et
un lexique. Que l’on soit béotien ou spécialiste, ce rapport à la langue
transforme littéralement la lecture de ces documents qui peuvent être ainsi
découverts à la fois comme des exercices épigraphiques, mais aussi au titre
de témoignages inédits de la civilisation pharaonique. Quelques encarts
grammaticaux rythment, enfin, ces pages, souvent émouvantes, lorsqu’elles
font revivre une mémoire enfouie sous les sables depuis des millénaires. Un
scribe royal, un prêtre d’Amon ou un soldat blessé et errant revivent ainsi
sous nos yeux, un témoignage unique et passionnant qui ne relève pas d’une
fiction contemporaine de plus, mais bien de sources ayant traversé les
temps. |
| |
 |
« La
France de la Préhistoire » de Romain Pigeaud, préface de Jean Guilaine,
Editions PuF, 2024.
Jean Guilaine, dans sa préface à l’ouvrage « La France de la Préhistoire »
de Romain Pigeaud paru aux éditions PuF, souligne à la fois l’audace et
l’intrépidité de l’auteur pour réaliser une telle exploration fructueuse des
origines de notre histoire, et plus précisément, en l’espèce, de notre
préhistoire. Il faut avouer que le défi était effectivement de taille avec
ce dessein de dresser un panorama impressionnant des cultures et peuples qui
ont marqué les millénaires de l’Hexagone (même si ses analyses dépassent
largement ces frontières, toujours relatives sur un tel sujet). Ainsi que le
souligne encore, le professeur émérite Jean Guilaine (lire notre interview),
Romain Pigeaud offre, en un style à la fois didactique et décomplexé, une
vaste synthèse à partir des recherches les plus récentes sur les temps
préhistoriques traités.
Ce long cheminement débute au pied… des pyramides ! Une manière originale de
commencer notre récit de la « France de la Préhistoire »… Avec Romain
Pigeaud, il ne faudra pas s’attendre pour autant à un roman, tant s’en faut.
Reléguant le plus loin possible les idées reçues, l’auteur appréhende, en
effet, en un récit passionnant, et néanmoins rigoureux, non seulement la
chronologie des temps préhistoriques, mais aussi, parallèlement, la
géographie et conditions climatiques en interaction avec les femmes et les
hommes de ces époques, n’hésitant pas à illustrer ses propos par les
exemples fameux de Lascaux, Chauvet ou encore Solutré.
Avec « La France de la Préhistoire », nous sommes à mille lieues des
caricatures de l’homme primitif, et plus encore des thèses créationnistes
plus actives que jamais. Se fondant sur les recherches archéologiques les
plus récentes, cet ouvrage souligne combien les sociétés de ces temps
reculés présentent des novations technologiques qui n’ont rien à envier à
leurs premières créations artistiques. Les modes de vie, mais aussi les
croyances, font l’objet d’analyses à la fois détaillées, mais toujours
accessibles au néophyte, qui apprendront ainsi au lecteur quel était, par
exemple, le rapport au feu de nos hommes préhistoriques, essentiel à leur
mode de vie. Après le temps des chasseurs-cueilleurs, vient celui des
fermiers avec l’émergence des premières notions de propriété qui
entraîneront à leur tour les premiers conflits… Mais au-delà, quel était le
rapport à la mort de nos ancêtres ? Quelle place occupaient les femmes dans
ces sociétés (l’auteur en profite sur ce sujet pour tordre le cou au vieux
mythe du matriarcat) ? Leur rapport à l’art et à la religion ? Telles sont
les nombreuses interrogations, et éléments de réponse, qui jalonnent cette
introduction aussi savante qu’accessible à la Préhistoire. |
| |
 |
« Le
grand Livre des Mythes grecs » de Pierre Sauzeau, 574 p., Belles Lettres
Editions, 2024.
« Le grand Livre des Mythes grecs », conçu par Pierre Sauzeau, fera entrer
le lecteur au cœur des plus légendaires histoires léguées par cette
civilisation de héros. Et pour ce faire, il était nécessaire d’avoir pour
guide un conteur né, ce qu’est assurément l’auteur, Pierre Sauzeau !
Avec 574 pages et une centaine d’illustrations, l’univers foisonnant – et
parfois quelque peu désemparant pour le néophyte – des mythes grecs
deviendra vite familier au lecteur de cette « bible » des récits fondateurs
et légendes de l’une des plus grandes civilisations occidentales. Pierre
Sauzeau est parvenu à se saisir de l’essence même de ces récits parfois
complexes, d’autres fois tragiques, légués à la postérité jusqu’à notre
époque contemporaine. Mais ce qui était encore familier à un grand nombre de
personnes pour les générations précédentes, avec ce qui était appelé « les
humanités », tend malheureusement de nos jours à disparaître. Certaines
initiatives, dont la présente édition, cherchent fort heureusement à
inverser ce cours des choses en offrant une présentation à la fois
synthétique et concise des principaux mythes fondateurs, et ce dans un style
accessible où l’humour n’est jamais très éloigné.
L’extrait du discours de réception du prix Nobel de littérature Georges
Séféris en 1967 laisse une petite idée de l’esprit de ce fort volume : «
J’ai joué dans le stade antique, sur la terre foulée par les dieux et les
héros. J’ai entendu les pierres raconter au vent les mythes et les légendes
», ce dont Pierre Sauzeau peut s’enorgueillir de partager. Ces fables qui
pourraient avoir l’air de « fables à dormir debout », selon l’auteur,
révèlent la plupart du temps pourtant une part de vérité ; Et c’est ce
paradoxe qui tisse le fil directeur de cet ouvrage où les mythes
entretiennent avec la réalité de biens surprenants liens. L’auteur a nourri
son amour de la mythologie grecque auprès des meilleures sources souvent
évoquées dans ces colonnes : Dumézil, Moreau, Vernant, Vidal-Naquet…
Du « Monde des Dieux » évoqué par Hésiode (et synthétisé en un très réussi
tableau donnant quelque peu le vertige), jusqu’aux « devins et poètes »
présentant l’inégalable Homère mais aussi Orphée, Sapphô ou encore Tirésias,
nous voyagerons loin avec ce captivant volume, une pérégrination riche de
mille enseignements que n’aurait pas reniée le célèbre Ulysse. |
| |
 |
"L'Odyssée
au Louvre - Un roman graphique" de Barbara Cassin, Editions Flammarion,
2024.
L’académicienne Barbara Cassin agit depuis longtemps déjà pour que la
mémoire des temps antiques ne soit pas limitée aux seuls domaines de la
recherche et de l’enseignement, mais puisse s’inviter également dans le
quotidien de notre société de plus en plus amnésique. Le présent ouvrage
répond à cet élan qui la caractérise, mais également à l’invitation lancée
par le Louvre à la philosophe et historienne à tenir la Chaire du Louvre en
2023.
Redécouvrant les collections du célèbre musée, notamment la fameuse galerie
Campana récemment restaurée, Barbara Cassin a accepté de porter un regard
nouveau sur ces témoins qu’elle connaissait pourtant intimement, un exercice
à la fois délicat et exigeant. Ainsi que le souligne Laurence des Cars,
présidente-directrice du musée, c’est à la question « Comment les œuvres
d’art nous changent-elles, et qui sommes-nous qui les vivons » qu’a tenté de
répondre l’académicienne dans ces pages stimulantes. Aussi, découvrons-nous,
page après page, cette « Odyssée au Louvre » convoquant tout autant les mots
et les mythes sous le regard des nombreux artefacts.
Le voyage de celui dont le nom était « personne » sert, ici, de cheminement
à cette quête d’identité, entre exil et oubli, pour un retour dépassant la
temporalité. Barbara Cassin nous invite à ce questionnement philosophique
antique, être mortel, avoir un nom, être soi-même, parler et être reconnu…
Nous l’aurons compris, cette pérégrination en terres attiques – et même
au-delà – suggère une quête bien plus profonde encore, une quête dont le
lecteur ressort transformé s’il consent à arpenter ces questionnements
fondamentaux tout autant que ces augustes témoins de la galerie Campana. Par
le truchement de l’académicienne, Homère dialogue dans ces pages avec les
chefs-d’œuvre du musée, là où, la poésie s’entrelace avec l’épique.
Par cette invitation, l’auteur nous propose une belle invitation : celle
déjà lancée par du Bellay dans son célèbre sonnet, d’un heureux voyage en
quête de sens dont nous reviendrons transformés…
Philippe-Emmanuel Krautter |
| |
 |
Patrick
Boucheron : « Léonard et Machiavel », Editions Verdier, 2024.
On ne peut que saluer la réédition dans la collection « Verdier Poche » de
l’ouvrage « Léonard et Machiavel » signé Patrick Boucheron. L’auteur,
aujourd’hui apprécié et bien connu du grand public, offre en ces pages une
captivante étude aussi érudite qu’accessible – dans ce style inimitable qui
a fait la réputation de l’historien, avec pour toile de fond l’Italie au
tournant des XVe-XVIe siècles, son domaine de recherche de prédilection.
Dans cet espace-temps dominé par les seigneuries, les influences et
alliances conclues par les princes, condottiere , protecteurs et autres
mécènes, Patrick Boucheron explore les possibles rencontres entre Léonard de
Vinci et Nicolas Machiavel. Ces deux protagonistes vécurent à la même époque
(pour rappel, Léonard naît à Vinci en 1452 et Machiavel à Florence en 1469)
et leur notoriété – qu’elle soit de génie pour l’un ou plus « machiavélique
» pour l’autre, a largement dépassé les limites de la Lombardie et de la
Toscane pour parvenir jusqu’à nous. Certes, et Patrick Boucheron avec la
rigueur de l’historien l’admet, on ne sait que très peu de choses sur ce
qu’ont pu se dire le vieux maître et le secrétaire de la Chancellerie de
Florence, et peu de certitudes semblent venir, il est vrai, en aide à
l’historien aventureux… Urbino, en son palais ducal, peut-être, sur fond de
cour de César Borgia, en cette année 1502 ? …
Mais, contrairement à Léonard ou Machiavel, Patrick Boucheron n’entend pas
dévier pour autant le cours de l’Arno, pas plus que celui de l’Histoire pour
faire capituler Pise et les dates. Néanmoins, et c’est tout l’intérêt de cet
ouvrage, nombre d’éléments et de circonstances, voire de coincidentia,
permettent à l’historien de belles conjectures et rapprochements pour ces
vies qui se sont assurément croisées, voire entremêlées, entre 1502 et 1504.
Et telle « La Bataille d’Anghiari » que Léonard n’acheva pas au Palazzo
Vecchio, tel ce seul carton central de l’œuvre laissant entrevoir – comme
les illustrations en noir et blanc de l’ouvrage nous le rappellent, ce que
purent être à droite et à gauche, le début et la fin de la bataille, il
reste également à l’historien ces échos de ce que purent se dire ou se
murmurer Léonard et Machiavel ; de ce que peuvent encore nous chuchoter,
sous la plume aussi précautionneuse qu’alerte de Patrick Boucheron, les
hauts murs des forteresses et palais italiens dans ce canevas inachevé que
nous a laissé l’histoire en ce début de XVIe siècle…
On l’aura compris : un ouvrage absolument captivant.
L.B.K. |
| |
 |
"Dictionnaire des Indiens de l'Amérique du Nord" de Daniel Dubois, 1472 p.,
14,5 x 23 cm, Guy Trédaniel Éditeur, 2024.
Une telle somme consacrée en langue française aux Indiens de l’Amérique du
Nord faisait défaut et c’est tout le mérite de son auteur, Daniel Dubois,
que d’avoir avec brio comblé cette lacune. Cet historien et spécialiste des
Indiens d’Amérique depuis plus de soixante ans livre, en effet, dans cet
ouvrage de plus de 1400 pages une impressionnante synthèse encyclopédique
sur les peuples autochtones d’un continent qui n’a cessé de nourrir les
mythes et les imaginaires. Grâce à cette somme, présentée sous la forme d’un
dictionnaire richement documenté, le lecteur pourra entrer au cœur même de
ces cultures, y découvrir de manière détaillée leurs traditions, et
retrouver ainsi l’histoire des premières nations nord-américaines.
Les multiples entrées de ce dictionnaire exhaustif exposent et développent de
manière détaillée tant les nombreux peuples indiens - notamment les fameux Cheyennes, que leurs pratiques guerrières ou religieuses. Que l’on suive
cette somme monumentale de la première à la dernière page, ou plus
probablement que l’on y puise selon ses centres d’intérêts ou
pérégrinations, chaque entrée mettra à la disposition du lecteur une
documentation scientifique impressionnante, combinant références
historiques, éclairages ethnographiques et anecdotes saisissantes.
L’ouvrage est complété de cartes, d’illustrations et de photographies
anciennes, qui ajoutent au plaisir de la lecture. Daniel Dubois est parvenu
avec ce Dictionnaire non seulement à proposer une synthèse scientifique
indiscutable, mais également à transmettre, ici ou là, son propre regard sur
ces peuples qui encore de nos jours sont confrontés à de multiples questions
identitaires et écologiques. Cinq siècles se trouvent ainsi réunis dans cet
ouvrage phare qui renouvellera à n’en pas douter le regard que nous pouvons
porter sur ces peuples si différents des caricatures qu’en ont livré les
occidentaux, notamment dans le 7e art… |
| |
 |
DDA.
Dire le Décor Antique. Textes grecs et latins au miroir des realia (IIIe s.
av.-VIIIe s. ap. J.-C.), Nicole Blanc, Marie-Thérèse Cam, Hélène Eristov,
Marie-Christine Fayant, Delphine Lauritzen et alii, 1600 p., Les Belles
Lettres, 2024.
Ne nous y trompons pas, ceci n’est pas un livre d’art (on n’y trouve aucune
illustration) mais une somme méthodique et encyclopédique recensant en
quelque 1600 pages un peu moins de 1400 textes grecs et latins classés
chronologiquement et qui mentionnent, longuement, ou, le plus souvent plutôt
brièvement (le cas de Pline l’Ancien auquel on consacre 130 pages est
exceptionnel et on aurait pu, tout aussi bien, citer in extenso le livre 35
de l’Histoire Naturelle qui est consacré à la peinture), peintures,
mosaïques, statues et décors (par exemple les inscriptions peintes ou les
revêtements muraux) dont on trouve trace dans les sources antiques. Les
témoignages ainsi recensés grâce aux bases de données vont de Plaute (une
citation d’Héraclide antérieure) à Grégoire de Tours et Isidore de Séville,
soit du IIIe siècle avant J.-C. aux VIe et VIIe siècles après J.-C. : on
mesure la gageure. L’ambition des cinq contributrices et de leurs très
nombreux collaborateurs est d’autant plus grande qu’elles ont voulu
accompagner les extraits, cités en grec, en latin et en traduction (la
plupart du temps empruntées aux éditions existantes), de commentaires et de
références bibliographiques. Ce travail de Bénédictines s’enrichit de divers
index, lexiques et glossaires construits avec méthode. On a donc avec cet
ouvrage un outil de consultation plus qu’un livre d’histoire de l’art.
L’ouvrage ne distingue pas, cependant, œuvres d’art réelles et œuvres
fictives comme les ekphraseis, ce genre littéraire à part entière qui, dans
l’Antiquité, consistait à décrire comme s’ils étaient réels des œuvres d’art
qui n’ont jamais existé, ce qui est le cas de la tapisserie qu’est censée
tisser Proserpine dans l’épopée du poète latin Claudien ou encore la
Description du Tableau cosmique « brossé » par Jean de Gaza au VIe siècle.
Il est vrai que la distinction n’est, cependant, pas toujours aisée à
établir ; on songe notamment à Callistrate, ce rhéteur du IIIe ou IVe s.
après J.-C., et à sa description de quelques statues antiques dont on ne
sait si elles sont imaginaires ou non. Le fait que l’ouvrage ne distingue
pas œuvres d’art réelles et œuvres fictives pourrait ainsi laisser la porte
ouverte à toutes sortes de mauvaises interprétations de la part de lecteurs
pressés ou inattentifs qui se contenteraient, sans lire les textes
originaux, de penser que ces témoignages, relèvent de realia, de productions
picturales ou architecturales réelles alors qu’il ne s’agit que de textes et
non de photographies. Il est délicat, en effet, d’attribuer une valeur «
documentaire » à des productions qui ne sont que le fruit de l’imagination
d’écrivains, de poètes ou d’historiographes.
Peut-être, enfin, certains auteurs sont-ils, certes, mieux traités que
d’autres. Les extraits de la Galerie de tableaux de Philostrate sont
commentés avec passablement plus de détails que d’autres dans le reste du
volume. Mais ces tableaux sont eux aussi plutôt fictifs que réels. On sait,
en effet, que La Vie d’Apollonios de Tyane du même Philostrate, ce
philosophe du IIIe siècle après J.-C., est un pur roman, ce qui devait
conduire en toute logique à être méfiant vis-à-vis de la supposée réalité
des tableaux dont on parle. Les extraits que l’on tire de l’Histoire
Auguste, ce recueil de biographies impériales de la fin du IVe siècle, elles
aussi en grande partie romancées, auraient gagné à être mieux contextualisés.
Au final, on saluera le travail fourni depuis plus de vingt ans pour ce
vaste dictionnaire dans lequel l’érudit ou le simple curieux trouveront
matière à de fécondes découvertes.
Stéphane Ratti |
| |
 |
Philostrate : « Vie d'Apollonios de Tyane » ; Texte introduit, traduit et
commenté par Valentin Decloquement ; Coll. « La Roue à Livres », Editions
Les Belles Lettres, 2023.
Si les noms de Philostrate et d’Apollonios de Tyane ne sont plus guère
connus que des spécialistes de l’histoire antique et autres spécialistes de
la philosophie pythagoricienne, la récente parution aux éditions Les Belles
Lettres de la « Vie d’Apollonios de Tyane » de Philostrate par Valentin
Decloquement devrait permettre de réviser ses classiques et de découvrir les
confins de la Méditerranée à partir du témoignage du sophiste athénien
Philostrate, au début du IIIe siècle apr. J.-C., sur un grand sage oublié du
1er siècle, un certain Apollonios de Tyane… Ainsi que le rappelle Valentin
Decloquement en introduction, ces deux personnages demeurent indissociables
malgré les siècles qui les séparent. Alors qu’Apollonios était présenté par
ses contemporains comme un charlatan, un mage perse plus ou moins sorcier,
Philostrate s’oppose à ce portait réducteur et décide de restaurer la
mémoire de ce personnage énigmatique que certains ont rapproché du Christ.
Ainsi est-ce plutôt la figure d’un grand sage que privilégie Philostrate en
évoquant Apollonios de Tyane, présenté à la fois comme un esprit ascétique
et doté d’une dimension divine. L’auteur relate en huit livres un voyage
initiatique jusqu’aux limites des frontières connues de la Méditerranée
antique, incluant l’Inde ou encore l’Éthiopie…
Au lieu et place d’un charlatan, nous découvrons plutôt un philosophe
pythagoricien dont la culture grecque le fait remarquer et apprécier de
nombreux souverains épris de culture classique alors que d’autres rejettent
violemment toute sagesse entravant leur pouvoir. Ce voyage presque
romanesque avant l’heure alterne discours philosophique et fiction, poésie
et mystique. Indépendamment de la véracité historique toujours difficile à
établir en raison du manque de sources, il demeure que ce récit s’avère
passionnant en livrant le regard d’un Grec du IIIe siècle sur le monde
romain du 1er siècle, fait original à l’époque et qui donne toute sa saveur
à ce récit anticipant nos fictions historiques et à découvrir dans cette
belle édition !Philippe-Emmanuel
Krautter |
| |
 |
"Pérégrinations dans la Gaule romaine et dans les provinces des Alpes et de
Corse" de Jean-Claude GOLVIN et Gérard COULON, 224 p., Éditions Errance &
Picard, 2024.
L’admirable travail graphique mené sur l’Antiquité par Jean-Claude Golvin
depuis de nombreuses années déjà n’est plus à présenter tant il a été
plébiscité par la critique et le grand public. Ce nouvel ouvrage vient
confirmer une nouvelle fois la qualité et la précision de ses recherches.
Premier spécialiste au monde de la restitution par l’image des grands sites
de l’Antiquité, Jean-Claude Golvin, architecte et directeur de recherche au
CNRS, s’est associé de nouveau pour cet ouvrage avec Gérard Coulon,
conservateur en chef du patrimoine et spécialiste du domaine gallo-romain.
Ce sont de bien belles « Pérégrinations dans la Gaule romaine et dans les
provinces des Alpes et de Corse » que nous proposent ainsi les deux
chercheurs aux éditions Errance en une somme aussi agréable à contempler que
passionnante à découvrir. Car l’image et le texte se complètent idéalement
en se répondant de manière complémentaire avec ces près de 140 aquarelles
toujours aussi surprenantes de réalisme et de précision, sans même insister
sur leur indéniable qualité esthétique.
Nourries d’une impressionnante documentation archéologique, ces restitutions
font littéralement revivre ces pages de notre Histoire ancienne en abordant,
comme si nous étions un voyageur du jour, les provinces de Narbonnaise,
Lyonnaise, Aquitaine, Gaule Belgique, Germanie ou encore Corse Alpes. Les
villes défilent, certaines plus impressionnantes que d’autres, telles
l’antique Arelate ou Arles moderne avec son fameux cirque restitué par le
crayon inspiré de Jean-Claude Golvin… Le fameux Pont du Gard est en
construction un peu plus loin, Vaison-la-Romaine (Vasio) affiche une
prospérité éclatante quant à son urbanisme.
Le lecteur sera bien surpris de découvrir des villes qu’il pensait pourtant
bien connaître comme l’antique Lutetia (Paris) ou bien Lugdunum (Lyon) dont
seuls quelques vestiges témoignent encore de nos jours de la splendeur de
leur architecture antique. Ce sont bien d’inspirantes et passionnantes
pérégrinations que nous offrent nos deux auteurs avec ce splendide ouvrage,
un livre qui redonne vie à des paysages depuis longtemps disparus, mais bien
présents dans notre Histoire et mémoire… |
| |
 |
Mathieu
Lours : « Les Cathédrales dans le monde – Entre religion, nation et pouvoir
», Folio histoire n°338, 352 p., 2024.
C’est une passionnante et riche étude consacrée aux « Cathédrales dans le
monde » que livre Mathieu Lours dans ce Folio histoire inédit. L’auteur,
spécialiste des cathédrales, de l’histoire des religions et du patrimoine
religieux, dresse en ces pages un tableau transversal et complet des
fonctions et pouvoirs des cathédrales de par le monde, d’hier à aujourd’hui.
Une histoire non seulement religieuse, mais aussi et surtout géopolitique.
Si, en tant qu’édifice, la cathédrale trouve ses fondements dans l’antiquité
tardive, étrangement, le mot même de « cathédrale » désignant la principale
église d’un diocèse n’est apparu dans la langue française que tardivement,
bien après ce temps que l’on nomme aujourd’hui « le temps des cathédrales ».
Le nom, proprement dit, tel que nous l’employons de nos jours apparaît, en
effet, seulement au XVIIIe siècle, et ce n’est qu’à la fin de l’époque
moderne que la cathédrale devient un « édifice mémoriel et identitaire »,
ainsi que le souligne Mathieu Lours dès son introduction. « Dès » et non «
dans » son introduction, car l’ouvrage va bien plus loin en déroulant de
manière claire et accessible toute l’évolution, le rôle et le poids des
cathédrales au fil de l’Histoire et des continents. Que sait-on en effet des
cathédrales aujourd’hui au XXIe siècle ? S’élèvent-elles encore ?
Reconstruction de Notre-Dame de Paris mise à part, qu’en est-il ailleurs, en
Afrique, en Russie ou au Moyen-Orient ? Au-delà du pouvoir et des nations,
c’est toute la captivante question de la mondialisation des cathédrales qui
se trouve ainsi posée et analysée, un terrain d’étude fructueux et peu
exploré jusqu’à maintenant. Le lecteur appréciera tout particulièrement le
riche et documenté chapitre venant clore l’ouvrage : « Cathédrale et nations
à l’heure des défis du monde contemporain ».
L.B.K. |
| |
 |
Patrick
Boucheron : « Les colonnes de San Lorenzo », Collection Fléchette, sun/sun
éditions, 2024.
La collection Fléchette des éditions sun/sun inaugure une série de petits
ouvrages, véritables instantanés dans lesquels dialoguent en une mise en
page soignée et esthétique des images tirées des Archives de la Planète
créée par le célèbre collectionneur Albert Kahn au tournant du XXe siècle et
des auteurs contemporains.
L’historien Patrick Boucheron déjà présenté dans ces colonnes, notamment
pour ses brillantes recherches sur Ambroise de Milan, converse ainsi en ces
pages avec cette autochrome des colonnes de la Basilique San Lorenzo au sud
de Milan. Cet entretien entre l’image et l’historien tient à la fois de la
confession, du dialogue amoureux et de la mémoire.

Entrelaçant souvenirs personnels et réminiscences
échappées de l’Histoire, Patrick Boucheron fait en effet preuve une fois de
plus d’une virtuosité déconcertante, déplaçant son lecteur en ces lieux que
l’auteur arpenta tant de fois, lui donnant presque à revivre ces espaces
naguère foulés par Ambroise de Milan et Augustin d’Hippone… Au fil des pages
quelques portraits s’esquissent, avec délicatesse, tel ce personnage de
Rosetta dont nous apprendrons l’identité qu’au terme de ce parcours dans la
permanence des lieux malgré les disparitions…
Philippe-Emmanuel Krautter |
| |
 |
« Une autre
histoire des samouraïs - Le guerrier japonais entre ombre et lumière » de
Julien Peltier, 368 pages, Perrin Editions, 2023.
Bushido, seppuku, ronin et autres chanbara n’ont guère de
secrets pour Julien Peltier, grand spécialiste reconnu de l’histoire des
guerriers japonais samouraïs. Si ces termes peuvent nous paraître bien
abscons, l’auteur se fait fort dans cette somme de 368 pages de nous initier
à leur compréhension en une étude à la fois complète et didactique. Julien
Peltier a retenu comme sous-titre « entre ombre et lumière » alors que nous
pouvions penser à tort que ces héros du pays au Soleil Levant n’avaient
connu que la gloire du fait de leur courage et de leurs nombreux faits
d’armes. Mais cette étude a choisi de lever certains mythes et a privilégié
une analyse plurielle pour ces soldats d’élite qui pouvaient tout aussi bien
servir les volontés autocratiques du shogun que terminer comme d’obscurs
hommes de main…
L’auteur débute son ouvrage par une très utile chronologie ainsi que par les
origines de ces redoutables guerriers, avec Tairan no Masakodo (900 ?-940)
que certains considèrent comme le « premier samouraï ». Bras armé de
l’empereur, personnage souvent indiscipliné et pourtant doté d’un code de
l’honneur infaillible, le samouraï accompagnera longtemps le pouvoir en
concentrant en sa personne bien des moyens de contrainte. Si nous avons en
mémoire les fameux samouraïs évoqués dans l’inoubliable film de Kurasawa, le
cinéma japonais et plus tard le manga présenteront d’autres facettes moins
reluisantes de ces guerriers d’élite qui pourront parfois servir aux basses
œuvres. Qu’il s’agisse de leur sexualité, souvent masculine, ou de la
renaissance le temps bref d’un coup de force tel celui de l’écrivain Yukio
Mishima, le mythe du samouraï a encore de beaux jours devant lui ainsi qu’en
témoigne cette belle et riche étude proposée Julien Peltier aux éditions
Perrin. |
| |
 |
Pindare
: « Œuvres complètes » ; Traduction, annotation, présentation et préface de
Jean-Paul Savignac ; 564 p., relié 18 x 25 cm, Français, Grec ancien, coll.
Classiques favoris N° 10, Éditions Les Belles Lettres, 2023.
Qui connaît encore l’œuvre de Pindare, ce poète naguère loué de toute la
Grèce, avant d’inspirer la Renaissance ? Les éditions Les Belles Lettres ont
confié au grand spécialiste des lettres classiques Jean-Paul Savignac - déjà
présenté dans ces colonnes pour ses travaux sur les Gaulois - le soin
d’établir les Œuvres Complètes dans la belle édition sur papier bible « Les
Classiques favoris » dirigée par Maxence Caron. À l’approche des Jeux
olympiques de 2024, il ne sera pas inutile de (re)découvrir ses Odes
Victoriales adressées aux vainqueurs des Jeux. Cette poésie lyrique chorale
dont Pindare fut l’un des maîtres incontestés plongera le lecteur dans le Ve
siècle av. J.-C. de sa Béotie natale aux portes de Thèbes en – 518, puis
dans toute la Grèce dont il parcourra les hauts lieux, devenant notamment
l’hôte des princes de Thessalie et du roi de Macédoine.
C’est l’art du traducteur que de restituer ce souffle antique qui associa
naguère le poète à un dieu. L’exercice est plus que périlleux pour celles et
ceux connaissant le grec ancien, il relève de la gageure. Comment transcrire
vers à vers le texte du poète ? Jean-Paul Savignac a pris le parti de
renouveler les précédentes traductions en recourant à toutes les subtilités
de la langue française, quitte à bousculer quelque peu l’approche classique
et suivre avec quelques hardiesses la progression du discours dans le grec
même. C’est ainsi par le truchement d’images qui, pour certains, seront
provocations et pour d’autres la « langue du songe » qu’il tente d’approcher
au plus près la langue du poète, réputée pour sa complexité. Que
découvrirons-nous dans ces pages singulières portées par le souffle de la
parole ? La valeur de l’athlète se conjugue à celle des dieux. Plus que la
prouesse sportive, les qualités morales du vainqueur l’emportent, ainsi
qu’en témoignent ces vers :
« Sauveur Haut-nuageux Zeus qui hantes la crête ktonienne
et bénis l’Alphée large coulant et la sainte caverne idéenne,
suppliant de Toi, je viens à même les lydiennes Te Héler, les flûtes,
Te demandant d’armorier de nobles cœurs cette cité,
et que toi, Vainqueur Olympique, que les chevaux poseidâniens
réjouissent, tu portes ta vieillesse allègre jusqu’à la fin,
tes fils, Psaumis, à tes côtés. Que celui qui abreuve bonheur et santé
et, content de ses biens, y ajoute l’éloge,
Ne cherche pas à devenir Dieu ».
Au terme de la lecture de cet ouvrage, jouissive parce que nourrie à ces
heures glorieuses où les Jeux n’étaient pas encore devenus ce qu’ils sont
depuis un siècle, le lecteur ne pourra que comprendre pourquoi Pindare
inspira tant de poètes et fins lettrés tel Ronsard qui le prit pour modèle.
Philippe-Emmanuel Krautter |
| |
 |
« Atlas
des guerres – Moyen-Âge, Occident, Byzance et Orient du Ve au XVe siècle »
de Loïc Cazaux, Coll. « Atlas des guerres », Tome 2, 192 pages, Editions
Autrement, 2024.
On retiendra volontiers pour ses atouts et qualités cet « Atlas des guerres
au Moyen-Âge » signé Loïc Cazaux, agrégé, docteur et professeur en histoire
médiévale, et paru aux éditions Autrement. Deuxième titre de cette nouvelle
série dénommée « Atlas des guerres », l’ouvrage offre une féconde analyse
transversale et comparative pour aborder au mieux cette période allant du Ve
siècle au XVe siècle. Prenant appui – comme son titre l’indique, sur de
nombreuses cartes, schémas et focus clairs et pédagogiques, l’ouvrage
s’ouvre sur « Les nouveaux royaumes germaniques en Europe occidentale à
partir du Ve siècle », puis traverse « Les royaumes européens face aux
guerres féodales du Moyen-Age central », avant d’envisager « L’expansion de
l’Empire turc ottoman du XIIe siècle au début du XVIe siècle » pour se
refermer sur la fin de la guerre de Cent Ans.
Évitant bien des écueils ou idées préconçues sur cette période
incontournable de l’histoire, ni image d’Épinal ni moyen Âge obscur, c’est
une analyse, en effet, globale ayant pour clef de lecture la guerre, les
batailles et les conflits que ce dernier livre au lecteur. La bataille de
Roncevaux, les Vikings, les croisades, la bataille de Bouvines, les
chevaliers Teutoniques, la guerre des Deux-Roses, pour ne retenir que
quelques titres témoignent et révèlent l’évolution du monde sur plus de dix
siècles. Distinguant le haut, moyen et bas moyen Âge, c’est tout autant en
effet l’évolution de l’Occident latin, de l’Orient ou encore de Byzance qui
se dévoilent ainsi à la compréhension. L’ouvrage propose ainsi véritablement
une géopolitique comparée des espaces médiévaux, une approche claire et
didactique permettant une meilleure compréhension du monde non seulement
d’hier, du Moyen-Âge, mais aussi de celui d’aujourd’hui. |
| |
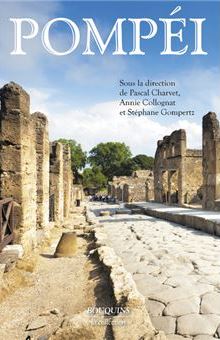 |
«
Pompéi » de Pascal Charvet, Stéphane GOMPERTZ, Annie Collognat, Bouquins,
2023.
Au lecteur qui penserait tout connaître de la légendaire ville sortie des
cendres, cet ouvrage lui est destiné ! Les très nombreuses découvertes
archéologiques réalisées ces dernières années grâce aux grands travaux
entrepris par l’État italien et l’Union européenne révèlent en effet de
nombreuses et nouvelles facettes de cette cité plurielle au carrefour de
Rome et de l’Orient. La date fatidique du 24 octobre 79 et le témoignage de
Pline le Jeune évoquant l’éruption fatale du Vésuve pour la cité romaine,
témoignage rappelé en avant-propos de l’ouvrage sont éloquents quant à
l’ampleur de la catastrophe : « On voyait des hommes à qui la peur de la
mort faisait supplier la mort elle-même »…
La luxuriance du paysage idyllique de Pompéi, sa douceur et la clémence de
son climat contrastent avec cette tragédie digne de la fin des temps ainsi
que la perçurent les contemporains de cette dramatique éruption mettant un
terme à l’histoire de Pompéi. Un terme remis fort heureusement en question
par ce stimulant ouvrage collectif qui redonne vie à ces habitants et à leur
vie quotidienne, à ces ruelles, jardins, thermes et même lupanars dans
lesquelles nous pouvons encore déambuler grâce à ces fabuleuses promenades
proposées dans cet ouvrage, 37 promenades précisément sans oublier le
dictionnaire de vies des Pompéiens qui ajoute encore à cette « proximité »
malgré les siècles qui nous séparent d’eux.
Vie et non point désastre, vitalité et non destructions, voici ce qu’offre
ce fort volume de 1152 pages abondamment illustré et nourri des analyses des
meilleurs spécialistes sur la célèbre cité antique. Une promenade hautement
dépaysante et instructive dans l’Histoire et la géographie antiques. |
| |
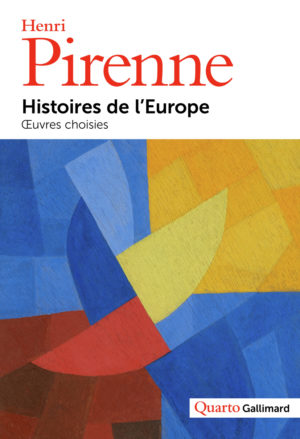 |
Henri
Pirenne : « Histoires de l’Europe - Œuvres choisies », Quarto Gallimard,
2023.
Le nom d’Henri Pirenne (1862-1935) est étroitement associé à l’étude des
origines de l’Europe et de sa lente construction. Cet éminent historien
belge compte parmi les chercheurs incontournables de la fin du XIXe et début
du XXe s., ce pourquoi la collection Quarto des éditions Gallimard vient de
lui consacrer un fort volume réunissant ses œuvres principales. Médiéviste
réputé, formé à l’historiographie allemande, sa méthode l’a porté à
renouveler le champ de ses recherches notamment à partir de deux axes
essentiels : l’histoire urbaine et la part grandissante de l’Islam à partir
du VIIe siècle. À l’image d’un Marc Bloch ou d’un Lucien Febvre, ses
contemporains, Pirenne explore avec une puissance de travail phénoménale
l’Europe médiévale dans son ouvrage – probablement le plus connu - «
Histoire de l’Europe » publié au terme de la Première Guerre mondiale,
partant de la fin du monde romain et des royaumes barbares jusqu’à la
Renaissance et la Réforme.
Avec « Les villes du Moyen Âge » rédigé en 1927, Henri Pirenne retrace en
une synthèse particulièrement éclairante l’émergence des villes du Moyen Âge
avec ses cités et ses bourgs, la renaissance du commerce avec ses marchands
avant la formation des plus grandes villes et l’essor de la bourgeoisie.
Mais, le maître ouvrage de Pirenne demeure certainement son « Mahomet et
Charlemagne » publié après sa mort en 1937. Avec un angle plus que novateur
à l’époque, l’historien étudie un domaine souvent sous-estimé à l’époque à
savoir l’expansion de l’Islam dans toute la Méditerranée…
D’autres ouvrages complètent ce Quarto notamment « Méthodologie de
l’Histoire » réunissant des articles et discours de l’historien allant de
1886 à 1931, « Économie et Société » avec des textes de maturité sur le
capitalisme, l’Instruction des marchands au Moyen Âge, les vins de France…
Pour finir, des articles et discours sur la Nation belge ont été réunis,
témoignant également de l’engagement de l’historien dans son temps. |
| |
 |
«
L’envers du Grand Siècle – Madame Palatine, le défi du Roi-Soleil » de
Thierry Sarmant, 350 p., Coll. « Au fil de l’Histoire », Editions
Flammarion, 2024.
Comment ne pas souligner la parution chez Flammarion de ce captivant ouvrage
« L’envers du Grand Siècle – Madame Palatine, le défi du Roi-Soleil » signé
Thierry Sarmant, historien, conservateur général du patrimoine aux Archives
nationales et auteur déjà de plusieurs biographies remarquées. Prenant appui
sur les destins croisés de Louis XIV et de Madame, sa belle-sœur, la
princesse palatine, l’auteur nous offre un éclairage aussi plaisant
qu’instructif. Car, des plus informés, mais loin d’être rébarbatif et non
dénué d’humour et de clins d’œil, cet ouvrage livre au lecteur une multitude
de précisions et détails sur la vie de Cour sous le règne du Roi-Soleil.
Lignées, protocole et intrigues… allant des plus grandes questions du
pouvoir et de la puissance du royaume jusqu’aux menus détails des sentiments
et vies intimes, nous découvrons en effet par le jeu des destinées et liens
croisés du Roi-Soleil et de Madame Palatine bien des enjeux et par, là-même,
« L’envers du Grand Siècle ».
Mœurs, goûts et divertissements, art, lecture et bibliothèques ou religions,
Louis et sa belle sœur, bien que très proches, ont peu de goût ou points de
vue communs, sans directement s’opposer, leurs opinions divergent le plus
souvent… La seconde épouse de Philippe, duc d’Orléans, frère cadet du roi,
est en effet une princesse franche, directe et spontanée ainsi que l’atteste
sa correspondance qui fait d’elle l’un des témoins privilégiés de ce règne.
Et, si le roi apprécie sa compagnie et aime surtout chasser avec elle, il
n’en sera pas toujours ainsi et bien des turbulences et ombrages marqueront
cette relation de plus de quarante années…
De cette fructueuse confrontation entre les prises de position du monarque
français et celles souvent plus tranchées de l’Allemande Élisabeth-Charlotte,
c’est véritablement la vie de Cour, de Versailles, Marly ou encore
Fontainebleau, celle des salons dorés jusqu’aux antichambres et couloirs
dérobés, du faste du règne de Louis XIV aux facettes moins connues de ce
XVIIe siècle finissant qui revivent sous la plume de Thierry Sarmant. |
| |
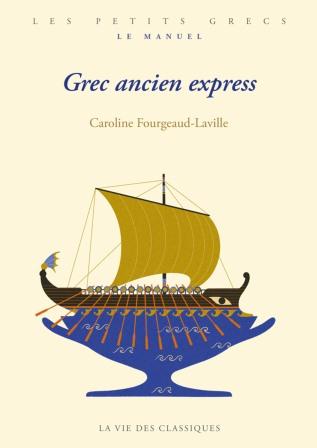 |
Caroline Fourgeaud-Laville : « Grec ancien express » ; Illustrations de
Djohr, Révisions d’Adrien Bresson et de Dorian Flores, Coll. « La vie des
Classiques », Éditions Les Belles Lettres, 2023.
Avec cet ouvrage « Grec ancien express », la langue d’Homère et d’Eschyle
retrouve en quelque sorte vie grâce à une méthode aussi plaisante que
rigoureuse. En revisitant l’aspect souvent austère et rebutant de nos
grammaires d’antan, l’auteur, Caroline Fourgeaud-Laville, Docteur ès
lettres, promouvant l’apprentissage du grec ancien en classes primaires,
offre une véritable méthode associant parole et fondamentaux grammaticaux.
Progressive et sous forme de leçons (pouvant être menées seul ou avec un
enseignant), cette méthode initie également à la culture grecque antique
souvent indissociable de la langue même.
En 24 étapes de 50 minutes chacune, cet apprentissage répondra aux diverses
attentes, qu’il s’agisse d’une démarche de culture générale, d’apprentissage
scolaire ou d’une révision de connaissances anciennes.
Zoé, Ulysse et Socrate seront les interlocuteurs privilégiés pour des
dialogues vivants conçus par l’auteur pour chaque leçon grammaticale, une
manière ludique et efficace de se (re)mettre au grec ancien dans la bonne
humeur ! |
| |
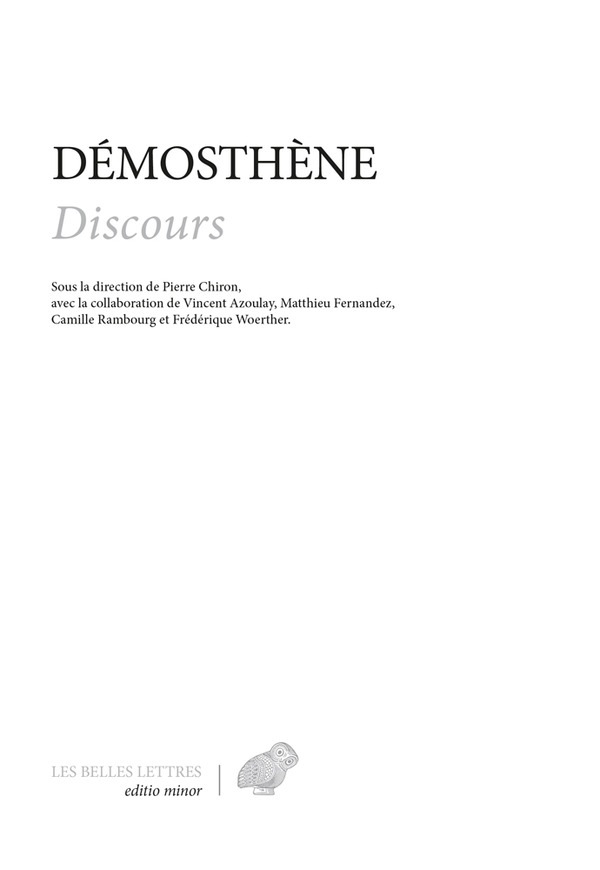 |
Démosthène : « Discours » sous la direction de Pierre Chiron avec la
collaboration de Vincent Azoulay, Matthieu Fernandez, Camille Rambourg et
Frédérique Woerther, 1344 pages, Editions Les Belles Lettres, 2023.
Beaucoup d’idées préconçues ont circulé - et circulent encore - sur le grand
orateur grec Démosthène (384-322 av. J.-C.) La monumentale édition de ses «
Discours » qui vient de paraître aux Belles Lettres ( 1 344 pages) sous la
direction de Pierre Chiron devrait assurément contribuer à une plus juste
évaluation de la place tenue non seulement par l’éminent orateur athénien,
mais aussi de son rôle politique, reconsidéré, sans oublier sa dimension
philosophique également présente dans son important corpus. Les auteurs ont
pour cette nouvelle édition entrepris un important travail de traduction,
l’option inédite retenue étant notamment de rendre plus lisible et surtout
plus audible le style et la pensée de celui dont l’éloquence est passée à la
postérité depuis le IVe siècle avant notre ère. Choix a également été fait
de présenter pour cette édition l’intégralité des 63 discours selon un ordre
chronologique.
Cet angle judicieux présente l’immense mérite de rendre beaucoup plus
lisible l’évolution de la pensée de Démosthène, une pensée forcément
influencée par les succès mais aussi les vicissitudes qui parsemèrent son
parcours. Farouche partisan de la liberté, Démosthène usa de l’éloquence non
point comme une fin en soi mais comme moyen de préserver cet espace menacé à
l’heure de la conquête de son pays par Philippe de Macédoine auquel il
s’oppose dès son premier discours. Contre la servitude et la soumission du
peuple, l’orateur souligne les failles de la démocratie à Athènes au IVe
siècle. Il est vrai que dès son jeune âge, orphelin, Démosthène eut à lutter
contre l’adversité et ses tuteurs qui dilapidèrent ses biens. Il fallut
cette pugnacité précoce pour lui permettre de forger progressivement de
nouvelles armes sur l’art de convaincre les Athéniens de sortir de leur
apathie face au péril macédonien grandissant.
Rien n’échappe à sa vigilance et le citoyen lucide incite et encourage ses
contemporains à renforcer une armée en déshérence et à combattre la
corruption qui gagne même les rangs athéniens. Sa célèbre opposition face à
un autre grand et célèbre orateur, Eschine, acquis à la cause macédonienne,
demeure un morceau d’anthologie, ce qui n’empêchera pas la défaite des
armées grecques à Chéronée.
Cet esprit combatif qui fut sa force sera, cependant, également cause de sa
chute : Démosthène, alors qu’Athènes subit une défaite cuisante, reconnaît
lui-même, en effet, sa part de responsabilité dans le fameux Discours sur la
couronne daté de 330, exigeant d’être lu pendant trois heures d’affilée…
Le lecteur de cette dernière et remarquable édition pourra à loisir retenir
une lecture chronologique ou passer d’un sujet à l’autre. Par ces célèbres
Discours, Démosthène a couvert non seulement les thèmes politiques et
judiciaires qui ont bâti sa réputation mais également des discours de
cérémonies et autres développements philosophiques (grandeur de l’homme et
de ses valeurs morales) témoignant ainsi de la richesse de l’oralité de leur
auteur. La profondeur de sa pensée n’a d’égal que cet amour fou qu’il ne
cessa de porter à sa cité dont la grandeur reste indissociable de la
liberté. |
| |
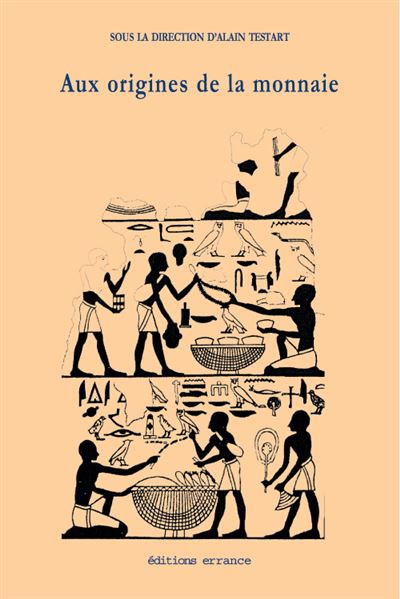 |
« Aux
origines de la monnaie » ; Sous la direction d’Alain Testart, Éditions
Errance & Picard.
Les éditions Errance & Picard ont eu l’heureuse initiative de publier une
réflexion collective à la fois ardue et néanmoins nécessaire sur les
origines de la monnaie. Cet élément du quotidien, ô combien trop présent
dans nos vies, n’a pas été depuis l’aube de l’humanité de soi, tant s’en
faut, et son apparition pose encore aujourd’hui de multiples questions sur
son rôle et place.
Ainsi que le souligne Alain Testart en introduction, la monnaie a une double
nature : son aspect « sonnant et trébuchant », tout d’abord, qui nous est
familier et qui l’assimile aux pièces de métal plus ou moins précieuses
selon les époques et les lieux. Mais la monnaie peut également prendre la
forme des matériaux les plus divers servant à quantifier les échanges entre
les hommes, cette dernière forme étant celle qui intéresse plus
particulièrement ce passionnant dossier. Nos sociétés modernes ont en effet
du mal, même à l’heure des cryptomonnaies, à abandonner toute référence aux
valeurs « matérielles » qu’elles fassent référence à l’argent ou à l’or. Ces
étalons demeurent ancrés dans nos consciences, signe de la prégnance de la
monnaie et de son origine.
Cette dernière sous la forme de pièces semble être apparue au VIe av. J.-C.
en Lydie en Asie Mineure pour rayonner rapidement en Perse, en Grèce et
jusqu’en Gaule. Mais l’ouvrage cherche surtout à explorer ce qu’était la
monnaie avant « les monnaies » dites « en pièces », une longue histoire qui
se perd dans la nuit de temps et que cette réflexion collective entend
remonter. Alain Testart analyse ainsi dans le détail la monnaie non
métallique comme moyen d’échange et de paiement dans les sociétés
primitives. Jean-Jacques Glassner s’intéresse, pour sa part, à la question
d’une monnaie en Mésopotamie au IIIe millénaire avant notre ère, alors que
Bernadette Menu étudie sa place dans la société égyptienne sous les
pharaons. Un dernier développement sur la monnaie chinoise clôt cet ouvrage
passionnant qui nous fera porter un autre regard sur les petites pièces de
notre porte-monnaie ! |
| |
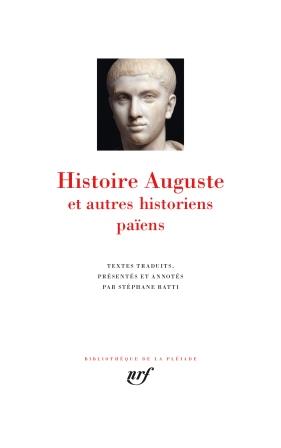 |
«
Histoire Auguste et autres historiens païens » ; Édition et traduction du
latin par Stephane Ratti, 1328 pages, 104 x 169 mm, Collection Bibliothèque
de la Pléiade (n° 665), Gallimard, 2022.
Le IVe siècle romain de notre ère connaît un tremblement jusqu’à ses
fondations. La religion minoritaire, naguère combattue jusqu’en ses
catacombes, deviendra l’unique religion officielle de l’empire par volonté
de l’empereur Théodose le 8 novembre 392. De Constantin à Théodose près d’un
siècle suffira, en effet, à bouleverser les piliers de la culture romaine.
C’est dans ce contexte pour le moins troublé que s’inscrivent les historiens
antiques du présent volume traduits et édités par Stéphane Ratti, lui-même
historien et que nos lecteurs connaissent bien pour avoir collaboré à notre
revue.
D’emblée, le spécialiste de l’antiquité donne le ton : « Les historiens
réunis dans ce volume sont tous païens », une indication précieuse
permettant de mieux apprécier le regard et témoignages d’hommes concernés au
premier plan par le vacillement des traditionnelles valeurs romaines. Alors
que ces lettrés ont été nourris au fond antique de la Rome éternelle, le
nouvel ordre chrétien leur impose de nouvelles valeurs et un fondement
sensiblement différent de ce qu’ils avaient connu jusqu’alors. C’est sous
ces empereurs nouvellement chrétiens – par choix stratégique ou par vertu –
que les auteurs antiques réunis dans cet ouvrage occuperont des postes
officiels et « s’avancent masqués » ainsi que le souligne Stéphane Ratti en
sa présentation.
Depuis Hermann Dessau à la fin du XIXe siècle, ce texte énigmatique de
l’Histoire Auguste a fait couler beaucoup d’encre, l’élève de Mommsen
estimant, en effet, que derrière ces différents auteurs de biographies des
empereurs se cacherait un seul et même historien ayant emprunté différents
pseudonymes… Stéphane Ratti rappelle que parmi tous les prétendants à la
paternité de l’Histoire Auguste, Nicomaque Flavien l’Ancien, aristocrate,
préfet du prétoire d’Italie, figurerait en première place, cette plume
acerbe et souvent ironique n’hésitant pas à se lancer dans de sévères
diatribes, moquant tour à tour les Pères de l’Église et même les Évangiles !
Et c’est peut-être l’un des charmes de ce recueil atypique que d’offrir un
regard décentré et critique sur son temps, exercice toujours périlleux pour
l’époque. A l’évidence et pour conclure, il ne faudra pas prendre l’ «
Histoire Auguste et autres historiens païens »pour un livre d’Histoire au
risque de sévères déconvenues, tant les incohérences et anachronismes sont
nombreux. Cependant, l’un des attraits d’une lecture contemporaine de cette
somme réside certainement – pour les non spécialistes – dans le style
littéraire et les frontières ténues entre histoire et écrit romanesque que
révèlent ces pages toujours passionnantes qu’a su rendre vivantes et alertes
Stéphane Ratti dans cette nouvelle traduction.
Philippe-Emmanuel Krautter |
| |
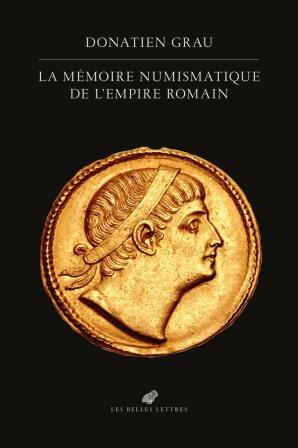 |
Donatien Grau : « La mémoire numismatique de l’Empire romain », Editions Les
Belles Lettres, 2022.
Avec cette riche et volumineuse étude, Donatien Grau nous introduit à la
découverte d’un monde merveilleux et insoupçonné, celui de l’histoire de
l’Empire romain à partir de ses monnaies, véritable source rarement visitée.
Alors que les textes littéraires et épigraphiques s’avèrent souvent
fragmentaires et sujets à discussion, cette masse monétaire qui dort
injustement dans nos musées a pourtant tant à nous dire ainsi que le
démontre cette somme d’une remarquable clarté pour un sujet aussi aride.
Le grand historien de cette période, Alexandre Grandazzi, qui signe la
postface ne s’est pas trompé en relevant combien Donatien Grau, par cette
quête historique d’une rare ampleur, parvient à faire « parler » ces
multiples pièces de monnaie en un véritable ensemble à considérer dans sa
globalité. Fruit de la rigueur romaine, le monnayage provient en effet
directement de l’autorité étatique en un temps et un espace donnés évoluant
selon les chronologies des conquêtes. Cet ensemble unique peut grâce à
l’éclairage donné par l’auteur nous parler et nous apprendre ou confirmer
une multitude d’enseignements à la fois économiques, sociaux, mais aussi
politiques ou encore culturels.
Il apparaît ainsi que la monnaie impériale romaine peut être perçue comme un
discours de ce même pouvoir impérial avec ses instruments rhétoriques, tout
comme un instrument de mémoire. Conviant pour cela de multiples disciplines
telles la philologie, l’iconographie ou encore l’analyse littéraire, cet
immense corpus des monnaies impériales, qui à n’en pas douter fera date,
livre de nouvelles pages d’histoire avec ses vicissitudes (damnatio memoriae)
comme ses heures de gloire (victoires et conquêtes).
Un ouvrage qui offre un nouveau et passionnant regard sur les monnaies
antiques romaines impériales. |
| |
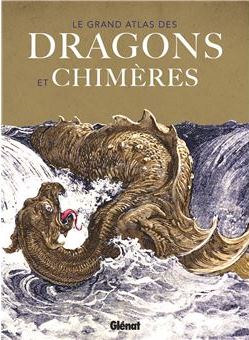 |
« Le
Grand Atlas des dragons et Chimères » ; Collectif ; Cartonné, 21.5 x 29.3
cm, 176 pages, Coll. Histoire, Editions Glénat, 2021.
Les dragons et autres chimères ont de tout temps fasciné les hommes et
habité leur imaginaire. Aussi est-ce une heureuse découverte que de
parcourir les pages de ce « Grand Atlas » dédié à ces mythiques créatures
aux éditions Glénat.
Extraordinaires ou réels, les dragons et chimères présents dans la
quasi-totalité des civilisations sont multiples, extrêmement variés et
sources dès lors de bien des malentendus. Comment les connaître et les
reconnaître ? Certains semblent même avoir mis leur légende au service de la
ruse pour mieux encore nous tromper et nous dérouter. Ainsi connaissez-vous
Le Dragon de Beowulf ou encore le Quetzacoaltl ?
L’ouvrage, appuyé par une vaste iconographie, fourmille de légendes et
d’informations sur ces fantastiques créatures que sont les dragons et
chimères. Mais, ce « Grand Atlas » ne se limite pas à cette seule approche –
déjà riche – et a également étendu son étude aux relations étroites qu’ont
toujours entretenues les dragons et les hommes. Une deuxième partie
instructive dans laquelle on pourra découvrir « Le dragon médecin », mais
aussi ceux de la peinture ou encore plus proche de nous « Les dragons de l’heroic
fantasy ». Le lecteur pourra même découvrir que certains dragons existent
peut-être même pour de vrai !
La dernière partie, enfin, de ce fantastique ouvrage est consacrée à cette
histoire souvent méconnue, celle de la « dragonologie ». Eh, oui, les
dragons et autres chimères, c’est toute une histoire, une histoire qui
méritait bien un « Grand Atlas » ! |
| |
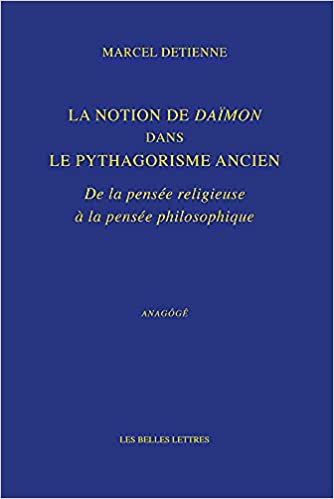 |
Marcel
Detienne : « La notion de Daïmon dans le pythagorisme ancien », Les Belles
Lettres éditions, 2021.
En offrant une nouvelle édition de cet ouvrage désormais classique paru pour
la première fois en 1963, les Belles Lettres rendent un hommage mérité au
célèbre et regretté helléniste Marcel Detienne disparu en 2019. Cet
historien anticonformiste fut très tôt remarqué en analysant la notion de «
daïmon » successivement en une dimension initiale religieuse puis
philosophique. Cette étude exigeante se trouve être la plus parfaite
démonstration de la méthode de l’auteur qui n’hésitait pas à reconnaître la
dette qu’il avait contractée auprès de chercheurs guère en vogue dans
l’université tel Georges Dumézil. Croisant, comparant et rapprochant des
domaines souvent éloignés au regard des disciplines habituellement plus
rigides, l’historien et anthropologue comparatiste sut briser les barrières,
ce qui lui fit apprécier très tôt la démarche structuraliste adoptée par
Claude Lévi-Strauss.
En recherchant ce qui rapproche les notions primitives du daïmon – que l’on
traduira par facilité par « démon » - de celles du pythagorisme, Marcel
Detienne rappelle tout d’abord que cette notion recouvre différentes
significations pouvant aller du domaine agricole à celui des rêves en
passant par celui de la vengeance, différentes facettes d’une expérience
religieuse des vivants à l’égard du monde invisible. L’helléniste dans ces
pages érudites analyse cette transition entre un premier plan « mythique » à
un stade philosophique et rationnel qui sera le fait des premiers
pythagoriciens. Plus que Xénocrate, disciple de Platon et auteur d’un essai
sur la démonologie rationnelle, Marcel Detienne souligne combien la pensée
religieuse du pythagorisme apportera des développements décisifs sur la
question en passant d’une notion équivoque à un concept univoque. Les VIIe
et VIe siècles connaitront ainsi une mutation décisive de la conscience
religieuse selon l’auteur avec Pythagore et ses disciples. Grâce à ces
penseurs, il sera possible de distinguer des démons « bons et pleins d’amour
pour les hommes », esprits provenant d’hommes ayant eu de leur vivant une
vie vertueuse. Cette pratique de la vertu confèrera à ces entités
intermédiaires une force inférieure à celle des dieux mais supérieure à
celle des hommes qu’ils pourront guider et aider.
Cet essai, incontournable, démontre de manière éclatante comment une pensée
philosophique peut s’élaborer à partir d’une pensée religieuse et ainsi
modifier « substantiellement » le concept initial. |
| |
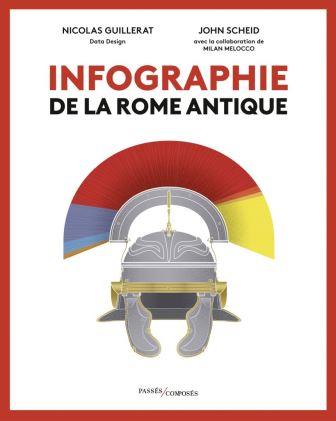 |
John
Scheid, Nicolas Guillerat et Milan Melocco : « Infographie de la Rome
antique » ; 23 x 29, 128 p., Éditions Passés /Composés, 2020.
Impressionnant, tel est le premier sentiment qui gagne le lecteur de cette
monumentale « Infographie de la Rome antique » ! En 128 pages, cet ouvrage
nourrit l’ambition d’appréhender des milliers de km2 de territoire, des
millions d’habitants, ainsi qu’une succession de régimes allant des
premières royautés jusqu’à l’empire implosant de son poids à la fin du Ve
siècle en passant par la République… Un tel exploit n’eut été possible sans
la science du grand historien de la Rome antique John Scheid accompagné pour
cette tâche immense par Milan Melocco, et conjugué au génie graphique de
Nicolas Guillerat. Combien de générations soupireront de ne pas avoir eu
plutôt un tel outil en classe…
Fort heureusement, cette didactique entreprise est désormais accessible
grâce à ce que l’on nomme la datavisualisation. Derrière ce terme un brin
barbare se cache une réalité bien connue, celle des organigrammes et autres
représentations graphiques permettant de mettre en évidence les multiples
données chiffrées de manière organisée, sous forme de cartes, organigrammes,
plans, cartes… L’effet visuel est une réussite, le monde romain lève
progressivement le voile de sa complexité, et cette succession de faits et
d’évènements trouve une cohérence et un fil évolutif grâce à l’érudition des
auteurs. Le plan de la Rome antique laisse apparaître ses monuments les plus
célèbres en une vue détaillée, les multiples régimes politiques se trouvent
schématisés, alors que les complexes institutions politiques, juridiques et
administratives, dont nous avons en grande partie héritées, sont présentées
avec clarté.
L’ouvrage limité pourtant à 128 pages parvient à entrer dans l’explication
détaillée de la composition des fameuses légions romaines, équipements et
tactiques. Les commentaires clairs et incisifs soulignent l’essentiel et
accompagnent la lecture des données graphiques, page après page.
Après une telle lecture, le monde romain antique malgré la complexité du
long terme et de ses différentes facettes semble presque familier, une
réussite à mettre au crédit des auteurs manifestement inspirés par l’ampleur
de la tâche !Philippe-Emmanuel
Krautter |
| |
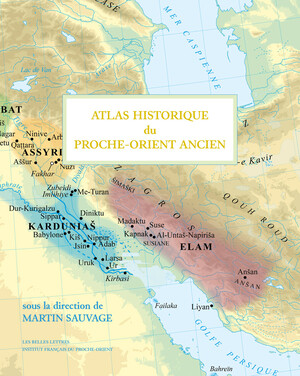 |
« Atlas
historique du Proche-Orient ancien », sous la direction de Martin Sauvage,
XXII + 218 pages, Relié, 30.6 x 38.3 cm, Belles Lettres éditions, 2020.
Au regard de la richesse et de l’importance du thème traité, le
Proche-Orient, il fallait assurément un ouvrage en conséquence. Un pari que
relève avec brio cet « Atlas historique du Proche-Orient ancien » ! Près de
20 000 ans déterminants pour l’humanité sont, en effet, couverts par cet
Atlas d’envergure, aussi bien sur la forme que le fond. D’un format généreux
(30,6 x 38,3 cm) afin de profiter de la clarté des cartes représentées,
mettant en valeur le relief, soulignant les fleuves et frontières, cet Atlas
historique fait en quelque sorte revivre l’histoire des hommes et des
civilisations dans cette région clé du monde antique.
Les sujets de fond abordés sont également à la hauteur de cette
présentation, avec le concours d’une cinquantaine de contributeurs, experts
reconnus et jeunes chercheurs mettant en commun une somme impressionnante de
connaissances, et livrant ainsi le dernier état de la recherche sur ces
thématiques riches et fertiles. Il est bien connu de nos jours combien des
éléments clés de toute civilisation, telle notamment l’écriture, sont nés
dans cette région même du monde, au sud de l’Irak. Ces premiers signes
cunéiformes furent en effet conçus afin de comptabiliser notamment les
récoltes de céréales, dont le fameux épeautre, nées de la sédentarisation
des hommes dans ces régions.
Géographie, géologie, météorologie et végétation, tous ces facteurs ont
concouru et concourent aux faits historiques et aux développements
ultérieurs. C’est l’une des leçons d’ailleurs les plus fascinantes de cet «
Atlas historique du Proche-Orient ancien » - en plus de livrer de
somptueuses cartes – que d’offrir une réelle mise en relation de disciplines
souvent distinctes et encore trop cloisonnées pour le néophyte. À partir de
ces fondamentaux parfaitement représentés en des cartes d’une lisibilité
exemplaire, le lecteur pourra découvrir la lente constitution de
civilisations bâtisseuses avec ses premières grandes villes entraînant
conquêtes et empires, dynasties et royautés.
Tour à tour macroscopiques ou faisant un focus sur une région bien précise,
les cartes de cet Atlas font défiler une à une les pages de l’humanité dans
cette région clé du monde, une belle leçon d’histoire et de géographie. |
| |
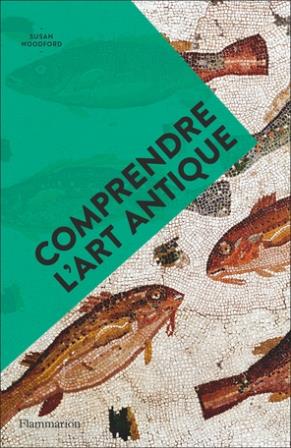 |
Susan
Woodford : « Comprendre l'art antique » ; Traduction de l’anglais par
Camille Fort, Coll. L'art en poche, 176 p., 140 x 216 mm, Couleur, Broché,
Éditions Flammarion, 2020.
Dans la collection « L’art en poche », Susan Woodford est parvenue avec «
Comprendre l’art antique » à concentrer plus de deux mille ans d’art
antique, partant des Grecs jusqu’aux Romains. Jetant les bases de
l’occident, ces deux civilisations apporteront, en effet, jusqu’à la
Renaissance qui s’en réclamera, des créations artistiques incontournables
dans l’histoire de l’art. Ainsi que le souligne l’auteur dès l’introduction
de cet opuscule très pédagogique, l’art en ces périodes se doit de prendre
en compte des nécessités pratiques extrêmement coûteuses, notamment celles
qu’imposent la sculpture et la peinture, aussi l’art antique se voit-il
réservé à des fonctions importantes liées au pouvoir. L’auteur, Susan
Woodford entend surtout démontrer que l’art antique romain ne saurait être
ramené sans nuances à l’art grec, un art ayant lui-même emprunté à l’art
égyptien... C’est cette compréhension de l’art antique que le lecteur pourra
au fil des pages découvrir.
Si les Grecs empruntent, en effet, aux Égyptiens leur technique pour
sculpter la pierre, c’est cependant pour mieux s’en départir.
Progressivement, les formes sculptées s’animent comme pour ces statues de
femmes drapées d’étoffes souples, les décors s’organisent pour constituer
une narration de plus en plus complexe où l’architecture tient sa place. La
peinture s’invite également dans l’art grec, les artistes étant à l’origine
de représentations sous la forme de tableaux avec leurs formes arrondies. De
nouvelles narrations sont inventées sur les amphores, se faisant souvent
l’écho de la poésie orale…
Même si certains auteurs ont contesté l’idée d’un art romain en tant que tel
en raison de l’importante reprise du modèle grec, il demeure que
progressivement, les artistes romains parviendront à imposer de nouvelles
créations soulignant les vertus romaines. L’art est en effet accepté chez
les Romains à partir du moment où il possède un usage social et moral. De
Fabius, premier artiste romain au IIIe s. av. J.-C., aux sculptures de
qualité de plus en plus dégradées du IIIe s. de notre ère, l’ouvrage retrace
les évolutions, influences et dérives d’un art contrasté selon sa finalité
officielle ou privée avec la nobilitas. Dans ce dernier cas, les peintures
ornant les villas romaines rivalisent de beauté et de décors somptueux, et
dont certaines sont parvenus intacts jusqu’à nous (Pompéi, musée national de
Rome,…).
De tous les débris occasionnés par les ravages du temps depuis la fin de ces
civilisations, il serait trompeur de penser que l’art antique se résume à
quelques colonnes ou sculptures, et ce petit ouvrage clair et accessible en
fait la plus parfaite démonstration ! |
| |
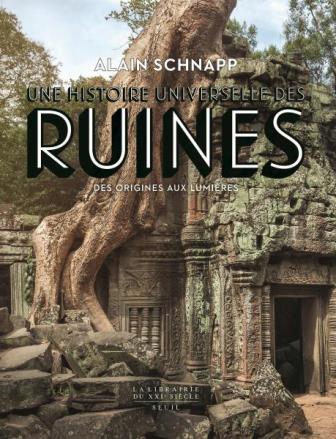 |
Alain
Schnapp : « Une histoire universelle des ruines - Des origines aux Lumières
» ; 744 p., Colle. La Librairie du XXIe siècle, Editions Seuil, 2020.
Les ruines, pour Alain Schnapp, l’auteur de cet excellent ouvrage, ne sont
pas synonymes de désolation, tant s’en faut pour cet historien et
archéologue réputé. Le questionnement sur les ruines de l’auteur également
d’une remarquable « Histoire des civilisations » présentée dans ces
colonnes, trouve son prolongement avec ce fort et beau volume pour le monde
ancien.
« Une histoire universelle des ruines » explore cette attraction pour notre
passé suscitée par ces vestiges de civilisations disparues et dont le
rayonnement transparaît encore à partir de ces restes laissés en témoignage.
Le goût pour les ruines est fort ancien, et même si le philosophe stoïcien
Sénèque avouait au Ier siècle de notre ère un mépris certain pour cette
attirance qu’il jugeait inutile. Notre société occidentale dès les
humanistes et les siècles suivants voueront, en effet, un culte certain à
leur encontre, tel Diderot dans son poème en prose, ou encore les
inoubliables descriptions laissées par Chateaubriand.
Que nous racontent ou murmurent ces témoignages du passé, souvent rongés par
le temps ? En un curieux retour de la culture à la nature, déjà relevé par
Georg Simmel, lorsque ces matériaux s’effritent et se confondent aux
éléments, les ruines révèlent l’impermanence de notre condition humaine et
de ses créations. Le rapport entretenu par les civilisations avec leurs
ruines sont sources d’autant de significations et constitue alors un objet
de recherche infini pour Alain Schnapp.
Ces assemblages de pierre et autres matériaux ont souvent plus à nous dire
que leur seule architecture. La ruine ne peut se concevoir que selon le
regard que l’on porte sur elles souligne Alain Schnapp, et l’exemple des
pyramides d’Égypte ou des alignements de Stonehenge, indépendamment de leur
monumentalité, n’ont de sens qu’à partir du moment où il est encore possible
de les interpréter. Les différents monuments étudiés dans cet ouvrage aux
magnifiques illustrations provoquent chez ceux qui les regardent tout un
réseau de dialogues plus ou moins étendus selon leur état. De la ruine aux
décombres, en passant par les vestiges, ce sont ces voix si chères à Malraux
qui demeurent alors plus ou moins audibles, et que l’historien et
archéologue Alain Schnapp explore dans ces pages en de lumineux
développements. Chaque époque révèle ainsi, selon le sort qu’elle réserve à
ses ruines, son identité.
Du Néolithique jusqu’aux confins de la terre, cet ouvrage fait défiler ces
témoignages, parfois fugaces, à peine lisibles ou au contraire monumentaux,
en soulignant ce qu’ils ont encore à transmettre, un souvenir adressé aux
temps présents et futurs. Ce dialogue avec les ruines donne lieu à des
paradoxes saisissants comme pour cette première image d’une vue d’un temple
d’Angkor enserré par les lianes d’un ficus plus géant que l’édifice, ou
encore ces « Méditations sur les révolutions des empires » proposées par
Volney en une prière laïque.
Cette belle aventure universelle des ruines ne pourra que combler le
lecteur, tant pour sa science que sa poésie, un parcours sur le long terme
qui suscitera à n’en pas douter à un questionnement quant à notre propre
rapport aux ruines, et à celles que nous laisserons aux générations futures…
Philippe-Emmanuel Krautter |
| |
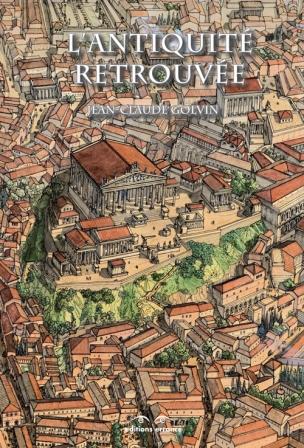 |
«
L'Antiquité retrouvée », 4e édition, revue et augmentée, de Jean-Claude
Golvin, Aude Gros de Beler, Éditions Errance, 2020.
Le travail de Jean-Claude Golvin n’est plus à présenter, lui, ce talentueux
architecte et directeur de recherche au CNRS qui a su majestueusement
redonner vie de la plus belle manière qui soit à l’Antiquité grâce à ses
aquarelles soignées. Il ne s’agit point là de vues d’artistes, plus ou moins
romantiques, auquel le passé nous avait habitués. C’est en une véritable
connaissance intime et scientifique du terrain – Jean-Claude Golvin a dirigé
pendant dix ans le Centre franco-égyptien de Karnak – que son travail trouve
ses sources. Alliant rigueur archéologique au talent de dessinateur,
l’Antiquité reprend vie sous la plume aquarellée de l’auteur.
Approfondissant le concept de « restitution », Jean-Claude Golvin souligne
que proposer au XXIe siècle une image la plus fidèle possible du site de
Delphes, du temple d’Amon à Karnak ou encore du Colisée de Rome ne peut se
réaliser qu’à l’aide de sources fiables et nombreuses telles que des
dessins, textes anciens, mosaïques et bas-reliefs, sans oublier les vestiges
archéologiques parvenus jusqu’à nous.
C’est dans l’appréhension et le traitement de ces milliers de données,
forcément parcellaires et souvent dispersées, que réside l’art de synthèse
et de rigueur de l’auteur pour ces magnifiques dessins. Sans se perdre dans
les méandres des ruelles de la Rome antique, Jean-Claude Golvin parvient
cependant à en rendre la richesse. Et si les personnages n’apparaissent que
très rarement, et en taille à peine visible, c’est pour mieux mettre en
évidence la vie des édifices et des sites qui livrent un témoignage
suffisamment évocateur du génie de ces civilisations.
« L’Antiquité retrouvée » mérite bien son titre en redonnant vie
admirablement à une centaine de sites parmi les plus fameux de l’Antiquité
sur près de trente siècles, de 2500 av. J.-C au Ve siècle de notre ère. Le
talent de Jean-Claude Golvin, appuyé par les textes éclairants d’Aude Gros
de Beler, réside assurément dans cette vision d’ensemble rendant
immédiatement lisible la complexité de ces architectures antiques.
C’est un fabuleux voyage dans le temps et dans l’espace que nous offre ce
passionnant ouvrage !
Philippe-Emmanuel Krautter |
| |
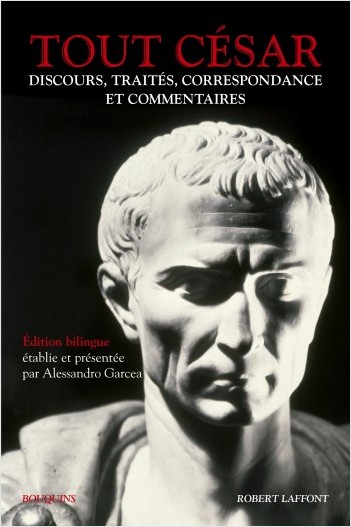 |
« Tout
César - Discours, traités, correspondance et commentaires » Jules CÉSAR,
Alessandro GARCEA (Traducteur, Directeur d'ouvrage), Collection Bouquins,
Robert Laffont éditions, 2020.
Assurément cette dernière publication aux éditions Robert Laffont fera date
en langue française car, étonnamment, il n’était pas possible jusqu’à
présent de disposer en édition bilingue de tous les écrits de l’un des plus
grands stratèges et personnalité politique de l’Antiquité, Jules César.
On oublie trop souvent qu’en plus d’avoir été le conquérant de la Gaule et
d’une grande partie du monde méditerranéen, à l’image de son illustre
prédécesseur Alexandre le Grand, Jules César fut également un historien dont
les écrits sont également passés à la postérité. Et, c’est justement l’objet
de ce volume de la prestigieuse collection Bouquins que de rassembler en 960
pages l’intégralité des écrits de Jules César, et ce, en version bilingue
latin et français.
Le lecteur sous la conduite éclairée d’Alessandro Garcea, grand spécialiste
de la littérature latine, aura grand intérêt de débuter sa lecture par
l’éclairante introduction résumant en une vingtaine de pages les grands
traits de celui qui atteint non seulement la magistrature suprême au sommet
de l’État, mais eu également l’intuition d’en dépasser les limites. La
politique de la ratio anime en effet l’action de Caius Iulius Caesar, né le
12 juillet 100 av. J.-C. d’une famille d’ancienne noblesse. Curieusement,
son action sera largement critiquée par des auteurs latins tels Tite-Live,
Plutarque, Suétone ou encore Dion Cassius. La personnalité et l’ampleur de
l’action de ce personnage hors-norme ne pouvaient, en effet, que susciter
l’inquiétude de ses contemporains à l’encontre de celui qui bouleversera non
seulement les frontières de l’Empire romain, mais également ses structures
politiques et culturelles. Contrairement à l’image laissée par ses
détracteurs, César eut aussi à cœur d’ouvrir la connaissance au plus grand
nombre et non plus à une seule élite, faisant de Rome un grand centre
intellectuel, nous sommes loin de l’image moderne – et trompeuse – d’un
dictateur.
Ce vaste ensemble réunit, enfin, les Commentaires, extraits des discours,
traités et correspondance conservés par les Anciens. Le lecteur pourra bien
sûr goûter aux charmes intrinsèques de la « Guerre des Gaules » dépassant en
ampleur les plus grandes fresques du cinéma hollywoodien, mais surtout y
découvrira la dimension littéraire de celui qui ne fut pas qu’un stratège
politique et militaire, en un parallèle saisissant avec le général de
Gaulle.
La traduction d’Alessandro Garcea met en évidence ce style césarien qui
transcende les formules historiques pour atteindre un genre révélant une
éthique et une rigueur à la source d’une éloquence stylistique remarquable,
ainsi qu’en témoigne cette belle édition.
Philippe-Emmanuel Krautter |
| |
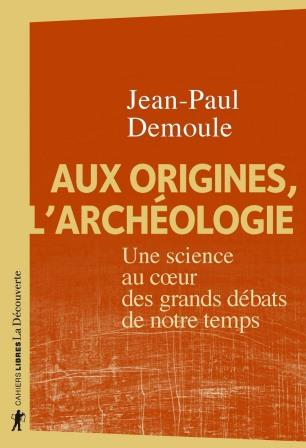 |
"Aux
origines, l’archéologie - Une science au cœur des grands débats de notre
temps" de Jean-Paul DEMOULE, La Découverte, 2020.
Jean-Paul Demoule offre avec ce dernier essai une porte d’entrée idéale et
accessible au monde à la fois circonscris mais aussi ouvert de
l’archéologie. Circonscris, car l’archéologie est de nos jours une science
aux frontières bien précises et aux méthodologies rigoureuses et éprouvées,
loin des approximations des siècles précédents. Ouvert également par son
champ d’investigation considérablement vaste, étendu à l’exploration et
compréhension de notre passé et des sociétés qui l’ont caractérisé.
Archéologue réputé, ancien président de l’INRAP et professeur à la Sorbonne,
Jean-Paul Demoule milite depuis longtemps pour que sa discipline soit
comprise par le plus grand nombre grâce à des publications et interventions
toujours saluées pour leur pédagogie et leur engagement. C’est cette même
implication qui se trouve au cœur de cet essai passionnant qui intéressera
non seulement les puristes de la discipline, mais aussi par son propos
élargit un vaste public cultivé qui appréciera cette mise en relation avec
les nombreuses problématiques sociétales, y compris idéologiques. Le
sous-titre de ce livre s’avère d’ailleurs des plus évocateurs : « une
science au cœur des grands débats de notre temps ».
Dès l’introduction, Jean-Paul souligne cette double fonction de
l’archéologie : scientifique et idéologique. Alors que la théologie n’est
plus guère présente que dans les Séminaires et Instituts spécialisés,
l’archéologie a été convoquée – souvent même manipulée – à des fins
idéologiques et rhétoriques pour mieux justifier tel passé ou telle «
identité nationale »… L’auteur, dans un premier temps, s’attache à cette
absence de neutralité axiologique manifeste à certains stades de
l’archéologie lorsqu’il s’est agi de « manipuler » l’histoire notamment en
France avec l’identité nationale, les fameux Gaulois et autres invasions
barbares intéressant certains présidents de la République et responsables
politiques. À l’image de certaines sciences dures telles la génétique et la
médecine qui en d’autres situations plus tragiques ont pu être « manipulées
» par des régimes iniques afin de justifier l’idée de race et d’inégalité
entre elles, l’archéologie peut également servir des desseins moins nobles
que la seule connaissance, ainsi qu’il ressort des nombreux exemples
détaillés rapportés par l’auteur.
Jean-Paul Demoule élargit son propos également au-delà de nos frontières
nationales, en soulignant combien sa discipline peut se trouver déviée de sa
mission première par des idéologies ultralibérales mettant souvent en péril
non seulement une archéologie préventive manquant la plupart de moyens
financiers, mais menaçant également la préservation d’un patrimoine
fragilisé par des enjeux qui la dépassent tel qu’il ressort de cet essai vif
et engagé.
Mais, il n’est pas trop tard pour être optimiste, conclut cependant
Jean-Paul Demoule. Et tel est bien le grand mérite de cet ouvrage,
soulignant et alertant pour mieux prévenir et enrayer les mauvais usages
faits de l’archéologie. |
|
Art, Culture, Essais... |
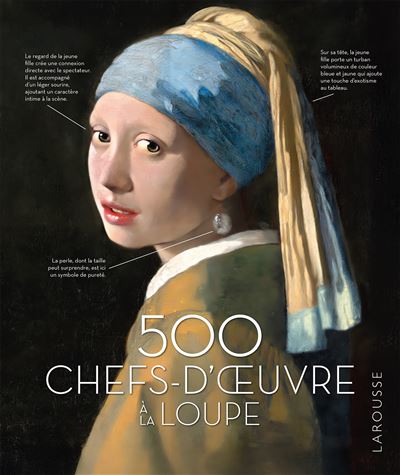 |
"500
chefs-d'œuvre à la loupe" ; Collectif, , 480 p., Larousse Editions, 2025.
Qui dans un musée ou lors d’une exposition n’a pas déjà éprouvé le sentiment
d’être passé trop vite devant des chefs d’œuvre, et dont les multiples
lectures lui aurait ainsi échappé ? C’est à cette attention à laquelle nous
convie l’ouvrage « 500 chefs-d’œuvre à la loupe » paru aux éditions Larousse
; une somme de 480 pages réunissant de nombreux spécialistes afin de prendre
le temps d’observer dans le détail ces œuvres qui ont pour la plupart
d’entre elles exigé de nombreuses heures de réflexion et de réalisation.
Le propos de l’ouvrage est clair et didactique, l’objectif visé étant de
faciliter l’abord d’une peinture ou d’une sculpture afin d’en saisir les
multiples facettes. Les secrets de composition, les motifs, la symbolique et
les infimes détails sont traités pour plus de 500 chefs-d’œuvre majeurs de
l’histoire de l’art en un format généreux et à l’iconographie abondante.
Allant de la Préhistoire (Venus de Willendorf) jusqu’à l’époque
contemporaine avec Frank Bowling (2017), l’ouvrage retient pour chaque œuvre
une mise en page soignée permettant d’orienter au mieux le regard du lecteur
vers ce qui importe le plus et qui pourrait avoir échappé à sa vigilance.
Cette éducation du regard, qui n’écarte pas bien entendu une part de
subjectivité, aura pour finalité de familiariser le non spécialiste au
langage de l’art et à la compréhension visuelle d’une œuvre dans son
contexte de création mais aussi quant à sa réception.
Afin de mieux affiner son regard et chercher à décrypter les différentes
lectures d’un tableau, cet ouvrage agréable à consulter ne pourra que
suggérer une belle invitation. |
| |
 |
«
Jacques-Louis David » d’Arlette Sérullaz – Éditions Larousse, 2025.
Nous célébrons en cette année 2025 le bicentenaire de la mort du célèbre
peintre Jacques-Louis David. A l’occasion de cette célébration, le musée du
Louvre consacre à cette figure majeure du néoclassicisme une exposition
couvrant l’ensemble de sa riche carrière, ainsi que son engagement
politique.
Jacques-Louis David (1748-1825) connut les bouleversements de son temps en
traversant les épisodes tourmentés de La Révolution française jusqu’à la
consécration du sacre de Napoléon. Arlette Sérullaz, spécialiste de
Delacroix et de David, signe avec cet ouvrage, à la fois accessible et
complet, une synthèse passionnante démêlant les multiples facettes de cette
figure majeure de l’histoire de l’art au XIXe s.
Associant étroitement art et politique, David s’inscrivit en un style
néoclassique mettant en scène les grands de son temps durant la Révolution
mais aussi l’Empire. Convoquant sur ses toiles l’antique – le fameux «
Serment des Horaces », mais aussi ses contemporains, « La Mort de Marat », «
Bonaparte franchissant le Grand-Saint-Bernard », sans oublier le légendaire
« Sacre de Napoléon », David sut mettre son pinceau au service de
l’Histoire, passant de la ferveur républicaine à la mise en scène du pouvoir
impérial, ainsi que le rappelle Arlette Sérullaz dans ces pages richement
illustrées. Grâce à ce portrait qui nous révèle bien des facettes de cette
personnalité plus complexe qu’il n’y parait, cet ouvrage accompagnera
idéalement les célébrations du bicentenaire en un format complet concis. |
| |
 |
"John
Singer Sargent" de Sandrine Andrews, Editions Larousse, 2025.
En écho à l’exposition qui se tient au musée d’Orsay jusqu’au 11 janvier
2026, les éditions Larousse, sous la plume de l’historienne de l’art
Sandrine Andrews, publient une synthèse éclairante sur la vie et l’œuvre du
peintre américain John Singer Sargent (1856-1925). Le célèbre portraitiste
dont l’œuvre fut célébrée très tôt dans son pays natal et au Royaume-Uni,
demeure quelque peu - à tort- plus méconnu en France. Cet ouvrage nous
propose ainsi de nous familiariser avec celui qui, aux côtés de Whistler,
fit ses premières armes à Paris, ainsi qu’en témoignent notamment des
portraits passés désormais à la postérité, tels ceux de Madame X ou encore
le Jardin du Luxembourg… L’ouvrage de Sandrine Andrews parvient en un style
accessible allant à l’essentiel à dresser un panorama complet de l’artiste
ayant saisi sur ses toiles les portraits mondains de la Belle Epoque. Les
peintures et aquarelles de Sargent dégagent une maîtrise à la fois technique
et artistique révélant sa grande sensibilité, ainsi qu’il ressort du vibrant
portrait de Mme Carl Meyer et de ses enfants ou, plus énigmatique, de ces
Bédouins au regard insaisissable… Replaçant la vie de l’artiste dans le
contexte de son temps, cet ouvrage nous permet de mieux appréhender la
virtuosité picturale de Sargent – son fameux « trait-au-pinceau », alliée à
une curiosité insatiable. Une analyse éclairante enrichie d’une abondante
iconographie qui accompagnera idéalement la découverte de l’exposition. |
| |
 |
« À
pied du Léman à la Méditerranée - Récit d'une marche à travers les Alpes » ;
Texte d'Antoine De Baecque ; photographies de Matthieu Gétaz, 288 pp,
Editions Slatkine, 2025.
C’est à une belle et longue promenade, du Léman à la Méditerranée, à
laquelle nous convient les photographies de Matthieu Gétaz aux éditions
Slatkine. Antoine de Baecque, historien et critique de cinéma, signe les
textes accompagnant ce beau livre broché suisse. Il s’agit d’une évasion des
plus inspirantes tant le texte rencontre l’image pour, non seulement,
convoquer l’idée même de voyage, mais également la transcender en une quête
multiséculaire. Cheminer sur plus de 650 km du Léman à la Méditerranée fait
en effet appel plus qu’à une épreuve physique à une méditation proche du
pèlerinage ou des usages sociaux de naguère. Ainsi, lorsque le passé croise
le présent, les récits personnels s’entrecroisent inexorablement avec cette
mémoire léguée par les siècles où les marchands tout autant que les
pèlerins, sans oublier les bergers, militaires et autres contrebandiers
empruntaient cette voie de nos jours prosaïquement « balisée » GR5…
Le récit photographique de Matthieu Gétaz du nord au sud traversant le
Beaufortin, la Tarentaise, la Maurienne, le Queyras, la Vésubie avant de
parvenir au pays niçois équivaut à une quête initiatique dont ces moraines
gardent parfois le souvenir afin de le partager aux générations à venir.
Cimes vertigineuses, pentes abruptes et lacs de montagnes embrumés laissent
une petite idée des difficultés et des joies d’une telle entreprise,
parfaitement rendues par les témoignages de l’écrivain suisse Corinna Bille,
épouse de Maurice Chappaz, ainsi qu’à partir des propres évocations
d’Antoine de Baecque.
Tous les amoureux de ces régions montagneuses retrouveront cette ambiance
unique rythmée par la minéralité et le végétal, tour à tour, témoin discret
ou omniprésent, selon les altitudes. A l’image du long fil de la vie, cette
pérégrination s’entend la plupart du temps dans la solitude ou tout au moins
dans un silence recueilli face à la majesté des éléments, ce qu’évoque
parfaitement le photographe et graphiste né à Vevey, véritable ambassadeur
de ces paysages.
Au fil des pages, la lumière se métamorphose à l’image de la nature. Le
cristallin se voile quelque peu afin d’introduire à d’autres horizons. La
Méditerranée n’est plus très loin et le Haut Pays niçois est là pour nous
rappeler qu’au terme de toute odyssée, le voyage n’est jamais totalement
fini… |
| |
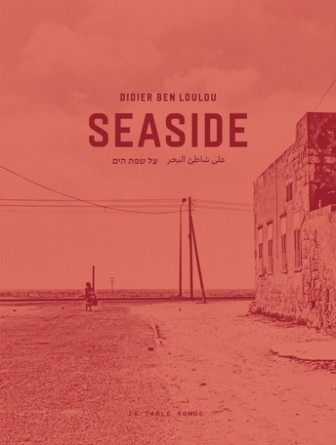 |
Didier
Ben Loulou : "Seaside", Editions La Table Ronde éditions, 2025.
« Seaside », tel est le titre attractif retenu pour le dernier recueil
du photographe Didier Ben Loulou que nos lecteurs connaissent bien. Mais ce
bord de mer ne renvoie pas – on s’en doute, à quelques notions convenues
pour ce photographe, mais bien à un cheminement introspectif prolongé par la
réflexion argentique qui parvient à graver sa vision poétique de la nature
et des êtres. Le procédé Fresson, dont il a su sublimer toutes les nuances,
renforce cette profondeur des tirages les plus inspirés – et inspirants. Le
photographe franco-israélien parcourt depuis des décennies les abords de la
Méditerranée dont il a recueilli ici et là les perles les plus précieuses,
bien loin des sentiers battus.
Alors que ces rivages aux confins de la Méditerranée retiennent tristement
aujourd’hui l’actualité, Didier Ben Loulou, sans pour autant nier leur dure
réalité, transcende ces souffrances pour épouser le souffle millénaire de
ces lieux chargés de passions, de haines, mais aussi de beauté et d’amour.
Le moindre fil à linge négligemment revêtu de serviette pourpre renvoie
ainsi à la symbolique d’un coquillage si essentiel aux temps antiques et
aujourd’hui délaissé…
Car là réside la force des photographies de Didier Ben Loulou : ses choix
transmettent, consciemment ou inconsciemment, une mémoire héritée d’un passé
immémorial dont son objectif – et sa sensibilité – sont les ambassadeurs.
Ciels menaçants sur une mer houleuse, rivages blessés par les derniers
hoquets de la modernité, et toujours cette lumière d’espoir qui surgit par
le truchement de ce rouge carmin qu’un Masaccio n’aurait pas renié. Un
recueil d’une rare profondeur, respiration inspirante parmi le chaos.
Philippe-Emmanuel Krautter |
| |

 |
«
Suivre les nuages le pinceau à la main -Correspondances 1861-1898 » Édition
établie et présentée par Laurent Manœuvre, 16 x 20 cm, 752 pp., Editions
L’Atelier contemporain, 2025.
L’invitation inspirante du titre de ces Correspondances signées du peintre
Eugène Boudin, « Suivre les nuages le pinceau à la main » attirera, à n’en
pas douter, plus d’un lecteur épris de l’art de celui que l’on surnomma le «
roi des ciels » avant qu’il ne devienne le maître incontesté des marines.
Laurent Manœuvre a rassemblé pour ce fort volume de 752 pages un nombre
impressionnant de lettres adressées principalement par le peintre à son ami
Ferdinand Martin qui prit une part importante dans la vie artistique de son
époque, mais aussi des lettres adressées à Jongkind, Monet, Pissarro,
Courbet… Si Eugène Boudin se reconnait quelque peu paresseux quant à l’art
épistolaire, il demeure cependant que ses missives vont droit à l’essentiel,
à l’image de ses études sur le motif comme le souligne Laurent Manœuvre dans
son introduction au volume.
La longue proximité entre Boudin et Ferdinand Martin sera le gage d’échanges
révélant la personnalité de Boudin, notamment à l’occasion d’évènements
tragiques comme la perte de Marie-Anne, son épouse au printemps 1889. Ces
lettres d’une rare intensité trahissent le désespoir total de l’artiste qui
se confie à son ami : « A présent me voilà vieux, seul et à moitié foutu. Je
ne m’intéresse plus qu’à quelques amitiés sûres comme la tienne » (Paris, 18
mars 1889). Fort heureusement, des lettres plus optimistes parviennent
également à cet ami de toujours, notamment lorsque le peintre (16 juin 1882)
confie encore : « Courir après les bateaux… suivre les nuages le pinceau à
la main. Humer le bon air salin des plages et voir la mer monter… ». C’est
un pan de vie du peintre qui se dévoile littéralement au fil des pages de
cette correspondance nourrie et dont il faut souligner la remarquable
édition abondamment illustrée.
A compléter par la lecture de l’ouvrage du même auteur : Laurent Manœuvre
« Quand les Impressionnistes s’exposaient » 18 x 24 cm, 272 pages, 225 illus
coul., Editions L’Atelier contemporain, 2025. |
| |
 |
Pierre-Jean Amar : « Photos Buissonnières 1972-2024 », Editions Arnaud
Bizalion, 2024.
C’est un titre inspiré qui a été retenu pour ce recueil de photographies de
Pierre-Jean Amar, des « Photos Buissonnières » réunissant aux éditions
Arnaud Bizalion ses images argentiques et numériques de 1972 à 2024. Ce
demi-siècle de regard(s) sur la nature ne tend pas à une quelconque apologie
de la beauté naturelle, mais cherche plus à témoigner de ce singulier
dialogue entretenu avec ces témoins « silencieux ». Nourri de l’œuvre de
photographes tels Edward Weston ou Wynn Bullock, Pierre-Jean Amar est
parvenu à proposer son propre style après une longue collaboration avec le
photographe Willy Ronis dont il a contribué à faire reconnaître l’œuvre.
Au-delà de cette esthétisation manifeste de la nature, Pierre-Jean Amar
s’inscrit dans cette relation intime qui réunit le regardant et l’objet
regardé par le truchement de ce « témoin mutique » qu’est la photographie.
En approfondissant cette exploration au long cours, nous réaliserons,
cependant, combien ce mutisme n’est que d’apparence, le travail du
photographe visant bien plus à révéler ces intimes rapports qu’à asséner des
vérités objectives. Aller au cœur des choses, tout en s’effaçant devant leur
ineffable présence, telle semble être la quête du photographe Pierre-Jean
Amar. L’œuvre photographique ici réunie laisse apparaître, ici ou là, une
sensualité certaine, une fragilité sublimée par le noir et blanc, une
vivacité s’échappant du champ de l’objectif. Ce foisonnement végétal n’est
pas sans suggérer quelques messages silencieux, à nous de les découvrir
grâce au remarquable travail présenté par cet ouvrage inspirant. |
| |
 |
« Oser le nu
» de Camille Morineau, 240 p., Editions Flammarion, 2025.
Dans la lignée de l’exposition « Artemisia Gentileschi »,
Camille Morineau propose une féconde étude sur « Le nu représenté par les
artistes femmes » dans l’histoire de l’art. Retenant une approche
chronologique, l’auteur, conservatrice du patrimoine et commissaire
d’exposition (notamment de l’exposition en 2009 « elles@centrepompidou »),
traverse ainsi les siècles en compagnie de femmes peintres, sculptrices ou
photographes qui par leur audace ont osé représenter le corps nu, que cela
soit celui des femmes ou celui des hommes.
Partant du Moyen-âge et de la Renaissance avec la représentation de corps –
notamment celui dénudé du Christ, par des artistes femmes, l’auteur s’arrête
également sur l’Italie du XVIe et XVIIe siècle, période durant laquelle -
telle Artemisia, et ainsi que le souligne le sous-titre du chapitre, les «
Femmes savantes et filles d’artistes [ont osé] s’emparer du corps nu », dont
leur propre corps de femme, leur propre nudité ou intimité. Par cette étude,
c’est toute la question de l’appropriation des corps et de la nudité qui se
trouve ainsi judicieusement posée.
Pour y répondre, l’auteur a retenu une chronologie longue. Ce sont, en
effet, pas moins de quatre siècles de nus représentés et osés par des
artistes femmes qui nous sont ainsi donnés à voir ; des nus peints, sculptés
ou photographiés dont trop souvent l’histoire a omis la signature… Car,
au-delà des grandes et célèbres signatures connues et reconnues, on songe
bien sûr, à Suzanne Valadon, à Louise Bourgeois, à Niki de Saint Phalle ou
encore à Alice Neel, que d’artistes femmes ayant osé le nu ont été oubliées,
effacées… Or, et ainsi que le souligne en son introduction Camille Morineau,
cet ouvrage « a pour ambition de renouer les fils, de retrouver les traces
», et c’est chose faite ! |
| |
 |
«
Turner - Le sublime héritage, en dialogue avec des artistes contemporains »
d’Elizabeth Brooke et David Blayney Brown, Editions Hazan, 2024.
L’influence de Joseph Mallord William Turner dans l’histoire de la peinture
est indéniable, on songe ainsi aux fabuleuses études que lui a consacrées
son contemporain John Ruskin, mais connaissons-nous pour autant son héritage
aujourd’hui ? C’est tout le mérite de cet ouvrage intitulé « Turner, le
sublime héritage » que de mettre justement en perspective son extraordinaire
rapport au sublime avec celui d’artistes du XXe et XXIe siècle, de mettre ce
grand peintre anglais du XIXe siècle « en dialogue avec des artistes
contemporains », ainsi que le précise également son titre.
Accompagnant initialement l’exposition éponyme au Grimaldi Forum de Monaco
et signé Elizabeth Brooke, conservatrice au Tate Britain, et David Blayney
Brown, également ancien conservateur au Tate et spécialiste de Turner, le
lecteur découvrira ainsi en ces pages une mise en regard des plus
fructueuses des œuvres majeures de Turner avec notamment Mark Rothko ou
encore Richard Long… Les éléments, la lumière à l’instar de Claude Monet,
bien sûr, ou plus près de nous, avec l’américain James Turrel ; « Ciel et
mer » également avec le photographe Wolfgang Tillmans, avec Roni Horn et la
nature de l’eau, mais aussi la neige, les glaciers avec Olafur Eliasson, les
montagnes avec Peter Doig, et au-delà des éléments et du paysage, toute la
grandeur et le sublime…
Véritable dialogue avec le génie de Turner, l’ouvrage livre une analyse à la
fois chronologique, partant de ses premières œuvres jusqu’à ses dernières
années, et thématique retenant notamment pour angle Venise avec pour face à
face les contemporains Howard Hodgkin et Laure Prouvost ou encore le thème
de la tempête avec Jessica Warboys, mais aussi l’installation de John
Akomfrah, sans oublier la photographie en grand format d’Edward Burtynsky...
Une étude qui révèle toute la puissance de l’héritage de Turner, non
seulement dans le paysage, la mer, le ciel…, mais plus encore dans la
représentation du « sublime » dans ce qu’il a de paradoxal, de plus
saisissant et d’éphémère. |
| |
 |
Carnet-Expo : « Figure du Fou » d’Elisabeth Antoine-König et Pierre-Yves Le
Pogam, Coll. « Découvertes Gallimard », Editions Gallimard, 2024.
Que vous l’ayez déjà parcourue ou que vous vous promettiez de la voir, le
dernier « Carnet d’Expo » dans la collection « Découvertes Gallimard »
accompagnera et complètera avantageusement la fameuse exposition « Figures
du Fou » actuellement au Louvre. Avec ses 64 pages et surtout ses
illustrations et pages qui se déplient, le lecteur y retrouvera toutes les «
Figures du fou » ayant traversé et marqué l’histoire de l’art : « Fous
d’amour », « Fous de cour », « Fêtes et carnavals »… Huit thèmes soulignant
au travers de la peinture, la sculpture ou objets d’art toute la portée
symbolique de la folie. Ordonnée chronologiquement, de la fin du Moyen-Âge
au XIXe siècle, la figure du fou apparait ainsi chapitre après chapitre
représentée dans tous ses états sous la plume et l’étude d’Elisabeth
Antoine-König et Pierre-Yves Le Pogam. Les auteurs ont retenu pour leur
analyse un angle étude large aussi bien religieux que profane permettant une
approche pluridisciplinaire et des plus dynamiques.
Un « Carnet-Expo » qui ravira assurément avec son petit format qui sait se
glisser partout, dans la moindre poche ou sac à dos. |
| |
 |
Catalogue Brancusi édité par Ariane Coulondre ; 320 pages, 343 illustrations
19 x 27 cm, Editions Scheidegger & Spiess, 2024.
En évoquant le nom du sculpteur roumain Constantin Brancusi (1876-1957),
nous avons spontanément à l’esprit cette fameuse tête de la « Muse endormie
» posée à même le sol… Mais cette œuvre iconique ne doit pas pour autant
réduire l’immense artiste que fut Brancusi dont la diversité et la
créativité de son art viennent de faire l’objet d’une exposition au Centre
Pompidou, actuellement fermé pour travaux. Le présent catalogue sous la
forme d’un original dictionnaire paru aux éditions Scheidegger & Spiess
permettra cependant de revivre cet évènement dont Ariane Coulondre était le
commissaire assistée de Valérie Loth et Julie Jones.
Étonnamment, l’artiste roumain n’avait jamais fait l’objet d’une exposition
d’une telle ampleur et ce dictionnaire vient fort heureusement combler cette
lacune. L’auteur de la fameuse Colonne sans fin, monumentale sculpture de
presque 30 m en fonte dressée vers le ciel tel un axis mundi pouvait tout
aussi bien exceller dans la réalisation d’une plus modeste tête de Danaïde
d’une trentaine de cm… L’art de Constantin Brancusi est par nature évolutif,
tant sur le plan des thèmes retenus (influences notamment de l’Afrique), que
sur celui des formes avec une prédilection pour la réduction. La poésie qui
se dégage de ses œuvres apparaîtra spontanément en découvrant chacune des
entrées de ce catalogue-dictionnaire abondamment illustré.
Débutant, comme il se doit, par la lettre A consacrée à l’Afrique si
déterminante pour l’artiste, Brancusi fut certainement celui qui parmi ses
contemporains sut plus que quiconque se saisir avec la fertilité que l’on
sait des modèles des sculptures africaines pour en livrer une
réinterprétation des plus créatives. La dernière entrée avec la lettre Z est
quant à elle réservée au critique d’art et éditeur français d’origine
grecque Christian Zervos. L’éditeur des Cahiers d’art réserva, en effet,
bien des études au sculpteur roumain même si leurs relations eurent à
souffrir du caractère bien trempé de Brancusi… |
| |
 |
Laurent
Bolard : "Les anges dans la peinture" , 26,8 x 31,8 cm, 240 p., Éditions
HAZAN, 2024.
Laurent Bolard, expert en peinture italienne, nous offre un magnifique
ouvrage explorant le monde mystérieux et délicat des anges à travers une
sélection de plus d’une centaine de chefs-d’œuvre. Le défi de capturer
l'essence de ces êtres immatériels n’était cependant pas mince, représenter
l’indicible étant tâche ardue à la fois dans la description et l’image.
S’appuyant sur le talent des plus grands maîtres italiens, allant du Moyen
Âge, au classicisme en passant par la Renaissance et le baroque, l'auteur
parvient à révéler la diversité céleste des anges et la singularité de leur
beauté, telle qu’immortalisée par les pinceaux des plus grands artistes,
notamment Fra Angelico pour son retable San Domenico, visible au couvent de
Fiesole. Avec une inspiration unique, l’artiste italien a su en effet rendre
hommage à la pureté et innocence angéliques incarnées dans des couleurs
vibrantes et des ailes déployées comme un arc-en-ciel céleste.
Ce livre richement illustré plonge le lecteur dans l’univers intime des
anges : ceux de l’Annonciation, de l’Apocalypse, témoins de la Passion et de
la Résurrection du Christ… Laurent Bolard met en ces pages en lumière les
représentations des anges telles que rendues par des maîtres italiens comme
Giotto, Botticelli, Titien ou encore Caravage. Ces figures angéliques
apparaissent dans les cieux, agenouillées en adoration ou encore sur terre,
toujours soumises à Dieu – sauf pour les anges déchus, bien sûr. Comme le
rappelle l’auteur, les anges forment ce lien subtil entre le divin et les
hommes souffrant sur terre. Page après page, le lecteur est invité à
découvrir comment ces êtres célestes viennent par leur grâce et de leurs
ailes interférer dans nos vies… |
| |
 |
Roberto
Longhi : « Le Caravage », traduit de l’italien par Gérard-Julien Salvy, 272
p., Editions du Regard, 2024.
C’est à une remarquable confrontation à laquelle est convié le lecteur de
l’ouvrage maître de Roberto Longhi (1890-1970), celle de l’art du Caravage
soumis au regard critique du grand historien de l’art italien. Cet éminent
spécialiste du peintre lombard lui a en effet consacré quasiment la plus
grande partie de son énergie et de ses études et a très largement contribué
à livrer le rayonnement de son style sur ses contemporains et successeurs.
Cette place du Caravage dans le parcours critique de Roberto Longhi débute
avec l’étude sur le « Garçon mordu par un lézard » du peintre qui initie
cette passion, ce qui n’empêcha pas parallèlement l’historien de
s’intéresser quelque temps au futurisme…
A une époque où seules les peintures toscanes et vénitiennes prédominaient,
quelle place pouvait dès lors encore occuper un artiste venu de Lombardie ?
Ce fut le génie de Longhi de démontrer justement l’intérêt révolutionnaire
du maître lombard, en tant que tel, certes, mais surtout et également pour
ses successeurs et pour l’histoire de l’art en général. Cet ouvrage
essentiel dans la bibliographie de l’historien de l’art - fort heureusement
traduit en français par Gérard-Julien Salvy aux éditions du Regard,
permettra au lecteur d’observer la manière unique de Longhi d’étudier Le
Caravage, le peintre observant, comme cela n’avait jamais été réalisé
jusqu’alors au XVIIe s., l’âme de ses contemporains et l’essence des choses.
Pier Paolo Pasolini ne s’était pas trompé alors qu’il était étudiant en
histoire de l’art à Bologne et suivait avec assiduité les cours de Longhi :
« Longhi était nu comme une épée hors du fourreau. Il parlait comme personne
ne parlait. […] Pour un jeune garçon opprimé, humilié par la culture
académique, par le conformisme de la société fasciste, c’était la
révolution. La culture que le maître révélait et symbolisait proposait une
voie nouvelle par rapport à l’entière réalité connue à ce jour ».
Cet anticonformisme de Longhi qui allait tant séduire et influencer alors le
cinéaste et poète se manifestera à de nombreuses reprises dans les études de
l’historien de l’art, notamment dans cette magistrale monographie sur
Caravage. Il est en effet le premier à souligner le style direct et
naturaliste du maître lombard, à mettre en évidence son regard poétique et à
analyser la place primordiale de la lumière dans cet ordonnancement
novateur, ce dont rendent parfaitement compte ces pages au style souvent
polémique.
Ce fort et riche volume de 272 pages abondamment illustré des œuvres du
peintre regroupe des textes déterminants consacrés tant aux artistes ayant
influencé Caravage qu’à sa propre influence sur ses successeurs qui seront
rangés dans le courant « caravagisme », qu’il s’agisse des peintres du
cercle immédiat de l’artiste à Milan ou des nombreux artistes plus lointains
ou postérieurs qui seront influencés par son originalité et modernité,
notamment en France.
Le lecteur retrouvera en fin d’ouvrage notes, catalogue complet des œuvres
du peintre, ainsi qu’une bibliographie et un index qui feront de cette
édition une référence incontournable pour toute étude sur le célèbre peintre
italien.
|
| |
 |
Jean-Pierre Luminet : « Les Nuits étoilées de Vincent van Gogh », 160 p.,
2023.
C’est un petit livre carré absolument passionnant signé Jean-Pierre Luminet
que nous proposent les éditions Seghers. Un ouvrage mené telle une enquête
et entraînant son lecteur sur les traces de Vincent van Gogh et du
firmament. Eh, oui, rien que cela ! L’auteur a, en effet, souhaité en
partant des chefs d’œuvre du peintre célébrant les étoiles tout simplement
remonter le temps et retrouver les étoiles de la célèbre « Terrasse de café
le soir » ou encore celles de la non moins célèbre « Nuit étoilée », des
toiles réalisées à Arles en 1888…
Pour ce beau défi, s’appuyant sur la correspondance de l’artiste, l’auteur
est retourné sur les lieux mêmes où le peintre avait posé son chevalet,
Arles, Saint-Rémy-de-Provence, le Rhône… juxtaposant œuvres, plans et
photographies. C’est en 1888 que van Gogh part, en effet, s’installer en
Provence. Là, il s’émerveille tant de la lumière du sud que de celle du ciel
étoilé de Provence.
Mais surtout, et là réside tout l’attrait de cet ouvrage, Jean-Pierre
Luminet n’a pas hésité à solliciter le concours de la science et des
logiciels pour retrouver les « vrais » ciels que l’artiste a pu contempler
et lui ayant inspiré ses plus grands chefs d’œuvres ; d’où le titre de ce
captivant ouvrage « Les Nuits étoilées de Vincent van Gogh » ! Il faut dire
que l’auteur a plus d’un atout pour surprendre et réjouir son lecteur :
astrophysicien, auteur de nombreux ouvrages sur le sujet, il sait de quoi il
parle… Mais c’est aussi en poète, avec cette poésie des étoiles et de
l’infini, que Jean-Pierre Luminet nous dévoile ces fameuses « Nuits étoilées
de Vincent van Gogh ». |
| |
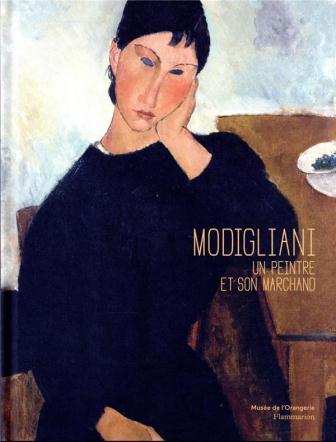 |
«
Modigliani – Un peintre et son marchand » ; Catalogue officiel de
l’exposition éponyme au musée de l’Orangerie, Co-édition Musée de
l’Orangerie/Flammarion, 2023.
Catalogue officiel de l’exposition « Modigliani – Un peintre et son marchand
» au Musée de l’Orangerie - Paris, l’ouvrage par son riche contenu réjouira
tout autant ceux n’ayant avec regret pu se rendre à cet événement que ceux
désirant en garder mémoire et souvenirs. Ainsi, outre le catalogue complet
des œuvres exposées et présentées, ici, sur de pleines pages, des portraits
essentiellement, le lecteur pourra également découvrir quatre fructueux
essais mettant en lumière tant les œuvres de cette période réalisées par
l’artiste que sa rencontre et relation avec son marchand, Paul Guillaume, en
1914. Modigliani est arrivé six ans auparavant à Paris et s’est consacré à
la sculpture après avoir rencontré Constantin Brancusi. Mais, sous
l’influence et les encouragements de P. Guillaume, Modigliani reviendra en
fin de compte à la peinture pour s’y consacrer dorénavant exclusivement…
Cécile Girardeau, conservatrice au musée de l’Orangerie, revient dans sa
contribution « Amadeo Modigliani, un peintre à Paris » sur les débuts de
Modigliani et l’influence de l’effervescence artistique parisienne de cette
époque, avant que Simonetta Fraquelli, historienne de l’art et commissaire,
souligne, pour sa part, les liens privilégiés unissant l’artiste et son
marchand. Il est vrai que nombre d‘intérêts artistiques communs liaient les
deux hommes notamment la poésie, la littérature ou encore les arts africains
auxquels Yaëlle Biro consacre son essai. C’est en 1918 et avec Guillaume
Apollinaire que Paul Guillaume lancera la revue « Les Arts à Paris » dont le
lecteur retrouvera quelques couvertures et pages, et dans laquelle jusqu’à
sa mort, il promut artistes et écrivains. Enfin, dans une passionnante
recherche Marie-Amélie Senot a recours à la science pour éclairer et
appréhender le projet artistique de Modigliani.
Illustré également de photographies d’époque, ce catalogue trouvera à
l’évidence bonne place dans toute bibliothèque. |
| |
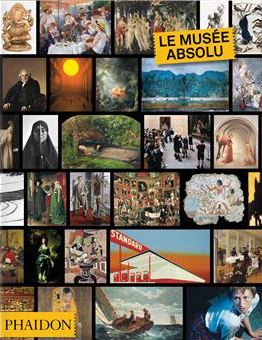 |
« Le
Musée absolu » ; Relié, 23,8 x 30,5 cm, 1 640 Ill., 584 p., Editions Phaïdon,
2023.
Ce n’est pas un musée imaginaire, mais bien plus puisque c’est un musée
absolu - « Le Musée absolu » que les éditions Phaïdon nous proposent dans
cette nouvelle édition ; un ouvrage remarquablement complet, ordonné et
idéal pour permettre à tout à chacun de choisir justement son propre musée
imaginaire ! Avec son grand format, ses plus de 500 pages et pas moins de 1
640 illustrations, l’ouvrage réalisé avec le concours de conservateurs,
d’historiens de l’art, d’artistes et critiques d’art, nous invite à visiter
la collection d’art la plus vertigineuse du monde, allant de « L’art de
l’âge de Pierre » à « L’art depuis le milieu du XXe siècle » en passant par
les arts de l’Asie, du Japon, les arts de l’Islam ou encore l’Afrique.
Divisé en sections selon les périodes ou les domaines, le lecteur pourra
parcourir bien des contrées, des espaces temps et des artistes : La Rome
antique, la Renaissance italienne ou du Nord, le baroque ou rococo, etc.,
aucun domaine ne gardera ses secrets et le lecteur aura tout à loisir de
choisir au gré des pages ses domaines de prédilection.
Avec un plan « de visite » présenté non en chapitres mais en galeries tel un
musée, chaque section ou galerie renvoie à une couleur déterminée que l’on
retrouvera sur le profil de l’ouvrage en onglet pour plus de facilité.
Chaque domaine abordé propose selon sa propre table des matières des
présentations et analyses détaillées des arts concernés ; ainsi sous
l’onglet rose, le lecteur retrouvera-t-il les arts de la Chine et de la
Corée avec des développements sur les bronzes rituels chinois antiques, les
bronzes mystérieux de Sanxingdui ou encore les Jades chinois ; au titre «
d’expositions » des focus y sont même régulièrement développés parallèlement
aux nombreuses œuvres et artistes présentés selon les domaines.
Un ouvrage soigné et didactique devenu un classique incontournable et
offrant au fil de ses pages ou des salles de ce fabuleux « Musée absolu »,
une porte d’entrée complète et idéale pour aborder l’histoire de l’art. |
| |
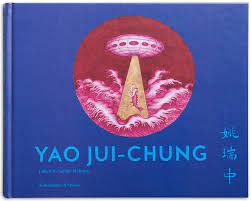
|
« Yao Jui-Chung » par Sophie McIntyre ; Version
anglais, 192 ill. couleur et 27 n&blc, 30 x 24 cm, Editions Scheidegger &
Spiess, 2023.
C’est une belle monographie consacrée à l’artiste taïwanais Yao Jui-Chung
que nous proposent les éditions Scheidegger and Speiss. Artiste aux
multiples expressions, mais aussi écrivain et conservateur, Yao Jui-Chung a
su s’imposer sur la scène internationale de l’art contemporain et de la
photographie ; pionnier dans tous les domaines, que cela soit la
photographie, la peinture ou encore les multiples installations, Yao Jui
Chung est devenu un artiste incontournable et indissociable de son pays dont
la renommée n’est plus à faire.
Dans son format allongé, l’ouvrage propose sous la direction de Sophie
Mcintyre, spécialiste de l’art taïwanais, une riche mise en perceptive sur
les trois dernières décennies de la carrière et de l’œuvre de l’artiste.
Avec plus de 200 illustrations et reproductions, le lecteur y retrouvera les
œuvres peintes réalisées par Yao Jui-Chung de 2007 à 2022, mais aussi son
œuvre photographique et visuelle pour la période 2000-2020, ainsi que nombre
de ses expositions.
Des œuvres qui retiennent immédiatement l’intérêt tant par leur singularité
que par leur engagement. Monde sociétal, politique, historique et religieux
jalonnent dans un esprit libre et critique l’ensemble de l’évolution
artistique de Yao Jui-Chung. Que ce soit dans son œuvre en noir et blanc, ou
dans celle aux couleurs luxuriantes, le regard ne cesse d’être surpris par
tant de diversité et de créativité. La dérision y est omniprésente et
s’invite dans une créativité aussi bien tournée vers le présent, le
politique et la société que vers le passé, la religion et les mythologies ou
encore un « pré-apocalyptique futur »… un regard artistique que le lecteur
retrouvera développé dans l’entretien de Yao Jui-Chung avec le critique
d’art et directeur artistique du MAXXI à Rome, Hou Hanru.
Un ouvrage qui ouvrira bien des horizons. |
| |
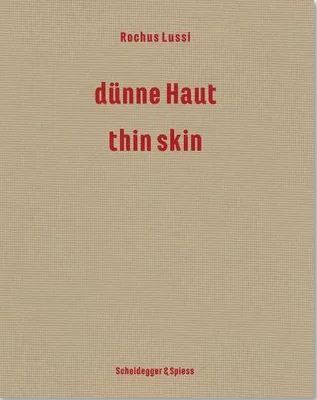 |
«
Rochus Lussi - Dûnne Haut thin skin » ; Relié, 400 p., 410 ill. couleurs et
34 en N&Blc, 21 x 26.5 cm, Version anglais/allemand, Editions Scheidegger &
Spiess, 2023.
C’est un fort et très bel ouvrage que les éditions Scheidegger et Spiess
consacrent à l’artiste suisse Rochus Lussi. Une œuvre singulière, ouverte,
tournée vers l’humain sous toutes ses formes, de la vie à la mort
pourrait-on dire. Certes, si quelques œuvres ou installations sont
consacrées au règne animal, l’angle de frappe de cet artiste, né en 1965,
réside dans la captation de l’humain, de l’existence de l'humain en tant
qu’animal grégaire ; L’humain, l’homme, la femme, l’enfant ou le nourrisson
pris dans les mailles de l’existence avec ses congénères. Avec une
sensibilité à fleur de peau propre à l’artiste, ces œuvres, sculptures,
dessins, installations extérieures ou intérieures ne sauraient laisser
indifférents. Y sont perceptibles tout autant la solitude, les faiblesses,
les désorientations, le mimétisme ou formatage, mais aussi la singularité de
ce qui fait l’humain. Personnages en série, visages vides, déshumanisés,
mais également divisés, écartelés, la mort y côtoyant la vie, la survie ou
l’absence…
Évoluant au fil du temps, Rochus Lussi questionne, interroge, scrute plus
que le spectateur ne le questionne. C’est un beau parcours ou voyage au sein
d’une œuvre de plus de trente années qui mérite amplement d’être connue que
nous propose cette belle monographie appuyée par de riches contributions et
analyses consacrée à Rochus Lussi. |
| |
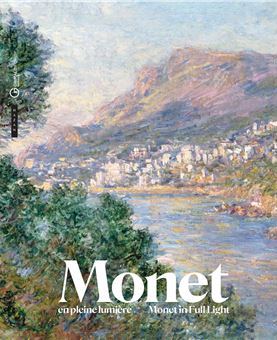 |
« Monet
en pleine lumière » ; Collectif sous la direction de Marianne Mathieu,
Éditions Hazan, 2023.
Accompagnant l’exposition du Grimaldi Forum Monaco, l’ouvrage « Monet en
pleine lumière » a souhaité célébrer le père de l’Impressionnisme sous la
lumière du fameux rocher de Monaco et de la non moins renommée Riviera lors
de son premier séjour, il y a 140 ans. Et quel plaisir jamais tari de
retrouver Claude Monet dans cette période essentielle des années 1880 de sa
longue carrière, une trajectoire infaillible retracée également en ces pages
et offrant au lecteur une belle mise en perspective… Mais, ce sont surtout
les jeux de lumière, de bleus et d’azur, ces ambiances à nulles autres
pareilles de la Riviera qui retiendront l’attention. Loin déjà de la lumière
des plages de Deauville, de Trouville ou des bords de Seine, loin encore des
effets si magiques de Giverny, ces toiles des années 1880, quelques peu
moins connues, imposent pourtant leurs charmes, beauté et caractères… Sous
la direction de Marianne Mathieu, les œuvres de Monet de cette période se
laissent, en effet, pleinement apprécier ; des œuvres, en ces pages,
appuyées par de riches contributions, des documents d’archives ou encore des
photographies d’époque. De Monaco à Antibes en passant par Bordighera,
Dolceacqua ou encore Cap Martin, c’est un voyage en compagnie de « Monet en
pleine lumière » auquel nous convie ce bel et riche ouvrage. |
| |
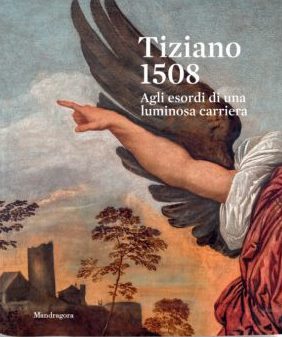 |
«
Tiziano 1508. Agli esordi di una luminosa carriera » ; Catalogue de
l’exposition Venezia, Gallerie dell’Accademia, sous la direction de Roberta
Battaglia, Sarah Ferrari et Antonio Mazzotta, (italien), Editions Mandragora,
2023.
La Gallerie dell’Accademia de Venise consacre au peintre Le Titien une
exposition majeure quant à ses œuvres de jeunesse. Le catalogue de cet
évènement publié aux éditions Mandragora permettra de se faire une idée de
l’importance de cet angle original retenu par Sarah Ferrari, Antonio
Mazzotta et Roberta Battaglia à partir de l’œuvre emblématique du peintre «
l’archange Raphaël et Tobie » datant de 1508, une peinture déterminante pour
la suite du brillant parcours de l’artiste.
Ces quelques années du début du XVIe siècle à Venise font ainsi l’objet
d’analyses approfondies dans ce catalogue en écho avec l’exposition,
renouvelant le regard porté sur le jeune Tiziano par le filtre de 17 œuvres
autographes confrontées à celles de ses contemporains tels son maître
Giorgione, mais aussi Sebastiano del Piombo, Francesco Vecellio ou encore
Albrecht Dürer.
Ainsi que le soulignent les riches contributions réunies dans ce catalogue,
l’an 1508 marque assurément le point de départ de la carrière publique de
Titien qui le conduira en quelques années seulement à devenir le peintre
officiel de la Sérénissime. L’analyse des œuvres de jeunesse, la décoration
du Fondaco dei Tedeschi, les pérégrinations du jeune Titien entre Venise,
Ferrare et Padoue sont ainsi étudiées en début d’ouvrage avant de proposer
au lecteur des analyses des œuvres majeures présentées de l’artiste, telles
la Nativité, le Triomphe du Christ, la Madonna con il Bambino ou encore
Judith avec la tête d’Holopherne. |
| |
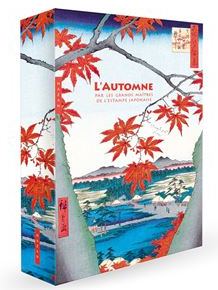
|
«
L’automne par les grands maîtres de l’estampe japonaise » réalisé par Anne
Sefriou ; Coll. « Chefs-d’œuvre de l’estampe japonaise », 17.2 x 24.6 cm,
Editions Hazan, 2023.
Les éditions Hazan célèbrent les saisons avec les grands maîtres de
l’estampe japonaise. L’ouvrage consacré à « L’Automne » offre
particulièrement un plaisir inégalé ! Avec son coffret et sa reliure en
accordéon, celui-ci livre en effet par le prisme de soixante œuvres signées
des plus grands maîtres japonais, non seulement toutes les couleurs
chatoyantes de l’automne, mais aussi toute la poésie et symbolique
extrême-orientales attachées à cette saison à nulle autre pareille. Les plus
grands maîtres de l’estampe, Hokusai, Hiroshige, mais aussi Hasui ou encore
Harunobu, signent ces estampes uniques où les couleurs et les « Rafales
d’automne », pour reprendre un titre de Sôseki, nous entraînent en une
rêverie infinie… Lorsque les érables se parent de rouge ou de jaune, lorsque
les kimonos des jeunes femmes se teintent des couleurs des chrysanthèmes et
que le vent d’octobre fait ployer les bambous… C’est toute la poésie des
songes d’automne que le lecteur retrouvera dans ces pages aux soixante
estampes… L’ouvrage est accompagné d’un livret explicatif réalisé par Anne
Sefriou, auteur de nombreux livres d’art notamment consacrés au domaine des
estampes japonaises. |
| |
 |
PAOLO
PORTOGHESI Sguardo, parole, fotografie edizioni dell’Accademia Nazionale di
San Luca, 2023.
Le catalogue officiel de l’exposition à l'Accademia Nazionale di San Luca
sous la direction de Francesco Cellini et Laura Bertolaccini permet de
découvrir et d’apprécier les liens intimes qu’entretenait Paolo Portoghesi,
grand architecte italien disparu en mai 2023, théoricien et professeur
d'architecture de l'université La Sapienza de Rome, avec la culture
architecturale internationale, et plus précisément ici son admiration pour
le grand architecte baroque Francesco Borromini dont il était l’un des
éminents spécialistes.
Dès son plus jeune âge, Portoghesi a en effet exploré par ses photographies
en noir et blanc - dont 72 sont reproduites dans l’exposition et le
catalogue - l’œuvre de Borromini en une passionnante enquête critique. C’est
dans les années 60 que Portoghesi débute cette vaste exploration en un
nombre impressionnant de clichés à travers de multiples lieux emblématiques
tels Sant'Ivo alla Sapienza, San Carlo alle Quattro Fontane, San Giovanni in
Laterano, la Casa dei Filippini, Sant'Agnese in Agone, Palazzo Falconieri,
le Collegio di Propaganda Fide ou encore l’église de Sant'Andrea delle
Fratte…
Avec des appareils Rolleiflex ou Hasselblad tenus à la main sans trépied,
Portoghesi sut saisir des angles inédits qui étonnent encore de nos jours
ainsi qu’il ressort des pages de ce catalogue avec ces contrastes lumineux
accentués par les jeux d’ombre. Dans cet ouvrage richement illustré par ces
photographies extraordinaires, le lecteur pourra également découvrir
l’écriture de Portoghesi révélant toute la richesse de son vocabulaire et la
magie opérée par le baroque de Borromini.
Une exploration dans l’univers fascinant de la pierre et de l’architecture
baroque transfigurée par un de ses plus passionnants analystes !
(Exposition organisée par Francesco Cellini et Laura Bertolaccini, avec la
collaboration de Maria Ercadi, sous le Haut Patronage du Président de la
République italienne. Toutes les photographies et reproductions du livre
Paolo Portoghesi de Francesco Borromini exposées ou publiées dans le
catalogue ont été aimablement fournies par Giovanna Massobrio Portoghesi). |
| |
 |
« All
Under One Roof - Revolutionising Basel’s Military Barracks” sous la
direction de Claudia Mion ; 22.5 x 33 cm, 224 p.; 181 illus. couleur et 50
b/w; Version Allemand / Anglais, Editions Park Books, 2023.
Les éditions Park Books livrent avec « Die Revolutionierung der Basler
Kaserne » ou « All Under One Roof - Revolutionising Basel’s Military
Barracks » une étude complète de la récente reconversion de la caserne
militaire de Bâle sur les rives du Rhin par le jeune cabinet d’architectes
bâlois Focketyn del Rio.
Appuyé par une vaste iconographie, l’ouvrage offre en effet une riche
analyse de cette réhabilitation de l’ancienne caserne de Bâle en un centre
culturel dynamique et vivant. Achevé en 2022, le kHaus propose aujourd’hui
plus de 3 000 m2 qui ont ainsi été aménagés en salle de théâtre, espaces et
salles de travail... Une reconversion décidée il y a une dizaine d’années,
en 2013 précisément, et menée sous l’élan créatif et dynamique de jeunes
architectes, ceux du Focketyn del Rio Studio à Bâle, ce jeune cabinet
d’architecture ayant en effet remporté le concours pour cette réhabilitation
en 2013, soit tout juste six mois après son ouverture !
Le lecteur pourra par cet ouvrage au format idéalement allongé découvrir
l’ensemble du process année après année de cette vaste et belle réalisation
architecturale ; Plans d’études, plans extérieurs et plans intérieurs étage
par étage, étapes de réhabilitation, photographies et interviews rythment
les différents chapitres de cette féconde étude.
Aujourd’hui, parfaitement intégrée à la ville de Bâle, cette reconversion
offre aussi une belle illustration de ce que peuvent apporter, bien au-delà
de Bâle et du Rhin, les diverses réhabilitations urbaines. À ce titre, cette
riche étude offre autant une fructueuse mise en valeur qu’une belle mise en
perspective. |
| |
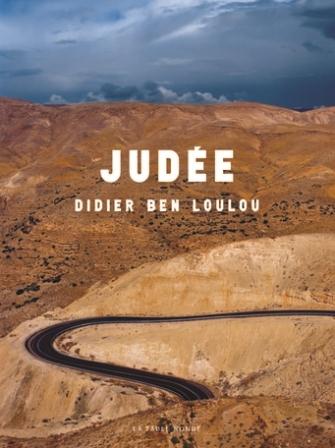 |
Didier
Ben Loulou : « Judée », Éditions La Table ronde, 2023.
A la seule évocation du mot « Judée », la mémoire se libère avec ces
paysages brulés par le soleil, ces peuples de la Bible, Ammonites, Edomites,
Samaritains, pour certains disparus, d’autres encore présents, ayant tracé
en lettres d’espérance une partie de son histoire… Ce sont ces déserts de
Judée où l’ocre se dispute au beige, terre d’ombre, terre de Sienne que le
photographe Didier Ben Loulou nous propose de parcourir avec ce dernier
album dans lequel la vie, la mémoire, les angles et ces couleurs inimitables
font la signature, aujourd’hui internationalement reconnue, du photographe.
La pierre omniprésente dans ces espaces comme dans l’œuvre artistique du
photographe constitue le sceau du secret, celui qu’il appartient patiemment
de comprendre pour mieux saisir le destin de tant de civilisations en ces
terres. Un chemin en apparence esseulé, des graminées tendant leurs tiges
vers le ciel comme des orants, des ciels chargés annonciateurs de présages,
partout une végétation calcinée des attentes des hommes… Et pourtant,
parfois, au détour d’un chemin, le photographe capte l’improbable couleur
pourpre d’une tunique antique abandonnée, non partagée… Nombreux seront en
effet les symboles laissés avec parcimonie par ces photographies inspirées
de Didier Ben Loulou, telle cette grenade à la fois synonyme de fertilité et
de charité dont les grains se dispersent aux quatre vents. Les éléments sont
omniprésents dans ces pages parfois rudes et austères tels ce feu qui dévore
les broussailles ou ce vent que l’on devine sur les ramures de ces
vénérables oliviers.
La Judée ne fait pas que marquer le paysage mais cisèle aussi les corps de
celles et ceux qui y vivent depuis l’aube des temps. Peaux craquelées de
soleil, regards songeurs en pleine lumière, pieds momifiés par la terre.
C’est une Judée habitée, vivante, que nous livre au regard le photographe,
terre habitée d’hommes et de femmes, de chèvres, de nuages, du souffle du
vent ; terre, surtout, de mémoire, cette mémoire des pierres, quête patiente
et inlassable…
La Judée de Didier Ben Loulou transporte ses lecteurs plus loin encore que
les vastes horizons car l’artiste nous propose par ses photographies un
véritable voyage intérieur, quelques fruits sur l’étal d’une marchande, et
partout cette vie qui se passe de discours… |
| |
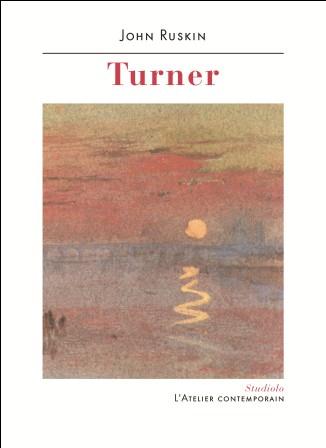 |
« John
Ruskin – Turner » ; Traduction et présentation de Philippe Blanchard, Coll.
Studiolo, Éditions de L’Atelier contemporain, 2023.
Les passionnés d’art et de littérature, les amoureux de Proust et d’Oscar
Wilde, savent combien sont d’une richesse aussi incomparable qu’intemporelle
les écrits de John Ruskin (1819-1900) notamment ses écrits sur Turner. Mais
comment retrouver ces derniers dans cette incommensurable somme que nous a
léguée l’écrivain et critique d’art anglais, auteur des célèbres « The
stones of Venice - Les Pierres de Venise » ? Aussi faut-il saluer cette
heureuse initiative des éditions de l’Atelier contemporain d’avoir regroupé
et agencé en un seul et même volume l’ensemble des écrits de Ruskin
consacrés exclusivement à Joseph Mallord William Turner, l’un des plus
grands artistes anglais du XIXe siècle avec John Constable.
Rappelons que Ruskin voua toute sa vie une passion sans faille pour le
célèbre artiste anglais qu’il découvrit à l’âge de treize ans lorsqu’on lui
offrit pour son anniversaire un livre de poèmes de Rogers principalement
illustré par Turner. Une passion précoce qui fit de lui un collectionneur
insatiable ; « Mes folies turnériennes » écrira Ruskin lui-même cinquante
ans plus tard dans « Praeterita » ! Et comment ne pas le comprendre face à
ces œuvres - dont une trentaine de reproductions jalonne ce « Studiolo » -
reconnaissables entre toutes, mais si fugaces ou évanescentes qu’elles en
demeurent pour le commun des mortels, au-delà de l’émotion visuelle,
indescriptibles…
Dans cet ouvrage intitulé simplement « John Ruskin / Turner », le lecteur
retrouvera avec ce plaisir toujours renouvelé, bien sûr, de larges passages
issus des « Modern Painters – Les peintres modernes », cette somme majeure
et unique que Ruskin entreprit initialement pour défendre l’artiste et qu’il
n’aura de cesse de compléter, de parachever sa vie durant, mais le lecteur
découvrira aussi des textes moins connus, extraits d’essais ou de catalogues
également consacrés au peintre. À noter que chaque chapitre, texte ou
extrait est introduit, présenté et replacé dans son contexte par Philippe
Blanchard préfacier et traducteur des écrits de Ruskin pour cette édition.
Agencés, selon un ordre choisi, judicieux, le lecteur percevra ainsi au
travers des thèmes de prédilection de Ruskin, la vérité, la nature,
l’imitation, le paysage, la mer et les bateaux…, cette spécificité,
subtilité et sensibilité qui ont fait le génie du célèbre peintre,
aquarelliste, dessinateur et graveur anglais, J.M.W. Turner.
Ruskin, lui-même très bon dessinateur, partagea bien des points communs avec
Turner : outre leur goût pour les voyages, tous deux présentaient surtout
une curiosité insatiable doublée d’une acuité des plus aiguisées. Aussi
n’est-il pas étonnant que le critique d’art ait si bien compris la
sensibilité du célèbre peintre et qu’il demeure encore aujourd’hui
incontestablement, ainsi que le souligne dans sa riche préface Philippe
Blanchard, « la voie royale pour accéder à la peinture de Turner ».
L.B.K. |
| |
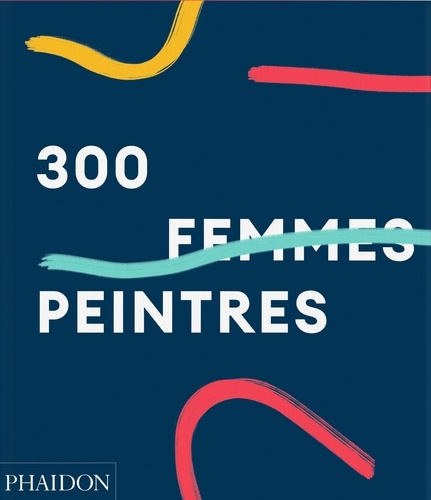 |
« 300
Femmes peintres – Cinq siècles de femmes peintres » ; Collectif ; Préface de
Rebecca Morrill, Simon Hunegs et Maia Murphy ; Editions Phaidon, 2022.
Les éditions Phaidon ont eu l’heureuse idée de regrouper en un seul et même
volume pas moins de trois cents artistes peintres femmes ayant, chacune à
leur manière, marqué l’histoire de l’art !
Couvrant cinq siècles et traversant plus de soixante pays à travers le
monde, cet ouvrage demeure une somme unique. Alison M. Gingeras, écrivain,
commissaire d’exposition et conservatrice que l’on ne présente plus, se
réfère dans son introduction, bien sûr, pour appréhender le rôle et la place
des femmes - que cela soit en littérature et surtout en art - à l’une des
premières femmes de lettres Christine de Pizan au Moyen-âge ou encore plus
proche de nous, au XXe siècle, à l’historienne de l’art Linda Nochlin,
auteur notamment, en 1971, du fameux ouvrage « Pourquoi n’y a-t-il pas eu de
grands artistes femmes ? ».
Issue ou représentant des mouvements ou courants très divers, chaque artiste
peintre est présentée en ces pages par un texte clair et concis et une œuvre
majeure. On songe ainsi à Mary Cassatt, à Marie Laurencin, à Judith Leyster
ou encore Frida Kahlo… Mais, le lecteur découvrira aussi aux côtés de ces
femmes peintres célèbres, des artistes reconnues plus tardivement, voire peu
connues ou injustement méconnues. Des femmes peintres d’hier qui nous disent
par leurs œuvres et vie leur siècle, mais aussi des artistes contemporaines,
d’ici ou de l’autre côté du globe, pour certaines à valeur montante et qui
nous entrainent à regarder vers demain et l’avenir…
Pour plus de facilité, l’ouvrage a retenu un ordre alphabétique complété
d’un glossaire par styles, mouvements et termes techniques. Le lecteur sera
étonné en découvrant au fil des pages la diversité et créativité ayant animé
ces femmes peintres d’hier et d’aujourd’hui, chacune ayant participé et
contribué de par son origine, son époque et style à écrire l’extraordinaire
histoire de la peinture. |
| |
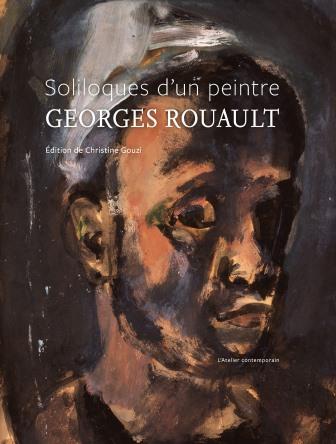 |
«
Soliloques d’un peintre » ; Édition établie et présentée par Christine Gouzi
; 16 x 20 cm, 1104 p., L’Atelier contemporain Éditions, 2022.
Véritable somme réunie par Christine Gouzi sur le peintre Georges Rouault
(1871-1958), « Soliloques d’un peintre » prendra une place de choix dans la
bibliographie consacrée à celui qui fut le contemporain de Matisse, Derain,
Camoin et Manguin, ces « fauves » du Salon d’Automne de 1905. Ce mouvement
nommé fauvisme marquera en effet les esprits en ce début du XXe siècle en
donnant la primauté à la couleur sur le dessin. Artiste complet, peintre,
dessinateur, céramiste, graveur, illustrateur, Rouault sut également tenir
une plume et a laissé une production littéraire souvent méconnue que cet
ouvrage réunit de manière exhaustive avec ces 1104 pages.
Celui qui avait un faible pour les laissés pour compte, les gens du cirque,
sans oublier l’univers sacré, a en effet livré de nombreux témoignages sur
ses contemporains ; Gustave Moreau, bien entendu qui fut son maître à
l’École des Beaux-Arts, mais également Léon Bloy, Suarès, Huysmans.
Théoricien de l’art mais aussi poète, cet artiste fut décidément doué en de
multiples disciplines où la sagacité de son regard savait dépasser les lieux
communs.
Christine Gouzi, avec la collaboration d’Anne-Marie Agulhon, a accompli pour
cette parution inédite un travail de titan en réunissant l’ensemble de ces
articles pour la plupart d’entre eux dispersés et couvrant une période
allant de 1896 à 1958. C’est une véritable « rage d’écrire » qu’évoque
Christine Gouzi en introduction rappelant que Georges Rouault tenait
l’écriture pour une nécessité presque aussi grande que la peinture, ce qui
laisse une petite idée de la place occupée par cette nécessité vitale.
Écrivant la plupart du temps la nuit alors qu’il était insomniaque, le
peintre cherchait ainsi à apaiser ses craintes et doutes grâce à cette
écriture cathartique. Laissant ses témoignages sur des papiers épars et de
diverses natures, la production littéraire de Rouault n’a pas facilité le
présent travail d’édition remarquablement réalisé. Replacés dans leur
contexte, ces écrits, dont de nombreux inédits, témoignent de l’engagement
protéiforme de cet homme épris d’absolu dont la poésie fut loin d’être la
portion congrue.
Ces « Soliloques d’une peintre » devraient passionner toute personne éprise
non seulement d’art, mais également de découvertes, telles celles qui
animèrent toute sa vie cet esprit curieux et engagé que fut Georges Rouault. |
| |
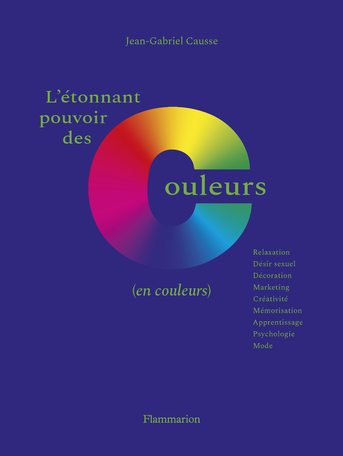 |
Jean-Gabriel Causse : « L’étonnant pouvoir des couleurs », Flammarion, 2022.
L’influence des couleurs sur nos humeurs est aujourd’hui bien connue, mais
en connaissons-nous pour autant tous les tenants et aboutissants ? C’est
pour répondre à nos multiples interrogations en ce mystérieux domaine que
Jean-Gabriel Causse nous livre analyses et découvertes les plus récentes
dans ce passionnant ouvrage « L’étonnant pouvoir des couleurs » aux éditions
Flammarion. L’auteur, designer, conseiller et membre du Comité Français de
la Couleur, a fait choix de proposer une riche approche thématique allant de
la relaxation à la mémorisation en passant par le marketing ou encore
l’apprentissage... De captivants thèmes savamment développés souvent avec
humour et confirmant « L’étonnant pouvoir des couleurs » sur nos
comportements et perceptions. Couleurs et pharmacologie, couleurs et odorat,
couleurs et vente en ligne sans oublier un chapitre entier consacré au choix
des couleurs même. Alors violet, bleu ou orange ? Harmonie, énergie, calme
ou liberté ? Eh ! Oui, « voir la vie en rose est une réalité
scientifiquement prouvée » et « on travaille mieux dans la couleur »
souligne Jean-Gabriel Causse.
Préalablement à ces thèmes, l’auteur nous invite à découvrir les couleurs,
leur perception, leur nombre et température, sans oublier ces étranges
illusions d’optique. Et même si les couleurs n’existent pas en tant que
telles, mais par notre regard, que ce soit de A à Z ou en zapping, ce livre
regorge d’informations et réflexions étonnantes, ludiques et instructives.
Êtes-vous sûr que le rouge soit une couleur chaude ? Et sommes-nous
réellement plus forts habillés en rouge ? Et le vert n’est-il pas
étonnamment la couleur la plus légère ?
Plus de 200 pages, un sommaire riche de plus 40 thèmes pour un captivant
ouvrage assurément haut en couleur… De quoi répondre à plus d’une
interrogation et bien plus encore ! |
| |
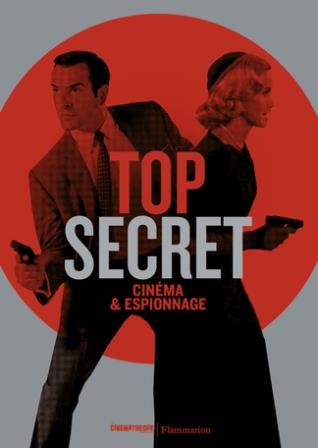 |
« Top
secret – cinéma & Espionnage » sous la direction de Matthieu Orléan et
Alexandra Midal, 288 p., 176 x 242 mm, Broché, La Cinémathèque française /
Flammarion, 2022.
Passionné et passionnées d’espionnage et du 7e art, cet ouvrage est pour
vous ! Innombrables sont, en effet, les films traitant de ce thème porteur
qui ont su réunir non seulement un nombre d’acteurs ahurissant depuis le
cinéma muet et noir et blanc jusqu’à nos jours mais également, de l’autre
côté de la toile, un nombre non moins croissant d’amateurs du genre… Fort de
ce constat, cette publication qui constitue le catalogue de l’exposition se
tenant actuellement à la Cinémathèque française jusqu’en mai 2023
transportera le lecteur dans les coulisses de ces films où agents secrets,
agents doubles et parfois même triples redoublent de sagacité pour tromper
l’ennemi et parvenir à recueillir les informations convoitées par les
puissances pour lesquelles ils travaillent en service commandé.
La palette du genre apparaîtra impressionnante en lisant ce catalogue plus
que complet et réunissant des textes passionnants signés notamment de
Pauline Blistène, de Luc Boltanski, Bernard Eisenschitz et bien d’autres
encore. « Top Secret » explore ainsi cet univers bien particulier qui
possède ses propres codes, parfois totalement fantaisistes au gré des
scénaristes, d’autres fois calqués sur la réalité. Impressionnante est la
liste des réalisateurs prestigieux qui se sont laissés convaincre par ce
genre, parfois considéré à tort comme mineur, Fritz Lang, Alfred Hitchcock,
Kathryn Bigelow, Brian De Palma, John Huston ou Laura Poitras feront la
preuve grâce à leur art du contraire à travers des films de légende.
À souligner enfin que ce catalogue à l’iconographie remarquable a retenu
fort à propos la forme d’un abécédaire avec des interviews inédites de
cinéastes et d’acteurs, des textes témoignant de la diversité de ces films
selon la situation géopolitique qui les a vus naître. Véritable bible du
film d’espionnage, « Top Secret » figurera assurément en bonne place dans
toute bibliothèque de cinéphile ! |
| |

|
« Dear
to Me - Peter Zumthor in Conversation” ; Edited by Peter Zumthor, 18
booklets in slipcase, 444 pages, 9 color illustrations, 12.5 x 21 cm,
Editions Scheidegger & Spiess, 2021.
Une importante exposition réalisée en 2017 intitulée « Dear to me » et
organisée par le célèbre architecte suisse Peter Zumthor a donné lieu à
l’édition de cet exceptionnel ouvrage publié par les éditions Scheidegger &
Spiess. Exceptionnel quant à la qualité tout d’abord des personnes qui y ont
concouru puisque Peter Zumthor a su s’entourer de personnalités aussi
diverses qu’avec Anita Albus, Aleida Assmann, Marcel Beyer, Hélène Binet,
Hannes Böhringer, Renate Breuss, Claudia Comte, Bice Curiger, Esther Kinsky,
Ralf Konersmann, Walter Lietha, Olga Neuwirth, Rebecca Saunders, Karl
Schlögel, Martin Seel, Rudolf Walli et Wim Wenders… Cette profusion
artistique a ainsi nourri cet ouvrage lui-même original quant à sa forme
avec pas moins de dix-sept livrets ou conversations réunies, ici, en un
luxueux boitier.
L’esthétique sobre et raffinée, enfin, qui préside à cette édition met
idéalement en valeur la remarquable qualité de ces conversations qui ont été
réunies convoquées, recueillies et rassemblées en ces pages par les soins de
Peter Zumthor. C’est dans le cadre alpin de l’atelier du célèbre architecte
que ces personnalités de tous horizons du monde de la culture sont venues
débattre de thèmes aussi divers que la philosophie, le cinéma, la
littérature, l’histoire, l’art, la photographie, etc. Ces dialogues révèlent
ainsi les grandes approches contemporaines des arts avec comme fil directeur
l’architecture reliant ces diverses disciplines. Les conversations libres et
passionnantes stimulent l’esprit et la créativité, ce qu’avait souhaité
avant tout le célèbre architecte pour ces rencontres dont le lecteur pourra
retrouver l’essence en ces ballades intellectuelles fascinantes servies par
une iconographie des plus inspirantes. |
| |
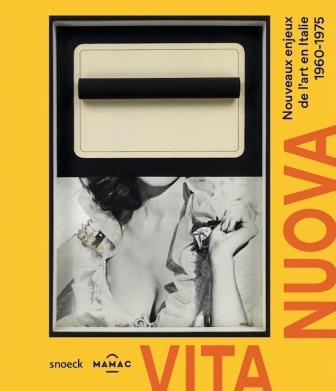 |
« Vita
Nuova - Nouveaux enjeux de l’Art en Italie 1960 – 1975 », MAMAC Snoeck
éditions, 2022.
La créativité de l’art italien de la deuxième partie du XXe siècle reste
encore à explorer en France où elle demeure quelque peu méconnue.
L’exposition qui vient de se tenir au musée d’Art moderne et d’Art
contemporain (MAMAC) de Nice est venue avec bonheur y contribuer ainsi que
le présent catalogue publié par les éditions SnoecK.
Deux décennies italiennes - du début des années 1960 jusqu’au milieu des
années 70 - ont connu en effet une rare effervescence dans les arts qu’il
s’agisse du cinéma, de la littérature, de la peinture sans oublier la
photographie et bien d’autres arts encore dont les pages de cet ouvrage
abondamment illustrées témoignent. Rome, Milan, Turin, Gênes sont autant de
pôles créatifs ayant réuni en ces années foisonnantes de nombreux artistes
qui tenteront, chacun à leur manière, de traduire les profondes mutations
vécues par la société italienne à cette époque. L’industrialisation, les
médias, la société de consommation opèrent en effet des changements radicaux
– pour certains irréversibles - dans le quotidien des Italiens, ce que
dénonça très tôt le grand intellectuel Pier Paolo Pasolini dans ses
multiples créations. Les corps, la nature font ainsi l’objet d’une relecture
d’un grand nombre de ces artistes qui proposeront de nouvelles approches
tout autant dans la photographie que la peinture, et autres multiples
installations qui tenteront d’appréhender ce modernisme envahissant.
Au-delà des instabilités politiques et sociales, ces créateurs persistent et
ouvrent les portes de la modernité tels Giosetta Fioroni, Mario Schifani,
Franco Angeli, etc. Cette vision pluridisciplinaire retenue par l’exposition
et le catalogue qui l’accompagne rend parfaitement compte de cette
complexité qui s’installe en ces années phares, complexité qui n’a pas fini
d’entrelacer ses questionnements… |
| |
 |
«
Buchner Bründler—Buildings II » de Ludovic Balland, 528 pages, 295 color and
816 b/w illustrations and plans, 23 x 27 cm, Editions Park Books, 2022.
Les noms de Daniel Buchner et Andreas Bründler ont largement émergé dans le
monde de l’architecture suisse depuis que ces deux créateurs bâlois ont eu
l’heureuse idée de créer leur studio en 1997. Emblématique de la jeune
génération suisse d’architecture, Buchner Bründler Architects a su
rapidement se distinguer par d’impressionnantes créations, des créations à
nulles autres pareilles présentées et commentées dans ce deuxième volume
entièrement consacré à la décennie 2010-2020.
Une quinzaine de projets font ainsi l’objet d’une analyse détaillée dans ces
pages aussi inspirantes qu’instructives et agrémentées de près de 1500
photographies, croquis, plans et visualisations. Qu’il s’agisse de nouvelles
constructions ou de restaurations, le style Buchner Bründler se définit et
s’impose, page après page, par ses concepts propres aux deux architectes de
spiral of Infinity ou encore d’espaces virtuels posant de manière pertinente
la question des rapports entretenus par toute construction avec son
environnement.
Conçu à la manière d’un « cabinet de curiosités », ce fort volume concentre
en ses pages toute l’étendue de la créativité des deux architectes, qu’elle
s’exprime à petite échelle en des volumes réduits ou au contraire sur une
large échelle en Suisse comme en Allemagne. Cette analyse est également
complétée par l’étude d’une cinquantaine de projets non réalisés. Ces
projets restés à l’état de plans offriront à n’en pas douter une source
d’informations et d’inspiration à de nombreux architectes ainsi qu’à toute
personne cherchant une voie originale et créative pour un projet de
construction.
Enfin, ce beau livre sera assurément en tant que tel source d’inspiration et
d’esthétique à l’image de cette métamorphose entreprise sur la Casa Mosogno
en Suisse au cours des années 2014-2018.
Contributions de Tibor Joanelly, Urs Stahel, Franziska Schürch, Oliver
Schneider et Ludovic Balland. Préface de Daniel Buchner et Andreas Bründler. |
| |
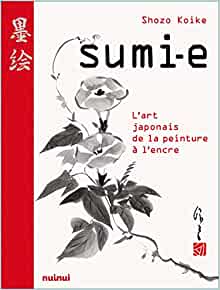 |
«
Sumi-e » de Koike Shozo, Editions Nuinui, 2019.
Véritable bible de la peinture japonaise sumi-e, l’ouvrage consacré à cet
art par le maître japonais Shozo Koike (qui vit en Italie où il dispense son
art) s’avèrera incontournable à celles et ceux souhaitant s’initier à cette
pratique picturale.
Épurée et allant à l’essentiel, la peinture sumi-e rejoint les sources du
zen dans cet art minimaliste de l’évocation de la nature, faunes et autres
objets du quotidien. Pratiquée avec seulement un pinceau, une pierre d’encre
de Chine et du papier japonais, celle-ci se trouve en ces pages expliquée en
termes clairs et didactiques par l’auteur qui n’hésite pas à en rappeler les
étapes, planche après planche.
Quelques traits épurés évoquent spontanément une forêt de bambous sous la
neige, un prunus en fleurs ou encore des montagnes éloignées en autant de
sujets de cet art hérité de la Chine et de la dynastie Tang (618-907). Ce
sont les moines bouddhistes zen japonais qui introduisirent cette pratique
dans la culture de leur pays, et depuis à l’origine de merveilleuses
créations. Tout est question de souffle et de posture mais aussi de
tranquillité d’esprit, à l’image d’une méditation zazen. Une pression du
bras en trop et le trait s’épaissit excessivement, à l’inverse un
effleurement trop léger sera insuffisant pour suggérer le paysage souhaité.
Ce sont aux techniques de base de cet art subtil auquel nous convie cet
ouvrage très pédagogique et agrémenté de nombreuses illustrations
indispensables au pratiquant. |
| |
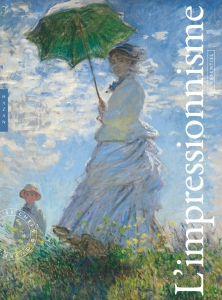 |
« L'Impressionnisme » de Valérie Mettais, Coffret
l'essentiel, 18,4 x 25,7 cm,
192 pages, Éditions Hazan, 2022.
Le coffret « L’Impressionnisme » réalisé par Valérie Mettais est parvenu à
concentrer en moins de 200 pages une belle synthèse aussi attractive que
didactique de ce courant majeur de la peinture né dans le dernier tiers du
XIXe siècle. Poursuivant la présentation originale de la collection en
format « accordéon » associant une sélection de 55 œuvres majeures
représentatives de l’art de l’impressionnisme, ce coffret est publié à
l’occasion de l’exposition « Le décor impressionniste - Aux sources des
Nymphéas » au musée de l’Orangerie.
Parvenant à évoquer les œuvres de personnalités aussi différentes que Monet
et Renoir, Pissarro ou Degas, cet ouvrage toujours agréable à déplier
permettra au lecteur de rapidement constater ce qui unit tous ces artistes
épris de nature et de couleurs ; Une attraction commune pour la libération
des formes et un désir partagé d’évoquer les sensations nées d’impressions
au contact de la nature. Ce livre est complété par une notice sous la forme
d’un cahier joint détaillant l’origine des œuvres et en rappelant les
notions essentielles.
Un beau voyage sous la forme d’une exposition temporaire chez soi. |
| |
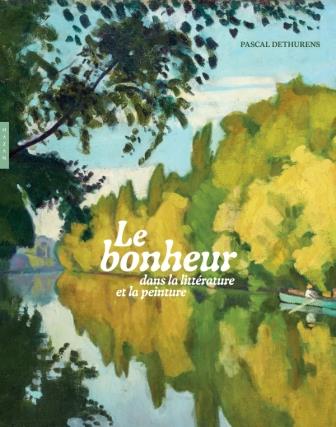 |
"Le
bonheur dans la littérature et la peinture" de Pascal Dethurens ; 221 x 280
mm, 192 pages, Editions Hazan, 2022.
Vaste sujet que le bonheur ! Sujet fécond surtout lorsqu’il est recherché
tant dans la littérature que dans la peinture… Une quête pleine de couleurs
et de surprises dont s'est saisi Pascal Dethurens et qu’il nous fait
partager avec cet attrayant catalogue paru aux éditions Hazan.
Le bonheur, cette notion qui a animé les philosophes dès la plus haute
antiquité n’a, il est vrai, cessé d’inspirer aussi bien les artistes que les
historiens, écrivains, romancier ou essayistes… C’est à cette quête croisée
et belle aventure, tâche ardue, cependant, à laquelle s’est attaché Pascal
Dethurens, professeur de littérature comparée et spécialiste des liens entre
arts et littérature. Ce bel ouvrage servi par un long et riche texte et par
une iconographie aussi inspirante qu’évocatrice transporte le lecteur dans
ces liens ténus entre sentiment de plénitude prêté au bonheur et création en
occident. Convoquant Marc Aurèle, Roger Caillois, Mircea Eliade... en regard
de Matisse, Bonnard, Léger et tant d’autres, l’ouvrage s’égrène tel un
sablier empli de sable précieux…
Instant rare et souvent fugace, le bonheur fait tour à tour l’objet
d’adulation ou de méfiance selon les courants de pensée au fil des siècles.
La subjectivité entre ainsi au cœur de cet état délicat proche, parfois, de
la nostalgie. Réminiscences éparses d’instants précieux, états de plénitude
face à l’immensité de la nature, émerveillements du quotidien le plus
infime, chaque occasion – grande ou petite – peut ouvrir au bonheur ainsi
qu’en témoignent les œuvres d’art et extraits d’œuvres littéraires réunis
par l’auteur. Si le lecteur veut un exemple concret, qu’il s’attarde sur ce
premier tableau reproduit dès les premières pages de l’ouvrage, une œuvre de
Pierre Bonnard, peintre de l’hédonisme et qui parvient à saisir si justement
ces quelques fractions d’éternité sur « La Terrasse à Vernonnet » en 1939,
plénitude des couleurs et de la lumière dont « La fête de Saint-Nicolas » de
Jan Sten à la page suivante constitue l’habile contrepoint avec cette
adorable petite fille serrant sa poupée comme un trésor unique…
Bonheur d’aimer, plaisir des dieux, intimité ou extase, nature sublimée,
plénitude spirituelle, tels sont quelque un des thèmes abordés dans cette
réflexion délicatement menée par un auteur lui-même inspiré ! |
| |
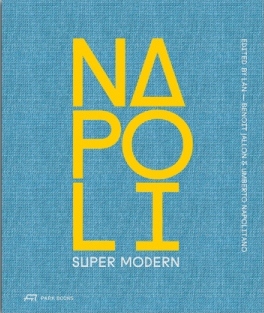 |
«
Napoli – Super modern »; Sous la direction du LAN - Local Architecture
Network, de Benoit Jallon, d’Umberto Napolitano et du Laboratoire R.A.A.R. ;
24 x 30 cm, 232 pages, Éditions Park Books, 2020.
Avis aux amoureux de l’Italie, Naples, et bien sûr, aux architectes, la
parution aux éditions Park Books de ce riche ouvrage entièrement consacré à
l’évolution architecturale moderne de Naples dans les années 1930 à 1960. Un
angle de vue architectural rarement étudié et que cet ouvrage sous la
direction de Benoît Jallon, associé fondateur du LAN (Local Architecture
Network) à Paris et de Umberto Napolitano appartenant également au LAN,
révèle avec autant de passion que de précisions.
Avec une iconographie exceptionnelle, notamment les photographies du célèbre
photographe français Cyrille Weiner, cet ouvrage apporte bien des éclairages
sur la construction moderne de cette ville italienne à nulle autre pareille.
Ainsi si Umberto Napolitano revient sur la genèse de cette modernité, Cyril
Weiner souligne la « Douce assimilation » de cette évolution architecturale
des années 1930 à 1960. Avec ses nombreuses contributions, dont celles
également de Manuel Orazi et de Guianluigi Freda, ses plans et détails
architecturaux, c’est un regard et surtout une riche analyse que propose «
Napoli – super modern » sur cet aspect moderne moins connu de cette
métropole portuaire unique du sud de l’Italie.
Une féconde étude d’ensemble appuyée également par un « Atlas » de dix-huit
bâtiments majeurs de Naples datant de 1930 à 1960 comportant plans,
élévations et coupes notamment le fameux « Cube d’or » ou encore le Teatro
Mediterraneo ; Un « Atlas » accompagné et éclairé par les textes d’Andréa
Maglio qui signe également « Of a « Conciliatory » Modernity : Naples
1930-1960 ». |
| |
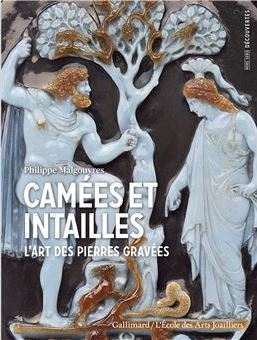 |
"
Camées et intailles, l’art des pierres gravées " de Philippe Malgouyres,
Hors série Découvertes, Gallimard / L’Ecole des Arts Joailliers, 2022.
A l’occasion de l’exposition consacrée à l’art des pierres gravées à L’École
des Arts Joailliers de Paris, les éditions Gallimard publient sous la plume
de Philippe Malgouyres une heureuse synthèse sur cet art trop souvent
méconnu. La pratique de tailler une pierre précieuse ou semi-précieuse
remonte à la plus haute antiquité et n’a cessé de gagner en raffinement
depuis ainsi qu’en témoigne ce numéro Hors-série Découvertes abondamment
illustré. L’auteur, conservateur en chef du patrimoine au département des
objets d’art du musée du Louvre et spécialiste de la glyptique – art de
graver les pierres – souligne combien ces pièces pour certaines
exceptionnelles sont nées du dialogue entre la pierre et la main de l’homme.
Relevant la difficulté quant à leur classement, souvent fantaisiste et moins
rigoureux que pour les espèces vivantes, l’ouvrage rappelle combien ces
imprécisions ont su nourrir une poésie certaine dont ces créations
témoignent au fil des siècles. Depuis le IIIe millénaire av. J.-C., ces
pierres provenant majoritairement d’Inde, feront l’objet de techniques, s’il
en était besoin, le degré de maîtrise et d’excellence atteint par de
nombreux graveurs. Rappelant les fonctions et usages de ces bijoux dès le
Proche-Orient antique, ce petit ouvrage aux inoubliables photographies
transportera le lecteur en un délicat voyage où poésie minérale et art ont
su composer les plus belles créations. |
| |
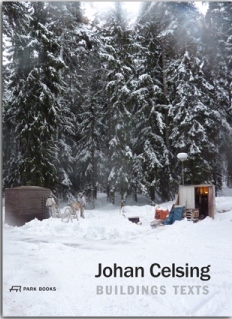 |
« Johan
Celsing – Buildings Texts » ; Sous la direction de Pamela Johnson avec les
contributions de Claes Caldenby, Johan Celsing et Wilfried Wang ;
Photographies de Ioana Marinescu ; Relié, Editions Park Books, 2021.
Johan Celsing a su s’imposer comme l’un des plus talentueux architectes
suédois contemporains. Une telle monographie entièrement consacrée à Johan
Celsing et à l’ensemble de son œuvre était donc vivement attendue. C’est
aujourd’hui chose faite avec ce fort volume de plus de 400 pages « Johan
Celsing – Buildings Texts » sous la direction de Pamela Johnson et publié
aux éditions Park books.
Johan Celsing, né en 1955, a, en effet, travaillé sur des créations très
diverses, allant de musées, bibliothèques, galeries, institutions publiques
à des habitats privés, et même des églises ou lieux de prières. Au fil des
pages de ce riche volume, le lecteur découvrira cependant une ligne
directrice et une conception homogène que le grand architecte n’a eu de
cesse de suivre. Il faut donc saluer cette belle et complète monographie
réunissant l’ensemble des travaux de Johan Celsing, aujourd’hui directeur du
Johan Celsing Architektkontor comprenant des studios basés à Stockholm et
Malmö. Johan Celsing est également professeur d'architecture au KTH Royal
Institute of Technology de Stockholm.
Appuyés par les photographies de Ioana Marinescu, plans, projets et
réalisations – plus de 600 illustrations, se succèdent au grès des
nombreuses contributions de ce fort beau volume dont celles de Claes
Caldenby et de Wilfried Wang soulignant le caractère intemporel des
créations de Johan Celsing. Le lecteur découvrira également des écrits
passionnants signés de Johan Celsing lui-même. Une riche monographie
incontournable qui devrait s’imposer en ouvrage de référence. |
| |
 |
« L’Art
en Mouvement ; Immersion dans le réseau de transport parisien » d’Anaël
Pigeat ; Photographies de Philippe Garcia ; RATP / Éditions La Martinière,
2022.
Le métro parisien a fait entrer notamment ces dernières décennies l’art.
Mais, connaît-on pour autant ces œuvres d’art qui jalonnent, ici ou là, les
stations et couloirs de métro de la capitale ? A-t-on déjà pris le temps de
les regarder et d’en connaître l’histoire ? C’est pour répondre à ces
légitimes interrogations que la RATP en collaboration avec les éditions La
Martinière viennent de publier « L’art en Mouvement », un attrayant ouvrage
revenant sur une vingtaine d’œuvres présentes sur les lignes du métro d’Ile
de France. Des œuvres d’art du passé, emblématiques, telles ces entrées de
station dans le pur style Art nouveau signées Hector Guimard et encore
tellement aimées de nos jours... Mais, aussi des œuvres proposant « Des
dialogues avec la ville » d’artistes français et du monde entier ; on songe
à Françoise Schein à la station Concorde, au Nautilus de François Schuiten
pour la station des Arts et Métiers ou encore à Carlos Sarrabezollers à la
station Richelieu-Drouot. Appuyé par les belles photographies de Philippe
Garcia, chaque sous-chapitre consacré à un artiste revient sur plusieurs
pages sur l’œuvre, sa genèse et son histoire. Indiquant station et lignes de
métro, ces sont de véritables « Voyages intérieurs » et « Ouvertures sur le
monde », des mondes à explorer, que livrent au regard ces œuvres d’art
signées notamment Hugues Reip sur la ligne 4 ou les « Energies » de
Pierre-Yves Trémois dans la gare d’échange du RER de Chatelet-Les Halles ou
encore Philippe Baudelocque à la station du même nom.
Un séduisant ouvrage offrant une jolie et instructive immersion dans cette
culture toute métropolitaine. |
| |
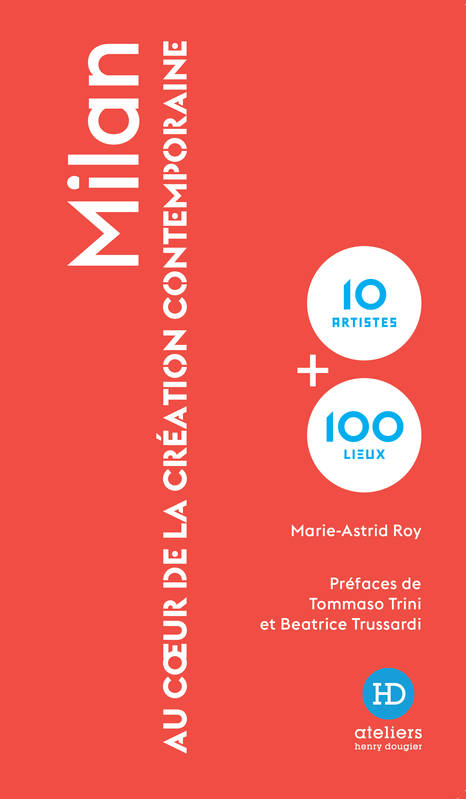 |
« Milan
- Au coeur de la création contemporaine » de MARIE-ASTRID ROY ; Préface de
Béatrice Trussardi, Tommaso Trin ; collection 10+100, Ateliers Henry Dougier,
2022.
La Collection 10+100 des Ateliers Henry Dougier accueille un nouveau titre
consacré à la ville de Milan en Italie signé Marie-Astrid Roy. L’auteur,
passionnée d’Italie et vivant dans la capitale lombarde, a décidé pour le
plus grand bonheur des amoureux de la ville de la mode et de la culture de
nous faire profiter de ses adresses et lieux incontournables à partir de 10
artistes et 100 lieux iconiques de son choix ainsi que le veut le titre de
la collection.
Avec cet ouvrage passionnant et abordant autant de chemins de traverse que
la ville peut en susciter, nous découvrons une autre Milan au fil de ses
créateurs tels Stefano Boeri, Giacomo Moor, Anna Franceschini et bien
d’autres encore ayant accepté de livrer leur témoignage sur la ville ; des
visions non seulement d’artistes mais également de Milanaises et de Milanais
d’adoption ou de naissance.
Fort de ces témoignages, le guide propose cinq parcours afin de (re)découvrir
100 lieux, pour certains emblématiques tel le Mudec, pour d’autres plus
secrets notamment l’Armani/Silos… Dans tous les cas, c’est une autre ville
qui s’ouvre au lecteur avec sa modernité et ses traditions cohabitant en une
harmonie sans cesse revisitée, l’auteur sachant mieux que quiconque en faire
partager la magie et nous donner l’envie de découvrir son charme et ses
trésors qui pour certains remontent à la plus haute antiquité.
Un guide précieux à emporter sans faute avec soi pour son prochain voyage en
Lombardie ! |
| |
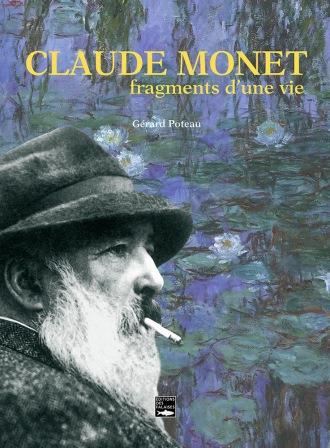 |
«
Claude Monet – fragments d’une vie » de Gérard Poteau ; Relié, 16 x 22 cm,
200 pages, Éditions des Falaises, 2021.
Avec « Claude Monet - fragments d’une vie » Gérard Poteau nous invite à
entrer dans l’intimité du Père de l’impressionnisme. L’ouvrage débute avec
les quatre-vingts ans de cette stature hors du commun, dans sa demeure, à
Giverny. Comment effectivement ne pas entrer dans l’intimité de Claude Monet
sans évoquer cette demeure rose ? Giverny avec sa salle à manger jaune, sa
cuisine bleue et surtout son jardin, ses ponts japonais et ses fameux
nymphéas, aujourd’hui célébrés dans le monde entier.
Dans un style très agréable, Gérard Poteau– déjà auteur de récits
biographiques, livre ici un intime portrait du peintre : Monet et « Camille
et Alice » ses épouses, ses amis et rencontres. Illustré de toiles du
maître, mais aussi par de nombreuses photographies, ce récit qui se veut
entre biographie et roman s’appuie notamment sur la vaste correspondance de
Claude Monet. Le lecteur retrouvera ainsi le peintre dans son atelier, dans
son jardin dont il dessina les allées et choisit les essences et presque
chaque fleur. On se surprend même à s’inviter à ce fameux « déjeuner » et «
à attendre les deux coups de gong qui annoncent l’heure du repas chez les
Monet »…
Une jolie immersion tant dans l’œuvre que la vie de l’un des plus grands
peintres de l’histoire de l’art. |
| |
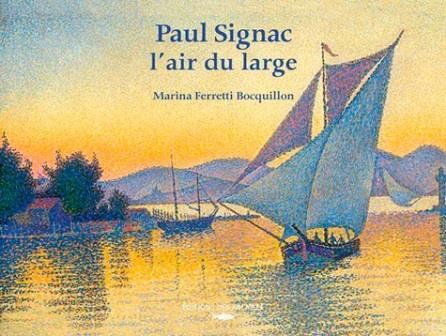 |
« Paul
Signac – l’air du large » de Marina Ferretti Bocquillon ; Relié, 22 x 16.5
cm, 80 pages, Éditions des Falaises, 2021.
Dans le même esprit de jolies escapades, Marina Ferretti Bocquillon nous
convie avec ce petit ouvrage à une croisière maritime au grès des toiles et
marines de Paul Signac. L’auteur, spécialiste du célèbre peintre,
responsable notamment des Archives Signac, sait combien ces thèmes, les
ports, la mer et les bateaux ont été des thèmes chers à l’artiste. Un amour
de la mer et des couleurs que Paul Signac néo-impressionniste chérira pour
ses œuvres toute sa vie, de la Normandie à la Méditerranée, mais aussi la
Bretagne ou encore l’Italie et Venise. Fécamp, Port-en-Bessin, Saint-Briac,
Portrieux, Concarneau, Antibes ou Constantinople, chaque œuvre surprend par
ses variations, ses transparences et jeux de lumière. Antibes sous un arc en
ciel, Saint Tropez sous ou après l’orage… Ainsi que le souligne l’auteur : «
Apôtre de la pureté des teintes, Paul Signac a dédié son existence à l’étude
de la couleur ». Ce dernier signera d’ailleurs un essai et traité
chromatiques aujourd’hui conservé aux Archives Signac. Se révèlent ainsi au
regard, page après page, toile après toile, toute la subtilité et les
variations, reflets et couleurs de la palette de Paul Signac que ce soit en
qualité de peintre, d’aquarelliste ou dessinateur.
Un bel et agréable « Air du large » ! |
| |
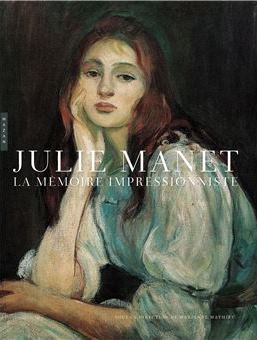 |
« Julie
Manet – la Mémoire impressionniste » ; Catalogue de l’exposition éponyme -
musée Marmottan Monet sous la direction de Marianne Mathieu ; Relié, 22 x
28.5 cm, 324 pages, 250 illust., Editions Hazan, 2021.
« La mémoire impressionniste » ! Quel plus joli et pertinent titre pouvait
être retenu pour cette superbe et unique monographie consacrée à Julie Manet
(1878-1966), catalogue accompagnant l’exposition éponyme actuellement au
musée Marmottan Monet. Julie Manet se trouva en effet au centre même de ce
fabuleux mouvement dénommé « l’impressionnisme » qui allait bouleverser
l’histoire de l’art. Qu’on en juge ! Julie fut la fille unique de Berthe
Morisot et seule nièce d’Édouard Manet, frère de son père Eugène Manet. Elle
posera très tôt pour les plus grands peintres de Renoir aux peintres
impressionnistes dont Monet ou encore Degas sans oublier, bien sûr, sa mère
Berthe Morisot, avant de devenir elle-même une artiste accomplie et une
collectionneuse avertie. « Julie rêveuse » ou « Julie Manet au chapeau
liberty » peinte par sa mère, Berthe Morisot, en 1894 et 1895 ou par Pierre
Auguste Renoir, « Julie Manet à la robe rose et au chapeau à fleurs de
pommier » en 1899… « Un art naturel de la pose » que développe Dominique
D’Arnoult.
L’ouvrage sous la direction de Marianne Mathieu retrace au travers de riches
contributions la vie de cette figure incontournable de l’impressionnisme :
son enfance, orpheline à treize ans, son mariage, mais aussi sa vie
d’artiste et de femme. Julie Manet s’engagea à faire connaître les œuvres de
sa mère et de son oncle. Elle voua un amour immodéré à l’art, et c’est avec
passion qu’elle réunira une belle et vaste collection avec son mari Ernest
Rouart, fils d’Henri Rouart. Son journal qu’elle tiendra de 1893 à 1899
révèle, ainsi que le souligne Claire Gooden dans sa contribution, une belle
qualité de jugement. C’est cette vie faite de toiles, tableaux et de dessins
que le lecteur découvrira en ces pages. Julie Manet sera, en effet, toute sa
vie entourée des plus grands noms et œuvres de l’impressionnisme à commencer
par sa mère, Berthe Morisot, première peintre impressionniste. Que de
rencontres pour cette femme qui à la fin de vie, toute de noire vêtue,
n’aura quasiment jamais quitté l’immeuble familial de la rue Villejuste !
Avec plus de trois cents pages, ce sont ces années et tournant de siècle que
l’ouvrage traverse, livrant ainsi au lecteur mille et une facettes de Julie
Manet.
Appuyé par une vaste iconographie, de nombreux documents et photographies
pour nombre inédits, cet ouvrage offrant la première monographie dédiée à
Julie Manet ne peut indéniablement que s’imposer au titre d’ouvrage de
référence. Incontournable ! |
| |
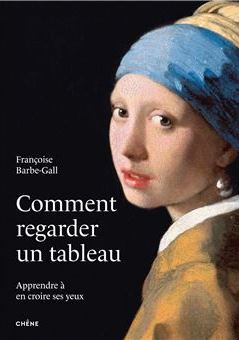 |
«
Comment regarder un tableau » de Françoise Barbe-Gall, Éditions Chêne, 2021.
C’est un ouvrage fort utile, voire précieux, que signe Françoise Barbe-Gall
aux éditions Chêne : « Comment regarder un tableau ». Qui, il est vrai, ne
s’est jamais senti, un jour, dérouté devant une toile ? Or, partant du
postulat que regarder et appréhender une œuvre s’apprend, que l’œil et le
regard peuvent s’éduquer, l’auteur, historienne de l’art et enseignante,
livre en ce fort volume didactique et passionnant de plus de 300 pages une
multitude de clés pour mieux regarder et saisir un tableau. Une
problématique que l’auteur connaît mieux que quiconque puisque cette
dernière a fondé l’association CO.RE.TA , comprenez « COmment REgarder un
TAbleau », pour laquelle elle assure et donne de nombreuses conférences.
Françoise Barbe-Gall a en effet à cœur de transmettre et de rendre
accessibles ces clés de lecture permettant à tout un chacun d’aiguiser à son
rythme et selon ses expériences son regard. Car « apprendre à regarder un
tableau suppose, avant toute chose, que l’on veuille bien, littéralement, en
croire ses yeux. » souligne l’auteur. C’est cette expérience aussi féconde
qu’indispensable que nous livre ainsi l’historienne de l’art dans ce
captivant ouvrage. Appuyé par une riche iconographie, l’ouvrage propose, en
effet, une progression réfléchie en six chapitres allant d’« Une simple
réalité » à « La douceur d’un tableau » en passant par « Les déformations du
visible » ou encore « La confusion des apparences ».
L’auteur n’entend pas cependant, en ces pages, bannir nos impressions
premières, mais bien à partir de ces dernières nous apprendre à saisir
pleinement le sens d’une œuvre, notamment « Deviner ce qui n’est pas dit »,
« renoncer aux évidences » ou encore « Prendre le temps de se tromper »...
Pour cela, sur le fondement de plus de 40 tableaux et artistes majeurs de
l’histoire de l’art (Giotto, Botticelli, Raphaël, mais aussi Bacon, Soulages
ou Rothko, etc.), l’ouvrage livre une analyse claire et pédagogique de
chaque œuvre allant d’une vision d’ensemble à l’étude des détails
signifiants, offrant ainsi au lecteur une fructueuse mise en perspective
didactique ou une clé de lecture, tel que « Découvrir l’essence d’un
caractère », « Voir naître la lumière » ou « Apprendre l’attente »…
À ces thèmes-clés d’étude, viennent s’ajouter en correspondance pour chaque
point abordé 42 pages de « Post-scriptum » comprenant repères et tableaux
chronologiques, historiques ou culturels permettant au lecteur curieux
d’aller plus loin et d’aiguiser plus encore son regard.
Un ouvrage aussi riche que plaisant pour accompagner ses escapades
culturelles. |
| |
 |
«
Impressionnisme ; De Giverny à la Norvège » de Hayley Edwards Dujardin,
Collection «Ça, c’est de l’art », éditions Chêne, 2021.
Pour une approche toujours plaisante et surprenante, il faut retenir dans la
fameuse collection « Ça, c’est de l’art » l’ouvrage « Impressionnisme ; De
Giverny à la Norvège. » d’Hayley Edwards Dujardin aux éditions Chêne. Un
ouvrage didactique relevant le défi de présenter en 40 notices les plus
grands peintres et œuvres de l’impressionnisme tout en offrant au lecteur
bien des surprises et étonnements. Hayley Edwards Dujardin, historienne de
l’art et de la mode, sait en effet plus que tout autre surprendre et capter
la curiosité. Anecdotes, détails, repère chronologique foisonnent à chaque
page faisant ainsi revivre l’un des plus grands mouvements artistiques de
l’histoire de la peinture. Sait-on par exemple que Pissarro sera le seul
impressionniste à participer aux huit expositions des impressionnistes ? En
revanche, Manet, bien que désigné par ces derniers de chef de file, ne se
considérait pas impressionniste et ne participera pour sa part à aucune de
leurs expositions…
Des incontournables aux plus inattendus, les thèmes privilégiés (les meules,
la plage, les cathédrales, etc.), les lieux (Giverny, La Montagne
Sainte-Geneviève, La Ciotat, etc.) et œuvres majeures défilent délivrant à
chaque page leurs secrets, précisions historiques, influences ou clins
d’œil. Ainsi si l’on retrouve en fin d’ouvrage, en 1895, Monet en Norvège,
le lecteur pourra aussi dans ces rendez-vous inattendus croiser dans la «
Loge aux Italiens » Eva Gonzalès ou encore à la « Gallery of HMS Calcutta »
Jacques Joseph devenu James Tissot…
On découvre ou redécouvre, l’œil s’enchante devant cette incroyable lumière
à nulle autre pareille, ces couleurs et impressions qui ont fait de ce
fantastique mouvement nommé impressionnisme, au-delà du foisonnement des
individualités, l’un des courants majeurs de l’histoire de l’art. |
| |
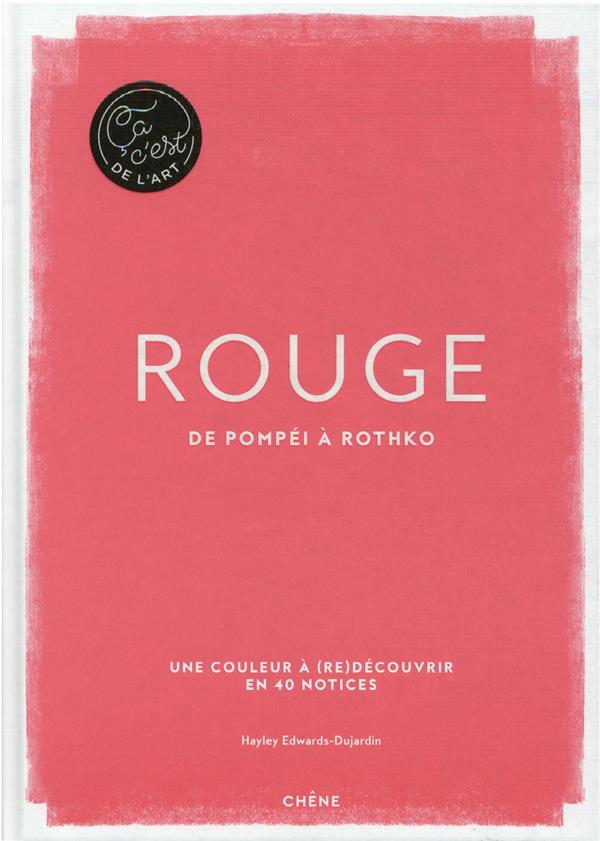 |
« Rouge
: de Pompéi à Rothko » de Hayley-Jane Edwards-Dujardin, collection « Ça,
C'est de L'art », Chêne éditions, 2021.
Avec ce dernier ouvrage paru aux éditions Chêne, Harley Edwards-Dujardin
enquête sur l’une des couleurs les plus anciennes, le rouge. Une couleur
associée aux premières représentations de l’homme sur les parois des
grottes.
Selon une formule déjà classique pour cette collection, grâce à 40 notices,
l’auteur retrace le parcours pour le moins singulier de cette couleur la
plus éclatante et repérable qui soit. Couleur des passions et des extrêmes,
elle fut l’apanage des empereurs romains à partir de la pourpre obtenue à
partir d’un coquillage, le précieux murex, tout comme celle des prostituées,
un destin décidément à part… Rares sont les artistes à n’avoir pas succombé
à ses charmes, qu’il s’agisse des décorateurs des villas pompéiennes ou,
plus proche de nous, Rothko. Ses nuances ont laissé des noms poétiques,
pourpre, garance, sépia, ocre, cinabre… Son aire géographique couvre le
Nouveau comme l’Ancien Monde, les divers continents ayant rapidement perçu
ses richesses et promesses. Neuf nuances de rouge sont en ces pages
rappelées : écarlate, magenta, vermillon, bordeaux, tomate, garance, carmin,
ocre rouge, et bien sûr le pourpre.
L’ouvrage abondamment illustré débute par les fameuses mains de Cueva de las
Manos en Patagonie qui transporteront le lecteur instantanément 11 000 ans
av. J.-C. ! Les belles coupes antiques de la Grèce au VIe siècle av. J.-C.
témoignent quant à elles de la virtuosité des artistes athéniens avec ces
figures rouges sur fond noir. La peinture plus proche de nous est également
abondamment illustrée dans ces pages avec Van Eyck, Van der Weyden, le
Titien, Bronzino, ainsi que Georges de La Tour, fameux pour ses rouges
flamboyants.
Pour chaque artiste, une double page présente l’œuvre retenue, une synthèse
complète ainsi que quelques anecdotes toujours instructives et attrayantes,
faisant de cet ouvrage une passionnante aventure dans le monde des couleurs. |
| |
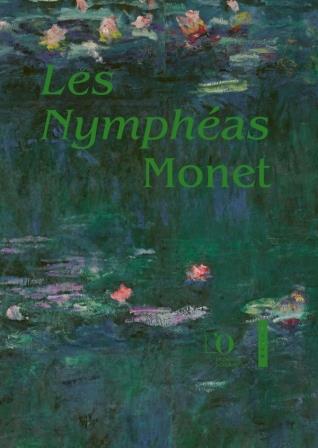 |
"Les
Nymphéas de Claude Monet" de Cécile Debray, Collection Beaux Arts, 218 x 312
mm, 208 p., Éditions Hazan, 2020.
Porte incontournable afin d’entrer dans l’univers de la création de Claude
Monet, les nymphéas – plus communément nommés nénuphars – semblent à la fois
familiers et pourtant si complexes sous le regard du père de
l’impressionnisme. Cécile Debray s’est attachée à ce monument de la peinture
en partenariat avec le musée de l’Orangerie où se trouve conservée la
remarquable collection de Nymphéas de Monet. C’est à une vision d’ensemble
de ce cycle auquel convie cet ouvrage passionnant qui bénéficie d’une
iconographie tout spécialement réalisée à cette occasion. Par un savant jeu
d’agrandissements, le regard entre littéralement dans l’intimité de la
composition grâce au saisissant travail de Fanette Mellier. La fascination
suscitée par ce travail à la limite de l’obsession chez l’artiste a depuis
longtemps gagné le public qui ne cesse de se presser à la découverte de
cette rencontre à nulle autre pareille entre végétal et univers aquatique.
Le foisonnement des formes et des couleurs se confond avec celui de la
palette de l’artiste à un point tel qu’il devient difficile de percevoir qui
en a été le modèle…
Majesté de ces toiles monumentales où l’infime prend valeur de témoignage
lorsqu’il pointe à l’occasion d’une discrète floraison. Cécile Debray
parvient en introduction à faire partager cette abstraction dans des
analyses à la fois accessibles sans leur ôter leur complexité. Les infimes
vibrations de la lumière sur le végétal, ses échos sur l’onde et ses
innombrables reflets composent une litanie éternelle que le peintre n’aura
de cesse d’explorer tout au long de sa vie. Comment saisir cette fugacité ?
Par quel moyen interrompre le temps afin de capter ces frémissements
imperceptibles pour la plupart d’entre nous ? C’est à cette magie auquel
convie cet ouvrage remarquable, aussi beau qu’inspiré, une évasion à lui
seul à découvrir au plus vite. |
| |
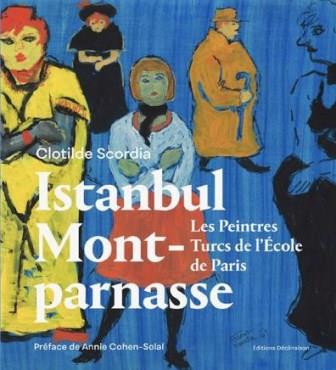 |
«
Istanbul - Montparnasse ; Les Peintres Turcs de L’École de Paris » de
Clotilde Scordia avec une préface d’Annie Cohen-Sohal, Éditions Déclinaison,
2021.
Si les cercles des peintres parisiens des années de l’après-Seconde-Guerre
Mondiale sont connus pour leur extrême vitalité, plus méconnus demeurent
cependant - et à tort - « Les Peintres Turcs de l’École de Paris ». Une
lacune que vient combler aujourd'hui avec bonheur cet ouvrage intitulé «
Istanbul Montparnasse » signé Clotilde Scordia aux éditions Déclinaison.
Ces peintres de l’École de Paris, tous contemporains de l’arrivée au pouvoir
de Mustafa Kemal Atatürk et de la République de Turquie, furent pourtant
largement célébrés en Turquie dans ces années d’après-guerre. Clotilde
Scordia a fait choix de nous faire découvrir les œuvres de onze de ces
artistes turcs majeurs. Onze « Peintres en quête de modernité » ayant choisi
la France à la fin de la guerre, ainsi que le souligne l’auteur en son
premier chapitre, avant de revenir sur les œuvres respectives de chacun de
ces peintres.
Parmi eux, deux femmes retiendront l’attention pour leur dynamisme,
détermination et modernité ; Fahrelnissa Zeid, une « personnalité
flamboyante » aux œuvres colorées, et Tiraje Dikman, livrant une œuvre plus
abstraite sous influence surréaliste. Mais le premier à avoir quitté en ces
années d’après-guerre son atelier d’Istanbul pour venir s’installer à Paris
fut Fikret Moualla en 1939. Ce dernier, reconnu déjà dans son pays natal
ainsi que de l’autre côté de l’Atlantique à New York, fut remarqué pour ses
célèbres cafés parisiens dans lesquels sa vie nocturne sulfureuse trouva
inspiration. Il fut rejoint à Montparnasse en 1946 par Nejad, puis par d’Avni
Arbas, et en 1947 par Salim Turan…
Tous ces artistes quittèrent leur atelier d’Istanbul pour venir rejoindre
les peintres et les cercles créatifs et féconds de Montparnasse.
Participants aux expositions consacrées à l’art turc du Musée d’art moderne
de Paris et du musée Cernuschi, ces peintres surent, au-delà des critiques
de l’époque, rapidement s’imposer en peintres majeurs notamment grâces aux
galeristes et collectionneurs. Chaque chapitre consacré à ces onze «
Peintres Turcs de l’École de Paris » offre au regard des œuvres chatoyantes
ou d’une profondeur sombre.
Aujourd’hui, Clotilde Scordia nous propose, au travers ces onze monographies
richement illustrées, de (re)découvrir ces « Peintres Turcs de L’École de
Paris ». À ce titre, on ne peut, ainsi que le souligne Annie Cohen-Sohal
dans sa préface, que l’en féliciter. |
| |
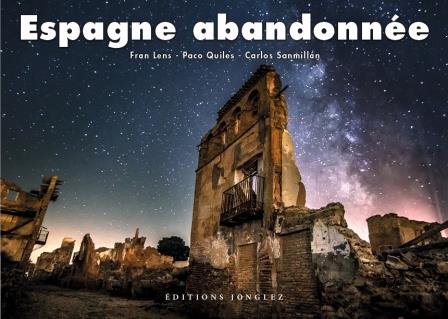 |
«
Espagne abandonnée » de Fran Lens, Paco Quiles & Carlos Sanmillán, 208 p.
297mm x 210mm, Editions Jonglez, 2020.
C’est une Espagne désolée, moins connue, marquée par la mémoire du temps et
de l’histoire que nous livre au regard ce superbe ouvrage photographique, «
Espagne abandonnée », paru aux éditions Jonglez. Issu du travail
photographique de Paco Quiles, Fran Lens et Carlos Sanmillan, chaque
chapitre, page et photos offrent, en effet, une découverte d’une autre
Espagne, loin des clichés habituels, celle d’une Espagne dont la mémoire ne
veut pas mourir…
Les auteurs appartiennent tous au célèbre et fameux groupe « Abanbonned Span
», un groupe s’étant donné pour tâche de faire revivre et de garder traces
de ces villages, places ou autres lieux désertés, abandonnés, parfois
laissés en ruines. Le célèbre Don Quichotte aimait à voir d’autres réalités
que celles des autres mortels, sublimant ce qui était vulgaire, comme avec
la douce Dulcinée ou ses fameux moulins… Notre trio sans chercher cependant
querelle à des chimères s’éloigne des autoroutes touristiques pour prendre
des chemins de traverse, au détour d’une église abandonnée, d’une masure
esseulée, compagne de lierres envahissants. La beauté n’est pas la seule
conviée dans cet ouvrage remarquable par la qualité de son témoignage,
d’anciennes friches industrielles laissent encore percevoir les espoirs que
des femmes et des hommes plaçaient dans la modernité, et ce qu’il en est
resté, gravas, cheminées fort heureusement sans fumée…
Le constat, parfois quelque peu amer, n’est cependant pas toujours
pessimiste avec ces magnifiques photographies réunies dans cet ouvrage, la
voûte céleste laisse encore percevoir ses constellations d’étoiles, même sur
une masure abandonnée, des lieux somptueux n’attendent que le baiser d’un
prince charmant, peut-être celui d’un lecteur, de cet ouvrage inspiré. |
| |
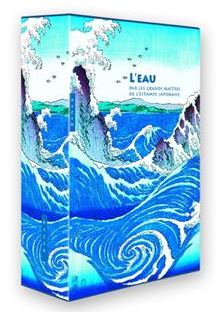 |
« L’Eau
par les grands Maîtres de l’Estampe japonaise » par Jocelyn Bouquillard ;
Coffret avec cahier explicatif, 12 x 17.5 cm, 226 p., Éditions Hazan, 2021.
La fameuse collection « Les grands Maîtres de l’Estampe japonaise » aux
éditions Hazan s’enrichit d’un nouveau titre « L’Eau par les grands Maîtres
de l’Estampe japonaise » du XVIIIe siècle et XIXe siècle. Un thème
effectivement porteur et privilégié des Maîtres japonais ; qui ne songe dès
à présent à la célèbre vague d’Hokusai ? Ponts, rivières, cascades ou
simplement pluie sans oublier la neige, cet élément naturel a donné lieu aux
plus belles et célèbres estampes, des estampes signées notamment Hokusai, ou
encore Kuniyoshi. Dans son coffret et sa reliure japonaise en accordéon, cet
ouvrage sous la direction de Jocelyn Bouquillard, responsable des
collections d’estampes de la Bibliothèque Sainte-Geneviève et auteur
notamment de « Hiroshige en 15 questions » et de « Les trente-six vues du
Mont Fuji d’Hiroshige » également aux éditions Hazan, offre en effet au
regard toutes les expressions de cet élément omniprésent au pays du Soleil
levant, lacs, océan, cascades… Plus de soixante estampes célébrant chacune à
leur manière l’eau. Communion et spiritualité s’y mêlent que ce soit dans la
poésie des fines pluies, dans la puissance ou bouillonnements des flots et
vagues ou dans les courbes et arabesques des rivières. Chaque estampe
retenue révèle à elle seule toute la virtuosité des grands Maîtres japonais
des siècles passés. Accompagné d’un livret introductif et explicatif livrant
dates et précisions sur chacune des estampes représentées, ce coffret vient
compléter à merveille cette collection enchanteresse. |
| |
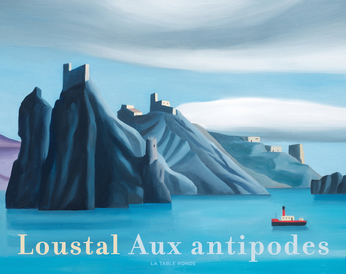 |
Loustal
: « Aux Antipodes » ; dessins, 180 p., Editions la Table ronde, 2020.
C’est un voyage « Aux antipodes » plein de charme et de poésie que nous
propose le dessinateur Loustal dans cet ouvrage aux pages enchantées dans
leur format paysage et paru aux éditions La Table ronde. Loustal nous conte
également chemin faisant sa découverte, enfant, de ces contrées lointaines,
son désir d’imaginaire et de dessin, et son aspiration enfin à voyager et à
acquérir son propre style. Les dessins de Loustal, passant du fusain aux
couleurs, ne sont pas seulement une belle invitation à voyager, ils
captivent et entraînent dans des rêves d’ailleurs et des songes infinis.
Rien d’étonnant à cela puisque le dessinateur sait plus que quiconque partir
de ses dessins au fusain pour laisser en fin de compte voguer sa propre
imagination et ses couleurs, aquarelle ou huile. Son style épuré offre en
ces paysages lointains bien plus qu’un pur dépaysement, il se colore en ces
pages une joie, une candeur, quelque chose de paisible, parfois nostalgique
voire d’esseulé…
Ainsi, glisse-t-on dans ces paysages de la « Terre de Feu », mélange de cap
lointain, de paysages marins, et d’épaves… On se surprend à rêver après
Brasilia, au soleil des plages de Floride, à la douceur des Îles Canaries
(hors saison, précise le dessinateur !). Et puis, le bleu se fait plus gris,
plus mélancolique lorsque l’on aborde l’Islande avant de retrouver les
couleurs éclatantes de soleil de l’Italie ou de la Grèce. A chaque dessin,
c’est une poésie singulière, épurée qui s’offre au regard, une poésie où
dominent le fusain et le bleu lointain des rivages d’un imaginaire infini.
Les dessins de Loustal sont une magie, ils racontent, disent, dévoilent,
laissent s’envoler souvenirs et voguer les rêves d’ailleurs aussi loin que
le souhaite le lecteur… |
| |
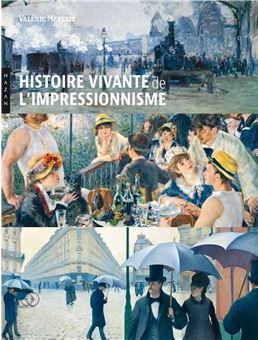 |
«
Histoire vivante de l’impressionnisme » de Valérie Mettais, Collection «
Beaux-Arts », Éditions Hazan, 2021.
C’est à une véritable « Histoire vivante de l’impressionnisme » que nous
convie Valérie Mettais, historienne de l’art. Rien de figé, en effet, dans
cet ouvrage paru aux éditions Hazan nous offrant toute l’aventure et la
diversité de couleurs des palettes de ces peintres qui furent désignés par
dérision « Les impressionnistes ». Un mouvement de fond, qui allait
bouleverser la trajectoire de la peinture. Pour capter ce formidable
foisonnement artistique, l’auteur a opté pour une approche chronologique,
décennie par décennie, de 1863 à 1905. Un choix judicieux qui permet à
Valérie Mettais de recontextualiser un mouvement artistique majeur trop
souvent à tort coupé de tout. Printemps 1863, c’est le salon dit « des
refusés », un succès et le début d’une longue et belle histoire… À la
Closerie des Lilas, Monet, Sisley, Renoir se rebiffent contre cet académisme
décidément trop académique. Ils sortent des ateliers pour le plein air ; ce
sera la Normandie, mais aussi les berges de la Seine, Chatou et sa
Grenouillère qu’immortalisera Renoir… S’appuyant sur une vaste iconographie,
les impressionnistes, au fil de l’eau et des pages s’affirment, se dévoilent
et s’imposent. Les années, les peintres et les destins se croisent. Ainsi
que le souligne Valérie Mettais en son avant-propos : « Cet ouvrage n’est
pas une histoire de l’impressionnisme en ce sens qu’il ne se concentre par
sur ses seuls et prétendus adeptes (…), mais accueille aussi ceux qui l’ont
accompagné et ceux qui ont croisé sa route, l’ont enrichi, suivi ou dépassé.
» Degas, Pissarro, Caillebotte ou encore Émile Bernard, Paul Sérusier, mais
aussi Manet, Cézanne et ses horizons. On y croise aussi Gauguin « Dans la
maison jaune » et les couleurs de Van Gogh. Le moulin de la galette enchante
Toulouse-Lautrec et le Moulin-Rouge tourne ses ailes et les têtes. Chacun de
ces peintres marquera à leur manière, de par leur singularité, leurs
perceptions et couleurs, ce que l’on appellera dorénavant l’impressionnisme…
En 1905, les impressionnismes enthousiasment et enthousiasmeront le monde
entier ouvrant ainsi leurs portes à l’avenir…
Un ouvrage riche et alerte qui fourmille de détails et d’anecdotes offrant
une réelle et belle « Histoire vivante de l’impressionnisme ». |
| |
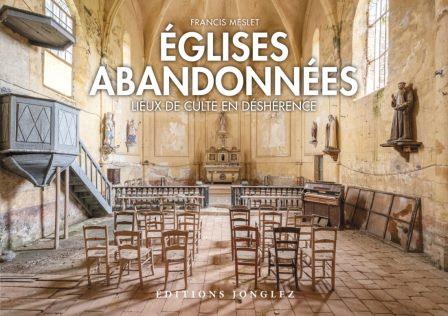 |
«
Églises abandonnées » de Francis Meslet, Editions Jonglez, 2020 ».
Au-delà du triste constat que pose tout édifice en déshérence, l’ouvrage de
Francis Meslet nous place cependant au-delà, face à notre propre rapport à
l’égard de l’histoire et de la culture, indépendamment de nos convictions
religieuses. L’auteur a, pour cela, mené une véritable enquête sur huit
années, enquête qui l’a emmené aux quatre coins de l’Europe où il a pu
saisir avec son appareil photographique ces insolites et désolés instantanés
d’abandons et de pesants silences… Quoi de plus triste, en effet, qu’une
église vidée de tout son sens, celui de la réunion, de la fraternité et du
partage, même si cette église doit avant tout s’entendre en un sens plus
spirituel que matériel…
L’auteur et photographe a choisi avec cet ouvrage saisissant de livrer un
réel et beau témoignage éloquent, celui d’une Europe qui a depuis longtemps
perdu ses racines chrétiennes et se débat avec cet héritage que certains
jugent encombrant si l’on en juge l’incurie et l’inaction à l’égard de ces
bâtiments en totale déshérence. Au-delà du silence qui pourrait à la rigueur
encore convenir à des lieux sacrés, c’est surtout le péril de leur
disparition définitive qui interpelle. Ces lieux non entretenus prennent
l’eau, leur structure se fragilise et à terme s’écroulent d’eux-mêmes ou par
mesure de sécurité font l’objet de mesures radicales.
Curieusement l’actuelle pandémie nous a livré de tels spectacles de
désolation avec une place Saint Marc vidée de ses touristes… Soudain, la
question du sens prend toute sa valeur, surtout lorsqu’il s’agit de lieux de
foi. Les photographies de Francis Meslet parlent d’elles-mêmes, elles qui
prennent à témoin le lecteur lorsque le cœur et le toit d’une chapelle du
Piémont sont mis à nu, ouverts à quatre vents… Ces statues d’une église
bourguignonne semblent attendre les fidèles, en une patiente éternité… Le
végétal et la nature reprennent aussi leur droit sur ces pierres de la foi,
faut-il voir là un signe ?
On ne peut qu’espérer que cet ouvrage émouvant par son sujet, « Les Églises
abandonnées » contribue à apporter une nouvelle pierre, celle d’une réponse
respectueuse de l’Histoire et des cultures… |
| |
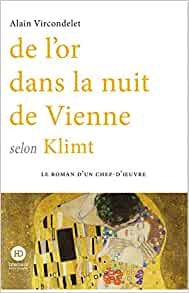
|
Alain
Vircondelet : « De l’or dans la nuit de Vienne selon Klimt », Éditions
Ateliers Henry Dougier, 2021.
« Le Baiser » du célèbre peintre autrichien Gustav Klimt, œuvre emblématique
d’une époque et d’un esprit, fait l’objet d’un essai séduisant d’Alain
Vircondelet, historien de l’art et biographe talentueux. Publié dans la
belle collection « Le roman d’un chef-d’œuvre » aux éditions Atelier Henry
Dougier, cet ouvrage sort des sentiers battus et offre un plaisant regard
transversal sur une œuvre d’art, roman à elle seule.
S’inscrivant dans le mouvement de l’Art nouveau et de la Sécession de
Vienne, Klimt a surpris indéniablement ses contemporains par ses toiles sur
fond d’or, véritables ponts entre tradition byzantine, Ravenne, Venise et
symbolisme de la fin du XIXe siècle. Par quelle alchimie, cependant, cette
œuvre envoûte-t-elle autant celles et ceux qui la découvrent ? Telle est la
quête passionnante que mène Alain Vircondelet sur cette icône souvent
réduite à un fougueux transport amoureux. Si l’amour semble bien en effet au
cœur de cette composition, l’or irradiant l’œuvre invite également à la
pureté et à l’absolu du désir inaltérable. Face à la fascination exercée par
ce tableau depuis un siècle, Alain Vircondelet cherche à lever les voiles
jetés sur « Le Baiser » et à en révéler les différents éclats. Les ors
sertissent la rencontre d’un homme et d’une femme au cœur d’une prairie
fleurie, cadre idyllique si ce n’est le vide qui commence à attirer les
amoureux à leur insu. Fragilité et insouciance cohabitent ainsi dans cet
espace plus sacralisé qu’il n’y paraît de prime abord.
Émilie Flöge, muse de Klimt, se trouve évoquée sur le tableau, une styliste
appréciée qui concevait les tissus représentés dans l’œuvre. Amour sacré,
amour profane, thème de prédilection de Titien et autres peintres de la
Renaissance, trouvent ici un écho repensé, loin des représentations
romantiques erronées de cette œuvre. L’or tente d’enchâsser pour l’éternité
l’évanescence des corps et de la vie à la veille de la pénombre qui guette
Vienne et le monde ; Une dimension religieuse possible du tableau, ainsi que
le suggère avec intelligence et passion Alain Vircondelet dans cet ouvrage
aussi attrayant que stimulant.
Philippe-Emmanuel Krautter |
| |
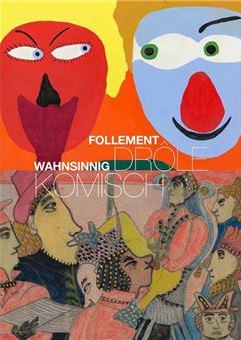 |
«
Follement drôle – Wahnsinnig Komisch » ; Sous la direction du Dr Anne-Marie
Dubois et du Dr Thomas Röske ; Couv.cartonnée, 19 x 26.5 cm, 160
illustrations, 232 p., Bilingue français-allemand, Editions In Fine, 2020.
Voilà, enfin, un ouvrage qui vous mettra de bonne humeur ! Intitulé «
Follement drôle », ce dernier donne, en effet, à voir les collections du
Musée d’art et d’histoire de l’hôpital Sainte-Anne (MAHHSA) et la collection
Prinzhorn de l’hôpital universitaire allemand de Heidelberg. Réunies pour la
première fois en ces pages à l’occasion de l’exposition éponyme au MAHHSA
jusqu’au printemps 2021, ces collections viennent illustrer avec bonheur que
« la « folie »ne se conjugue pas nécessairement avec le « drame » ».
Ici, les œuvres présentées riment avec drôlerie, humour et plaisanterie,
voir avec caricature, et révèlent la distanciation que peuvent avoir
certains malades. Nez rouges, portraits caricaturés et sens du dérisoire
s’entremêlent. Des œuvres singulièrement drôles qui surprennent tant pas
leur identité propre que par leurs points de contact au-delà des époques. On
y retrouve ainsi comme des fils conducteurs la caricature, le grotesque, la
grivoiserie ou encore la distanciation à l’égard des institutions
psychiatriques. Des traits-unions ayant dicté la présentation des œuvres et
les chapitres de l’ouvrage. Sous la direction du Dr Anne-Marie Dubois,
directrice scientifique du MAHHSA et du Dr Thomas Tüske, directeur du
Prinzhorn Collection Museum, et appuyé par de nombreux textes et
contributions, l’ouvrage propose également une éclairante analyse tant des
œuvres que de ce « follement drôle » qui les anime.
À ce titre, les collections respectivement de Sainte-Anne réunie à partir
des années 1950 et Prinzhorn constituée en 1900 sont emblématiques de ce que
peuvent révéler et offrir à voir ces œuvres singulières et ici colorées de
drôleries. |
| |
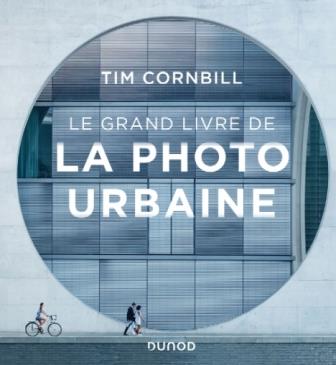 |
Tim
Cornbill : « Le grand livre de la photo urbaine », 235 x 255 mm, 192 p.,
Éditions Dunod, 2020.
La photographie urbaine a acquis ses lettres de noblesse au siècle passé
grâce aux travaux précurseurs d’artistes comme Atget, Brassaï,
Cartier-Bresson. Mais connaît-on véritablement ce qui la compose, la
caractérise et la constitue ? C’est à cette délicate tâche à laquelle s’est
attelé avec rigueur et pédagogie Tim Cornbill dans cet ouvrage concis sur un
sujet pourtant sans frontières… Diurne ou nocturne, avec ou sans habitants,
noir et blanc ou couleur, la liste est quasi infinie des multiples
variations auxquelles se prête la ville pour le photographe ayant décidé
d’en faire son sujet. Tim Cornbill a choisi dans ces pages de dévoiler cette
passion qui l’anime depuis fort longtemps et qui le porte à braquer son
objectif de Paris à New York, en passant par Berlin, Dubaï ou Barcelone...
Chaque lieu possède son identité, et ce bien au-delà de la mondialisation
galopante. Une singularité urbaine peut fort heureusement poindre encore de
nos jours à la condition de respecter certaines règles que l’auteur rappelle
et détaille. Ainsi, comment choisir les bonnes focales, les lieux propices,
la météo pour la lumière et les couleurs ou encore gérer les perspectives ?
Cet ouvrage, riche d’enseignements, aborde tous ces points essentiels, et
bien d’autres encore, avec un nombre impressionnant de conseils pratiques
pour réussir ses plus belles photos urbaines. L’ouvrage offre au regard en
plus du travail de l’auteur commenté lui-même, les œuvres de huit autres
artistes majeurs de la photographie urbaine, tels Brassaï, Martin Parr,
Cartier-Bresson, Sebastien Weiss… Au-delà, et grâce à aux conseils pratiques
de Tim Cornbill, c’est une approche artistique nourrie par l’esprit même des
lieux urbains qui vient animer les œuvres des plus grands photographes.
Un ouvrage unique livrant une véritable philosophie de la photographie. |
| |
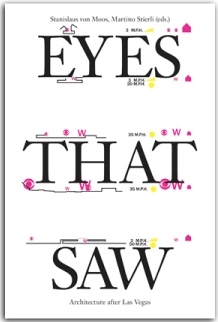
|
« Eyes
that Saw – Architecture After Las Vegas », Collectif; 14 x 21 cm, 197
illustrations, 504 p.; Stanislaus von Moos and Martino Stierli, Scheidegger
& Spiess Editions, 2020.
« Eyes that Saw » intéressera assurément plus d’un architecte, historien
d’art ou créateur puisque cet ouvrage propose une riche et instructive étude
sur l’héritage encore présent de nos jours du « Learning from Las Vegas ».
Ce dernier paru dans les années 1970, fruit du travail mené par Robert
Venturi et Denise Scott Brown, fut un immense et immédiat best-seller qui a
su imposer jusqu’à aujourd’hui au titre de référence incontournable en
matière d’architecture des années 70. Robert Venturi et Denise Scott Brown y
livraient, en effet, leur étude menée avec Steven Izenour sur le thème de
Las Vegas à la Yale School of Architecture.
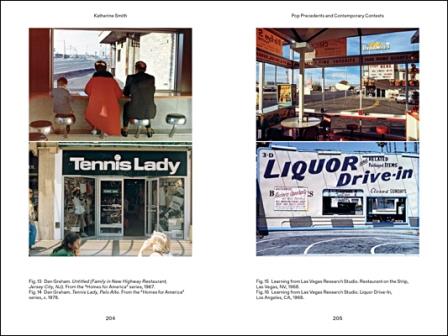
Aujourd’hui, plus de quarante ans après, ce ne sont pas
moins de quatorze experts, architectes, historiens de l’art et artistes qui
livrent au lecteur dans ces quelque 500 pages de « Eyes that Saw -
Architecture After Las Vegas » leur analyse de cette influence incontestable
et incontestée du « Learning from Las Vegas » sur notre quotidien. Apportant
chacun leurs propres vues selon des angles différents appuyés par plus de
190 illustrations, c’est l’ensemble du vaste rayonnement du « Learning from
Las Vegas » qui se dévoile, ainsi, au lecteur que ce soit en matière
architecturale, de design mobilier urbain ou encore dans le domaine des arts
visuels.
Le lecteur y découvrira également des archives et documents provenant de
Venturi, Scott Brown & Associates de l'Université de Pennsylvanie, ainsi
qu’une chronologie médiatique illustrée de l’influence du « Learning from
Las Vegas » de par le monde entier.
Une étude collective riche et instructive offrant une réelle et belle mise
en perspective du rayonnement dans le monde du « Learning from Las Vegas »
depuis maintenant presque un demi-siècle. |
| |
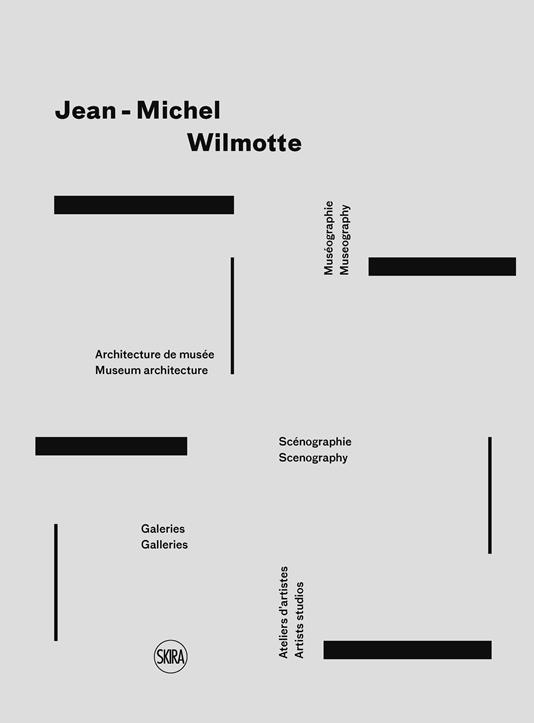 |
«
Jean-Michel Wilmotte Muséographie, Architecture De Musée, Scénographie,
Galeries, Ateliers D’artistes » ; Contributions de Jean-Jacques Aillagon,
Taco Dibbits, Françoise Mardrus, Luis Monreal, Jean-Michel Wilmotte ;
Édition reliée et toilée, bilingue français/anglais, 22 x 30 cm, 376 p., 300
illustrations, Éditions SKIRA, 2021.
Jean-Michel Wilmotte compte assurément plusieurs casquettes à son actif.
Architecte, urbaniste, mais aussi designer, cet esprit insatiable de
curiosité surprend depuis le milieu des années 70 pour l’étendue, la
diversité et la qualité de ses réalisations dans des domaines aussi
différents que l’architecture, l’architecture d’intérieur, la muséographie,
le design, l’urbanisme… Électron libre, son esprit créatif n’a de cesse
d’étonner et de forcer l’admiration par ses réalisations imposantes comme
celles plus discrètes. Rien n’est acquis sauf l’ouverture d’esprit, sans
cesse remise sur le métier comme pour le stade Allianz Riviera. Le soin
apporté à chaque détail, même le plus infime, la conjugaison des sources
d’inspiration et des cultures et une attraction immodérée pour l’art
composent son univers ainsi qu’il ressort de ce bel ouvrage paru aux
éditions SKIRA et présentant les plus audacieuses réalisations de Wilmotte &
Associés. L’entretien de Jean-Michel Wilmotte avec Taco Dibbits (Directeur
du Rijksmuseum Amsterdam) permettra également de se faire rapidement une
idée de ce créateur impénitent. Les 300 photographies réunies offrent elles
aussi un bel aperçu de l’ampleur et de la qualité des créations réalisées
tel l’Hôtel Lutetia récemment rouvert à Paris, le siège londonien de Google,
le stade de Nice ou encore le Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe
sans oublier les innombrables muséographies réalisées.
Cet éclectisme ne doit pas cacher la griffe Wilmotte faite de cette délicate
alliance de sobriété et de transparence afin de valoriser les espaces et le
rapport entretenu entre le visiteur et les œuvres d’art notamment pour ses
réalisations pour le musée du Louvre dans l’Aile Richelieu et le département
des Arts premiers au Pavillon des Sessions. Tout visiteur de la collection
Pinault à La Dogana de Venise se souvient en effet de cette habileté à jouer
des contrastes entre l’espace, le volume, les ouvertures et la lumière. La
muséographie et la scénographie sont des arts à part entière et Jean-Michel
Wilmotte démontre par son inspiration que ses réalisations nourrissent de la
plus belle manière qu’il soit le rapport d’un objet à son espace. |
| |
 |
Stefano
Zuffi : "Le Caravage par le détail", version compacte, 156 x 196 mm, 288 p.,
Éditions Hazan, 2021.
L’œuvre du Caravage s’avère être aussi foisonnante que complexe, à l’image
du peintre dont le destin tragique éclaire un grand nombre de ses
compositions. Aussi, Stefano Zuffi a-t-il conçu « Le Caravage par le détail
» comme un ouvrage clair et accessible, afin d’entrer au cœur de cette
création d’un des plus grands peintres de son temps.
Retenant une approche qui a fait le succès de la collection, c’est par le
détail d’œuvres aussi célèbres que Bacchus, Méduse, David et Goliath, Judith
décapitant Holopherne, et La Diseuse de bonne aventure, que le lecteur se
familiarisera avec l’univers de Caravage dès les premières pages de
l’ouvrage. La vie de Michelangelo Merisi, plus connu sous son nom d’artiste,
Le Caravage, s’apparente au clair-obscur dont il façonne ses toiles : une
lutte éternelle entre la lumière d’une inspiration foudroyante et la
pénombre des affres vécus par le peintre toujours en lutte avec lui-même et
ceux qui croiseront sa vie. Né en 1571 à Milan, la période romaine de
Caravage sera essentielle pour celui qui « …était venu au monde pour
détruire la peinture », souligna abruptement Nicolas Poussin. Si cette
appréciation témoigne de l’effet révolutionnaire que fit ce peintre sur ses
contemporains et ses successeurs au XVIIe siècle, elle révèle aussi
l’ampleur de la tempête artistique qu’initia, en effet, le jeune et fougueux
peintre sur la peinture italienne. Adepte du clair-obscur qui allait envahir
toutes ses toiles comme pour mieux révéler l’âme de ses représentations,
l’artiste s’imposera comme le plus grand peintre naturaliste de son temps,
avec cependant un naturalisme bien singulier pour l’époque.
Si l’artiste mena souvent un parcours solitaire, ce dernier ne sera pas
néanmoins sans relation avec les cercles intellectuels de son époque. Alors
que le fougueux peintre entretint des rapports souvent conflictuels avec
certains de ses contemporains, tel le peintre Annibal Carrache, Le Caravage
sut également nourrir des rapports fructueux avec les poètes et musiciens
qui viendront inspirer des œuvres comme celle du fameux Joueur du Luth. Les
mécènes notamment le marquis Giustiniani (1564 - 1637) et le cardinal
Francesco Maria del Monte (1549 - 1627) auront, eux aussi, une grande
importance dans le parcours du Caravage en étant à l’origine de nombreuses
commandes.
L’artiste se fait remarquer très tôt pour son art à peindre d’après un
modèle vivant, une manière qui aura d’ailleurs une influence déterminante
sur ses contemporains et successeurs. Au lieu de copier les maîtres, il
s’essaie avec le talent qui sera le sien à des représentations personnelles
atypiques comme celle du Petit Bacchus malade, œuvre qui marque la rupture
avec son maître le Cavalier d’Arpin dont il quittera l’atelier après huit
mois seulement. Ce naturalisme va se développer pendant ces riches et
fertiles années romaines jusqu’à ce que le peintre fuyant son destin de
toiles en rixes, achève cette période romaine avec le meurtre suite à une
bagarre avec Ranuccio Tomassoni en 1606, ce qui lui vaudra une peine d’exil.
Ce sera alors Naples, Malte…et la mort au terme de cette fuite incessante.
Stefano Zuffi a privilégié une présentation des œuvres du peintre délaissant
l’ordre chronologique au profit de thèmes récurrents tels les natures
mortes, les lames étincelantes, les cinq sens, les têtes tranchées, les
corps, etc. Comme à l’accoutumée, de gros plans sur de nombreux détails
révèlent la création caravagesque de manière lumineuse et pédagogique
offrant ainsi un ouvrage passionnant. |
| |
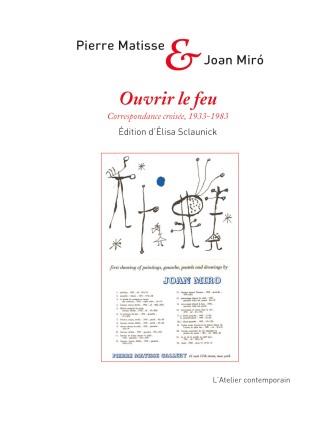 |
«
Pierre Matisse & Joan Miró ; Ouvrir le feu – correspondance croisée,
1933-1983 » ; Édition établie, annotée et présentée par Élisa Sclaunick, 16
x 20 cm, 792 p., L’Atelier contemporain éditions, 2020.
Si le nom d’Henri Matisse est mondialement connu, celui de son fils Pierre
est resté plus confidentiel et réservé à l’univers des marchands d’art du
XXe siècle, monde auquel il appartenait. Son action inlassable à faire
connaître des peintres comme Chagall ou Miró qui s’avéreront être des icônes
de l’art moderne a été, pourtant, majeure bien que quelque peu méconnue du
grand public. Cette ample et volumineuse correspondance entretenue entre le
marchand d’art, Pierre Matisse, et le peintre espagnol Joan Miró (1893-1983)
publiée par les éditions de l’Atelier contemporain offre à la fois une mise
au point et une mise en perspective des plus fructueuses.
Cet ensemble épistolaire dépasse, en effet, rapidement les relations
d’affaires pour dresser un tableau évocateur, vu de l’intérieur, du monde de
l’art de cette époque. À l’image de l’action entreprise par Pablo Picasso,
Pierre Matisse reste persuadé que seule une action engagée peut assurer une
meilleure diffusion des œuvres créées par ces artistes pour la plupart
encore méconnus. C’est une relation amicale, mais surtout d’initiés qui va
ainsi se tisser au fil des pages dès 1933.
Le début de cette correspondance dévoile un peintre espagnol aspirant à une
reconnaissance internationale, passant par les États-Unis, et bien sûr, New
York, où Matisse possède une galerie reconnue en raison de ses relations
dans le monde de l’art. Ainsi que le souligne Élisa Sclaunick qui a établi
l’édition de cette correspondance, Pierre Matisse encouragera et sera le
spectateur privilégié de la fabrique de l’œuvre du peintre espagnol : « Joan
Miró rend précisément compte de la progression de son travail, de sa
manière, de la façon dont il crée. Il est plaisant de voir se dessiner un
mythe forgé notamment par Michel Leiris amusé du contraste entre cet artiste
et son voisin de la rue Blomet, André Masson : Joan Miró est très ordonné,
très organisé dans son travail, capable de prévoir son travail à l’avance,
de suivre le rythme qu’il s’est fixé, comme il le répète souvent à Pierre
Matisse, peut-être pour rassurer en lui le marchand désireux de faire des
expositions et de réaliser des ventes ». Et effectivement, Joan Miró tient
rigoureusement dans ces lettres le journal de sa création dont les nombreux
détails précisent non seulement sa manière de travailler, mais surtout la
vision de son œuvre en création justifiant le temps passé à son travail pour
son marchand.
Rapidement, à la fin des années 30, Pierre Matisse disposera de l’essentiel
de l’œuvre peint de Miró et confiera avec un jugement d’une rare acuité «
qu’il y a tout lieu de croire que le marché le plus important pour votre
œuvre se trouve ici et que nous arrivons à le développer, c’est ici qu’il
faut faire le grand effort »… Au fil des années, les relations gagnent en
profondeur et en amitié, sur un ton plus direct, Pierre Matisse confiera
sans détour à son ami peintre ce qu’il pense être le mieux pour son œuvre et
son image, indépendamment de toute considération marchande : « On vous
engage dans des chemins où votre dignité souffre et votre réputation en
sortira endommagée. Il est temps de freiner et de refuser à vous prêter à ce
jeu », note-t-il dans une lettre du 30 septembre 1954 à l’occasion de ses
relations avec Aimé Maeght. Ce que nous considérons en ce XXI° siècle comme
des « classiques » de l’art moderne, notamment les céramiques de Miró sont
encore balbutiants, ainsi qu’en témoignent ces échanges épistolaires,
l’artiste s’inquiétant d’un possible faible intérêt pour ces dernières de la
part du marchand d’art.
Une correspondance riche et féconde dans laquelle la complicité qui unit les
deux hommes converge pour établir la reconnaissance d’une œuvre originale et
unique, présentée et commentée « en direct » au fil des pages. C’est
véritablement au cœur de l’atelier de Miró, mais aussi de celui du monde de
l’art du XXe siècle que ces échanges s’échelonnant sur cinquante ans nous
convient, dévoilant au lecteur plus qu’une époque, une évolution
déterminante dans l’histoire de l’art.
Philippe-Emmanuel Krautter
|
| |
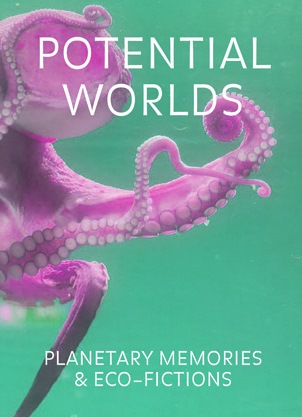 |
«
Potential Worlds – Planetary Memories & Eco-fictions »; Textes de Benjamin
H.Bratton, TJ Demos, Reza Negarestani et Jussi Parikka; Introduction de Suad
Garayeva-Maleki et Heike Munder ; 18 x 23,5 cm, 272 p., 1ère édition,
Éditions Scheiddeger & Spies, 2020.
« Potential Worlds » réunit un vaste ensemble d’œuvres récemment montrées
dans le cadre de plusieurs expositions notamment à Zurich (au Migros Museum
für Gegenwartskunst) et à Bakou (au YARAT Contemporary Art Space). Œuvres de
pas moins de trente-six artistes venus du monde entier, chacune d’elle a à
cœur de révéler les désastres subis par la nature et notre environnement.
Collages, montages, clichés ou installations, etc. Ce sont des œuvres de
conviction, originales, singulières et d’une extrême variété dénonçant
toutes à leur manière l’exploitation sans limites des richesses et
ressources de notre univers et ces indéniables conséquences écologiques et
sociales.
Avec des textes signés Benjamin H.Bratton, TJ Demos, Reza Negarestani et
Jussi Parikka, chaque auteur entend accompagner ces œuvres fortes et mettre
en perspective, chacun avec leur propre regard, les différentes façons de
concilier la nature, l’avenir et notre environnement. Des approches tant
écologiques que posthumanistes dans lesquelles l’art a un rôle essentiel à
jouer en tant qu’expérience tant technologique, scientifique et sociale
telle notamment l’adaptation artistique des nouvelles technologies.
L’ouvrage, introduit par Suad Garayeva-Maleki, commissaire et directrice du
YARAT Contemporary Art Space Migros, et Heike Munder, directeur artistique
du Museum für Gegenwartskunst, se propose avant tout de rechercher au
travers de ces différentes annexions et exploitations de notre environnement
quelle serait la meilleure – et peut-être la plus protectrice - définition
de la nature qui pourrait dès lors, et dès aujourd’hui, en être dégagée.
Une approche engagée nous interrogeant, bien sûr, sur la crise
environnementale que notre monde actuel connaît et visant à orienter notre
regard vers la nature de demain, celle que souhaiterions. |
| |
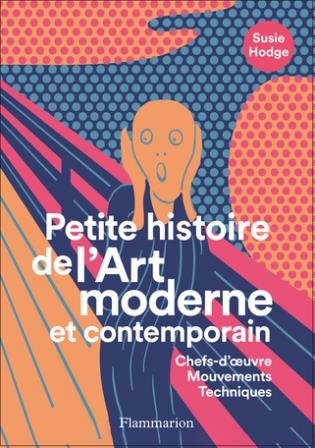 |
Susie Hodge : « Petite histoire de l’art moderne et
contemporain ; chefs d’œuvres, mouvements, techniques » ; Broché, 148 x 210
mm, 150 illustrations, 224 p., Coll. « Petite histoire de », Éditions
Flammarion, 2020.
Susie Hodge, historienne, auteur de nombreux ouvrages et artiste elle-même,
nous livre, dans la collection « Petite histoire de », une collection
aujourd’hui bien connue aux éditions Flammarion, une fort attrayante
introduction à l’histoire de l’art moderne et contemporaine.
L’ouvrage a retenu quatre grandes divisions, partant des grands mouvements
ou styles ayant marqué l’art moderne et contemporain (du réalisme aux
YougBritish Artists) jusqu’aux différentes techniques que ces arts ont su
retenir et développer dont notamment « l’impasto », le Ready-Made, les
matériaux industriels ou encore l’art vidéo. Deux chapitres essentiels entre
lesquels viennent s’intercaler pour mieux les illustrer les plus grands
chefs œuvres et les thèmes classiques ou majeurs, offrant ainsi au lecteur
un large éventail d’artistes et d’œuvres choisi et illustré. Chaque section
pouvant être abordée et lue séparément, et comportent des renvois forts
utiles vers les autres parties
L’auteur réussit ainsi le pari d’expliquer de manière claire et concise
l’art moderne depuis Courbet, puis l’art contemporain jusqu’à nos jours avec
notamment l’installation de Yayoi Kusama. Une évolution majeure pour
laquelle Susie Hodge a su également sans en brouiller le sens mettre en
évidence les différences influences, interactions et connexions.
Chaque partie offre, en effet, pour chaque mouvement, chefs d’œuvres, thèmes
ou techniques, présentés sous forme de fiche, les différents points de
repère, associations ou liaisons indispensables à une pleine appréhension
(date, auteurs associés, lieux, etc.) de l’art moderne et contemporain.
Un ouvrage présentant un large panorama de l’art moderne et contemporain
plus que clair et pédagogique, aussi plaisant qu’indispensable ! |
| |
 |
Charlie
Koolhaas : "City Lust - London Guangzhou Lagos Dubai Houston », texte en
anglais, relié, 412 p., 354 illustrations couleur, 20.5 x 30 cm, Scheidegger
Éditions, 2020.
C’est hors et bien loin des sentiers battus auquel nous convie le dernier
ouvrage de l’artiste Charlie Koolhaas. L’auteur invite en effet à un
dialogue incessant entre mots et images par le filtre des grandes villes
dans lesquelles elle a vécu ou travaillé. Les confrontations engendrées par
la mondialisation et les traits culturels originels de ces mégapoles ne
cessent d’interroger son regard, qu’il s’agisse de Londres, Dubaï ou
Houston, des métropoles pourtant différentes mais qu’une culture mondiale
tend aujourd’hui à rapprocher. Il ne s’agit pas ici d’un plaidoyer, ni d’une
diatribe sur la mondialisation, mais d’un témoignage vécu de l’intérieur,
source de ces nombreuses créativités pouvant surgir de ces grandes
tendances.

À l’image des nouvelles solidarités qui peuvent naître des
plus grandes fractures sociales et économiques, de nouveaux regards peuvent
aussi provoquer des fulgurances inattendues parmi les décombres de
l’économie mondiale. Les photographies et le texte de Charlie Koolhass ne
manquent pas d’humour lorsque surgit parmi la grisaille urbaine des couleurs
éclatantes, symboles d’espoirs encore présents. Les contrastes sont
manifestes dans ce regard porté comme pour mieux rappeler cet incroyable
brassage international auquel ce siècle, et le précédent, nous ont habitués
ou contraints.

Certes, tout n’est pas rose sous le regard de Charlie
Koolhass, tant s’en faut, mais une certaine poésie émerge cependant, contre
toute attente, de ces prises de vues étonnantes, un brin de vie né des
paradoxes de nos capitales internationales et qui livre au lecteur comme un
témoignage d’espoir malgré les sombres nuages pesant sur l’humanité. |
|
Spiritualités |

 |
Pour
l’Avent 2025, deux initiatives de prières sous la forme de livret…
Le magazine Magnificat publie un Hors-Série
intitulé « En route vers Noël ! » ; une injonction, comme à l’accoutumée,
placée sous le signe de la parole de Dieu et de la méditation pour chaque
jour de cette période de l’Avent qui s’étend du 1er au 25 décembre 2025. Ce
livret au format aisément transportable permettra au fidèle de prier au
quotidien en lisant une parole de la liturgie, en récitant ou en chantant un
psaume, sans oublier une prière d’intercession et une proposition de
méditation. Ce compagnon de l’Avent qui inclut un commentaire de Noël de
Monseigneur Dominique Lebrun sera l’occasion de nourrir la préparation de
chaque fidèle vers la joie de Noël.
Pour les lecteurs de la langue de Dante, les éditions du
Centro Ambrosiano de Milan publient, quant à eux, un livret de Monseigneur
Mario Delpini intitulé « Prego con te – A tu per tu con Dio ogni giorno
» littéralement je prie avec vous - Face à face avec Dieu chaque jour.
L’archevêque de Milan, le plus grand diocèse d’Italie, nous fait le beau
cadeau de prendre le temps de prier avec nous, à chaque page de ce livret ;
une invitation lancée par ailleurs à chaque membre des familles préparant
l’Avent 2025, un Avant qui a déjà débuté en Italie. Ce don de prier ensemble
repose sur cette idée de partage, même au cœur de la plus grande des
solitudes, que le dynamique évêque entend rompre par ces instants de
méditation ouvrant vers le mystère de Dieu incarné. Une prière pour chaque
jour, avec des psaumes, une oraison extraite du Missel Ambrosien, une prière
d’intercession sans oublier une préparation aux fêtes de la Nativité, et
même, des prières pour les instants les plus difficiles viennent compléter
ce petit et néanmoins bien précieux guide de l’Avent. |
| |
 |
Xavier
Morales : « 325. Le grand et saint synode de Nicée », Le Condottierre
Editions, 2025.
Xavier Morales, théologien et professeur de patristique, propose à ses
lecteurs avec son dernier ouvrage de revenir sur un évènement déterminant de
l’histoire de l’Église et de l’histoire de manière générale : le Concile de
Nicée de 325. Nous fêtons en effet en cette année le 1 700e anniversaire de
ce premier concile œcuménique convoqué par l’empereur Constantin au IVe
siècle ; un Concile qui connaîtra l’une des plus grandes controverses née
avec l’arianisme niant la divinité de Jésus-Christ et son égalité avec le
Père. Ce ne sont pas moins de 318 Pères qui se réuniront afin de préserver
l’unité de la foi d’une Église encore fragile dans une époque troublée où
l’empire voit ses frontières menacées de l’extérieur et la stabilité
intérieure contestée.
De ce concile dont l’importance se trouve détaillée et expliquée par
l’auteur en un style didactique et accessible naîtra le fameux Credo
(complété par le Concile Constantinople de 381), un Credo bien connu puisque
proclamé encore chaque dimanche lors de la liturgie. Ces pages font ainsi
revivre les débats christologiques opposant les partisans de l’arianisme à
ceux soutenant la consubstantialité du Fils au Père en rappelant dans le
détail les participants à ce « Grand et saint synode de Nicée », les canons
adoptés sans oublier la détermination de la date de célébration de Pâques.
Cet ouvrage incisif permet ainsi de mettre en perspective non seulement les
sources disponibles quant à leur authenticité et à leur portée, mais offre
également une synthèse pédagogique de ces débats souvent ardus et dont les
enjeux sont, ici, soulignés de manière accessible. Avec ce concile, rappelle
cet ouvrage, prend en effet forme la doctrine chrétienne en un élan d’unité
qui sera déterminant pour l’histoire de l’Église, un moment clé que cet
ouvrage éclaire de manière synthétique et analytique.
Philippe-Emmanuel Krautter |
| |
 |
Anthony
Giambrone : "La Quête du Christ historique" ; Traduction sous la direction
de Renaud Silly ; Préface de Régis Burnet ; 528 p., Éditions Les Belles
Lettres, 2024.
L’ouvrage d’Anthony Giambrone paru aux éditions des Belles Lettres propose
de revenir sur l’un des débats les plus anciens et complexes de la théologie
chrétienne et de l'historiographie à savoir « La Quête du Christ historique
». Depuis le XIXe siècle, historiens et théologiens s’attachent en effet à
redéfinir l’identité et place de Jésus de Nazareth à partir des sources
historiques dont nous disposons, en particulier les Évangiles. L’auteur,
lui-même dominicain et élève de John P. Meier célèbre pour sa volumineuse
enquête en quatre volumes - « Un certain juif Jésus », s’inscrit dans cette
démarche en proposant une voie médiane, ayant recours aux dernières
découvertes récentes et méthodologies critiques.
Tout débute par une enquête sur le contexte historique, démarche initiée par
les travaux de David Friedrich Strauss au XIXe siècle. Progressivement,
l’auteur cherche à montrer combien ses prédécesseurs ont tenté de distinguer
aspects historiques de la vie de Jésus et dogmes relevant de la foi. Grâce à
ce fort volume de plus de cinq cents pages, le lecteur prendra connaissance
non seulement des sources disponibles sur ce sujet sensible, mais également
une critique rigoureuse de ces dernières. Entre Évangiles canoniques et
apocryphes, historiens tel Flavius Josèphe et documents romains, les nuances
s’imposent quant à leur interprétation, ce que souligne l’auteur qui
n’hésite pas à questionner les critères d’authenticité de ces sources et à
en souligner les limites et questions cruciales.
Anthony Giambrone souligne les risques à se limiter aux seules dimensions du
Jésus historique sous peine d’effacer inexorablement toute dimension
spirituelle. C’est à la réunion de ces deux approches souvent opposées à
laquelle invite l’exégète afin de préserver la profondeur même de la
personne du Christ, sans pour autant nier les éléments factuels touchant à
sa vie. En un style didactique et accessible malgré la complexité du sujet,
l’auteur réussit à démêler les fils de l’histoire de Jésus, rappelant les
faiblesses des approches le « déshistorisant ».
Sans proposer de nouvelle position sur la quête du Christ historique,
l’ouvrage d’Anthony Giambrone entend clarifier un champ d’études
particulièrement complexe à partir d’une habile étude des données de
l’Histoire et de la foi.
Philippe-Emmanuel Krautter |
| |
 |
Maurice
Zundel : « Dieu qui rend libre » - Œuvres complètes - Tome VII édité par
Marc Donzé, Editions Parole et Silence, 2024.
Il n’est plus nécessaire de présenter le grand théologien que fut Maurice
Zundel, nos lecteurs ayant suivi les précédentes recensions de l’édition
complète de ses œuvres aux éditions Parole et Silence. Marc Donzel,
spécialiste de la pensée de Maurice Zundel, a réuni pour ce septième volume
deux ouvrages « La liberté de la foi » et « Morale et mystique », ainsi que
23 articles couvrant la période de 1960 à 1963, sans oublier un important
texte intitulé « Découverte de Dieu » regroupant quatre conférences que
donna l’abbé durant l’Avent 1961.
Nous retrouvons, dans ces pages brulantes de foi et inspirées, toute la
rigueur de l’intellectuel exigeant que fut Maurice Zundel et ce désir
insatiable de transmettre au plus grand nombre ce feu intérieur qui
l’habitait depuis ses plus jeunes années. C’est justement avec « La liberté
de la foi » que le lecteur pourra puiser dans ces pages vibrantes cette
quête de la Présence divine et aimante dont le théologien avait su partager
les plus rayonnantes émotions. Ce regard porté sur l’homme, ce « croire en
l’homme » si cher au théologien demeure indissociable des liens avec la
création et l’univers. Pour Zundel, c’est dans nos quotidiens que s’établit
l’éternité.
Plus encore qu’à l’époque de Maurice Zundel, évoquer les notions de « Morale
et Mystique » est toujours entreprise délicate après les Lumières, la
Révolution de 1789 et Mai 68. Une fois de plus, le théologien suisse esquive
toute dogmatique pour se décentrer sur l’analyse de l’homme afin d’en
esquisser les bases ontologiques permettant de mettre au jour une morale «
naturelle », non limitante et dégagée de l’ordre social. Face au relativisme
déjà sensible à l’époque où il écrivit ces pages, Maurice Zundel prône la
quête d’un absolu moral qui puise une fois de plus ses racines dans la
nature même de l’homme et la rencontre de l’Amour infini ; celle du Dieu
Trinité Amour, d’où le rapprochement des concepts de morale et mystique
entendus dans la réalité de nos vies au quotidien, ainsi que le souligne le
théologien : « Rien n’est plus terre à terre que la vraie mystique,
c’est-à-dire rien n’est plus réel, comme rien ne tient plus fermement au sol
qu’une cathédrale »…
Dans la dernière partie de ce volume, le lecteur trouvera matière à
méditation avec les conférences toujours aussi stimulantes du théologien,
conférencier aussi passionné que passionnant. Ces textes couvrant la période
de 1960 à 1963 témoignent de l’ampleur des sujets abordés par Zundel allant
de thèmes aussi divers que « Sexualité et personnalité » aux pages si
directes si l’on songe à l’époque et à la qualité de celui qui les écrivit
(notamment sur la déception de la femme dans le rapport amoureux), mais
aussi « La dignité de la vie prénatale », « La souffrance de Dieu » ou
encore « L’expérience de la mort ». Un ouvrage exigeant, mais toujours
stimulant qui élargira la vision de tout chrétien.
Philippe-Emmanuel Krautter |
| |
 |
Saint
Jean de la Croix : "Cantique Spirituel" ; Traduction Jean-Marc Sourdillon,
illustrations Catherine Sourdillon, Illador Éditions, 2023.
Jean-Marc Sourdillon, accompagné de Catherine son épouse pour
l'illustration, nous propose en ces pages une merveilleuse traduction et
édition du poème Le Cantique Spirituel de saint Jean de la Croix ; un poème
né dans les tréfonds d'une geôle dans laquelle saint Jean de la Croix avait
été tenu captif dans des conditions effroyables. Le réformateur du carmel,
compagnon de sainte Thérèse d'Avila, s’était heurté à l'opposition des
conservateurs de son ordre. C'est dans ce contexte digne de l'Inquisition
que Juan de Yepes Álvarez, de son nom d'église Jean de la Croix, composera
ces vers mentalement, l'écriture lui étant formellement proscrite.
Le lecteur du 21e siècle ne pourra qu’être ébloui par le degré de foi
atteint pour avoir fait naître une telle confession amoureuse à partir des
abîmes les plus sombres. Travaillant de mémoire, le saint mystique revisite
le célèbre Cantique des Cantiques bibliques pour en proposer une variation
lumineuse et pleine d'espérance. Le traducteur, Jean-Marc Sourdillon, s'est
attaché à souligner la délicatesse incandescente de cette poésie allégorique
entre l'époux et l'épouse, l'âme et son créateur. Entrelacs amoureux
ineffables et pourtant magnifiés par le verbe, tension exclusivement portée
par l'abandon mystique :
“ Mon âme s'est mise, et tout mon avoir, à son service.
Je ne garde plus les bêtes, je n'ai plus d'autre office,
aimer est à présent mon seul exercice”.
C'est un souffle unique que nous propose cette très belle édition servie par
les illustrations irradiantes de Catherine Sourdillon soulignant
l'embrasement provoqué par cet amour mystique.
Philippe-Emmanuel Krautter |
| |
 |
« La
Vie de la Vierge Marie » de Marie-Gabrielle Leblanc ; Photographie de John
Pole ; Editions Pierre Téqui, 2023.
C’est un merveilleux ouvrage consacré à « La vie de la Vierge Marie dans
l’art » que nous propose Marie-Gabrielle Leblanc, historienne d’art, aux
éditions Pierre Téqui. Une vie de Marie extrêmement détaillée et superbement
illustrée par une centaine d’œuvres d’art du Moyen-Âge à nos jours. Allant
de la « Naissance de la Vierge Marie, ses parents et son enfance » à « La
Sainte Famille » en passant par « L’Immaculée Conception », son mariage, «
l’Annonciation…, ce sont ainsi pas moins de 10 chapitres de la vie de la
Vierge Marie que le lecteur retrouvera. Des épisodes de sa vie qui, après
avoir été préalablement explicités, se dévoilent plus encore au travers des
plus belles œuvres d’art ; des œuvres, connues ou moins connues, du VIIIe au
XXIe siècle, analysées et présentées pour chacune sur une double page. C’est
donc à un véritable dialogue auquel nous convie Marie-Gabrielle Leblanc,
auteur déjà dans la même collection de plusieurs ouvrages remarqués
consacrés à la vie du Christ.
Bien que reposant sur l’Ancien et le Nouveau Testament de la Bible Crampon,
cet ouvrage se veut avant tout un livre d’histoire de l’art plus qu’un
ouvrage théologique. Aussi, trouvera-t-on également - ce qui est un peu
inévitable concernant les épisodes de la vie de Marie – des références aux
évangiles apocryphes. L’auteur a cependant souhaité rassurer son lecteur en
soulignant dès son avant-propos : « … je m’efforce d’être fidèle aux dogmes
enseignés par l’Église catholique et attentive aussi à ce qu’enseignent en
matière d’iconographie chrétienne, les Églises orthodoxes et orientales
pré-chalcédoniennes comme Coptes. » Une précision bien venue faisant de cet
ouvrage une très riche et belle ouverture aux mystères de la Vierge Marie. |
| |
 |
« Saint
Michel » ; Collectif, 256 p., Editions du Cerf, 2023.
A souligner la parution aux éditions du Cerf d’un splendide ouvrage
entièrement consacré à saint Michel. Rappelons que le culte de saint Michel,
ange de Dieu avec Raphaël et Gabriel, est l’un des plus anciens de la
chrétienté et qu’il est l’un des saints les plus vénérés que ce soit en
Orient ou en Europe. Fêté en France le 29 septembre, on ne compte plus le
nombre de cathédrales, chapelles, sanctuaires, grottes ou ermitages dédiés à
ce saint patron de la France et de la Normandie, mais aussi de la Cité du
Vatican, de Kiev ou encore de Bruxelles.
Réunissant sous la direction de Giorgio Otranto et de Sandro Chierici les
meilleurs spécialistes, historiens et médiévistes, l’ouvrage remarquablement
illustré nous livre la vie, l’histoire, la représentation et la dévotion
dévolue à ce saint archange tant prié dans le monde. Avec de riches
contributions et pas moins de 300 illustrations, c’est véritablement à un
magnifique pèlerinage dédié à celui dont le nom signifie en hébreu « Qui est
comme Dieu » auquel nous invite cet ouvrage collectif. Un pèlerinage tant
dans la vie religieuse et l’Histoire, notamment au Moyen-âge, mais aussi
dans l’histoire de l’art ou de la littérature sans oublier les lieux de
cultes incontournables lui étant consacrés : le Mont-Saint-Michel, bien sûr,
mais aussi l’Abbaye Saint Michel-de-la-Cluse... une analyse iconographique
poursuivie et élargie à toute l’Europe et au-delà, nous entraînant notamment
en Irlande où l’archange Michel est très présent, mais également en terres
ibériques ou encore dans les lointaines contrées russes…
Un ouvrage offrant une passionnante analyse consacrée à saint Michel, cet «
Ange des hauteurs » pour reprendre le titre du Père Ladislao Suchy, Recteur
du sanctuaire de Saint-Michel-Archange, Monte Sant’Angelo. |
| |
 |
«
Les Saints – Aventure spirituelle et représentation » de Robert Bared,
Editions Hazan, 2023.
Chaque jour de l’année apporte son saint, et que l’on soit croyant ou non,
nombre d’entre nous aiment souhaiter les fêtes de nos proches, amis ou
collègues, ce qui souligne combien les saints sont encore dans notre
quotidien bien vivants ! Mais les connaît-on vraiment ? C’est justement pour
combler notre curiosité que les éditions Hazan proposent cet agréable
ouvrage signé Robert Bared. Plus de 77 saints – chiffre à symbolique
biblique – de l’histoire chrétienne sont ainsi présentés selon une mise en
pagne claire et pédagogique, avec une double page pour chaque saint.
Commençant par le Prince des anges, l’archange Michel, l’ouvrage poursuit
égrenant les saints selon un ordre chronologique de leur mort. « Comme tout
corpus – souligne Robert Bared dans sa préface, celui-ci peut avoir sa part
de subjectivité, mais il a été surtout déterminé par la conjonction de deux
critères objectifs : la vivacité du culte à travers les siècles et la
présence notable dans l’histoire de l’art. »
Le lecteur découvrira ainsi pour chaque saint non seulement leur vie
terrestre parfois bien surprenante et leur vie spirituelle avec leurs
miracles, mais également leurs attributs et représentation. À cela
s’ajoutent pour chaque étude, outre la date de leur fête, leurs principaux
cultes et patronages. Enfin, et cela est assez rare pour être souligné, le
lecteur retrouvera précisées pour chacun les scènes où ces derniers sont
habituellement représentés en art, ainsi qu’en regard une reproduction d’une
œuvre les représentant plus précisément accompagnée d’une citation biblique,
poétique ou littéraire. Des représentations, œuvres ou chefs-d’œuvre
révélant combien les saints sont présents tant dans les églises que dans nos
musées. Il est vrai, et ainsi que le souligne le dernier texte venant clore
ce merveilleux ouvrage : « Tant qu’il y aura des saints… » ! |
| |
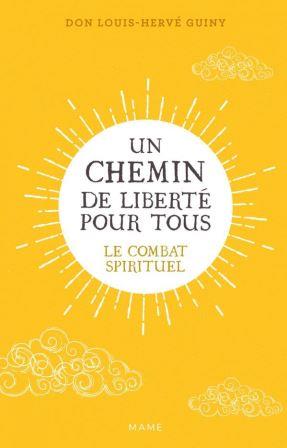 |
"Un chemin de
liberté pour tous : le combat spirituel" de Don Louis-Hervé Guiny, 224
pages, Editions MAME, 2024. Le combat spirituel
contrairement à ce que l’on pourrait penser n’appartient pas qu’aux seuls «
professionnels » de la foi et encore moins à un passé révolu. Combattre ses
démons intérieurs – et extérieurs – et rechercher le discernement
constituent encore une quête que tout à chacun peut et se doit de mener au
risque d’être balloté telle une feuille sur le flot de ses passions.
C’est à cette attitude de corps et d’esprit à laquelle nous convie Don
Louis-Hervé Guiny, par ailleurs professeur de théologie. L’ouvrage à la fois
très accessible et exigeant démêle un à un tous les niveaux permettant à
chaque croyant de s’élever au-delà des passions tristes pour atteindre la
lumière. L’auteur est bien conscient qu’il ne s’agit pas pour autant de nous
transformer du jour au lendemain en saint mais plutôt d’ouvrir notre regard
sur toutes ces entraves qui enchaînent notre quotidien : tristesse, paresse,
envie-jalousie, angoisse, dépression, la liste est malheureusement encore
longue.
De la même manière qu’un analyste aide son patient à ouvrir son regard sur
ses déterminismes, le combat spirituel invite le croyant à se décentrer pour
mieux observer ses failles, ainsi que le recommandait déjà Ignace de Loyola
dans ses Exercices spirituels ; prendre conscience de ses manquements à la
foi, s’en repentir parfois dans les larmes, d’autres fois avec humour, pour
au final atteindre la lumière.
Si l’accompagnant spirituel revêt une grande importance pour éviter de
s’égarer et de se mentir, la force du Dieu aimant accompagne au quotidien le
fidèle qui s’astreint à cette démarche difficile et semée d’embûches. C’est
toute la force de l’ouvrage de Don Louis-Hervé Guiny que de présenter cette
longue et belle route, certes avec ses cols raides et ravins vertigineux,
mais aussi cette plénitude pour celles et ceux qui chercheront à « imiter »
Celui qui a déjà parcouru pour nous ce chemin sinueux.
|
| |
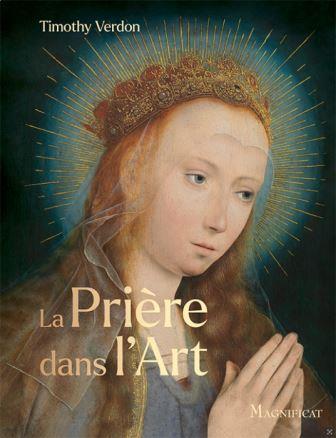 |
« La
prière dans l'art » de Mgr Timothy Verdon ; Couverture Relié - Tranchefile
et jaquette, 272 pp. 22 x 29 cm, MAGNIFICAT, 2023.
L’historien de l’art Mgr Timothy Verdon n’est plus à présenter à nos
lecteurs (lire nos interviews) tant sa pensée
et ses ouvrages sont devenus depuis des années des références notamment dans
le domaine de l’art sacré. Dans ce dernier ouvrage « La prière dans l’art »
paru chez Magnificat, l’auteur explore de manière lumineuse les rapports
intimes entretenus entre image et foi. En analysant de manière à la fois
didactique et scientifique plus de 100 chefs d’œuvre, Timothy Verdon
convoque et invite le lecteur à approfondir sa foi par une meilleure acuité
visuelle artistique. L’élan de la prière se constate assez spontanément sous
ses différentes formes « instinctives ». Mais, afin de dépasser cet élan
premier face au mystère de la vie, la religion chrétienne a proposé depuis
des siècles une prière à la fois consciente et organisée, un « art de la
prière » qui interagit entre le croyant et le sujet de sa foi manifesté par
les plus belles œuvres d’art. Ce sont ces liens intimes et éblouissants
qu’explore avec virtuosité Timothy Verdon qui non seulement bénéficie d’une
culture visuelle immense, mais sait, qui plus est, la faire partager au plus
grand nombre par ses analyses subtiles et néanmoins accessibles. Ainsi,
l’auteur de cet ouvrage aussi beau que profond sollicite-t-il le lecteur
pour qu’il approfondisse son regard porté vers Dieu par l’intermédiaire des
chefs d’œuvre de l’art choisis et abondamment illustrés. La prière, souligne
l’auteur, deviendra ainsi le fruit de l’imagination sanctifiée, une voie
vers la beauté et l’avenir. Ce chemin de la beauté ou via pulchritudinis
se trouve suggéré à chaque page de ce splendide ouvrage, des catacombes de
Priscille de Rome (IIIe s.) à Wilhelm Leibl (XIXe s.). Avec « La Prière dans
l’Art », l’intimité de la Beauté rejoint celle de la Prière en un élan
irrépressible à la transcendance.
Philippe-Emmanuel Krautter |
| |
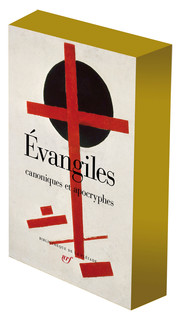 |
« Évangiles
canoniques et apocryphes » - Tirage spécial ; Préface de Paul-Hubert Poirier
; Bibliothèque de la Pléiade, 1136 pages, rel. Peau, 104 x 169 mm,
Gallimard, 2023.
Rapprocher des textes traditionnellement opposés constitue une heureuse
initiative avec cette parution des Évangiles canoniques et apocryphes dans
la collection de la Pléiade aux éditions Gallimard. Ces deux grandes sources
essentielles au christianisme furent initialement opposées aux croyances
gnostiques. C’est à partir d’une relecture drastique des évangiles dits
canoniques que ces derniers furent, par la suite, également opposés aux
apocryphes qui seront alors écartés de la foi de l’Église. C’est sur cette
relecture et ce choix posés notamment par Irénée de Lyon au IVe s. que les
règles de la nouvelle foi allaient dès lors s’établir, laissant ainsi le
merveilleux et l’ésotérique de côté.
Réunir aujourd’hui en un seul volume les quatre évangiles « bibliques » que
les catholiques connaissent bien et les « évangiles » apocryphes longtemps
considérés comme hérétiques offre la possibilité non seulement de discerner
ce qui constitue la foi officielle, mais également de compléter par un fonds
unique le contexte même dans lequel est apparu cette même foi. Ainsi que le
rappelle en préface Paul-Hubert Poirier, cette édition rassemble vingt-huit
textes ayant pour point commun d’évoquer Jésus de Nazareth, qu’il s’agisse
des quatre évangiles du Nouveau Testament, mais aussi des nombreuses autres
sources rangées sous le vocable évangiles apocryphes rédigés de la fin du
1er siècle au début du Moyen Âge.
Si les évangiles retenus par l’Église s’attachent plus au message légué par
le Christ qu’à sa personne, les apocryphes quant à eux retiennent souvent un
angle plus merveilleux composé d’évènements extraordinaires. C’est le grand
intérêt de ce volume de la Pléiade que de réunir pour la première fois ces
sources diverses disponibles jusqu’alors dans des volumes distincts et de
permettre cette confrontation croisée de traditions, légendes, croyances et
message de foi. Entre sources canoniques ou officielles de la foi des
Églises chrétiennes et des textes revisitant la vie de Jésus – et même
parfois son message - les frontières sont parfois ténues, d’autres fois plus
manifestes et conduisant alors à ce qui sera souvent considéré comme des
hérésies. Tout le mérite de cette publication est de permettre au lecteur de
se faire une idée par lui-même, aidé en cela par un important appareil
critique, afin de confronter ces textes pour certains essentiels de la foi,
pour d’autres relevant de la culture et de la tradition léguées par les
premiers temps du christianisme.
|
| |
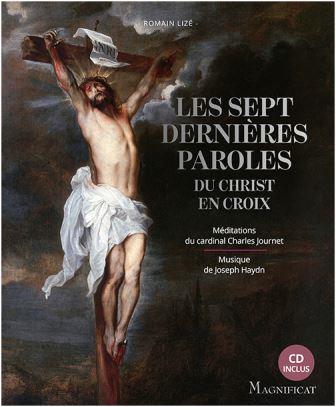
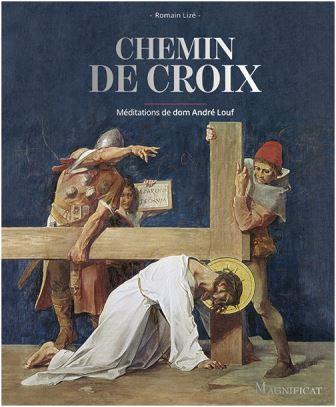 |
« Les
Sept Dernières Paroles du Christ en Croix » et « Chemin de Croix » réalisés
par Romain Lizé, éditions Magnificat, 2023.
Deux parutions récentes accompagneront idéalement le fidèle dans sa
préparation aux prochaines fêtes pascales et la prolongeront même longtemps
après. « Les Sept Dernières Paroles du Christ en Croix » ainsi que le «
Chemin de Croix » réalisés par Romain Lizé aux éditions Magnificat offriront
en effet un matériel spirituel propice à de longues et nombreuses
méditations.
Pour la première de ces parutions, c’est l’œuvre bouleversante de Joseph
Haydn sur les Sept Dernières Paroles du Christ en Croix qui vient soutenir
les méditations fulgurantes du cardinal Charles Journet, l’ensemble étant
mis en lumière par une sélection choisie des plus belles œuvres d’art sacré…
En proposant une heure de méditation par chapitre associée à l’écoute des
pistes du CD audio tout en prenant le temps de l’oraison à l’aide des œuvres
d’art, cet ouvrage offrira un accompagnement spirituel d’une rare profondeur
à celles et ceux souhaitant méditer cette épreuve ultime de la Croix.
Dans le même esprit, la seconde publication, le « Chemin de Croix » réunit
les méditations de dom André Louf, à la fois d’une simplicité…biblique et
d’une intériorité inspirante ! Ainsi que le souligne Romain Lizé en
avant-propos, cet ouvrage accessible permettra d’accompagner le fidèle dans
sa marche vers Pâques, une marche souvent difficile et donnant lieu à de
nombreux écueils et renoncements. Avec ces textes limpides également
illustrés par les plus grandes œuvres d’art sacré, le méditant pourra, pas à
pas, approcher du mystère pascal et chercher la Lumière qui s’en dégage.
|
| |
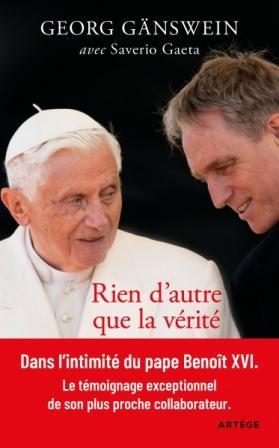 |
Georg
Gänswein : " Rien d'autre que la vérité" Artège, 2023. « Rien d’autre que la vérité
» tel est le titre de l’ouvrage écrit avec le
journaliste Saverio Gaeta par le secrétaire personnel du pape Benoit XVI
récemment disparu le 31 décembre 2022. Ce titre constitue ainsi un écho de
la devise du pape allemand - « ut cooperatores simus veritatis » -
début de la troisième lettre de saint Jean.
Ce rare témoignage de l’un des plus proches du pape émérite ne pourra
qu’attirer l’attention non seulement des spécialistes du Saint-Siège mais de
manière plus générale de toute personne intéressée par le fonctionnement du
plus petit État du monde. Et il faut avouer que l’auteur, Mgr Georg Gänswein,
lui-même théologien et enseignant de droit canon, livre en ces pages un
témoignage sans voile sur les arcanes du Vatican et dont certaines lignes
pourront faire grincer des dents.
Georg Gänswein, jusqu’à l’actuel pontificat du pape François, jouissait de
la réputation d’un homme affable et souriant, à qui tout réussissait avec
son allure photogénique. Pourtant, ces dernières années ont connu des
tensions conduisant à l’écarter des responsabilités qu’il occupait
jusqu’alors en tant que préfet de la Maison pontificale, officiellement pour
le réserver au service du pape émérite… Dans cet ouvrage, Georg Gänswein,
d’origine allemande, rappelle en prologue combien ce qui avait été à
l’origine une nomination « provisoire » aux côtés du cardinal allemand
Ratzinger en 2003 allait devenir un accompagnement jusqu’à l’ultime jour de
sa disparition le 31 décembre dernier… Cette compagnie de tous les instants
se trouve ainsi évoquée dans des pages émouvantes témoignant de la profonde
affection et du respect sans réserve envers le pape Benoît XVI, à mille
lieues des caricatures qui avaient pu être faites de lui.
C’est cet amour filial blessé qui se trouve aujourd’hui exprimé dans ces
mêmes pages parfois impulsives cherchant ainsi à rétablir des vérités qui ne
manqueront d’être commentées ou contestées. Pour Gänswein, Benoît XVI fut en
effet « l’un des plus grands protagonistes de l’histoire du siècle
dernier, trop souvent dénigré par les médias et ses détracteurs… » Aussi
n’hésite-t-il pas à rappeler combien la priorité qui avait été donnée par
Benoît XVI lors de son pontificat à la liturgie et au rapprochement avec les
traditionalistes souhaitant célébrer selon le rite de Saint Pie V venait
d’être balayée d’un revers de main en 2020 par l’actuel pape François, un
revirement qui aurait été douloureux pour le pape émérite…
Aussi faudra-t-il découvrir ces pages comme celles d’un plaidoyer émouvant
et entier pour le pape défunt, un hommage certes parfois acerbe, mais
sincère, et qui permettra de mieux comprendre qui fut Joseph Ratzinger,
Benoît XVI, 265e successeur de Pierre de 2005 à 2013 et pape émérite de 2013
jusqu’au dernier jour de l’année 2022.
Philippe-Emmanuel Krautter |
| |
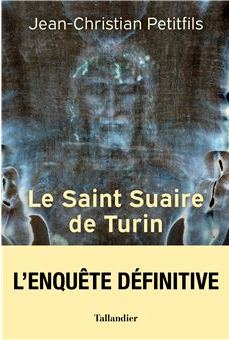 |
"Le
Saint Suaire de Turin" Jean-Christian PETITFILS, 464 pages Tallandier, 2022.
Le Saint Suaire de Turin a fait couler beaucoup d’encre et l’historien
Jean-Christian Petitfils qui avait déjà signé un « Jésus » remarqué et plus
que largement salué, offre avec ce dernier ouvrage une non moins remarquable
synthèse sur ce dossier pourtant sensible. Sensible car le Suaire de Turin
n’a cessé, en effet, de donner lieu à des controverses, non seulement sur
son historicité, mais également sur le sens à donner à cette célèbre toile
de lin. Objet de dévotion et de méditation pour les croyants, de
supputations plus ou moins hasardeuses pour d’autres, le Suaire méritait une
telle étude à la fois détaillée et accessible, ayant recours non seulement
aux disciplines scientifiques quant à sa datation, mais également à
l’Histoire et aux multiples disciplines permettant de mieux appréhender ce
qui a longtemps été une énigme.
Dès l’introduction Jean-Christian Petitfils souligne d’emblée que « toutes
les constatations scientifiques vont dans le même sens, celui de
l’authenticité ». L’historien réputé pour sa proverbiale rigueur ne peut
être suspecté de partialité et fustige ces personnes qui campent sur des
thèses dépassées, notamment celle de la datation erronée au carbone 14 de
1988 dont les résultats avaient été faussés du fait d’une pollution des
tissus examinés et avait conclu de manière hâtive à une datation médiévale…
En un véritable examen des pièces à conviction, l’historien mène son enquête
et retrace tout d’abord dans cet imposant livre les différentes étapes
historiques sur cette question sensible ayant opposé parfois stérilement
discours de la foi et de la science. L’ouvrage détaille ainsi les longues
péripéties du Suaire, les incendies dont il eut à souffrir, ses multiples
lieux de résidence présumés jusqu’à son actuelle conservation en la
cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin. Les villes et les lieux défilent à
une vitesse vertigineuse, ce linceul ayant couvert des milliers de
kilomètres pour arriver dans la capitale du Piémont en un état de fraîcheur
étonnant après tant de péripéties (Petitfils offre d’ailleurs une carte
précieuse retraçant cet itinéraire probable depuis Jérusalem et la mort de
Jésus en 33 ap. J.-C.).
Le lecteur sera également impressionné par la synthèse précieusement
proposée dès différentes analyses scientifiques ayant porté sur le morceau
de tissu dont l’auteur détaille avec minutie les protocoles et conclusions.
La dernière partie intéressera tout autant les fidèles que les passionnés
d’art et de croyance. Rappelant les premières représentations du Crucifié et
leur évolution vers un nouveau modèle à la fin du IVe siècle, Jean-Christian
Petitfils souligne combien un nouveau stéréotype plus figuratif commence à
se diffuser dans l’art, modèle qui n’est certainement pas étranger à la
présence du Suaire dans ces régions…
Cette passionnante enquête tiendra le lecteur en haleine de la première page
jusqu’à la dernière ouvrant sur cette « seconde résurrection » déjà
soulignée par Claudel et qui n’a pas fini de questionner l’homme sur sa
condition et ses convictions.
Philippe-Emmanuel Krautter |
| |
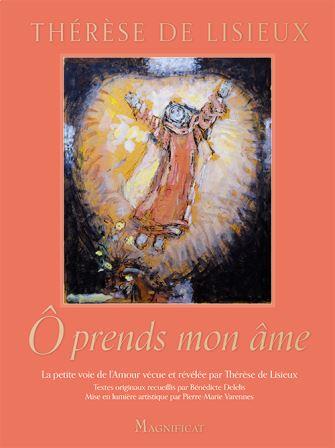 |
"Ô
prends mon âme - Thérèse de Lisieux" de Bénédicte Delelis et Pierre-Marie
Varennes, relié cousu et tranche fil, 192 Pages, Format 24 x 32, Magnificat,
2022.
Publication inspirée pour les fêtes de la Nativité que ce livre d’art
consacré à sainte Thérèse de Lisieux « Ô prends mon âme » !
Les auteurs, Bénédicte Delelis et Pierre-Marie Varennes, ont conjugué leur
savoir pour concevoir à la fois un ouvrage esthétique servi par les plus
belles oeuvres d’art et un florilège de la pensée de la petite sainte du
Carmel de Lisieux. La voie de l’amour, si chère à cette âme éprise d’absolu,
se trouve ainsi présentée dans le plus bel écrin, celui des tableaux
enchanteurs de Maurice Denis, Georges Desvallières, tous deux ardents
chrétiens, mais aussi par d’autres sensibilités tels Claude Monet, Paul
Cézanne ou encore Marc Chagall. Ainsi que le souligne Pierre-Marie Varennes
dans sa préface, Thérèse était convaincue que nous serions jugés sur un seul
critère lors du retour glorieux de Jésus, celui de l’amour par l’amour.
Vaste programme ainsi exploré en ces pages illuminées par la foi de celle
qui sur son lit de mort considérait qu’elle n’était pas une sainte mais bien
« une toute petite âme que le bon Dieu a comblée de grâces » comme le
rappelle Bénédicte Delelis.
Cet ouvrage, en de belles pages, explore ainsi ce « programme d’amour »
délivré par Thérèse à partir de ses plus grands textes. Chaque étape de sa
vie spirituelle se trouve enluminée par les chefs-d’œuvre de la peinture en
des liens intimes conduisant le lecteur à une méditation inspirée. Croire à
l’amour et à ses multiples manifestations dans les instants d’extase comme
ceux du quotidien, telle est l’invitation lancée par Thérèse, et ce
splendide ouvrage, annonçant de la plus belle manière la célébration du 150e
de la naissance de Thérèse de Lisieux. |
| |
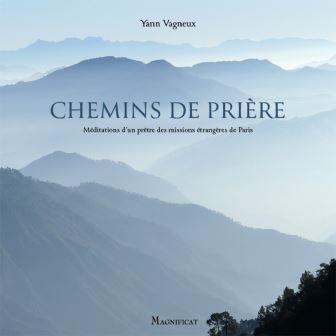 |
«
Chemins de prière » du Père Yann Vagneux, Magnificat, 2022.
Empruntons ces « Chemins de prière » proposés par le Père Yann Vagneux, 12
méditations pour 12 invitations à l’évasion par la prière. Parues dans la
revue Magnificat, ces prières sont le fruit d’un prêtre des Missions
Étrangères de Paris, regard d’un grand priant mais aussi d’un poète doublé
d’un photographe talentueux.
Nourries par ses nombreux voyages, notamment en Inde où l’auteur est établi
depuis de nombreuses années, ces « Chemins de prière » invitent au silence,
un silence qui ne doit pas inquiéter mais au contraire rassurer. Qu’il
s’agisse de méditer sur la grâce sur fond d’une cime montagneuse du Népal
émergeant des nuées ou, plus terre à terre, le désir associé au pas d’un
vieil agriculteur dans une rizière, chaque élan de l’âme humaine trouve un
écho dans ces pages inspirées, à la fois accessibles et parallèlement
élevant l’esprit à la transcendance.
Un beau livre à emporter avec soi sur son lieu de vacances ou chez soi pour
enrichir encore chaque instant de prières. |
| |
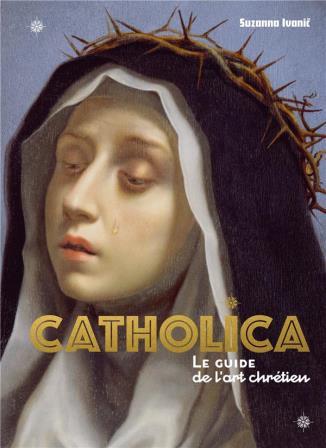 |
«
Catholica – Le guide de l’art chrétien » de Suzanna Ivanic, Cernunnos
éditions, 2022.
Les ouvrages consacrés à l’art chrétien se font rares alors même que cet
immense patrimoine trop souvent ignoré présente des œuvres des plus grands
artistes dans nos musées et églises. Fort de ce constat, Suzanna Ivanic qui
enseigne en Angleterre l’histoire moderne de l’Europe centrale et notamment
la religion, a choisi de réunir en un ambitieux ouvrage de 256 pages plus de
deux milles ans d’art chrétien. Fresques, peintures, retables, parures
liturgiques sont ainsi passés au filtre d’une analyse rigoureuse et
détaillée, servis par une abondante iconographie.
Chaque forme artistique se trouve expliquée, les clés de compréhension des
œuvres présentées étant généreusement précisées au lecteur. Loin d’être
austère et fastidieuse, la lecture de cet ouvrage, qui manquait jusqu’alors,
emporte le lecteur en un passionnant voyage où la spiritualité, les lieux et
enfin l’esprit qui anime communautés et individus sont abondamment
détaillés.
Pour mieux décrypter les sept œuvres de la miséricorde au cœur des plus
grandes toiles des maîtres de la peinture telle celle du Caravage pour la
Confrérie du Pio Monte della Misericordia de Naples, l’auteur fait
véritablement œuvre pédagogique en détaillant chaque aspect à partir de
l’œuvre. Dans le même esprit, l’explication des styles architecturaux
présentés par les cathédrales, églises et chapelles éclaire également la
lecture de cet ouvrage décidément bien utile à la compréhension des cultures
nourries par l’art chrétien. |
| |
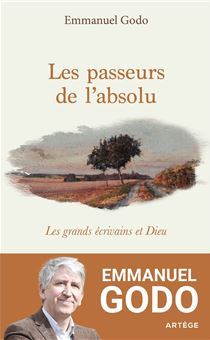 |
Emmanuel Godo : « Les passeurs de l'absolu - Les grands écrivains et Dieu »,
Editions Artège, 2022.
Avec un titre proche de l’oxymore, Emmanuel Godo fait la démonstration dans
son dernier essai « Les passeurs de l’absolu » que les grands écrivains ont
pu par certains de leurs écrits se rapprocher de l’indicible. Relevant d’une
véritable aventure spirituelle, cette quête fait figure de défi, celui de
suggérer, chacun avec son charisme, les cheminements vers la lumière.
Dépassant les scintillements souvent trompeurs de l’éphémère, Emmanuel Godo
part à la recherche des affinités spirituelles léguées par certains
écrivains allant de Dante à Saint Exupéry. Chaque expérience recueillie par
l’auteur, lui-même épris d’absolu, conduit à ce dépassement de l’âme. Cette
élévation peut en effet survenir avec cette « bible des pauvres » que fut
Les Misérables de Victor Hugo, œuvre dont l’importance fut pourtant
redécouverte sur le tard au XXe siècle par la sagacité d’un André Malraux.
Dostoïevski soulignait que "L'humanité peut vivre sans la science, elle peut
vivre sans pain, mais il n'y a que sans la beauté qu'elle ne pourrait plus
vivre, car il n'y aurait plus rien à faire au monde. Tout le secret est là,
toute l'histoire est là". Emmanuel Godo l’a bien perçu, lui qui offre avec
cet ouvrage un ensemble de Fioretti littéraires intrinsèquement reliées au
divin. Bien entendu, le lecteur ne trouvera pas en ces pages les « dernières
recettes » relevant des bestsellers empilés en tête de gondoles. Il
approchera bien au contraire, grâce à ce compagnonnage à la fois silencieux
et pourtant si parlant, de ces voix -et voies- lui permettant d’enrichir son
expérience spirituelle, suivant en cela le conseil donné par le grand poète
Max Jacob « Ne lisez pas de médiocrités. Lisez des œuvres de grands esprits
et concourez avec eux »…
Philippe-Emmanuel Krautter |
| |
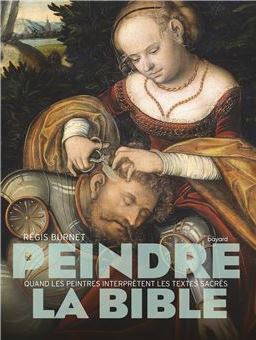 |
Régis
Burnet : « Peindre la Bible », Éditions Bayard, 2020.
Le théologien et animateur vedette de la chaîne KTO Régis Burnet signe avec
« Peindre la Bible » un bel ouvrage abondamment illustré des plus belles
peintures inspirées de la Bible. Ce livre paru aux éditions Bayard réunit
les chroniques régulières tenues par le talentueux bibliste dans la revue Le
Monde de la Bible, revue de référence en la matière ouvrant notamment à
chaque numéro ses colonnes à l’art.
La démarche didactique de son auteur n’est plus à rappeler, Régis Burnet
sait plus que quiconque transmettre ce qui peut de prime abord apparaître
aride. Sous sa plume alerte et non dénuée d’humour, l’auteur aide le lecteur
à entrer non seulement au cœur de la composition picturale et dans l’atelier
de l’artiste, mais également en dégage les traits saillants et la profondeur
théologique et spirituelle qui sous-tend chaque œuvre présentée. Et là
réside la réussite manifeste de l’exercice. Loin d’une étude de plus
relevant de l’histoire de l’art, Régis Burnet rend vivant et accessible
l’art sacré grâce à une analyse de ces différentes lectures de la Bible par
les artistes. Plus encore, en s’approchant au plus près de l’œuvre - au sens
propre et figuré – chaque focus élargit encore notre propre lecture des
Écritures par un réseau de significations et appropriations successives.
Chaque œuvre fait l’objet d’une étude débutant par un rappel des grandes
lignes quant à leur auteur, l’histoire de la représentation et son contexte
historique, une approche complétée par de nombreux détails, ainsi qu’une
référence aux Écritures associées.
De la fameuse « Tentation d’Ève » de Gislebert à l’émouvant « Christ
bénissant » de Giovanni Bellini, chaque page de « Peindre la Bible » ouvre
au lecteur non seulement le sens caché des Saintes Écritures, mais également
en révèle toute leur beauté sublimée par les meilleurs peintres.
Philippe-Emmanuel Krautter |
| |
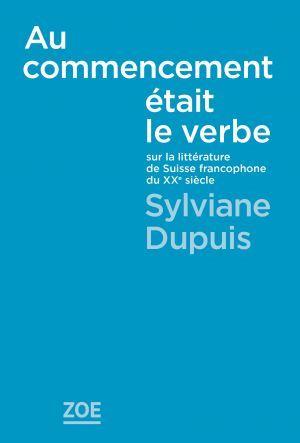 |
Sylviane Dupuis : « Au commencement était le verbe
- Sur la littérature de Suisse francophone du XXe siècle », Zoé Éditions,
2021.
Sylvaine Dupuis, poète et auteur de théâtre, s’est attachée dans cette étude
parue aux éditions Zoé aux liens unissant la littérature de Suisse
francophone aux sources bibliques. Il faut rappeler que l’auteur a su
cultiver depuis ses années de formation un goût certain pour l’Histoire la
plus ancienne ayant participé à des fouilles archéologiques sans oublier ses
multiples enseignements dans la ville de Genève. Ainsi qu’elle le souligne
en introduction : « nous sommes faits, que nous le sachions ou non, que nous
le voulions ou non, de toutes les paroles (mots, phrases, images, formules,
injonctions et interdits) qui nous précèdent ». Sauf à concevoir une amnésie
totale – redoutée par certains de nos jours – nos pensées et nos paroles
sont en effet précédées par un réseau complexe de références culturelles,
plus ou moins conscientes, et irradiant nos productions. Certains y verront
des archétypes, d’autres des acculturations multiples, quel que soit leur
nom, « nous sommes écrits par ce qui nous précède » rappelle Sylvaine
Dupuis.
Ainsi, selon l’auteur, le matériau biblique compte pour beaucoup dans ce
substrat déterminant pour la littérature née en Suisse francophone. Si la
France a cru devoir s’émanciper plus tôt de ces références pour se réfugier
dans le primat de l’art, la Suisse francophone est demeurée plus longtemps
marquée par ces références au Livre. L’incontournable C. F. Ramuz en sera
l’illustration éclairante, tout en affirmant son indépendance au regard de
la religion. Ce miroir obligé ne cessera d’accompagner ses écrits jusqu’aux
années 1970. La poésie qui irradie de nombreux textes de l’Ancien, comme du
Nouveau Testament, s’invite ainsi plus ou moins subrepticement dans la
littérature suisse francophone, ces romanciers étant la plupart du temps des
poètes tels Ramuz, Cendrars, Chessex, Bouvier, Bille, Chappaz, etc.
Quel que soit le rapport – parfois complexe, d’autrefois littéralement
décomplexé – de ces écrivains à l’égard des Écritures, ces multiples renvois
font l’objet d’analyses passionnantes livrées par Sylvaine Dupuis, preuve
s’il en était besoin, que ce substrat biblique rayonne encore malgré les
annonces fracassantes depuis plus d’un siècle de « la mort de Dieu »…
Philippe-Emmanuel Krautter |
| |
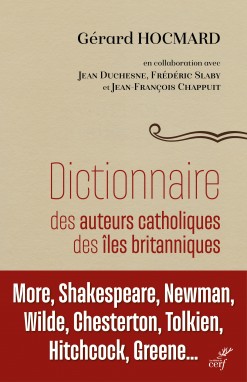 |
«
Dictionnaire des auteurs catholiques des îles britanniques » sous la
direction de Gérard Hocmard, 496 p., Éditions du Cerf, 2021.
C’est un impressionnant travail qui a été réalisé sous la direction de
Gérard Hocmard pour ce Dictionnaire des auteurs catholiques des Îles
britanniques paru aux éditions du Cerf. Avec près de 500 pages, c’est tout
ce que la Grande-Bretagne et l’Irlande comptent d’écrivains d’inspiration
catholique qui se trouve ainsi réuni en ce fort volume, outil de travail
pour les spécialistes, tout comme sujet d’évasions et de découvertes pour le
lecteur passionné. Il suffira de parcourir les multiples notices (500) pour
réaliser l’ampleur de la tâche avec des auteurs parfois méconnus tels Abbon
de Fleury (v.945-1004) ouvrant le volume ou l’incontournable de la culture
mondiale avec William Shakespeare.
Chaque notice détaille la vie de l’impétrant et rappelle ses créations
majeures. La diversité des auteurs se rejoint en une foi commune, parfois
fervente dès l’origine, d’autres fois plus tardive. Tolkien cohabite avec le
cardinal Newman, Oscar Wilde avec Pélage alors que l’anglicanisme domine ces
terres depuis le XVIe siècle et son indépendance avec Rome. Le lecteur
pourra remonter le fil chronologique de cette sensibilité spirituelle chez
nos voisins d’outre-Manche grâce à la passionnante introduction historique
signée par Gérard Hocmard, spécialiste du paysage culturel de la
Grande-Bretagne. Une christianisation qui débute très certainement très tôt
dès le IIe siècle en Britannia et qui ne cessera depuis lors de se
développer et de gagner en importance ainsi qu’en témoignent ces 500 auteurs
présentés dans ce Dictionnaire.
Une vitalité qui n’a point tari avec des auteurs contemporains tels David
Lodge, William Brodrick ou encore Piers Paul Read.
Philippe-Emmanuel Krautter |
| |
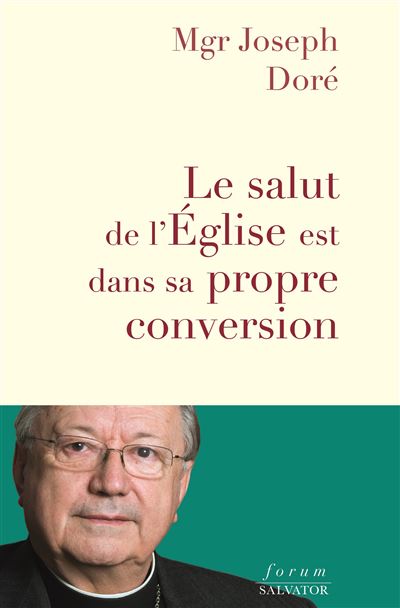 |
« Le
salut de l’Église est dans sa propre conversion » de Mgr Joseph Doré,
Salvator Éditions, 2021.
Lorsqu’un évêque s’exprime sur l’état de l’Église, cela peut donner une
réflexion sans complaisance, ni langue de buis… En effet, Monseigneur Joseph
Doré n’a pas pour habitude de voiler sa pensée, encore moins de donner dans
le religieusement correct. Tout en rappelant son attachement à sa foi
chrétienne, il n’hésite pas à souligner dans cet ouvrage le bilan contrasté
de ces soixante dernières années. L’auteur que nos lecteurs connaissent bien
(lire nos
interviews) pour ses ouvrages de théologie, d’art sacré et de
responsable religieux se livre en ces pages à un examen de conscience, non
point individuel mais collectif de l’Ecclesia entendue comme ensemble
des croyants réunis en la foi du Christ ressuscité.
Il fallait du courage – et Joseph Doré n’en manque pas – afin de se livrer à
cet état des lieux qu’il a souhaité circonscrire à la France, même si nombre
de ses remarques pourront être élargies bien au-delà de l’Hexagone. L’évêque
et théologien lance un cri d’alarme : « Oui, notre Église va mal et on ne
doit pas sous-estimer la gravité de son état ». Un cri d’alarme en écho à
celui lancé quelques années avant sa disparition par le cardinal Carlo Maria
Martini.
D’où vient ce mal ? Alors même que l’on s’attendrait plutôt à trouver au
sein de l’Église l’abondance du bien et de la charité, ces racines du mal
puisent notamment à cette mondanité et à l’oubli de la mission première que
dénonce par ailleurs le pape François depuis son accession au siège de
Pierre. Mgr Doré passe en revue toutes les questions brulantes qui ont été
selon lui trop longtemps tues et cause des maux et scandales que nous
connaissons ces dernières années : pédophilie, place des laïcs et surtout
des femmes, rôle du pape et de la Curie romaine… Cet ouvrage engagé ne se
limite pas à un constat critique, mais suggère des voies et des pistes,
notamment celle de la conversion nécessaire et préalable à tout engagement
de réforme ; une conversion des cœurs et des esprits afin de s’engager sur
sa mission première et essentielle reposant sur la foi et l’amour chrétien.
Un retour aux sources du christianisme et au message du Christ rappelé par
les Évangiles doit primer pour l’Église du XXIe siècle au risque de perdre
tous ses fidèles. Il ne s’agit pas d’un quelconque et vague programme
religieux, semblable à ceux des élections politiques. Les données sont
précises, le théologien appuie ses propositions sur des raisonnements à la
fois théoriques et pratiques, véritable vadémécum à l’usage de nos
contemporains croyants. Aucun d’entre eux ne devra se sentir exclu de ces
engagements, condition essentielle pour cette conversio, ce
changement radical appelé par l’auteur.
C’est un vent frais qui souffle dans ces pages inspirées et qui doit entrer
dans toutes les églises et demeures des fidèles afin de repenser ce « salut
de l’Église » auquel appelle l’auteur.
Philippe-Emmanuel Krautter |
| |
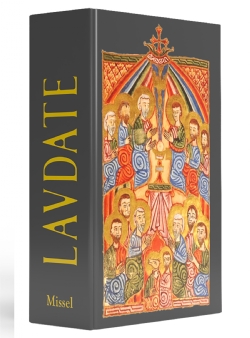 |
Missel
Laudate, 2400 pages, nouvelle traduction liturgique, Artège éditions, 2021.
Un nouveau missel vient de paraître destiné aux fidèles catholiques, et ce,
plus particulièrement, depuis le premier dimanche de l’Avent 2021, date
d’entrée en vigueur du nouveau missel romain. En effet, le Missel Laudate
des éditions Artège comprend classiquement les textes et lectures pour le
dimanche et la semaine, des notices biographiques des saints, l’ordinaire de
la messe Français-Latin ainsi qu’un large choix de prières. Ce fort et
nouveau volume de 2400 pages présente également et surtout à l’occasion de
cette nouvelle édition un certain nombre de modifications dans les habitudes
de la messe, ces changements provenant de la nouvelle traduction du Missel
romain. Ce missel destiné aux fidèles accompagnera ces derniers dans la
préparation et le déroulement de la liturgie. Dans cette optique,
l’introduction de nombreux commentaires spirituels permettra de mieux
apprécier les lectures de chaque messe. Cette dimension pédagogique qui
prévaut pour cette nouvelle édition s’avérait d’autant plus importante en
raison des changements qui vont intervenir dès à présent dans le quotidien
du fidèle lors des assemblées. Réalisé par une équipe de liturgistes de la
communauté Saint-Martin et des éditions Artège, ce travail monumental a
exigé trois années, confrontant les savoirs de théologiens, historiens,
moines et moniales, et spécialistes notamment du chant. Cette somme a
également bénéficié d’une présentation remarquable grâce à une mise en page
soignée offrant une typographie et des illustrations éclairant le texte et
invitant à se plonger dans les splendeurs de la liturgie avec en vis-à-vis
les textes latin et français. Fort de cette réalisation, chaque pratiquant
pourra aborder l’un des points culminants de la vie spirituelle en étant non
seulement initié à sa dimension sacrée mais également aux nombreux
questionnements et méditations qu’elle ne manquera pas de susciter. |
| |
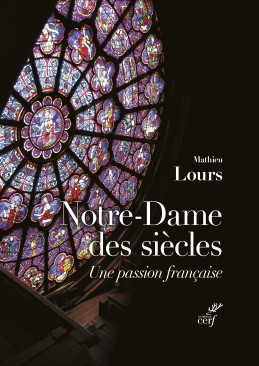 |
«
Notre-Dame des siècles. Une passion française » de Mathieu Lours, 336 pages,
dimensions : 19 x 26, Éditions du Cerf, 2021.
Mathieu Lours, que nos lecteurs connaissent bien, signe avec « Notre-Dame
des siècles » un nouvel ouvrage consacré au patrimoine religieux, livré
malheureusement parfois au péril des éléments. Conscient de l’émotion
suscitée par l’incendie du 15 avril 2019 qui ravagea une partie de la
cathédrale Notre-Dame-de-Paris, l’auteur a cherché à analyser au-delà de
cette émotion les raisons d’une telle passion qui dépassa largement les
frontières de l’Hexagone. C’est aux racines mêmes de l’édifice auxquelles
puise l’auteur afin de proposer une réflexion de fond sur l’importance de
Notre-Dame dans notre histoire, notre culture et patrimoine. Partant de l’Ecclesia
parisiensis avant Notre-Dame, ces pages nourries d’une iconographie
passionnante font la démonstration de la place essentielle du sanctuaire au
cœur de la cité dès les premiers siècles du royaume des Francs. Page, après
page, Mathieu Lhours retrace ainsi les grandes heures de Notre-Dame, heures
souvent mouvementées et faisant écho aux évènements qu’elle accompagna.
Chaque siècle, en effet, sut se saisir de ce puissant symbole de la
chrétienté, qu’il s’agisse de la longue dynastie capétienne ou lors de la
lente construction d’une idée nationale. L’ouvrage redonne plaisamment vie à
cette longue histoire, retenant les personnages illustres ou moins célèbres
ayant contribué à perpétuer sa mémoire. Anecdotes et évènements déterminants
se côtoient, agréablement conférant à ce récit une dimension presque
romanesque et rendant sa lecture passionnante. Les derniers chapitres
permettront enfin au lecteur de mieux comprendre les débats et tensions qui
s’expriment actuellement quant aux rénovations envisagées. Véritable cœur de
la nation, Notre-Dame ne laisse personne indifférent et peut-être est-ce
mieux ainsi, sans pour autant sacrifier l’idée d’unité qu’elle symbolise par
ailleurs, ainsi que le démontre ce captivant ouvrage.
Philippe-Emmanuel Krautter |
| |
 |
« Sonus
1 Firenze » Sous la direction de Mgr Timothy Verdon, Centro Di Ed. 2021.
Sonus 1 Firenze constitue le premier opus d’une collection d’ouvrages
consacrés à l’iconographie musicale présente dans les musées italiens. Selon
une idée initiée par Barbara Aniello, cette collection vise à révéler la
beauté de la sculpture, peinture, fresques, mosaïques et autres œuvres d’art
ayant pour thème commun la musique. Ce premier volume ouvre ainsi une voie
entre témoins sonores et visuels en partant tout d’abord du beau et
incontournable Musei dell’Opera del Duomo à Florence dirigé par Mgr Timothy
Verdon, puis du Campanile et de la cathédrale de Santa Maria del Fiore, sans
oublier le célèbre Baptistère de San Giovanni.
En prélude à ce premier ouvrage abondamment illustré, Timothy Verdon place
en exergue trois notions clés : Musique, louange et joie. La musique sacrée
a su prendre, en effet, rapidement le rôle de véhicule de la louange des
croyants. Elle sait accompagner les textes bibliques – on pense bien sûr aux
psaumes – mais aussi le culte dans ses mystères les plus profonds. C’est
pourquoi ce premier volume de la collection Sonus ayant pour cadre la ville
de Florence explore ces liens étroits entre musique et les autres arts
présents dans la capitale florentine grâce à des études souvent prospectives
de jeunes chercheurs ouvrant des voies pour l’avenir.
Ainsi, l’ouvrage n’hésite pas à employer des titres pour certains
provocateurs tel cette contribution « Musiques à voir, entre réalité et
symbolisme » de Gabriele Giacomelli ou encore cette analyse passionnante
livrée par Barbara Aniello sur la valeur symbolique de la dimension visible
et sonore particulièrement perceptible à partir des sculptures, peintures ou
fresques suggérant la mélodie.
Que peuvent nous livrer ces multiples références à la musique gravées dans
le marbre, la toile ou l’enduit ? Comment lever ces paradoxes entre ces
témoins silencieux et leurs assourdissants messages n’attendant qu’à être
perçus ?
C’est à cette merveilleuse quête à laquelle nous convie cette belle étude
inaugurant une collection à qui l’on souhaite un bel avenir !
Philippe-Emmanuel Krautter |
| |
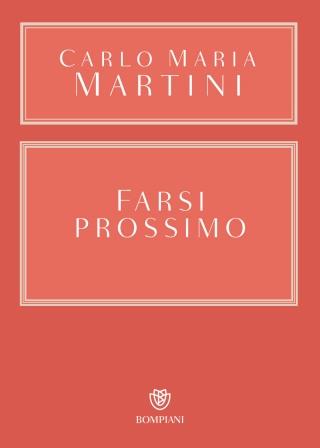 |
Carlo Maria Martini : « Farsi Prossimo », Opera
Omnia VI, Editions Bompiani, 2021.
Le sixième tome de l’Opera Omnia du théologien et cardinal italien Carlo
Maria Martini vient de paraître aux éditions Bompiani. Intitulé « Farsi
Prossimo », le titre de ce riche volume renvoie à l’idée de coopération
lancée par le message de Jésus, à l’opposé de la solitude qui enferme
l’individu. Les idées de charité et de proximité, essentielles pour Carlo
Maria Maritini, font l’objet des nombreux documents et interventions de ce
volume. Le cardinal Luis Antonio Tagle dans la préface de ce volume tient à
souligner combien au titre de président de Caritas internationalis,
il a été lui-même amené à rencontrer des personnes dans la plus grande
détresse matérielle et psychologique. Dans cette mission ardue et toujours
délicate, le cardinal Martini évoque la nécessité dans ces situations d’être
proche et de se laisser toucher par la parole par celles et ceux qui
souffrent. Carlo Maria Martini connaissait les risques du mot charité,
souvent synonyme d’un acte de compassion humaine convenue tels un don
matériel ou une vague parole de réconfort. Cette charité n’est pas celle
puisée au cœur du christianisme et du message laissé par Jésus ainsi que le
rappellent les différentes études réunies dans ce volume, toutes résultant
d’une expérience « sur le terrain » du cardinal responsable du plus grand
diocèse d’Italie pendant de nombreuses années…
Martini n’avait pas de recettes préfabriquées et encore moins de formules
générales sur ce sujet qui exige de se laisser toucher personnellement par
chaque situation douloureuse, qu’elle soit le fait de la maladie, du grand
âge, du handicap, du statut de migrant ou de la marginalisation. Cette
rencontre ne peut avoir lieu selon le théologien qu’à la lumière de la
Parole de Dieu qu’il médita si souvent et contribua à diffuser avec l’École
de la Parole qu’il initia au Duomo de Milan. L’écoute de la Parole forme
ainsi le préalable indispensable, il n’est possible d’aimer qu’à la
condition d’être aimé, cœur du message des Écritures. À partir de cette
donnée initiale et intangible, le cardinal n’eut de cesse sa vie durant
d’inviter à cette proximité notamment dans la justice et son action
personnelle en faveur des prisonniers, les nombreuses réformes sociales
auxquelles il invita, l’engagement au volontariat et à l’animation de la vie
chrétienne, toutes ces actions ne pouvant et ne devant être menées que par
une pratique de proximité à laquelle convie de nos jours régulièrement le
pape François.
Cet ouvrage foisonnant et passionnant se trouve être la démonstration
éclatante de la démarche toujours remise en question par cet inlassable
homme de Dieu qui s’interrogea tout au long de sa vie afin de savoir comment
aimer davantage son prochain, se faire plus proche de lui tout en le
respectant.
Philippe-Emmanuel Krautter
www.bompiani.it/catalogo/farsi-prossimo-9788845299612 |
| |
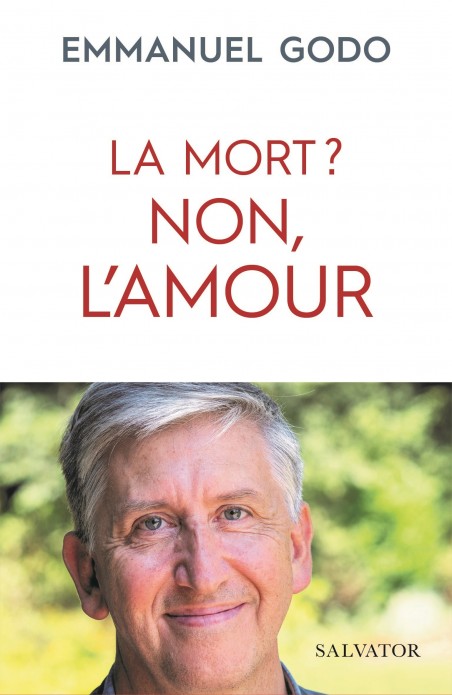 |
Emmanuel Godo : « La mort ? Non l’amour », Éditions Salvator, 2021.
L’écrivain et poète Emmanuel Godo livre avec « La mort ? Non, l’amour » le
dernier volet de sa trilogie présentée dans nos colonnes. Après la tristesse
et la joie, c’est un couple pour le moins singulier qui se partage cette
dernière réflexion. Derrière le titre inspiré repris de l’un des plus beaux
poèmes d’Elisabeth Browning (« Sonnets portugais ») se cache une vérité que
l’auteur parvient à se saisir avec la délicatesse qui le caractérise. Point
de traité philosophique en ces pages, mais une subtile digression
personnelle sur les rapports complexes entretenus non entre la vie et la
mort, mais ceux de cette dernière avec l’amour. Au seuil de la mort, l’amour
de ses proches et amis vient en premier des interrogations existentielles.
Partant de cette vérité fondamentale, Emmanuel Godo explore son vécu de la
manière la plus libre en un dialogue avec les vivants, mais aussi les
disparus dont sa mère. Et si le poète regrettait que « Les morts, les
pauvres morts, ont de grandes douleurs » (Baudelaire « La servante au grand
cœur »), il est pourtant un remède à cette peine, l’amour dont Emmanuel Godo
rappelle la force qui transcende tous ces tourments. Et là réside l’antidote
livré par l’auteur en une profonde invitation à la vie grâce à l’amour, deux
entités consubstantielles. L’amour peut vaincre la mort lorsqu’il encourage
à chaque instant de notre quotidien de ne point passer à côté de la vie.
Pour cela, nous pouvons préserver un espace personnel, citadelle imprenable,
une « arrière-boutique » comme l’y invitait Montaigne dans laquelle aucune
pulsion mortifère ne saurait s’immiscer. « Dans tout amour, il y a un adieu
» rappelle Emmanuel Godo, un à Dieu sous la forme d’une âme toute vouée à
l’amour, dont ces pages démontrent la force et la puissance sur la mort.
Philippe-Emmanuel Krautter |
| |
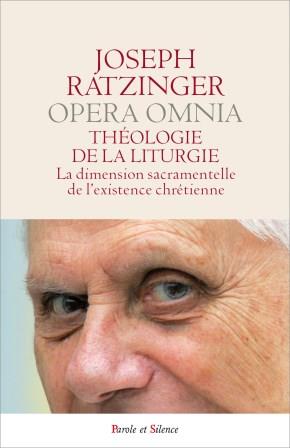 |
Joseph
Ratzinger : « Théologie de la liturgie » ; Collection Opera Omnia, Éditions
Parole et Silence, 2021.
Le thème de la liturgie a toujours été au cœur de la réflexion du théologien
Joseph Ratzinger, ainsi qu’au sein de l’action du pape Benoît XVI tout au
long de son pontificat. Ce dernier confie en effet en présentation de cet
ouvrage venant d’être publié aux éditions Parole et Silence dans la
collection Opera Omnia : « Ce volume réunit tous les travaux, petits et plus
ou moins grands, par lesquels je me suis exprimé à propos de la liturgie au
cours des années, à différentes occasions et dans des perspectives diverses.
À partir de toutes les contributions nées ainsi, l’idée s’imposait
finalement à moi de présenter une vision de l’ensemble, qui parut lors de
l’année jubilaire 2000 sous le titre L’esprit de la liturgie. Une
introduction ».
Pour le grand théologien, la liturgie s’avère être, en effet, beaucoup plus
qu’un rite ou une mémoire mais bien un renouvellement et une actualisation,
lors de chaque messe, du sacrifice christique. Joseph Ratzinger démontre
dans ces pages d’une limpidité didactique remarquable, malgré la complexité
du sujet, combien cet esprit de la liturgie ne saurait être parfaitement
saisi sans le rattachement au Nouveau à l’Ancien Testament. Il n’est pas une
parole de Jésus qui ne se rattache aux livres fondateurs de la foi d’Israël,
qu’il s’agisse de sa prédication lors de sa vie publique jusqu’au dernier
souffle sur la Croix. C’est dès lors en puisant aux sources
vétérotestamentaires qu’il est possible d’accéder à la pleine compréhension
de chaque strate de nos liturgies.
Suivant en cela l’influence initiale de la pensée de Romano Guardini dans «
L’esprit de la liturgie », Joseph Ratzinger souligne combien la liturgie se
doit d’être entendue non seulement dans sa beauté et sa richesse cachée,
mais également selon une dimension qui dépasse les âges et la temporalité.
Cette extension de la liturgie s’étend en effet non seulement à toute
l’Église et à la vie chrétienne, mais prend également une dimension cosmique
à l’ensemble des êtres humains, quelle que soit leur confession. La liturgie
se présente ainsi comme étant non point le fait de quelques élus réunis en
un lieu donné, mais comme une célébration universelle de l’amour destinée à
l’ensemble de la Création et l’Histoire. Le lecteur saisira combien une
célébration ne saurait être comprise comme un acte répétitif et ressassé,
comme ce fut trop souvent le cas avant ce rappel opéré par le Concile
Vatican II.
Aussi, ces pages essentielles de la pensée du théologien et pape Benoît XVI
seront-elles déterminantes au lecteur du XXI° siècle afin de prendre
conscience de la force et de la puissance de la liturgie entendue en une
célébration à dimension universelle.
Philippe-Emmanuel Krautter |
| |
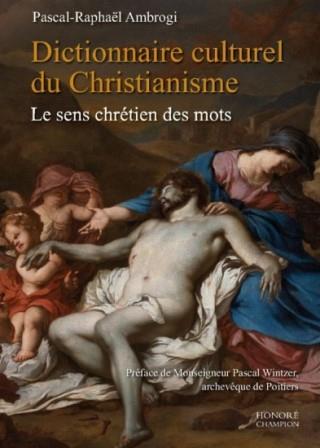 |
«
DICTIONNAIRE CULTUREL DU CHRISTIANISME - Le sens chrétien des mots.» de
Pascal-Raphaël Ambrogi ; Préface de Monseigneur Pascal Wintzer, archevêque
de Poitiers ; Honoré Champion Éditions, 2021.
À l’heure où les racines chrétiennes de l’Europe tendent de plus en plus à
être reléguées dans l’oubli, la somme exceptionnelle proposée par
Pascal-Raphaël Ambrogi devrait retenir l’attention. Il s’agit là par
l’ampleur de la tâche non seulement d’un trésor d’informations et de
données, mais surtout d’un regard, celui porté sur notre culture classique,
que celui-ci s’inscrive ou non dans une démarche de foi. Ainsi que le
soulignait l’académicien Marc Fumaroli dans un entretien accordé à notre
revue, tout un pan de la culture classique qui vacille de nos jours ne
saurait être jeté aux oubliettes de l’Histoire sous peine de perdre le sens
entier de notre civilisation. Or, si la langue française, naguère source de
rayonnement dans l’Europe entière, a perdu cette prééminence, celle-ci offre
encore au XXIe siècle une mine inépuisable à laquelle puiser bien des
trésors.
C’est à cet immense patrimoine auquel s’est attaché l’auteur, haut
fonctionnaire, mais aussi écrivain défendant le patrimoine linguistique
français. Ce « Dictionnaire culturel du Christianisme » s’avère être aussi
impressionnant que précis avec ses milliers d’entrées nourries de
définitions et s’attachant à mieux rappeler les nuances de chaque mot
retenu. Un exemple ? L’entrée « Déréliction », ce mot qui ne s’écrit pas «
dirélection » comme le rappelle l’auteur et qui définit l’état de l’homme
privé du secours de Dieu. Toutes ces nuances s’égrènent au fil des pages
comme les perles d’un chapelet, révélant les trésors hérités du
christianisme ainsi que l’entreprit en son temps Chateaubriand dans son
fameux « Génie du christianisme » au lendemain de la Révolution française.
Si la fameuse adresse en latin « Habemus papam » est bien connue
après l’élection d’un nouveau pape, le lecteur découvrira amusé à la lecture
de cette entrée les différentes techniques permettant d’obtenir, selon les
résultats, une fumée noire ou blanche grâce à l’ajout de composants
chimiques. Le Dictionnaire offre également des entrées essentielles pour
rafraîchir sa mémoire biblique avec des rappels clairs et précis des grands
rois et prophètes de l’Ancien Testament, les lieux de la Bible, mais aussi
de nombreuses expressions en latin si fréquentes dans la liturgie et dont la
compréhension tend également à s’effacer depuis quelques décennies. A ces
explications claires et rigoureuses, ces entrées incluent enfin également de
nombreuses citations tirées des écrits des papes ou des grands textes
chrétiens, une mine de connaissances et un précieux outil de travail.
Ce Dictionnaire de plus de 1 000 pages répondra, en effet, à de multiples
usages. Il sera le fidèle compagnon de l’honnête homme du XXIe siècle qui
aura décidé de ne point perdre cette richesse culturelle. De même, il
répondra à toutes les questions à l’occasion d’une célébration, la réception
d’un sacrement ou encore lors de la préparation d’une catéchèse ou d’un
enseignement. Avant tout, l’immense tâche réalisée par Pascal-Raphaël
Ambrogi relève de la conservation d’un patrimoine de nos jours menacé, au
même titre que des conservateurs veillent à la protection d’une œuvre d’art.
Pour toutes ces raisons, ce « Dictionnaire culturel du Christianisme »
mérite toute l’attention du lecteur.
Philippe-Emmanuel Krautter |
|
CINÉMA, MUSIQUE |
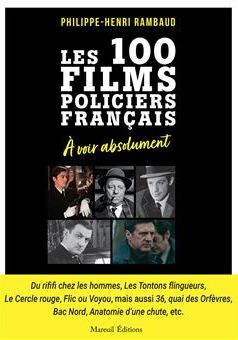 |
« Les
100 films policiers français à voir absolument » de Philippe-Henri Rambaud,
Mareuil Éditions, 2025
Voici un sujet pointu, mais néanmoins porteur, pour les amateurs
de polar hexagonal : son auteur, Philippe-Henri Rambaud, spécialiste du
genre, voue en effet pour le 7e art, et notamment le polar, une passion qui
l’a conduit à créer le site filmpolicier.fr. Cette somme de 366 pages
répondra à toutes les questions que peut se poser le cinéphile, amateur ou
plus avancé, sur les 100 films à (re)découvrir, qu’il s’agisse des
classiques ou des pépites plus méconnues…
Le cinéma policier français compte en effet parmi les genres les plus
fertiles si l’on considère certains de ses titres passés à la postérité ; on
songe notamment à « Cercle rouge », « Ascenseur pour l’échafaud », « Le cave
se rebiffe », « Le samouraï », « Quai des Orfèvres », « Touchez pas au
grisbi », et bien d’autres encore entrés dans la légende…
Philippe-Rambaud parvient dans cette bible à transmettre sa passion de
manière très communicative avec des notices aussi complètes que savoureuses,
au style alerte non dénué d’humour. Pour chaque film, un synopsis complet,
le contexte du tournage et de sa production avec souvent de croustillantes
anecdotes telles celles relatée concernant le style radicalement différent,
sur le plateau et hors caméra, des deux monstres du policier français :
Delon et Belmondo. Enfin, une fiche technique complète cet ensemble avec
notamment la distribution et le nombre d’entrées en salle. Une synthèse
incontournable à garder sous la main pour de longues heures de cinéma en
perspective ! |
| |
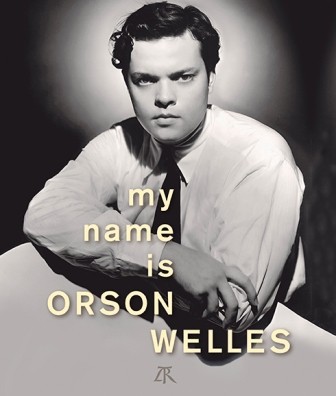 |
« My
Name Is Orson Welles », Collectif sous la direction de Frédéric Bonnaud, 464
p., Éditions de la Table Ronde, 2025.
Cela fait quarante ans déjà que la figure emblématique du cinéma américain
en la personne d’Orson Welles s’est éteinte. A l’occasion de cet
anniversaire, la Cinémathèque française a organisé une exposition et de
nombreuses rétrospectives. Afin d’accompagner cet évènement, une publication
d’envergure vient d’être publiée aux éditions de La Table Ronde sous la
direction de Frédéric Bonnaud, directeur de la Cinémathèque.
Orson Welles, figure inclassable du 7e art, fait depuis longtemps partie du
panthéon de l’histoire du cinéma. Iconique et pourtant anticonformiste, ce
dernier ne fut en effet jamais là où on l’attendait et, peut-être, est-ce là
la source de son génie. Viennent à l’esprit à l’évocation de son nom «
Citizen Kane », bien sûr, mais également « La soif du mal » ou encore « La
Ricotta » sous la direction de Pier Paolo Pasolini…
Acteur de légende, mais aussi réalisateur hors pair et metteur en scène,
Orson Welles s’impose comme un génie polymorphe auquel cette somme rend
hommage en permettant au lecteur de mieux comprendre ses débuts, son
parcours et sa personnalité complexe. En ces pages, nous retrouvons ainsi de
nombreuses sources précieuses offrant différents regards sur l’homme, qu’il
s’agisse des témoignages de Borges, Sartre, Aragon, etc. mais aussi des
entretiens réunis du réalisateur.
L’ouvrage propose également de nombreuses analyses de cet esprit passionné
et amoureux des classiques. A cette synthèse remarquable, il fallait une
iconographie à la hauteur, ce qui est accompli avec d’abondantes
illustrations permettant ainsi au lecteur de plonger de nouveau dans le
monde – en noir et blanc - d’Orson Welles ! |
| |
 |
Maurice
Ravel : « Correspondance, écrits et entretiens », Édition établie, présentée
et annotée par Manuel Cornejo, Coffret 2 volumes, 2 934 pages, Coll. Tel
Gallimard, 2025.
A l’occasion du 150e anniversaire de la naissance du compositeur Maurice
Ravel (1875-1937), les éditions Gallimard dans la collection Tel publient «
Correspondance, écrits et entretiens » en deux forts volumes sous la
direction de Manuel Cornejo. Si l’œuvre du célèbre musicien français est
largement diffusée depuis plus d’un siècle, ses écrits et correspondance
demeurent encore trop confidentiels, alors même que ces précieux documents
éclairent non seulement la vie de l’auteur du célèbre Boléro, mais également
la vie artistique de son époque.
Tout le mérite de l’immense travail réalisé par Manuel Cornejo est de mettre
à disposition du lecteur un foisonnement de sources (plus de 2 900 documents
dont 2 000 lettres) livrant diverses facettes de cette personnalité à la
fois raffinée et discrète. L’humour transperce de manière récurrente dans
ces lettres, notamment lorsque Maurice Ravel se plaint de ne pas avoir été
retenu lors de la mobilisation de la Première guerre mondiale en raison d’un
poids trop léger de 2 kilogrammes… A chaque page fourmillent les anecdotes
de la vie quotidienne, tout autant que l’élaboration de l’immense œuvre en
cours. De nombreuses personnalités, Jean Cocteau, Lili Boulanger, Jean
Giraudoux, et bien d’autres encore, abondent dans ces pages au style soigné,
ne dédaignant pas, ici ou là, quelques libertés avec l’argot : « Ce boulgre
de Duo me donne bien du mal » évoquant sa Sonate pour violon et violoncelle…
Cette correspondance des plus variées s’adresse tout autant à ses collègues
musiciens qu’à des amis, en passant par des éditeurs et autres institutions.
Mais, toujours, reviennent les réflexions du compositeur sur son art et ses
méthodes, cette soif inextinguible de l’innovation musicale qui caractérisa
son œuvre.
En complément indispensable de ces précieuses sources, les notes critiques
apportées par Manuel Cornejo ajoutent encore à l’intérêt de cette édition en
en faisant un ouvrage non seulement de référence à l’adresse des
spécialistes, mais aussi un témoignage unique pour un large public sur la
riche personnalité de Maurice Ravel. |
| |
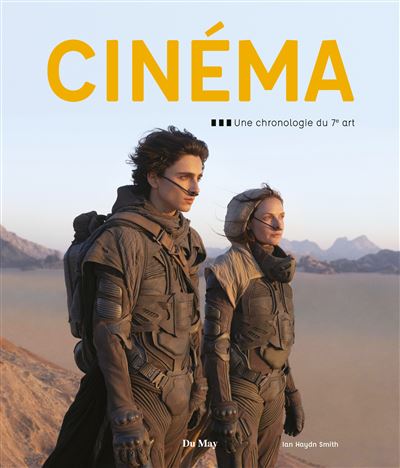 |
«
Cinéma, une chronologie du 7e art » de Ian Haydn Smith, Sophia Editions,
2025.
Voici un ouvrage qui devrait réjouir non seulement les amateurs du 7e art,
mais aussi intéresser un public plus large à la recherche d’une synthèse
éclairante sur l’histoire même du cinéma. Son auteur, Ian Haydn Smith, n’en
est pas à son premier coup de maître et a déjà signé notamment une « Petite
histoire du cinéma » et « le Cinéma s’affiche, une autre histoire du cinéma
», des ouvrages remarqués. Editeur du Curzon Magazine et du site « 1001
Movies You must see before you die », journaliste informé, Ian Haydn Smith
sait mieux que quiconque mettre en lumière les 150 ans qui marquent
l’histoire du cinéma. Décennie après décennie, le lecteur pourra ainsi
découvrir les grandes dates du 7e art, dès le passionnant chapitre consacré
aux origines du film permettant de comprendre quelle alchimie a permis ce
passage toujours étonnant entre une image fixe et son animation. Pour chaque
période, les évènements majeurs associés au contexte de la société sont
rappelés, pour mieux mettre en avant les films majeurs qui seront produits
pour chaque période, tel le fameux film « J’accuse » d’Abel Gance de 1919
dans le contexte de la Première Guerre mondiale… Tous les genres et tous les
styles sont clairement présentés au regard de la chronologie internationale
qui l’accompagne. Le lecteur profitera de cette vaste synthèse pour parfaire
ses connaissances sur cet art en perpétuel questionnement, ainsi que le
démontre la conclusion de ce riche ouvrage. |
| |
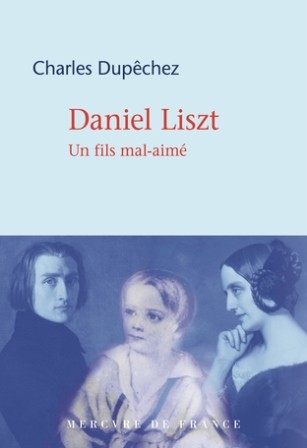 |
Charles
Dupêchez : « Daniel Liszt – Un fils mal-aimé », Editions du Mercure de
France, 2025.
Voici un récit poignant, véridique mais le plus souvent méconnu, livré avec
sensibilité par Charles Dupêchez dans cet ouvrage intitulé « Daniel Liszt –
Un fils mal-aimé » paru aux éditions du Mercure de France. Autant prévenir
le lecteur que ce portrait à charge de Franz Liszt et de Marie d’Agoult
déconcertera assurément, ces deux phares de la culture européenne du XIXe s.
ayant par ailleurs brillé d’une tout autre manière. Même si les us et
coutumes de l’époque quant à l’éducation des enfants de la société
aristocratique et bourgeoise privilégiaient, certes, très souvent une « mise
à distance » des jeunes enfants jusqu’à leur âge adulte, nos deux
prestigieux parents ne ressortent pas, il faut bien l’avouer, ni grandis ni
glorieux quant au souci de leur progéniture…
L’ouvrage rappelle que Daniel fut un fils non désiré dans cette union
illégitime, Marie d’Agoult, de son vrai nom Marie Catherine Sophie de
Flavigny, comtesse d’Agoult, n’aspirant qu’à atteindre le statut de femme de
lettres française, ce à quoi elle réussit sous le pseudonyme de Daniel
Stern, le masculin demeurant, à l’époque, la condition incontournable pour
toute reconnaissance dans les arts. De cet amour passionnel avec le jeune et
célèbre virtuose naîtront trois enfants : Blandine, Cosima (future épouse de
Richard Wagner) et Daniel lors d’inspirantes pérégrinations à Genève, puis
en Italie à Bellagio, Milan, Venise, etc., des voyages qui ont nourri
admirablement l’œuvre de Liszt. Mais, tant Marie d’Agoult que Franz Liszt ne
brilleront pour leur instinct parental. Ces individualités, pourtant
généreuses avec un grand nombre de personnes fréquentant leur salon et
concerts, semblent, au fil des pages, ne laisser que peu de place à leur
progéniture, ce dont le jeune Daniel souffrira grandement. Cette
personnalité très sensible, et manifestement douée, fera pourtant tout pour
plaire à ses parents, allant jusqu’à exceller dans l’art de l’autocritique,
mais en vain…
Alors que les parents se séparent, le destin de cet enfant sera tragique,
balloté entre personnes plus ou moins bienveillantes et toujours
l’indifférence, feinte ou réelle, de son père qui voit en ce fils plus une
charge qu’un amour. Daniel cherchera parfois cet amour impossible avec sa
mère qui l’initiera aux arts, faisant de lui un esprit raffiné et
prometteur. Mais le destin rattrapera cette jeune âme de cruelle manière,
ainsi que le rappelle Charles Dupêchez dans ce brillant et touchant essai, à
découvrir pour lever le voile d’un aspect méconnu de ces illustres parents… |
| |
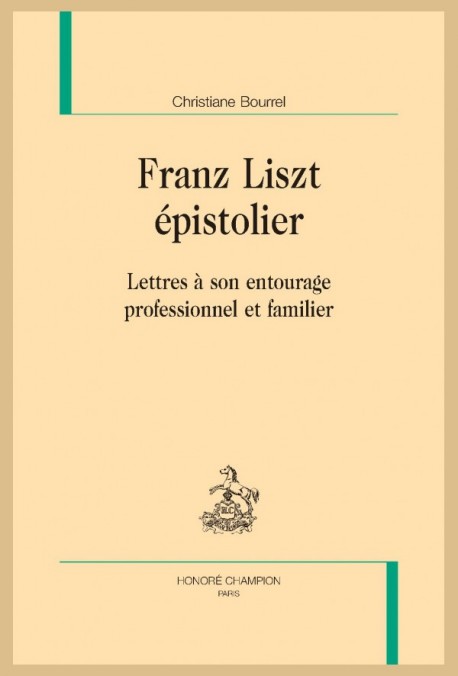 |
Christiane Bourrel : « Franz Liszt Épistolier - Lettres à son entourage
professionnel et familier » avec un cahier d'illustrations en couleurs,
Editions Honoré Champion, 2024.
Christiane Bourrel, talentueuse musicologue, a mené un important travail de
recherches et d’études consacré à la correspondance de Franz Liszt et dont
le présent ouvrage est l’aboutissement. Ce fort volume de 762 pages plongera
le lecteur dans l’univers captivant de l’Europe culturelle du XIXe siècle
par le filtre de l’un de ses plus illustres ambassadeurs, le compositeur
virtuose hongrois Franz Liszt. Jeune prodige du clavier, Liszt arpentera
bientôt toutes les scènes majeures de la musique. Si ses compositions sont
devenues depuis célèbres tant pour le piano que pour l’orchestre, on ignore
souvent qu’il prit à maintes occasions la plume pour rédiger une abondante
correspondance ainsi que des essais. C’est en quelque sorte un concentré des
multiples intérêts du musicien qui se trouve ainsi réuni en ces pages, aussi
diverses quant à leur sujet, que multiples. La virtuosité alterne avec les
engagements nombreux de cette âme éprise d’absolu, le jeune romantique adulé
et aux multiples amours terminant ses dernières années en revêtant la
soutane et en portant le titre de l’abbé Liszt…
Les lettres réunies par Christiane Bourrel révèlent – tout autant que la
musique du compositeur, un esprit très sensible, doutant et en quête de
reconnaissance. Ouvert aux rencontres fructueuses pour l’esprit, le lecteur
suit Liszt, au fil des pages et des lettres, échangeant avec ses proches et
amis, tel le violoniste Lambert Massart qui dût se réjouir à la lecture de
cette lettre dithyrambique rappelant leurs souvenirs de jeunesse partagée.
Liszt dialogue dans l’esprit du temps, romantique exaltant les passions,
mais il sait aussi partager ses positions esthétiques, notamment sur
Beethoven, dont il encourage la diffusion des œuvres au plus grand nombre
par le truchement des arrangements pour piano, Liszt étant en effet réputé
pour ses innombrables transcriptions. Christiane Bourrel livre avec cette
somme une réflexion de fond non seulement sur la pensée de Liszt, mais
également une analyse riche d’enseignements sur le style de l’écriture de
cet épistolier souvent méconnu et révélant toute sa complexité, bien que le
célèbre virtuose se plaignit de manière récurrente des difficultés
ressenties dans cet art épistolaire, ses exigences littéraires lui imposant
un véritable effort, à l’inverse de ses compositions musicales. |
| |
 |
« Billy
Wilder, "et tout le reste est folie"- Mémoires », Editions Nouveau Monde,
2024.
Véritable légende du 7ᵉ art, le réalisateur Billy Wilder méritait assurément
une réflexion d’ampleur non seulement sur son œuvre, mais également
concernant son propre parcours mené sous le signe de l’humour… incisif à
l’image de ses films ! Considéré comme l’un des plus grands cinéastes de son
siècle (1906-2002), Billy Wilder confie sa vie au critique Hellmuth Karasek
dans ces pages, notamment ses débuts pour le fameux film de Robert Siodmak «
Les hommes le dimanche » (193). Ce sera le point de départ d’une riche et
longue aventure, alternant entre films noirs et comédies. Wilder écrit,
réalise et produit un nombre incroyable d’œuvres passées à la postérité
telles La Scandaleuse de Berlin, Boulevard du Crépuscule ou encore Certains
l’aiment chaud… Sa griffe inimitable est teintée d’ironie et d’humour
parfois grinçant, tentant d’explorer les tréfonds de l’âme humaine.
L’ouvrage abonde en anecdotes et témoignages de première main, le
réalisateur, grâce à sa lucidité impressionnante, parvenant à poser un
jugement des plus éclairants sur son travail et celui de ses collaborateurs,
sans oublier ses acteurs de légende Bogart, Marylin Monroe, Gary Cooper,
Marlene Dietrich et bien d’autres encore. Loin d’être cependant une
hagiographie, cet ouvrage livrera aux passionnés du cinéma une belle mise en
perspective du processus créatif de Billy Wilder dans le contexte
hollywoodien, milieu qui dut souvent composer avec sa liberté d’esprit…
cette folie créative des plus inspirantes ! |
| |
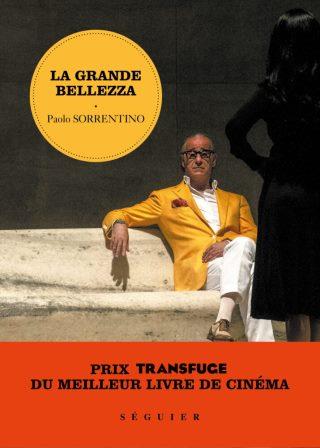
|
« La
grande bellezza – Paolo Sorrentino », ; Scénario original écrit avec Umberto
Contarello, , Avant-propos inédit de Paolo Sorrentino, ; Traduit de
l’italien par Anna Colao, ; 15 x 21 cm, 240 p., Editions Séguier, 2023.
10 ans déjà que le film iconique La grande bellezza du
réalisateur italien Paolo Sorrentino est sorti sur le grand écran et
pourtant les images de ce très beau film défilent encore sous nos yeux, sans
une ride même sans l’aide de l’esthéticien Alfio Bracco ! C’est cette magie
que vient prolonger cette publication inspirée par les éditions Séguier du
scénario original du film, ici, dans une traduction française d’Anna Colao.
Autant dire que le souffle à la fois sensible et caustique du film se
retrouve sans faiblir en ces pages d’une lucidité à toute épreuve. Le
narrateur, Jep Gambardella, journaliste et auteur d’un seul roman à succès,
a longtemps été à la quête de la grande beauté, sans pouvoir la trouver.
Cette recherche désabusée l’a conduit à être le roi des mondanités grâce à
une inspiration toujours renouvelée sur fond de fêtes romaines décadentes et
autres futilités qui ne parviennent plus cependant à le distraire. Dans quel
monde vivons-nous ? Telle est la question existentielle lancée entre deux
chenilles effrénées sur les terrasses de la Ville éternelle après un nombre
incalculable de gins tonic… Le lecteur retrouvera ainsi en ces pages tous
les protagonistes du film avec plusieurs scènes en sus non reprises lors du
tournage. Alors Silence ! Action… sur ces petits trains qui ne mènent nulle
part… |
| |
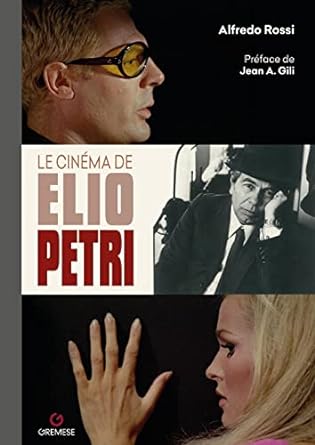 |
« LE
CINÉMA D'ELIO PETRI » par Alfredo Rossi, Editions Gremese, 2023.
Le prisé mais trop confidentiel réalisateur italien, Elio
Petri, fait avec cet ouvrage l’objet d’une passionnante et complète analyse
d’Alfredo Rossi, lui-même spécialiste du 7e art. Les cinéphiles ont encore
en mémoire le fameux film « Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon
» de 1971 ou encore « La classe ouvrière va au paradis », Palme d’or au
Festival de Cannes l’année suivante. Cinéaste engagé dont le travail et
l’inspiration se rapprochent de celui de Pier Paolo Pasolini quant à la
critique exacerbée de la société de consommation d’après-guerre, Petri
n’hésite pas à adopter un style violent, voire halluciné, ainsi que le
rappelle Alfredo Rossi. Le cinéaste qui jouissait d’une vaste culture et
d’amitiés solides approfondit au fil de ses réalisations soignées sa vision
personnelle du monde. Le lecteur débutera avec profit sa lecture avec la
préface de Jean A. Gili qui rappelle toute la dimension poétique de l’œuvre
d’Elio Petri, ainsi que sa francophilie indéfectible alors même que le
réalisateur de nos jours n’est pas reconnu comme il le devrait même si ses
films sont encore programmés. Alfredo Rossi quant à lui commence son essai
par la fin en partant d’une lettre du réalisateur rédigée en 1982, quelques
mois avant sa disparition par laquelle il rappelle ses profondes convictions
intellectuelles. Plus qu’un réalisateur politique engagé, Petri s’inscrit
dans un cinéma expérimental dont les grandes lignes sont rappelées par cet
ouvrage passionnant qui permettra de redécouvrir ce cinéaste singulier.
Philippe-Emmanuel Krautter |
| |
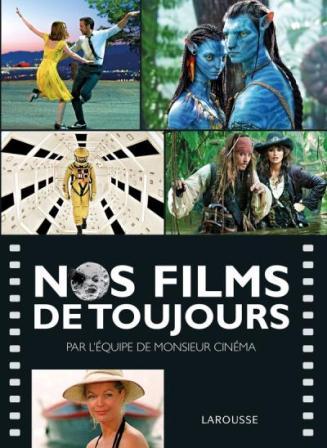
|
« Nos
films de toujours » de Marc Combier, Editions Larousse, 2023.
L’équipe de Monsieur Cinéma s’est réunie pour proposer en un
seul et même volume près de 360 films ayant marqué le 7ième art. Cette
extraordinaire mémoire cinématographique se trouve ainsi rassemblée dans ce
guide aussi pratique que complet. Avec ses 400 pages, ce fort ouvrage est
prêt à répondre à toutes les questions que peut se poser le cinéphile
passionné. Allant des grosses productions comme Piège de cristal de John
McTiernam avec le fameux Bruce Willis en 1988 jusqu’au sulfureux Mort à
Venise de Luchino Visconti en 1971, chaque long métrage bénéficie d’une
fiche technique complète rappelant non seulement l’histoire du film mais
également ses coulisses et portée. Bénéficiant d’une mise en page dynamique
allant à l’essentiel, ce guide dénommé à juste titre « Nos films de toujours
» devrait figurer au sein de toute bonne bibliothèque de cinéphile averti ! |
| |
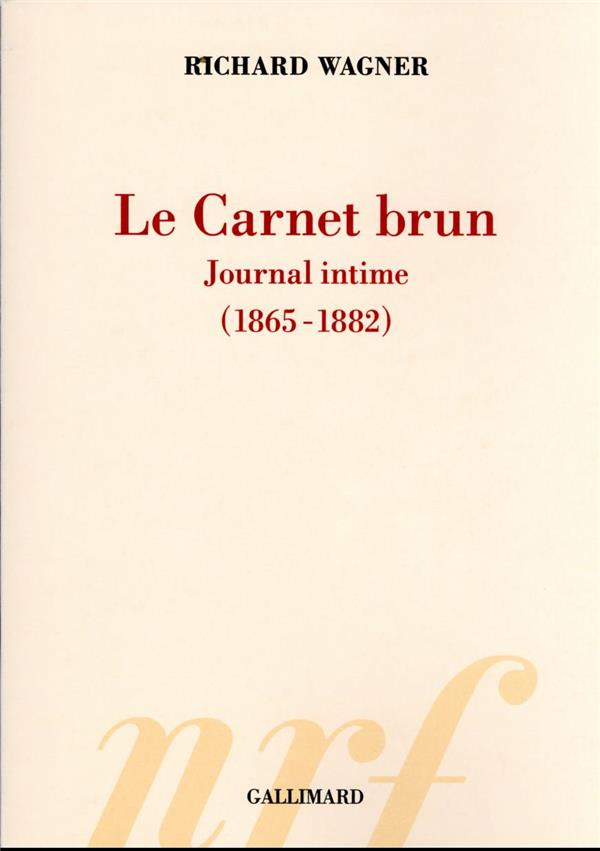 |
Richard
Wagner : « Le carnet brun : journal intime (1865 -1882) » ; Traduit,
présenté et annoté par Nicolas Crapanne ; Préface Jean-François Candoni,
Hors-série Connaissance, Gallimard, 2023.
Après les « Écrits sur la musique » présentés dans ces colonnes, c’est au
tour du « Carnet brun » de Richard Wagner de bénéficier d’une belle édition
réalisée par Nicolas Crapanne avec la collaboration de Marie-Bernadette
Fantin-Epstein, Éva Perrier et Solange Roubert. Il faudra attendre 1975 pour
que ce mystérieux cahier de cuir offert par Cosima, la fille de Franz Liszt,
à son amant Richard Wagner qu’elle épousera quelque temps après en 1870,
fasse l’objet d’une publication en langue allemande. Dans ce journal intime
et précieux à plus d’un titre, le grand musicien se confesse, livre ses
pensées mais aussi son quotidien ; une mine d’informations, donc, pour tous
les musiciens, mélomanes et passionnés du compositeur allemand. L’important
travail critique accompagnant cette première traduction intégrale en
français permettra au lecteur de se familiariser avec l’univers bien
particulier du musicien ainsi que sa riche vie artistique.
La première entrée correspond à la date du 10 août 1865, une époque troublée
dans la vie du musicien ayant connu bien des déboires avec son Tristan et
Isolde et songeant même à mettre un terme à sa vie… Mais, c’est
également une période faste puisqu’ il rencontrera son alter ego, la
fille du grand pianiste et compositeur hongrois Franz Liszt, Cosima née à
Bellagio des amours avec Marie d’Agoult. Ces deux êtres malheureux en ménage
se rapprocheront pour finalement fonder l’un des couples légendaires de la
musique de la fin du XIXe s. Ce carnet contient également des poèmes, des
préfaces et même des réflexions inattendues sur le bouddhisme ! Sur un plan
plus strictement musical, le lecteur se délectera de la première esquisse du
scénario de Parsifal, œuvre maîtresse du compositeur. Mais avant
tout, « Le carnet brun » réservera des moments d’introspection et d’intimité
du musicien d’une rare authenticité. |
| |
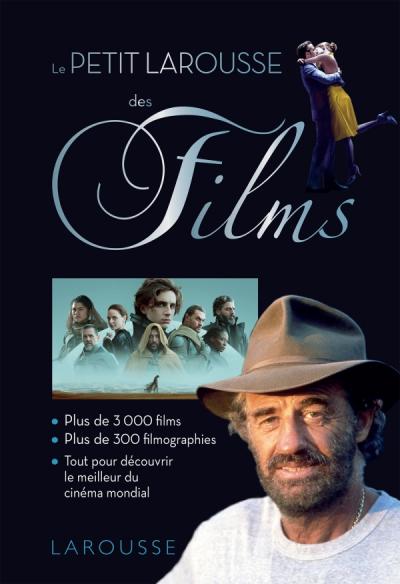 |
« Le
petit Larousse des Films » Larousse, 2023.
Cet ouvrage, véritable somme, publié par les éditions Larousse est parvenu à
réunir et à présenter plus de 3 000 films et 300 filmographies en un seul
(fort) volume de 1 104 pages ! Ce coup de force ravira bien entendu les
passionnés du 7e art qui retrouveront ainsi instantanément les fiches
indispensables à la découverte ou redécouverte des films de légende mais
aussi des pépites plus cachées pour leur plus grand bonheur.
Organisé selon un classement alphabétique, ce guide offre le synopsis de
chaque film, sa distribution ainsi qu’une analyse critique plus ou moins
développée selon son importance dans l’histoire du cinéma. Qui plus est, cet
ouvrage très complet ne se contente pas de dresser un catalogue mais
présente également des filmographies par genres, pays, réalisateurs et
acteurs, un outil pratique pour avoir en quelques pages l’essentiel
permettant de mener ses propres découvertes.
Cette véritable cinémathèque concentrée en un format également pratique (138
x 198 mm) constituera à l’évidence un ouvrage incontournable pour les
amoureux du grand écran ! |
| |
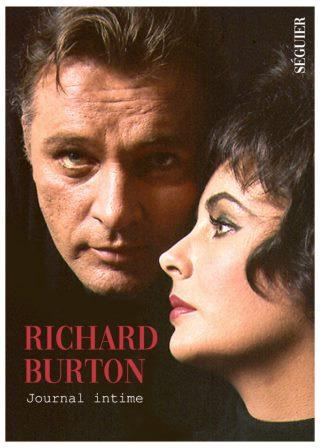 |
Richard
Burton : "Journal intime" publié sous la direction de Chris Williams,
traduit de l’anglais par Alexis Vincent & Mirabelle Ordinaire, 15 x 21 cm,
592 p., Séguier éditions, 2020.
Contrairement à un jugement trop rapide, l’acteur Richard Burton dévoile
dans les pages de son « Journal intime » bien des aspects méconnus de sa
personnalité. Loin des spots d’Hollywood, l’homme y apparaît, en effet, plus
sensible, fragile, tourné vers la littérature, les livres et le théâtre que
les artifices du 7e art ne pouvaient le laisser penser…
Pour cette seule raison, ce volumineux journal déjà expurgé par les
responsables de l’édition mérite d’être lu. Nous y découvrons un esprit bien
éloigné du quotidien des célébrités, même si les excès ne manquent certes
pas dans sa vie débridée… Alors que l’acteur évoque le tournage d’une scène
d’un de ses films, ce dernier n’hésite pas à faire dans son journal une
référence implicite au poète écossais du XVe s. William Dunbar. De même,
enchaînant les tournages, ses rêves se portent sur l’achat d’une péniche où
il pourrait y installer des milliers de livres dans une bibliothèque…
Les jugements sont en ces pages également acerbes, effilés comme une flèche
touchant droit au but, qu’il s’agisse de lui-même où des nombreuses
personnalités qu’il côtoie. Sa description du duc et de la duchesse de
Windsor tient plus d’une évocation du musée Grévin que de ses royaux amis :
« Ébréchés sur les bords. Quelque chose qu’on garde au salon et qu’on ne
sort que les dimanches. Des monarques déchus » ! L’alcool coule à flots,
seul antidote à la trop grande lucidité du comédien qui confesse par
ailleurs ses rêves de voyager, seul, dans un « petit tortillard » avec une
machine à écrire comme compagne au lieu du jet privé qu’il vient de louer
pour des vacances à Gstaad…
Les succès s’additionnent, les déconvenues également, et les excès tentent
vainement d’étouffer toutes les vanités concentrées par le milieu dans
lequel le comédien évolue. Seule échappatoire, pour cet acteur trop connu et
célébré, l’écriture, la poésie et le théâtre, une ivresse moins destructrice
que l’alcool, dans laquelle se réfugiera de plus en plus cette âme plus
sensible que son image ne pouvait le laisser croire... |
| |
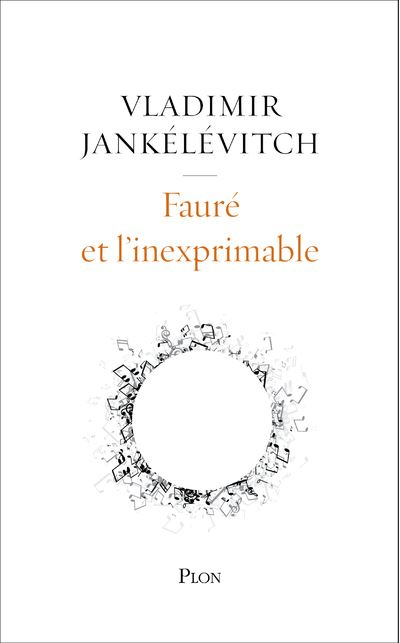 |
Vladimir Jankélévitch : "Fauré et l'inexprimable", Editions Plon, 2019.
Vladimir Jankélévitch est bien connu pour être un philosophe engagé avec sa
fameuse métaphysique du « je-ne-sais-quoi » et du « presque rien ». Fervent
défenseur de la morale au cœur de la philosophie, ce penseur vif et
iconoclaste fut également un musicologue averti, ainsi qu’un pianiste
passionnément amoureux notamment de la musique de Liszt et de ses fameuses
rhapsodies. Mais, c’est à Gabriel Fauré qu’il a également consacré une somme
impressionnante de plus 400 pages et qui vient de faire l’objet d’une
nouvelle édition chez Plon.
Le titre préfigure l’angle retenu par le philosophe – musicologue : « Fauré
et l’inexprimable ». C’est en effet le mystère d’ambiguïté qui sert de trame
à cette réflexion alerte et vive dans laquelle le lecteur retrouvera le
style « Janké », ainsi que le rappelait avec malice le regretté Lucien
Jerphagnon. Il est acquis que la musique de Fauré déconcerte et déroute bien
souvent pour ses apparentes contradictions. L’auteur de « Pelléas et
Mélisande », de « Pavane », suggère, en effet, souvent des couples de
contradictions, qu’il s’agisse de sa musique de chambre, pour piano, de ses
mélodies ou encore de son Requiem. Insaisissable, son inspiration puise à ce
goût certain de l’ineffable si cher à Jankélévitch.
L’auteur consacre la première partie de son essai aux mélodies de Gabriel
Fauré ; Qui n’a jamais entendu en effet sa fameuse Pavane ? Soulignant
l’osmose parfaite qui peut unir poètes et musiciens, Gabriel Fauré n’est pas
en reste, et Verlaine a offert au compositeur ses plus beaux vers où puiser
son inspiration. Fauré n’est pas pour autant le musicien d’un mode unique
d’expression, « son art est complet » souligne Vladimir Jankélévitch. C’est
la « sonorité abstraite et immatérielle » que retient son inspiration, «
celle qui vient du centre de l’âme ». Gabriel Fauré n’est pas plus le
musicien des décors trop précis et des couleurs insistantes selon Vladimir
Jankélévitch. Chez lui « les modes et les influences extérieures semblent
avoir peu de parts » poursuit encore le philosophe avant d’analyser les
trois périodes chronologiques de ses mélodies.
Pour sa musique de piano, si le romantisme est toujours présent, Gabriel
Fauré fait encore preuve de grande liberté. Ses valses se révèlent être à la
fois élégantes sans mièvrerie, brillantes et intimistes. « Mais Fauré ne
nous a-t-il pas habitués à ces contradictions ? » rappelle avec un clin
d’œil Jankélévitch, encore une fois séduit par cette beauté de l’ordre de
l’ineffable.
L’auteur explore encore avec une rare virtuosité « le paradoxe de la rigueur
évasive » du compositeur. L’humour n’est jamais loin de ces renversements de
valeur, où l’accompagnement lui-même est accompagné comme ces « Clair de
lune » et « À Clymène » renversant les rôles entre le piano et la voix. Il
n’est pas jusqu’aux ordres pourtant les plus préétablis qui ne vacillent
dans la partition de Gabriel Fauré, notamment pour l’indétrônable main
droite, avec cette volonté manifeste d’une indépendance des parties, comme
pour la musique d’orgue.
Avec Gabriel Fauré, la musique polyphonique atteint une dimension «
plurivoque » ou plusieurs lignes de pensée sont conduites de front, tout en
étant distinctes et indépendantes. Dialogues et superpositions de voix sont
menés, d’où surgissent parfois des étincelles relève malicieusement Vladimir
Jankélévitch. Gabriel Fauré s’écarte des voies explorées par Liszt et
Debussy et cherche plutôt à suggérer des états d’âme, comme pour «
Allégresse » et « Tendresse » (Dolly). Il faut alors apprendre à composer en
tant qu’interprète et mélomane avec cette apparente nonchalance et pourtant
rigoureuse musique. C’est là toute la complexité, et certainement
l’abondante richesse, de la musique de Gabriel Fauré, comme le met en
évidence de toute aussi brillante et magistrale manière notre philosophe –
musicologue.
Philippe-Emmanuel Krautter |
| |
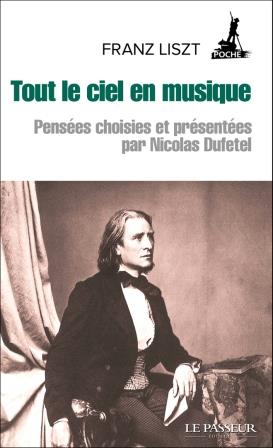 |
« Franz Liszt ; Tout le ciel en musique ; Pensées
choisies et présentées par Nicolas Dufetel, Le Passeur Editeur, 2019.
Un plaisant et bel ouvrage livrant les pensées choisies du grand
pianiste et compositeur du XIXe siècle que fut Frantz Liszt. Réunis pour
la première fois par Nicolas Dufetel, musicologue, chercheur et
spécialiste du XIXe siècle, ces pensées, maximes ou aphorismes sont à
l’image de la musique et du caractère de cette figure majeure du
romantique. Figure complexe, trop souvent mal connue, qui aima
passionnément Marie d’Agoult, fut ami de Georges Sand, de Richard Wagner
qui épousa sa fille Cosima… Des réflexions tout à la fois profondes,
intempestives, impétueuses et fulgurantes empreintes de toute la fougue du
compositeur et abordant les grands sujets de son époque : L’homme et la
société, philosophie et philosophes, les pays et l’Europe, mais aussi bien
sûr, pour cet abbé, la spiritualité et la religion, sans oublier bien
entendu la musique, l’artiste et l’art en général. Un réel régal ! C’est
tout le génie visionnaire de Franz Liszt qui se trouve concentré en ces
pages par les soins et le travail de Nicolas Dufetel, comme pour mieux s’y
déployer. Issues de ses écrits publics ou de correspondances privées,
écrites dans un merveilleux français, langue que le grand compositeur «
hongrois », né en Autriche (1811-1886), affectionnait particulièrement, le
lecteur retrouvera dans ces pensées choisies l’esprit universel de ce
grand cosmopolite du XIXe siècle romantique. Un bel ouvrage avec,
effectivement, « Tout le ciel en musique » pour horizon ! |
| |
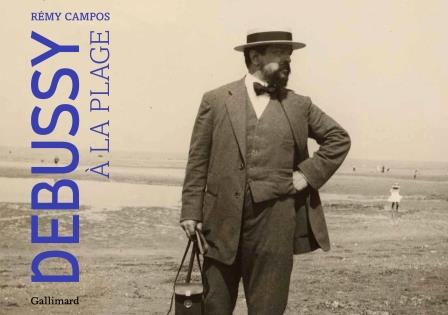 |
Rémy
Campos "Debussy à la plage" Préface de Jean-Yves Tadié, Contient 1 CD audio.
Durée d'écoute : 74 mn, Hors série Connaissance, Gallimard, 2018.
Rémy Campos, professeur d’histoire de la musique au CNSM de Paris, a décidé
de nous faire partager un épisode de la vie de Claude Debussy méconnu, et
pourtant bien plaisant, celui de son séjour pendant l’été 1911 à Houlgate
sur la côte normande, voisine de Cabourg et non loin de Deauville. Là, sur
cette plage paisible, il n’y composera étrangement aucune œuvre, pendant un
mois il sera le vacancier anonyme de ces lieux, sept ans avant sa mort.
Surgis d’archives familiales, les documents, par-delà leurs valeurs
anecdotiques, qu’a su réunir l’auteur Rémy Campo témoignent à la fois de
l’esprit d’une époque, trois ans avant le premier conflit mondial, mais
aussi de l’environnement et entourage du musicien. Houlgate compte en ce
début de siècle parmi les villégiatures appréciées, station balnéaire
prisée, certes moins célèbre que sa rivale Deauville ou sa voisine Cabourg,
elle jouit cependant d’une belle fréquentation. La préface du spécialiste de
Marcel Proust, Jean-Yves Tadié, souligne combien il est étonnant que ni
Proust ni Debussy ne se soient rencontrés, fréquentant pourtant à la même
époque des lieux voisins d’à peine quelques kilomètres. Rendez-vous manqué ?
Très certainement, si l’on songe aux nombreuses affinités qui auraient pu
réunir les deux hommes. En 1911, l’œuvre célèbre de Debussy La Mer a
déjà été créée depuis six ans alors que La Recherche est encore au
stade des brouillons… La mer a inspiré Debussy à distance et le musicien se
plaint de ne trouver en ces lieux l’inspiration alors même que «
Pourtant, la Mer est belle, comme c’est d’ailleurs son devoir »,
devoir ? Lapsus révélateur… Toujours est-il que ce séjour balnéaire
s’avère riche d’enseignements comme le démontre ce livre bien mené, tant sur
le plan iconographique, que pour l’enquête entreprise par son auteur. C’est
en effet tout un passé qui resurgit sous la plume de Rémy Campos, un passé
que les vacanciers de la côte normande ignorent bien souvent, passant sous
les ombres d’anciens grands hôtels reconvertis en villégiatures des temps
modernes aux musiques et animations tapageuses… Nul doute que Debussy et
Proust se seraient rencontrés sur ce point, le second déjà en son temps
trouvait confondant que « de grosses femmes viennent jouer sur la plage
des valses avec des cors de chasse et des pistons jusqu’à ce qu’il fasse
nuit. C’est à se jeter dans la mer de mélancolie » ! Debussy se refusa,
quant à lui, à de porter ces caleçons et maillot rayé, point de bain pour
lui, mais une tenue de ville pour mieux goûter au spectacle de la mer, une
attitude loin d’être singulière à son époque, salon sablonneux où l’on
conversait plutôt. Debussy se fait photographe, lit des romans à 95c., une
vie ordinaire et anonyme de vacancier. C’est le temps de l’insouciance, des
rencontres, du Casino encore existant aujourd’hui, faible ombre de ce qu’il
fut, si le lecteur s’arrête quelque temps sur les photographies
réunies…Mais, en ce temps passé, déjà le mauvais goût faisait ses ravages et
notre compositeur se plaint d’un artiste de saison qui dispense une mauvaise
musique : « la Mer en profite pour se retirer, justement indignée. – Moi
aussi ! » siffle Debussy. Mais la vie du Grand Hôtel d’Houlgate où toute
la famille Debussy a élu résidence pendant un mois rattrape bien ces fausses
notes, vie passée à s’observer, à se changer aux différentes heures du jour
et du soir. Ce beau voyage se termine par un retour à la capitale où le
lecteur pourra découvrir l’intimité du musicien dans un cadre plus formel.
Un bien agréable voyage qui se conclut comme il se doit en musique grâce au
CD audio qui accompagne ce livre avec 74 mn d’enregistrements d’époque
d’œuvres de Debussy, dont une inédite ! |
| |
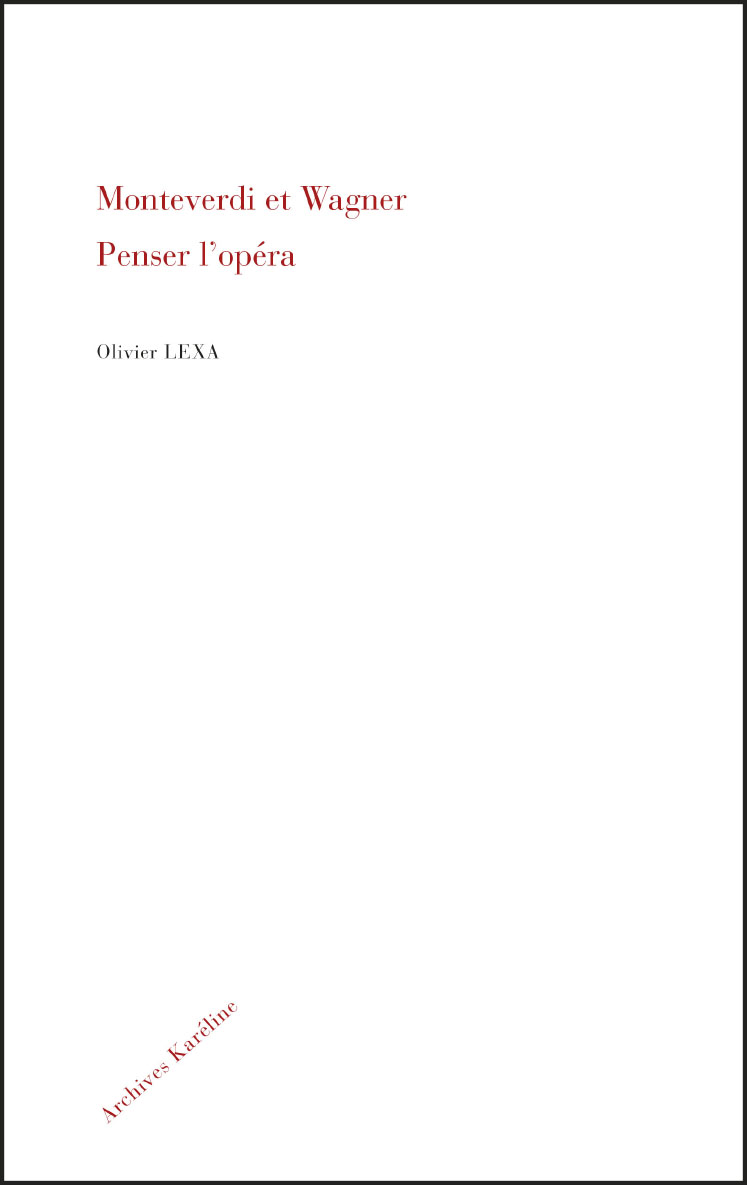 |
Olivier
Lexa « Monteverdi et Wagner, Penser l'opéra » Archives Karéline, Broché -
format : 13,5 x 21,5 cm, 352 pages, 2018.
Curieuse association pour ce titre - Monteverdi et Wagner, Penser l'opéra,
retenu par Olivier Lexa dans son dernier essai paru. Rapprocher le nom de
Wagner à celui de Monteverdi peut, en effet, surprendre si l’on songe à tout
ce qui sépare les deux musiciens sur pas moins de deux siècles. Cependant,
associant histoire de l'art, histoire culturelle et esthétique analytique,
l’auteur - metteur en scène, dramaturge et historien - rapproche avec brio
ces deux compositeurs quant à leur goût commun pour la musique et le
théâtre, et bien sûr, leur rôle essentiel pour l’opéra. En effet, si
Monteverdi jette le premier les bases de ce que sera l’opéra moderne,
Wagner, pour sa part, en repoussera à l’extrême les limites avant la
modernité. La pensée néoplatonicienne qui les anime tous deux inspire
fortement leurs rapports à la création musicale et à l’art, médium entre
réalité quotidienne et réalité supérieure. Tous deux théoriseront leur art,
Monteverdi pour répondre aux attaques dont il était l’objet quant à la
modernité de sa musique, Wagner produisant de nombreux écrits théoriques. Le
rapport au temps, la rédemption par l’amour, nombreux sont les thèmes qui
rapprochent les deux musiciens, similitudes parfois évoquées par le passé
par des analyses comme celles de Pierre Boulez mais jamais étudiées de
manière exhaustive, ce que fait avec science et pédagogie Olivier Lexa dans
ce livre qu’il a su ne pas limiter aux seuls musicologues, mais au contraire
a souhaité laisser toujours accessible. L’ouvrage « Les règles de l’art
» de Pierre Bourdieu a manifestement inspiré l’auteur ; ce dernier a
également retenu l’exemple des œuvres et les nombreuses analogies entre
Monteverdi et Wagner pour développer dans un second temps un historique de
la pensée de l’opéra depuis ses origines au XVe siècle jusqu’à la période
contemporaine. À partir d’une approche pluridisciplinaire et d’une réflexion
sur ce qui constitue une œuvre d’art, Olivier Lexa a souhaité approfondir
cet espace philosophique après Hegel, Novalis, Schopenhauer, Kierkegaard,
sans oublier Nietzsche qui consacra un essai bien connu sur Wagner.
Analysant le rapport à ce genre musical de penseurs comme Adorno, Barthes,
Deleuze, Foucault, Bourdieu, il invite à une conception pleine et entière de
l’opéra. L’auteur souligne en effet les limites de l’enregistrement d’œuvres
qui n’ont jamais été conçues pour s’abstraire du rapport visuel et de leur
dimension théâtrale. Nous entrons ainsi dans ces pages inspirées au cœur
d’une philosophie de l’opéra moins connue que celle instrumentale et que
l’auteur illustre idéalement avec ce livre à partir des exemples comparés de
deux géants de la musique. |
| |
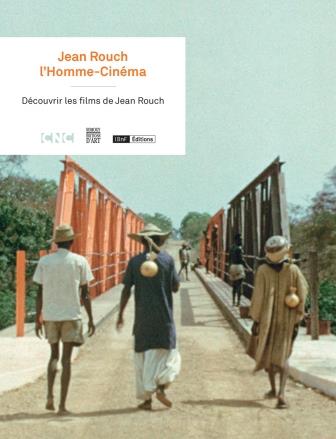 |
« Jean
Rouch, l’Homme-Cinéma - Découvrir les films de Jean Rouch » Somogy, 2017.
Le CNC et la BnF ont heureusement œuvré afin de préserver les archives
filmiques, photographiques et documentaires du cinéaste Jean Rouch. Cette
impressionnante collecte se trouve aujourd’hui réunie à portée de mains et
d’yeux dans ce livre de plus 243 pages, constituant assurément une Bible
incontournable pour tous les amateurs de Cocorico ! Monsieur Poulet, Moi
un noir, Chronique d’un été… Si la filmographie de Jean Rouch est ainsi
réunie dans cet ouvrage, l’avant-propos ne manque pas de rappeler qu’il est
néanmoins fort possible que quelques réalisations soient passées entre les
mailles et sommeillent encore sur des étagères, tant le cinéaste fut
prolixe. Toujours est-il que l’abondance du matériel ne doit pas être
sous-estimée, et l’apparente simplicité du cinéma de Jean Rouch pourrait
laisser croire à tort que la collecte est définitive. Qu’il s’agisse des
photographies de jeunesse, des compagnons de la première heure avec Dalarou,
Damouré Zika, Lam Ibrahima Dia, Talou Mouzourane ou encore des premières
réalisations, c’est un demi-siècle d’images qui défilent d’un continent à
l’autre au fil de ces pages. L’aventure débute en 1947 avec « Au pays des
mages noirs », 13 mn que Jean Rouch jugea sévèrement avec le recul et
qui prélude pourtant à sa grande œuvre à venir. Pour chaque film, une fiche
technique, un résumé, des commentaires et diverses notes accompagnées de
photographies permettent d’avoir une information complète et détaillée sans
arpenter les couloirs de bibliothèques et cinémathèques spécialisées. Ici ou
là, le lecteur découvrira des images ou témoignages émouvants comme cette
fameuse 2CV break de Cocorico ! Monsieur Poulet, annonçant
d’interminables palabres mémorables… Cette riche iconographie complète ainsi
idéalement les fiches réunies sur chaque film, un ouvrage indispensable pour
mieux appréhender et comprendre l’univers du cinéma rouchien. |
|
Sciences, Nature |
 |
«
Plantes rescapées - Récits de sauvetage » de David Happe, 128 p., Editions
Le Mot et le Reste, 2025.
David Happe connaît intimement le domaine végétal auquel il a consacré une
part importante de sa vie, notamment au ministère de l’écologie. Cet expert
arboricole, aujourd’hui indépendant, voue toute sa passion à l’impérieuse
nécessité, celle d’une prise en considération du dramatique déclin de la
flore. Si les périls écologiques font la une des journaux, la lente agonie
d’un grand nombre d’espèces de la flore se fait, en revanche, souvent de
manière plus silencieuse et à l’abri des projecteurs médiatiques…
Ainsi l’auteur a-t-il décidé de poursuivre sa patiente croisade en
témoignant assidûment contre cette évolution qui ne saurait être inexorable
si l’espèce humaine veut bien s’en saisir. A partir de dix courts récits, le
lecteur prendra justement conscience de l’extinction de certaines espèces
florales et ce dont certains passionnés sont parvenus à réaliser afin
d’endiguer cette tendance aussi néfaste pour la planète que pour l’homme.
Botanistes, scientifiques et même parfois l’armée, ont pu en effet conjuguer
leurs forces afin d’apporter des solutions pour la préservation de la
biodiversité aux quatre coins du globe.
A partir du témoignage précieux d’une trentaine d’experts internationaux,
cet ouvrage dresse non seulement un état des lieux, mais souligne également
combien la lutte est loin d’être gagnée si l’on considère que de nos jours
les espèces détruites du fait de l’homme sont plus nombreuses que celles
apparaissant… |
| |
 |
Étienne
Ghys : "Ma Petite Histoire des nombres", Odile Jacob Editions, 2025.
Le mathématicien Etienne Ghys n’est plus à présenter. Mais, au-delà de ses
travaux, ce spécialiste de la géométrie et des systèmes dynamiques s’avère
être également un vulgarisateur scientifique hors pair, ce qui lui a
notamment valu la Médaille de la médiation scientifique en 2022.
Ce souci de transmission dans un domaine aussi abscons se trouve au cœur de
son dernier ouvrage paru aux éditions Odile Jacob « Ma petite histoire des
nombres ». Ce récit accessible entend nous rendre plus familier le concept
mathématique à la source de bien des blocages du genre « J’ai toujours été
nul en maths » ou encore « je suis fâché avec les chiffres »…
L’auteur part du principe que la plupart de ces appréhensions reposent sur
une incompréhension initiale, source de malentendus. Lorsque l’on prend
mieux connaissance des origines d’une idée – en l’espèce d’un concept – et
de ses usages, le rapport s’inverse et permet alors un meilleur
discernement. En un style plaisant et didactique, Etienne Ghys partage
l’objet de sa passion par le truchement de nombreuses anecdotes personnelles
et évocations des nombres dans l’Histoire, qu’il s’agisse des Grecs, des
Romains ou des Arabes. Au fil des pages, le lecteur découvrira que les
nombres sont omniprésents, des lointaines fusées lancées au-delà de l’orbite
de notre planète jusqu’à la plus simple des calculatrices de nos smartphones.
« Tout est nombre » selon Pythagore et Etienne Ghys s’entend dans ces pages
alertes à nous faire partager cette passion pour un sujet devenant bien plus
abordable qu’il n’y paraissait… |
| |
 |
"Atlas
des déserts" de Ninon Blond ;Cartographe d’Aurelie Boissier ; 96 p.,
Autrement Editions, 2025.
À l’heure de la désertification de nombreux territoires de la planète, cet
Atlas des déserts élaboré par Ninon Blond, maître de conférences en
géographie et spécialiste de la physique et humaine, apportera de nombreuses
réponses aux questions que pose cette évolution. L’ouvrage débute en
soulignant la difficulté à définir strictement ce que recouvre la
dénomination désert, sujet délicat exigeant une approche pluridisciplinaire.
L’aridité, bien entendu, mais aussi la dimension temporelle (millions ou
milliers d’années selon les espaces concernés), comptent pour beaucoup dans
la compréhension du phénomène désertique. Grâce également aux nombreuses
cartographies d’Aurélie Boissière, le lecteur réalisera qu’il vaut mieux
parler de déserts au pluriel plutôt qu’au singulier. Entre les déserts
chauds et les déserts froids, il faudra, en effet, aussi compter sur les
déserts d’abri, côtier, continental, de hautes pressions, brumeux ou
ensoleillé… Bref, c’est ainsi toute une typologie des déserts qui s’impose
et que rappelle cet Atlas soulignant également leur longue histoire, leurs
conquêtes et ressources si convoitées de nos jours, sans oublier, bien
entendu, les systèmes traditionnels agricoles et le tourisme. Cet atlas,
illustré par une centaine de cartes et illustrations, offre en moins d’une
centaine de pages un aperçu à la fois éclairant et informé sur ces vastes
espaces mal connus et plus complexes qu’il n’y paraît. |
| |
 |
« Les
plus belles cartes du monde – Du XVIe siècle à nos jours » ; Collectif,
Éditions Autrement, 2023.
Un livre pour voyager et rêver, tel est effectivement l’objet de cette
parution aux éditions Autrement offrant « Les 20 plus belles cartes du monde
» depuis le XVIe siècle jusqu’à nos jours. À peine ouvert, l’ouvrage reflète
effectivement ses trésors, ces cartes d’aujourd’hui et d’hier qui enchantent
par leur diversité, leurs couleurs, formes et univers ; chaque carte livre,
en effet, au regard, à la curiosité et à l’imagination ses mondes propres,
chacune étant présentée sur une page recto-verso avec son histoire, sa date,
son créateur, etc. Scientifiques ou artistiques, ces cartes offrent au fil
des siècles et de leur objet une richesse inouïe.
Des cartes déroutantes et fascinantes venant de siècles lointains telle
cette mappemonde du XVIe siècle en forme de cœur d’Oronce Fine, un des
premiers savants cartographes ou encore des cartes plus récentes notamment
d’artistes ou de plasticiens contemporains telle « La main de la méduse » de
Julien Jaffré de 2022 ou cette carte de Marine Le Breton de 2023 avec son
graphisme en dentelle, mais aussi des cartes célestes, du système planétaire
ou de la lune…
Le plus de ce splendide ouvrage : chaque carte peut être détachée pour être
affichée, rangée précieusement ou offerte… |
| |
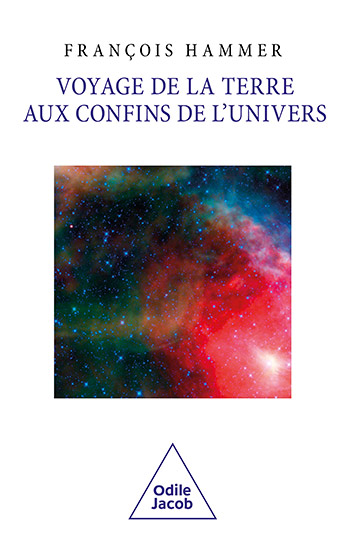 |
François Hammer : "Voyage de la Terre aux confins de l'Univers", Odile Jacob
Éditions, 2023.
L’astrophysicien François Hammer bien connu pour ses travaux sur les
galaxies lointaines nous embarque de nouveau avec son dernier ouvrage pour
un merveilleux voyage interstellaire en sa compagnie… Et comment résister à
cette invitation tant il est vrai que le scientifique se révèle être un
aussi bon pédagogue qu’un guide de l’espace hors pair !
Ainsi, avec lui, au fil des pages alertes et oniriques, nous explorons tout
d’abord notre système solaire qui apparaîtra presque familier sous sa plume
tant l’auteur sait en rendre les complexités compréhensibles. Mais bientôt,
nous dépasserons avec lui les frontières de notre galaxie pour aborder
l’immensité toujours impressionnante des lointaines galaxies et ces espaces
vertigineux dignes des meilleurs films de science-fiction… Des centaines de
milliards de galaxies, rappelle François Hammer !
Mais attention, en ces pages toujours accessibles, il ne s’agit pas pour
autant de vulgarisation facile, mais bien d’un tableau complet sur
l’astrophysique conçu par cet éminent responsable scientifique de grands
spectrographes installés au Chili sur les sites du Very Large Telescope.
Grâce à lui, nous comprendrons ce que sont les planètes, exoplanètes, les
trous noirs comme les nuages de gaz pépinières des nouveaux astres.
Les deux derniers chapitres passionneront également le lecteur en explorant
cette fois-ci le passé de l’univers, un véritable voyage dans le temps dont
François Hammer parvient à rendre la complexité compréhensible au néophyte
avec un rare bonheur. Quasars, galaxies biscornues et autres nuages d’Oort
n’auront plus aucun secret après lecture de ce passionnant ouvrage qui se
conclut sur l’évolution prévisible de la recherche en astronomie ; une
évolution qui file à toute vitesse, mais des progrès qui ne doivent
cependant par faire oublier le danger qui nous guette non pas des confins de
l’univers mais de notre propre planète toute proche de la limite de l’effet
de serre… |
| |
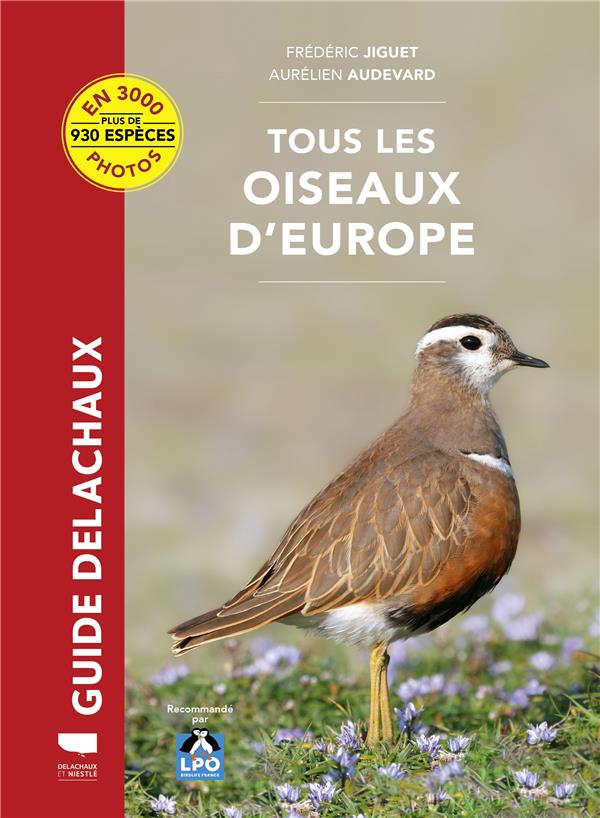 |
"Tous
les oiseaux d'Europe" de Frédéric Jiguet et Aurélien Audevard, 528 p.,
Editions Delachaux et Niestlé, 2023.
Les oiseaux sont menacés, ce n’est malheureusement une découverte pour
personne, mais leur meilleure connaissance devrait cependant contribuer à
une plus grande protection. Tel est le souhait des auteurs de ce passionnant
guide qui vient d’être publié aux éditions Delachaux et Niestlé. Frédéric
Jiguet, professeur au Muséum national d’histoire naturelle, et Aurélien
Audevard, chargé d’études à la LPO, signent ensemble, en effet, cette somme
de plus de 500 pages enrichie de 3 000 photos et 800 cartes permettant
d’identifier 930 espèces de nos contrées et pays d’Europe.
Au-delà de l’exhaustivité remarquable de l’ouvrage, ce guide méritera
l’attention des passionnés de la nature en raison de sa philosophie et de sa
conception faisant de ce livre non seulement un guide de terrain mais
également une somme didactique accessible et complète. Qu’il s’agisse des
nicheurs, migrateurs, hivernants mais aussi des espèces les plus rares, «
Tous les oiseaux d’Europe » offre une description complète de chacun – y
compris de sa voix ! – sans oublier son habitat, et répartition
géographique. Plaisant, exhaustif et qui plus est esthétique, ce Guide
Delachaux sera Le guide à réserver pour découvrir l’univers passionnant de
l’ornithologie. |
| |
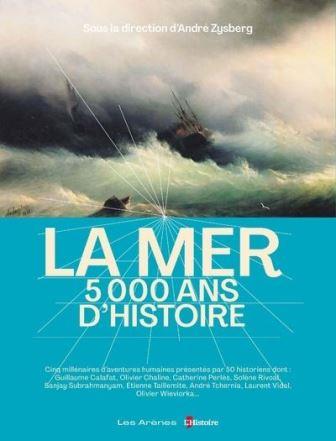 |
André
Zysberg : "La Mer, 5 000 ans d’Histoire", 640 p., 153x240mm, Les Arènes
Editions, 2022.
Somme unique en langue française, « La Mer, 5 000 ans d’Histoire » réalisée
sous la direction d’André Zysberg parvient, véritable défi, à circonscrire
un sujet aussi vaste que ses étendues… Il fallait en effet oser ce défi en
réunissant un comité des plus grands spécialistes sur chaque sujet traité.
Publié en coédition avec le magazine L’Histoire, ce fort volume de presque
650 pages à la fois érudit et accessible aborde la dimension historique des
multiples rapports entretenus par l’homme avec la mer. Qu’il s’agisse des
premiers navigateurs de la préhistoire, des grandes civilisations antiques
étroitement associées à l’élément marin, la Grèce ou encore Rome, sans
oublier ces grands explorateurs et aventuriers qui osèrent la parcourir,
souvent à leurs risques et périls, cet ouvrage monumental embarque le
lecteur dans une odyssée aussi étonnante que diversifiée. La vie quotidienne
des marins au fil des millénaires, les innombrables guerres qui ont troublé
ces eaux, les non moins nombreuses ressources que l’élément marin recèle,
c’est une somme vertigineuse complétée de multiples cartes couleurs dans un
encart central. Cet ouvrage devrait assurément rencontrer un succès mérité,
un cadeau à faire à tout amoureux de la mer ! |
| |
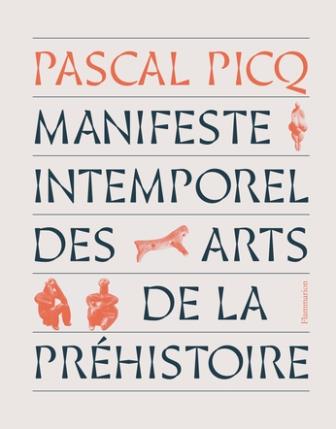 |
Pascal
Picq : « Manifeste intemporel des arts de la préhistoire », Relié, 217 x 276
mm, 160 p., Flammarion, 2022.
Les témoignages des premières expressions culturelles et artistiques des
Sapiens, Dénivosiens ou encore Néanderthaliens ne cessent de questionner nos
contemporains depuis leurs redécouvertes. Art ? Religion ? Symboles ? Ces
divers témoignages de leur créativité parvenus jusqu’à nous demeurent pour
le grand public muets et c’est au spécialiste d’être investi de la lourde
tâche de tenter de les faire parler… Pascal Picq, paléoanthropologue fameux
et réputé pour ses travaux sur l’évolution humaine, livre avec cet ouvrage
une réflexion précieuse sur ces gestes et sensibilités manifestés à l’aube
des temps et dont nous avons perdu les clefs et significations. Loin de
toute supériorité de l’art occidental qui prévalait encore il y a un siècle,
Pascal Picq traverse ces millénaires en rappelant la façon dont nous avons
pu estimer ces œuvres primordiales – et parfois les juger de manière
caricaturale – ces deux derniers siècles. « Aujourd’hui, l’archéologie
préhistorique décrit les vastes civilisations dont les influences
esthétiques et artistiques s’étendent sur des milliers de kilomètres et au
fil de milliers d’années » souligne l’auteur. Dans ce Manifeste intemporel
des arts de la préhistoire, Pascal Picq explore ainsi les origines de cette
volonté de création qui anima les premiers humains, expression qui prit des
formes aussi diverses que la peinture de mains négatives projetées sur des
parois, la sculpture sur bois de cervidé de félins dont nous ignorerons à
jamais la symbolique ou encore cette impétueuse envie de représenter des
formes humaines telles ces éternelles Vénus qui n’ont pas fini de nous
questionner, ce qui n’est pas le moindre mérite de cet ouvrage ! |
| |
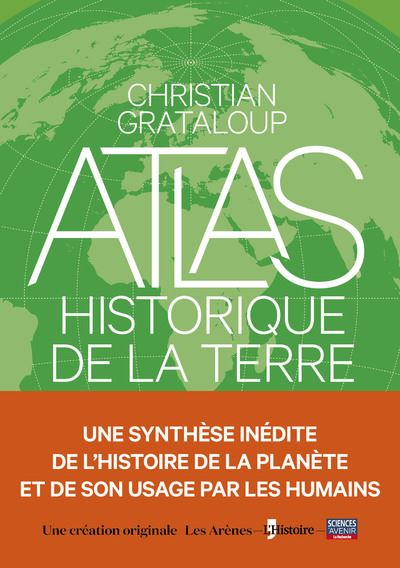 |
Christian Grataloup : « Atlas historique de la Terre », 340 pages, Éditions
Les Arènes, 2022.
L’Atlas élaboré sous la direction de l’éminent géographe Christian Grataloup
devrait combler tous les lecteurs en recherche d’informations exhaustives et
accessibles sur notre planète. Conjuguant les savoirs de plus de trente
scientifiques provenant de différentes disciplines en une habile synthèse,
l’ouvrage parvient en effet en ces 340 pages à proposer une Histoire de
notre planète vieille de 4,5 milliards d’années sur laquelle l’espèce Homo
sapiens ne surgira que vers 300 000 ans. La mise en rapport de ces multiples
échelles chronologiques permet ainsi au lecteur de mieux comprendre nos
implications vis-à-vis de notre planète terre qui à l’échelle de l’univers
n’occupe que quelques brefs instants…
Mettant rapidement en évidence l’un de ses traits caractéristiques,
Christian Grataloup souligne combien la terre se distingue des autres astres
par le fait qu’elle abrite la vie depuis des millions d’années. Conjuguant
avec un rare bonheur cartographie, histoire et géographie, cet Atlas
parvient à placer ces cadres temporels indispensables à la compréhension de
notre histoire et celle de notre planète. Sans verser dans le catastrophisme
climatique et le déclin irréversible, Christian Grataloup souligne : « Notre
objectif est la lutte contre l’amnésie : les passés ne peuvent se comprendre
qu’articulés les uns aux autres. Notre présent est simultanément vieux de
milliards d’années et de quelques siècles ». Du big bang initial à l’état
actuel d’une planète vulnérable sous l’action humaine, cet ouvrage
indispensable devrait assurément figurer dans toute bonne bibliothèque ! |
| |
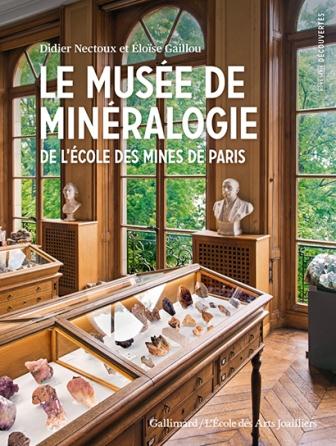 |
Didier
Nectoux et Eloise Gaillou : « Le musée minéralogique de l’Ecole des Mines de
Paris » ; Hors-série Découvertes, Gallimard, 2022.
Le musée de minéralogie est installé depuis 1815 à Paris, précisément à
l’Hôtel Vendôme, en plein cœur du Quartier Latin, accolé au jardin du
Luxembourg et longeant le boulevard Saint-Michel. Ce sont justement les
portes de cette vénérable institution datant du milieu du XIX° siècle, que
vient ouvrir au lecteur le dernier « Découvertes Gallimard ». Une heureuse
idée puisque cette collection minéralogique unique au monde se veut
également être un pôle dynamique permettant au plus grand nombre de
réfléchir aux implications industrielles, politiques, économiques et
environnementales de l’exploitation des minéraux.
Grâce à l’action de Didier Nectoux, le directeur des lieux, c’est une image
modernisée de ces collections qui a été aujourd’hui favorisée et mise en
œuvre. Néanmoins, et pour le plus grand plaisir des amateurs et curieux, ces
collections sont encore présentées dans leur mobilier d’origine préservé,
fait quasi unique au monde, alors qu’un grand nombre d’institutions ont cédé
depuis longtemps aux sirènes du modernisme en abandonnant ce qui faisait
leur charme pour des mobiliers contemporains. Le lecteur aura ainsi le rare
bonheur d’aborder au fil de l’ouvrage ce haut lieu des sciences minérales en
découvrant son histoire et ses évolutions grâce aux explications claires et
concises de Didier Nectoux et d’Eloïse Gaillou, conservatrice au musée.
C’est à une vision d’ensemble à laquelle invite cet ouvrage didactique dont
l’un des atouts, et non des moindres, est de sensibiliser le public aux
implications sur l’écosystème et géostratégique. L’ouvrage invite également
à admirer tout simplement ces collections les plus précieuses de gemmes
rares et aux couleurs chatoyantes, charme visuel unique qu’il sera possible
de prolonger avec une visite sur place ! |
| |
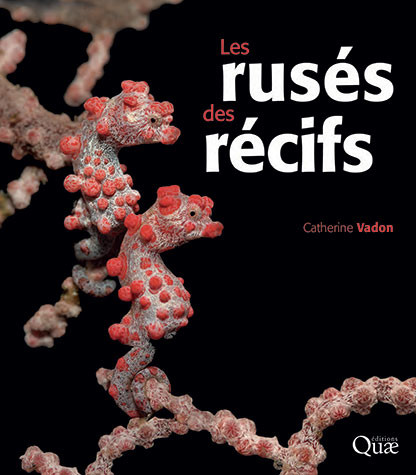 |
"Les
rusés des récifs" de Catherine Vadon, Format 21,5 x 24,5 cm, 168 p.,
Collection : Beaux livres, Éditions Quae, 2022.
Les récifs coralliens, on le sait malheureusement trop bien, sont en danger.
Et pourtant leur importance et la vie luxuriante qu’ils abritent devraient
nous encourager à nous soucier bien plus de leur avenir… C’est l’angle
retenu par ce beau livre signé Catherine Vadon, océanographe de formation,
chercheur au Muséum d’Histoire naturelle et aujourd’hui dans l’expertise de
la biodiversité et écologie marines. Ainsi que le relève d’emblée l’auteur,
ces récifs n’occupent paradoxalementque 1% des fonds de l’océan et sont le
lieu de vie de 25% des espèces océaniques ! Face à cette richesse menacée,
une meilleure connaissance de ce milieu complexe et foisonnant était
nécessaire, ce que contribue à faire cet ouvrage passionnant. Passionnant,
car immergeant littéralement le lecteur dans ces fonds marins où des espèces
les plus diverses déploient des tactiques dignes des plus grands stratèges
pour échapper à leur prédateur ou au contraire attraper leurs proies… Après
avoir évoqué cette « vie en association » qui se trouve à la base même de la
création des récifs, l’auteur décrit dans le détail – souvent effroyable ! -
tout l’arsenal déployé par ces êtres aquatiques : dents, pinces, piquants,
venins, substances chimiques et bien d’autres procédés dissuasifs. Servi pas
de magnifiques photographies, cet ouvrage contribuera à n’en pas douter à
cette sensibilisation impérieuse sur l’avenir des fonds marins. |
| |
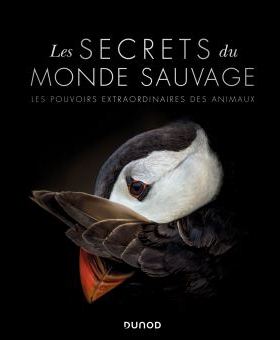 |
« Les
secrets du Monde Sauvage ; Les pouvoirs extraordinaires des animaux » ;
Préfacé par Christ Packham ; Traduit de l’anglais par Benjamin Peylet ; 336
pages, Éditions Dunod, 2021.
C’est un merveilleux et passionnant ouvrage que préface Chris Packhman aux
éditions Dunod. Illustré des plus splendides images, Christ Packham,
naturaliste, écrivain, photographe, mais aussi grand défenseur engagé de
l’environnement, propose de nous dévoiler dans ces magnifiques pages les
fabuleux « Secrets du monde sauvage ». Comment le caméléon réussit-il à se
confondre si bien avec son environnement ? Des plus petites moustaches à
l’esthétique d’un bout de queue, chaque secret nous conte la formidable
adaptation des espèces sauvages à leur environnement. Car si nous
connaissons certes les grandes espèces du monde sauvage, combien de secrets
cependant ignorons nous de cet étrange mais fascinant univers…
Non dénué d’humour, livrant de nombreuses anecdotes instructives, l’ouvrage
aborde aussi bien la communication animale que la séduction ou encore les
migrations. Ce sont ainsi d’extraordinaires capacités d’adaptation que le
lecteur émerveillé par tant de beauté et de performances découvrira, que ce
soit la perception des couleurs, l’odorat ou encore l’art du camouflage.
Loin de n’être qu’un splendide ouvrage, ce dernier aborde une multitude de
thèmes souvent ignorés du monde du règne animal. De la question qu’est-ce
qu’un animal, sa forme, son squelette, chaque chapitre livre ses secrets et
précisions, peau et écailles, sens, bouches et nageoires, bras et queues…
jusqu’aux œufs et petits.
Appuyé par nombreux schémas explicatifs, de dessins et planches joliment
présentés, ce sont tous les secrets, atouts et pouvoirs extraordinaires du
monde sauvage, bien souvent totalement méconnus, qui se dévoilent ainsi page
après page.
Des découvertes infinies qui laissent le lecteur ébahi par tant de beauté,
d’ingéniosité et de capacité d’adaptation. Ainsi que le souligne Christ
Packman en sa préface : « Ce très beau livre présente une fusion parfaite de
(ces) trois vertus. Il célèbre l’art, révèle d’éclatantes vérités, et attise
la curiosité pour les sciences naturelles ».
|
| |
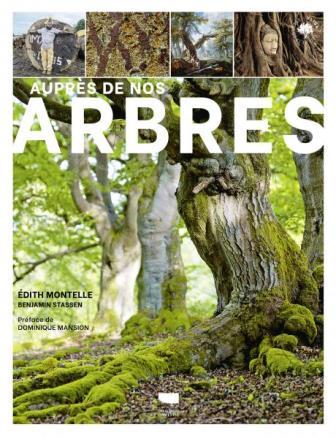 |
«
Auprès de nos arbres » d’Édith Montelle, Éditions Delachaux et Niestlé,
2021.
Certains de nos contemporains redécouvrent ces derniers temps la présence
immuable et pourtant menacée des arbres dans notre environnement. Édith
Montelle et le photographe Benjamin Stassen se chargent dans ce bel ouvrage
paru aux éditions Delachaux & Niestlé dès lors de les accompagner avec
bienveillance et science en une livraison à la fois inspirante et détaillée.
Cet ouvrage fort heureusement réalisé selon le respect de l’environnement
avec du papier issu de sources responsables fourmille en effet
d’informations sur nos majestueux aînés qui préexistaient des millénaires
avant l’apparition de l’homme. Tour à tour protecteurs, guérisseurs, sources
de multiples productions, les arbres semblent quelque peu réduits à un rôle
décoratif de nos jours lorsqu’ils ne sont pas tout simplement omis du
paysage de bien de nos villes contemporaines. Apprendre à les redécouvrir,
retrouver les mythes et légendes auxquels ils ont été très tôt associés,
cette belle réflexion allant d’un simple germe d’un gland de chêne jusqu’au
plus ancien des arbres connus souligne ce lien indéfectible qui nous unit à
ces témoins à la fois robustes et fragiles de la nature. Un ouvrage à
partager en famille afin de prolonger encore notre respect à leur égard pour
les générations futures. |
| |
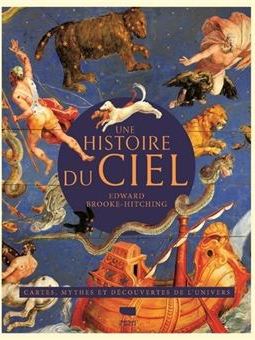 |
« Une
Histoire du ciel » d’Edward Brooke-Hitching ; 18.9 x 24.6 cm, 256 pages,
Éditions Delachaux et Niestlé, 2021. C’est une
belle histoire que nous conte Edward Brooke-Hitching, celle du ciel, de
notre ciel. Une histoire à la croisée des chemins entre histoire, mythologie
et sciences. Du ciel de l’antiquité au « Ciel moderne » en passant par celui
du moyen-âge ou celui des révolutions scientifiques, bien plus qu’une simple
histoire, c’est une fantastique aventure dans le temps et dans l’espace que
nous propose l’auteur, écrivain, journaliste et documentaliste. Passionné de
cartes, de mythologies et de représentations, Edward Brook-Hitching livre,
en effet, en cet ouvrage richement illustré de plus de 250 pages une
extraordinaire histoire de ce qui a de tout temps fasciné les hommes, le
ciel, la Voie lactée, les étoiles et comètes ; Le ciel vu de la terre ou la
terre vue du ciel ou encore lorsque « La mer était au-dessus de la terre » !
Astrologie, astronomie, croyances et sciences scandent ainsi cette
fantastique aventure de la découverte du cosmos et de l’univers des temps
les plus reculés à aujourd’hui. L’imaginaire y côtoie les plus grandes
découvertes dans des représentations fascinantes et à couper le souffle. Une
jolie façon, pour reprendre la pensée de Ptolémée, que nos pieds ne touchent
plus terre, un régal ! |
| |
 |
« Au
nom de l’arbre » ; Collectif sous la direction de Cyril Drouhet ;
Introduction de Sylvain Tesson ; Préface de Jacques Rocher ; 224 pages,
Éditions Albin Michel, 2021.
« Au nom de l’arbre » est à la fois un cri d’alarme mais aussi un bel éloge
de l’arbre, des arbres et des forêts, et surtout un très bel espoir… Car,
souligne en son introduction Sylvain Tesson, si
« les modalités techniques de la déforestation sont multiples, l’origine
profonde est la même : partout où la pression humaine s’accroît, la forêt
s’efface » . L’espoir renaît
cependant lorsqu’on va à la rencontre de ceux et celles qui se battent et
résistent aujourd’hui pour contrer cette déforestation et destruction
massive des ressources naturelles. Ce sont ces extraordinaires
rencontres avec ces hommes et femmes engagés, ces batailles concrètes pour
la replantation et la biodiversité, tel un espoir pour l’humanité que nous
propose justement ce splendide ouvrage réalisé sous la direction de Cyril Drouhet.
Ainsi, le lecteur pourra-t-il découvrir cette forêt qui renaît en Éthiopie
ou encore celle renaissant de ses cendres au Portugal. Jacques Rocher,
président de la fondation Yves Rocher, rappelle pour sa part, en sa préface
son engagement et sa rencontre décisive avec « la Femme qui plantait des
arbres », Wangari Muta Maathai, prix Nobel de la paix et écologiste.
Des
pages qui nous entraînent également vers ces contrées ou paysages où la
forêt est protégée et gardée, au Togo avec les jardiniers de la forêt ou
encore en France avec les gardiens du territoire. Rencontre magique aussi
avec ces papillons monarques du Mexique et la réserve d’El Rosario…
Ce sont ainsi pas moins de neuf rencontres d’une forêt vivante et plurielle
que l’ouvrage nous propose ; neuf rencontres écrites par neuf auteurs et
magnifiquement illustrées par neuf photographes engagés et de talent. Et, «
là où les arbres reviennent, bêtes, hommes et dieux rétablissent l’équilibre
! » écrit Sylvain Tesson convoquant pour cette belle ode aux arbres la
poésie, Victor Hugo ou encore Larbaud ou Nerval...
Et si nous prenions effectivement le temps, un jour, – ainsi que le suggère
Jacques Rocher – d’être un arbre ?... |
| |
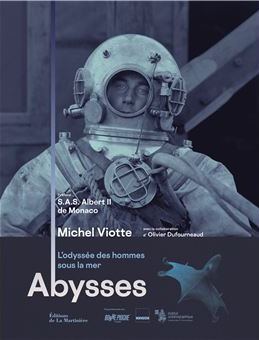 |
«
Abysses – L’Odyssée des hommes sous la mer » de Michel Viotte avec la
collaboration d’Olivier Dufourneaud ; Préface de S.A.S. le Prince Albert II
de Monaco ; 224 pages, Éditions La Martinière, 2022.
L’histoire de l’exploration des fonds marins constitue une incroyable
aventure tant humaine que technologique. Cette science commencée au milieu
du XIXe siècle qui a pris le nom d’« océanographie » a été le fait
d’aventuriers, de scientifiques, mais surtout de passionnés tel le Prince
Albert 1er, le « Prince navigateur », ainsi que le rappelle le Prince Albert
II de Monaco dans sa préface. C’est cette fabuleuse aventure, cette «
Odyssée des hommes sous la mer » que nous faire découvrir ce formidable
ouvrage de Michel Viotte avec la collaboration d’Olivier Dufourneaud. Face
aux profondeurs, aux pressions et courants extrêmes, face aux contraintes du
froid et à l’absence de lumière, que de défis relevés !
Que d’exploits, effectivement, réalisés ayant permis depuis plus d’un siècle
et demi l’exploration des profondeurs de l’océan, on songe à l’invention du
scaphandre autonome, aux submersibles à propulsion, aux habitats sous-marins
ou encore aux robots téléopérés… les auteurs reviennent sur la naissance et
« Les pionniers de l’océanographie ». Largement et joliment illustré et
appuyé de cartes, de reproductions et photographies, l’ouvrage nous fait
également découvrir le travail sous la mer avec les premiers scaphandres et
pieds-lourds, puis les scaphandres rigides jusqu’à « L’avènement de la
plongée autonome ». Les chapitres suivants se consacrent à repousser
toujours plus loin les limites et présentent les « Nouveaux défis » avec
notamment les habitats, vaisseaux, robots et laboratoires sous-marins. Une
histoire et un monde fascinants... Que de défis et d’avancées ! C’est
assurément une passionnante plongée dans les plus grands fonds marins que
nous offre cet ouvrage. |
| |
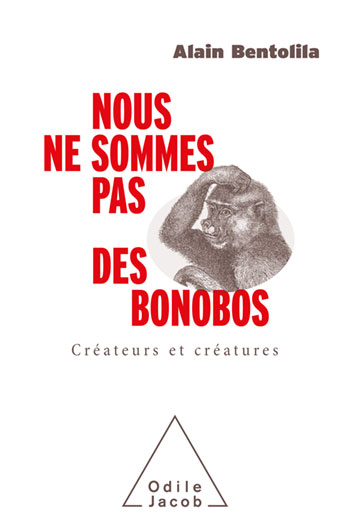 |
Alain
Bentolila : "Nous ne sommes pas des bonobos - Créateurs et créatures",
Éditions Odile Jacob, 2021.
Derrière ce titre un brin provocateur se cache un brillant essai sur la
fonction du langage. Ainsi que le souligne l’auteur, professeur de
linguistique à l’université Paris-Descartes et directeur de recherche : « Ce
n’est pas l’évolution de l’espèce humaine qui a entraîné la création du
langage ; c’est la création du langage qui a défini son évolution. Un petit
enfant n’apprend pas le langage parce qu’il grandit, c’est le langage qui le
fait grandir », dont acte !
L’ouvrage explore ainsi en termes clairs et didactiques comment et par
quelles voies le langage se trouve constitutif de créations et
d’originalités, et non d’imitations et répétitions. Par cette approche,
l’auteur s’oppose à l’idée selon laquelle notre langage serait comparable
aux instruments de communication des autres espèces animales. L’audace de la
pensée humaine dépasse pour lui les simples automatismes de communication
pour atteindre un degré de nuances, de sensibilités, à nulle autre pareille.
Mais, entre manipulation et conviction, information et mensonge, combien de
subtilités et d’imperfections possibles ? L’art du langage et de la
rhétorique étaient naguère choyés par les Anciens qui nourrissaient ce bien
si précieux au point de le placer au sommet de l’éducation des jeunes
enfants. Parler, lire et écrire n’étaient en rien une activité mécanique et
répétitive, mais un art en soi dont il fallait le plus tôt acquérir les clés
au même titre que le musicien à l’égard de la musique. Propre de l’homme, le
langage nourrit et enrichit notre humanité, mais si nous le négligeons et le
reléguons à l’arrière-plan de l’éducation, il pourrait bien être le terreau
de nouvelles manipulations et violences, nées de l’impuissance à exprimer ce
qui est au cœur de l’homme ainsi que le démontre ce stimulant essai. |
| |
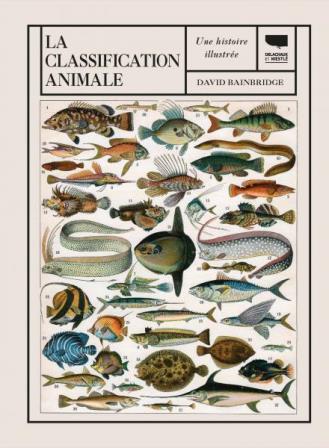 |
« La
classification animale – une histoire illustrée » de David Bainbridge ;
171x236, 256 p., Éditions Delachaux et Niestlé, 2020.
Avec l’ouvrage de David Bainbridge, c’est l’univers à la fois mystérieux et
fascinant de la classification animale qui se dévoile pour le plus grand
bonheur de ses lecteurs. En un ouvrage clair et didactique pour un sujet
ardu, l’auteur montre combien toutes ces disciplines aux noms souvent
hermétiques trouvent leur source dans cette tentative de décrire le vivant
et, en l’espèce, le monde animal. Phylogénétique, taxonomie, cartographie
génétique, phénétique, systématique, biostratigraphie, taphonomie,
génomique… Cependant, toutes ces disciplines ne sont pas nées du hasard,
mais bien de cette lente et patiente interrogation des hommes depuis
l’Antiquité sur les différentes espèces d’animaux vivant parmi eux. L’auteur
est un scientifique réputé à l’Université de Cambridge au département de
médecine vétérinaire. Son point de vue est non seulement celui de l’homme de
sciences, mais également d’un pédagogue hors pair, et ce, afin de mieux
faire comprendre comment toutes ces divisions et sous-classements trouvent
leur origine.
Les premières pages décrivent ainsi combien l’univers de la science peine
tout d’abord à se dégager de croyances métaphysiques et religieuses, ces
domaines étant souvent confondus à l’origine. Ce n’est que par une lente et
patiente observation, une volonté toujours plus aiguisée de s’abstraire de
l’idéologie pour s’appuyer sur de nombreuses expérimentations que l’univers
animal sera progressivement présenté sous une forme plus rationnelle.
L’ouvrage abondamment illustré de nomenclatures artistiques fait la
démonstration que ces interrogations, en plus d’éclairer le monde qui nous
entoure, révèlent souvent bien des traits de notre propre espèce. |
| |
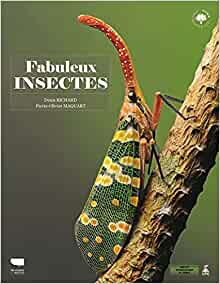
|
«
Fabuleux insectes » de Denis Richard et Pierre-Olivier Maquart ; 22 x 28.5
cm, 240 pages, Éditions Delachaux et Niestlé, 2021.
Denis Richard et Pierre-Olivier Maquart signent un fabuleux ouvrage consacré
aux plus fantastiques insectes aux éditions Delachaux et Niestlé. Très
joliment illustré, avec une vaste iconographie et plus de 230 pages, les
auteurs, tous deux docteurs et spécialistes, nous ouvrent en effet les
portes d’un monde d’une richesse inouïe, celui des insectes les plus
fabuleux de notre monde. Entre cabinet de curiosités aux mille secrets et
découvertes, études d’entomologie et histoire des sciences, l’ouvrage
présente ainsi pas moins de cinquante « Fabuleux insectes » répertoriés sur
les cinq continents.
D’extraordinaires insectes reconnus pour leur beauté à nulle autre pareille,
leur rareté ou encore pour leurs fantastiques capacités notamment
d’adaptation. En cinq chapitres, non sans humour, les auteurs font
assurément mouche et livrent à la curiosité, mais aussi à la fascination,
voire à l’imagination du lecteur, des mondes surprenants et passionnants.
Des insectes aux aptitudes étonnantes relevant « Records et défis », tels
ces « Guêpes lilliputiennes » ou ces insectes des lieux inhospitaliers,
coléoptères peuplant les déserts d’Afrique australe ou encore la mouche «
Belgica antarctica », seul insecte en Antarctique. Des insectes faisant
aussi rêver tels les « Scarabées-bijoux », mais également des insectes
recherchés comme un « Dieu des choses laides » !
Si certains ont disparu, d’autres apparaissent ou réapparaissent ces
dernières années dans nos contrées notamment les fameux moustiques tigres ou
encore les redoutables punaises de lit.
Assurément, ce sont les portes d’un monde fascinant que les pages de cet
ouvrage richement illustré nous ouvre, celles-là même de notre monde, celui
de « Fabuleux insectes » lorsque la nature se fait féérique ou magicienne… |
| |
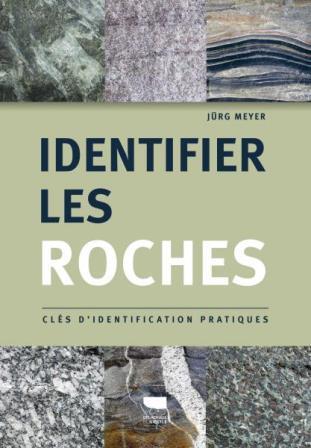 |
«
Identifier les roches » de Jürg Meyer, 144 p., Éditions Delachaux & Niestlé,
2021.
Les roches nous environnent de partout, même lorsque nous ne soupçonnons pas
leur présence. Combien de fois avons-nous buté subrepticement sur l’une
d’entre elles sans même savoir son nom, ses origines ou son âge, souvent
vertigineux… Afin de ne plus rester dans l’ignorance, Jürg Meyer a conçu un
guide très précieux car il s’adresse au néophyte, tout en lui prodiguant des
enseignements complets, et ce, de manière très accessible sur les bases de
géologie.
Cette passion qui l’a conduit à partager ses connaissances de diverses
manières (géologue, guide de montagne, conférencier) se retrouve à chaque
page de cet ouvrage qu’il a su rendre agréable et attractif sur un sujet qui
par ailleurs aurait pu être aride. Grâce à la pédagogie de l’auteur, le
lecteur saura distinguer la structure des roches, leur origine volcanique,
sédimentaire, métamorphique, plutonique…
L’approche repose sur une démarche à la fois scientifique et pratique, l’une
n’allant pas sans l’autre. 300 types de roches se trouvent ainsi distingués
en ces pages agrémentées de 460 photographies et de nombreux graphiques.
C’est à un véritable jeu de repérage et d’identification auquel convie Jürg
Meyer avec cet ouvrage, une pratique accessible au moindre détour d’un
chemin, aidé seulement d’une bonne loupe, de ces précieux conseils et de
curiosité pour notre environnement ! |
| |

 |
L’Atelier la Trouvaille – matériel et conseils pour la géologie et minéraux
L’Atelier La Trouvaille compte assurément parmi ces adresses incontournables
dans le monde de la géologie, minéralogie, taille de pierre et autres
domaines scientifiques où le sérieux allié à la passion prédomine. Depuis
plus de 40 années à Remoulins, cette société réputée a su s’adapter au fil
des évolutions technologiques tout en gardant en permanence les critères
d’excellence et de haute qualité en matière d’outils et d’articles liés à la
pierre. En recherchant en permanence les meilleures sources et les dernières
technologiques, l’Atelier La Trouvaille porte, en effet, bien son nom et
fait figure de véritable adresse incontournable tant pour les professionnels
que pour les amateurs.
Le site web de l’Atelier de la Trouvaille fourmille ainsi de propositions
allant des outils nécessaires aux plus inimaginables pour la pratique de la
géologie comme pour la gemmologie jusqu’aux précieux microscopes et autres
machines perfectionnées.
L’amateur de minéraux et fossiles trouvera son bonheur pour s’équiper dans
les meilleures conditions avec un choix de matériel adéquat et de qualité.
Parmi les nombreuses propositions, l’incontournable loupe de poche.
Indispensable, celle-ci permettant d’observer le détail des échantillons
prélevés.
La loupe Doublet de terrain de grossissement x10 assurera avec précision et
efficacité toutes les observations de détail sur les minéraux, fossiles,
botanique, entomologie… Le terme aplanétique signifiant que les lentilles de
la loupe ont été corrigées quant aux défauts géométriques. Avec une lentille
de diamètre 20mm et un champ de vision également de 20mm, cette petite loupe
en métal protégée par un étui en cuir s’avérera le compagnon précieux et
indispensable de l’amateur comme du professionnel.
Soulignons, enfin, que l’Atelier la Trouvaille est plus qu’un site de
matériel en ligne, les passionnés qui animent cette aventure proposant
également tout au long de l’année de partager leurs compétences sous forme
de stages autour de la taille de pierres précieuses, facettage, cabochonnage,
initiations à la gemmologie, mais aussi en proposant des conseils en ligne
avec de nombreux articles sur la géologie, les minéraux, les microscopes,
sans oublier la vente de minéraux… A découvrir !
Pour toutes commandes et renseignements : Atelier la trouvaille 4,rue LT.
Colonel Broche BP 48 30210 Remoulins Tél. 04 66 37 07 65
www.atelierlatrouvaille.com |
| |
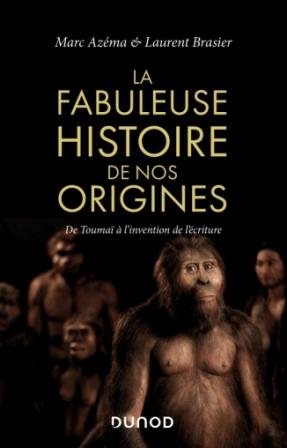 |
« La
fabuleuse histoire de nos origines – De Toumaï à l'invention de l'écriture »
de Marc Azéma et Laurent Brasier, Éditions Dunod, 2020.
C’est une vertigineuse plongée dans le passé de l’humanité qui attend le
lecteur de « La fabuleuse histoire de nos origines ». 7 millions d’années
défilent en effet sous nos yeux, page après page, en un panorama aussi vaste
que concis, servi par deux plumes éprises de pédagogie et de science. Marc
Azéma est chercheur associé au CREAP et membre chargé de l’étude de la
grotte Chauvet en Ardèche. Laurent Brasier, quant à lui, voue une véritable
passion dans le cadre de son métier de journaliste scientifique pour tout ce
qui a trait au passé, ce qui justifie pleinement cette étonnante odyssée
humaine illustrée et nourrie par des textes précis et clairs. Jean Guilaine,
l’éminent professeur au Collège de France (lire notre interview) souligne
d’ailleurs en préface de l’ouvrage le caractère atypique de cette somme qui
retient 120 « flashes » déterminants de l’évolution.
Cette approche est d’autant plus originale qu’elle se trouve étendue à
l’ensemble de la planète et bénéficie des toutes dernières données de la
science. Ainsi le lecteur prendra-t-il connaissance des conditions
d’émergence des premiers hominidés bipèdes avec notre ancêtre, le fameux
Toumaï découvert par Michel Brunet (lire notre interview), il y a plus de 7
millions d’années. De ces dates lointaines et abstraites pour nous, jusqu’à
l’invention de l’écriture, que d’évènements décisifs pour l’humanité et les
civilisations qui en découleront, des étapes essentielles rappelées avec un
rare talent didactique par les auteurs en des synthèses précises et
facilement mémorisables grâce aux repères et échelles temporelles
constamment rappelés en gras pour chaque notice. Les premiers pas, les
premiers mots, les premiers outils et représentations pariétales sont
égrenés au fil de ces pages en un merveilleux récit de nos origines. |
| |
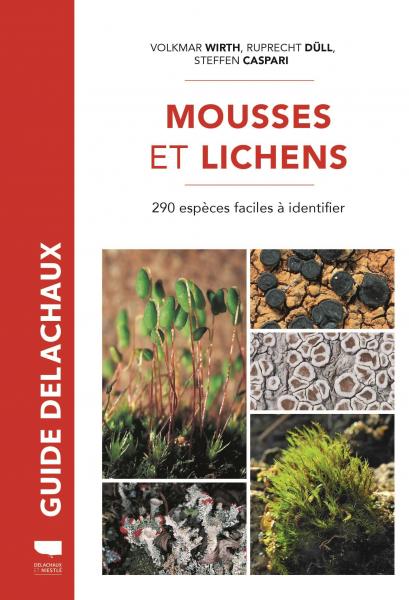 |
«
Mousses et lichens » Volkmar Wirth, Ruprecht Dull et Steffen Caspari, Guide
Delachaux, 336 p. Éditions Delachaux & Niestlé, 2021.
L’univers des mousses et lichens accompagne bien souvent notre quotidien à
notre insu. Un interstice subrepticement caché à l’embrasure d’une fenêtre,
deux pierres disjointes ou encore le sommet d’un faîtage peuvent
soudainement se métamorphoser en pépinière merveilleuse de ces plantes, la
plupart du temps négligées. Certes, ces dernières n’offrent guère de
floraisons spectaculaires, ni de fruits tentateurs, mais les subtiles
variations de leurs teintes au gré des saisons et la multitude des détails
qui se dévoilent à qui sait leur prêter attention réserveront bien des
heures inoubliables.
C’est le thème de ce fantastique univers des « Mousses et lichens » qui est
justement retenu par ce très réussi Guide Delachaux réalisé avec science et
passion par Volkmar Wirth, Ruprecht Dull et Steffen Caspari. Un guide
recensant et présentant pas moins de 290 espèces facilement à identifiables
grâce aux nombreuses photographies réunies. Afin de se transformer en
bryologue – dénomination officielle des spécialistes de ces petites mousses
et lichens - les auteurs ont adopté une démarche à la fois rigoureuse et
souple, en présentant ces plantes, leur port et leur substrat. Deux critères
essentiels ont prévalu pour les auteurs, à savoir que l’espèce soit à la
fois commune et aisément reconnaissable. L’identification d’une mousse peut,
en effet, parfois poser quelques difficultés, aussi les auteurs de cet
ouvrage ont-ils volontairement privilégié les exemplaires les plus faciles à
distinguer.
Les lichens présents sur les arbres, rochers et sols maigres sont
étrangement composés simultanément d’un champignon et d’une algue. Cette
combinaison surprenante constitue dès lors le propre des lichens,
conditionnant selon leur variété, leur aspect extérieur, mais aussi leur
physiologie et écologie. Les mousses comme les fougères appartiennent aux «
archégoniates », bien adaptées à la vie terrestre, puisque les traces
fossilisées des plus anciennes mousses remontent à 350 millions d’années… à
l’image des lichens, les mousses font figure de plantes colonisatrices, les
premières supportant plus une pénurie hydrique.
À l’aide des précieux conseils fournis par ce guide, l’amateur équipé d’une
bonne loupe et de curiosité pourra partir à la découverte d’un univers
passionnant et disponible au seuil de sa porte ! |
| |
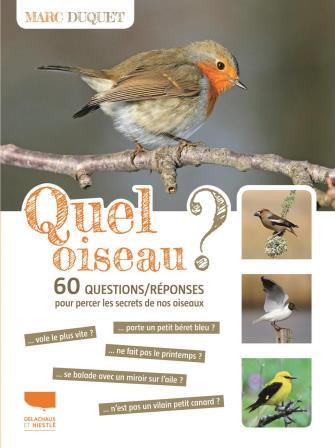 |
« Quel
oiseau ? » de Marc Duquet, 140 x 190, 128 p., Editions Delachaux et Niestlé,
2020.
Qui n’a jamais ressenti la frustration de ne pouvoir répondre à la question
« quel est cet oiseau ? » De nos jours, identifier ces compagnons du
quotidien relève non seulement de la curiosité naturelle mais, qui plus est,
d’une démarche écologique indispensable. Alors qu’un grand nombre d’espèces
d’oiseaux se trouvent menacées par la pollution, la destruction de leur
habitat et l’urbanisation excessive, mieux connaître la soixantaine
d’espèces communes vivant en Europe ne peut contribuer qu’à leur
préservation. Une connaissance et préservation des plus urgentes. D’autant
plus que le style alerte et ludique de Marc Duquet, passionné de nature et
spécialiste des oiseaux, rendra l’exercice attractif et plaisant avec des
réponses à des questions simples comme « quel oiseau harponne les poissons
avec son bec ? » (le martin-pêcheur) ; « Quel oiseau chante à tue-tête la
nuit dans le jardin ? » (le rossignol) ; « Quel oiseau a des pattes beaucoup
trop longues ? (L’échasse)… Avec pour chaque espèce, une description
rappelant les caractéristiques principales de chaque oiseau, ce petit livre
ludique illustré de 110 photos s’avère être particulièrement instructif et
pourra servir d’ailleurs à des jeux de question/réponse en famille ou entre
amis. Un ouvrage toujours bien venu. |
| |
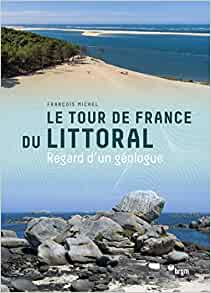 |
« Le
tour de France du littoral ; regard d’un géologue » de François Michel, 21
x28.2 cm, 288 p., Éditions Delachaux et Niestlé, 2020.
En cette époque où les Français redécouvrent leur littoral, les éditions
Delachaux et Niestlé proposent un ouvrage qui ne peut manquer de susciter
intérêt et curiosité puisque ce dernier nous entraîne dans un tour de France
géologique du littoral français. Un fabuleux tour des nombreuses et diverses
côtes françaises, de celles de la Manche à celles de l’Atlantique jusqu’à la
Méditerranée sans oublier les côtes des territoires d’outre-mer, offrant non
seulement un voyage de découvertes, mais également des plus instructifs et
passionnants sous le regard du géologue François Michel. Car, ne l’oublions
pas, au-delà de cette merveilleuse diversité des côtes françaises, le
littoral parce qu’entre terre et mer, vit, évolue et bouge… « Le littoral
est cette ligne mouvante, trait d’union qui marque la triple frontière entre
la terre, la mer et l’air. Ces trois composantes modulent son aspect et
façonnent les paysages sous contrôle des changements climatiques qui, depuis
toujours, animent et dessinent la géographie de la planète. », rappelle
l’auteur.
Extrêmement bien réalisé et documenté, scientifique mais accessible, ce «
Tour de France du littoral » permet, en effet, non seulement de découvrir
l’ensemble et la diversité du littoral français, mais aussi et surtout d’en
appréhender leur histoire et leur nature géologique. Que nous content, en
effets, ces étendues de sable fin que nous avons parcouru cet été, quelle
est « La petite histoire d’un grain de sable » ? Que disent ces dunes
presque magiques qui « naissent et se déplacent ». C’est toute l’histoire du
littoral du bassin parisien, du Massif armoricain, aquitain, méditerranéen
et de l’outre-mer que nous racontent en ces pages.
Par cette compréhension, l’auteur François Michel, déjà auteur de nombreux
ouvrages, entend aussi sensibiliser aux phénomènes affectant les multiples
et variées côtes françaises. Vagues, marées, tempêtes, courants, bien peu de
phénomènes garderont en ces pages leurs mystérieux secrets, sans oublier,
bien sûr, l’impact du changement climatique sur l’ensemble du littoral
français. À la lecture de cet ouvrage, nous comprenons comment et pourquoi
certains phénomènes - pour certains imminents - sont ou peuvent être dès à
présent prévisibles et comment nous pouvons dès aujourd’hui commencer à nous
en protéger.
Un ouvrage, clair, détaillé et captivant livrant une merveilleuse et
accessible compréhension du littoral français à mettre sans hésitation entre
toutes les mains ! |
| |
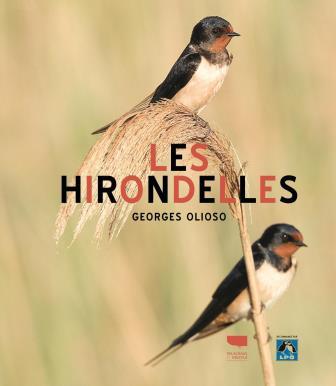 |
« Les
hirondelles » de Georges Olioso, Éditions Delachaux & Niestlé, 2020.
Et si les hirondelles disparaissaient à jamais de nos maisons et jardins, à
l’image des abeilles menacées ? C’est un cri d’alerte que lance Georges
Olioso, spécialiste depuis plus de 40 ans de ces oiseaux, et qui a noté des
comportements étranges concernant ces petits animaux pourtant si familiers
des hommes depuis l’aube des temps.
Ainsi, l’auteur note-t-il qu’un grand nombre de nids se trouvent inoccupés
année après année, et pire encore sont souvent arrachés par l’homme au
prétexte que ces oiseaux seraient sources de nuisances dans notre quotidien…
Pesticides, poteaux et autres pièges tendus par l’homme menacent également
ces petites bêtes pourtant si utiles dans notre vie quotidienne, sans parler
du plaisir esthétique à les regarder.
C’est pour éduquer les générations futures à leur préservation que cet
ouvrage a été conçu, en proposant une réflexion particulièrement exhaustive
sur cette famille d’oiseaux dont cinq espèces vivent en France alors que
leurs congénères occupent tout aussi bien le Moyen-Orient, l’Alaska ou
encore l’Égypte. L’auteur propose quelques repères utiles pour comprendre
leur histoire la plus ancienne puisque ces petits volatiles trouveraient
leur origine, certes lointaine, auprès des énormes dinosaures ! Leur mode de
vie, leur reproduction et, bien sûr, leurs toujours aussi mystérieuses
migrations se trouvent analysés dans ces pages à la fois accessibles,
détaillées et joliment illustrées. La dernière partie, surtout, de l’ouvrage
se doit d’être partagée avec le plus grand nombre possible de personnes au
risque, un sombre matin, de ne plus voir aucune hirondelle zébrer nos ciels
d’été…
Un plaidoyer passionné et passionnant qui encourage à la préservation de ces
petits oiseaux si familiers et aimant tant partager nos granges, remises et
habitations ! |
| |
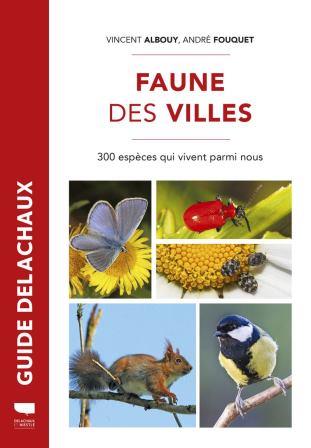 |
« Faune
des villes - 300 espèces qui vivent parmi nous » de Vincent Albouy (Auteur),
André Fouquet (Photographies), Relié, 224 p., Éditions Delachaux et Niestlé,
2020.
L’épidémie que le monde connaît actuellement donne une nouvelle actualité à
la « Faune des villes », titre du dernier ouvrage paru aux éditions
Delachaux et Niestlé. Le confinement provoqué par cette crise a, en effet,
non seulement conduit nos contemporains à mieux observer ces êtres vivants
bien souvent ignorés, mais qui plus est, à remarquer qu’ils profitaient de
la situation pour être beaucoup plus visibles. Et que de diversité et
découvertes !
« Faune des villes », ce guide écrit par Vincent Albouy, et nourri d’une
abondante iconographie grâce aux belles photographies d’André Fouquet,
invite justement le lecteur à cette rencontre fascinante, et connaître ces
pas moins de 300 espèces qui vivent parmi nous dans nos villes, souvent à
notre insu. Comme le souligne Vincent Albouy, les centres urbains les plus
bétonnés peuvent paradoxalement accueillir une faune insoupçonnée, même si
les dernières décennies démontrent une décroissance notable de leur
diversité. Si nos communes commencent à prendre conscience de la nécessité
de ne point faucher systématiquement les espaces publics afin d’encourager
cette biodiversité, il n’empêche que rares sont devenus de nos jours les
friches et terrains vagues qui abondaient il y a encore une trentaine
d’années dans nos villes. Ce que l’homme a gagné sur la nature, cette
dernière la retranche inexorablement de notre quotidien. Aussi est-il
indispensable, notamment pour les futures générations, de sensibiliser le
plus grand nombre à cette présence souvent discrète, et néanmoins
indispensable.
Après avoir rappelé les grands principes indispensables à la préservation et
encouragement de la biodiversité - tout à fait accessible au niveau
individuel - ce précieux guide dévoile quelles sont précisément ces 300
espèces qui cohabitent, tant bien que mal, avec notre propre espèce. Ce sont
tout d’abord les vertébrés bien connus avec les oiseaux, ceux bien
familiers, bien entendu, tels nos pigeons, moineaux, canards et autres
mouettes, et tant d’autres dont nous ignorons le nom. Mais aussi de plus
rares qui s’installent parfois dans nos villes telles la cigogne blanche sur
les clochers et les toits, les hérons au bord de nos plans d’eau ou encore
ce beau et bleu Martin-Pêcheur d’Europe d’un si joli bleu… Pour chacun, une
petite fiche pratique propose une photographie, ses caractéristiques,
identification et biologie. Le lecteur pourra dès lors poursuivre son
exploration naturaliste en découvrant au fil des chapitres cette étonnante
diversité parmi les mammifères et autres vertébrés, puis les invertébrés
avec les somptueux papillons, sans oublier les insectes de toute sorte, un
fascinant bestiaire observable au seuil de notre porte ! |
| |
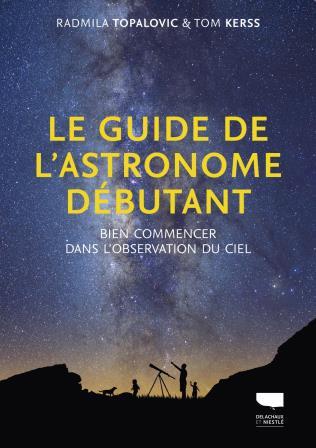 |
"Le
Guide de l'astronome débutant - Bien commencer dans l'observation du ciel"
de Tom Kerss & Radmila Topalovic, Delachaux et Niestlé, 2020.
Si la voûte céleste s’offre à la vue de tout à chacun lorsque la pollution
lumineuse s’estompe, sa découverte nécessite cependant quelques guides et
conseils, au risque de céder trop rapidement au découragement. C’est l’objet
de ce petit ouvrage pratique conçu par Tom Kerss et Radmila Topalovic, tous
deux astronomes professionnels à l’Observatoire royal de Greenwich. Mais que
l’on ne prenne pas peur, nos deux guides ont souhaité proposer un
accompagnement des plus clairs et accessibles pour les néophytes comme
l’indique le titre de l’ouvrage bénéficiant d’une belle iconographie malgré
sa petite taille.
Tirant avantage du handicap certain de nos cieux urbains noyés de lumière la
nuit, nos auteurs suggèrent justement de faire l’apprentissage dans ce
contexte contraignant, avant de se rendre à la campagne ou en montagne où
des myriades d’étoiles attendent chaque nuit l’astronome. À l’instar de
chaque discipline, une séance d’astronomie ne s’improvise pas - et après
avoir rappelé en une précieuse synthèse l’essentiel à connaître du ciel
nocturne – ce guide précise dans le détail comment préparer une séance
d’observation de manière très pratique. Habituer sa vision à la nuit, savoir
distinguer les couleurs des astres et leurs significations, être capable de
déchiffrer une carte du ciel et connaître les différentes magnitudes, sans
oublier les récents logiciels d’astronomie disponibles sur smartphones et
tablettes, c’est tout d’abord « avec les yeux » que les auteurs conseillent
de découvrir la voûte céleste.
Puis viendront les séances magiques aux jumelles ou mieux encore au
télescope qui révéleront le ciel profond, les fameux anneaux de Jupiter,
sans oublier Dame Lune, si proche au grossissement de l’objectif que l’on
croirait pouvoir la saisir…
La deuxième partie propose, enfin, une série d’objets à observer ainsi que
différentes cartes saisonnières du ciel en fin d’ouvrage.
Un précieux guide à emporter lors de ses découvertes astronomiques à la
campagne ou en ville du balcon de son appartement au cœur de la nuit étoilée
! |
| |
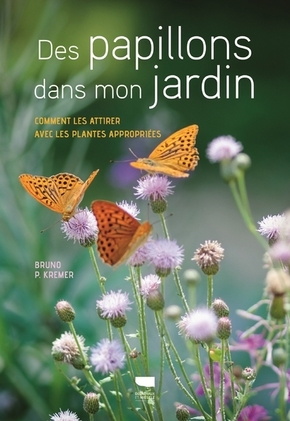 |
« Des
papillons dans mon jardin - Comment les attirer avec les plantes appropriées
» de Bruno P. Kremer, 208 p., Format 15,5 x 22,5, Coll. Les guides du
naturaliste, Éditions Delachaux et Niestlé, 2020.
Alors que la faune et la flore sont de plus en plus menacées par la
pollution et le réchauffement climatique, les lépidoptères - ou papillons
dans le langage courant - sont en première ligne des victimes de ces
changements. Il devient de plus en plus rare en effet de les observer dans
nos jardins et ce n’est que très récemment qu’une prise de conscience a été
entreprise afin d’inverser cette tendance et de retrouver ces tableaux
multicolores miniatures de nouveau sur les parterres de fleurs qu’ils
affectionnent. C’est justement l’objet de ce petit livre informé, véritable
guide illustré désireux d’accompagner tout amateur de papillons. L’ouvrage
souligne deux points essentiels à respecter afin de favoriser cette présence
tant souhaitée : bannir tous traitements chimiques de son jardin et choisir
les bonnes plantes dont le nectar attirera sans hésitation ces nobles
insectes. L’auteur, Bruno P. Kremer, offre dans cet ouvrage abondamment
illustré la démarche à suivre, de manière simple et didactique à partir de
40 papillons fréquentant le plus souvent nos jardins et le choix de 80
plantes permettant de les attirer. La tâche n’apparaît plus aussi complexe
après avoir retenu les nombreux et judicieux conseils de l’auteur ; La
lecture des trois étapes essentielles au développement de l’espèce aideront
à faire les bons choix pour pouvoir observer la chenille, puis la
chrysalide, et enfin le papillon dans toute sa splendeur. Quels lieux
retenir, quelle architecture florale, les plantes hôtes, les bonnes
pratiques comme celle de laisser en paix certains coins du jardin où se
cacheront les précieuses chenilles avant la phase de repos… tels sont les
nombreux conseils avisés dispensés par l’auteur avant la seconde partie
consacrée à la description détaillée des plantes favorisant la venue des
papillons dans son jardin, des plantes de toutes les couleurs et pour tous
les goûts afin de transformer nos espaces en un enchantement esthétique et
vivant, une pratique écoresponsable indispensable à la survie de ces nobles
insectes. |
| |
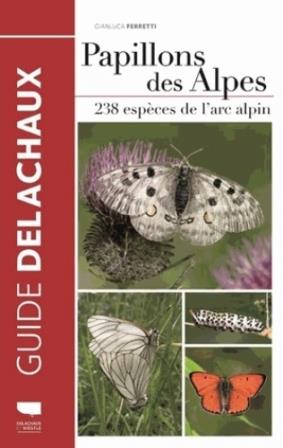 |
«
Papillons des Alpes - 238 espèces de l'arc alpin » de Gianluca Ferretti,
Coll. Les guides du naturaliste, Cartonné, 351 p., Editions Delachaux et
Niestlé, 2020.
Alors que nombre de papillons ont malheureusement déserté nos villes et
campagnes en raison de la trop grande pollution, il est des lieux cependant
où leur habitat demeure encore – provisoirement ? – préservé, notamment les
montagnes des Alpes. Quiconque a eu le plaisir de marcher, grimper ou
crapaüter dans les alpages un jour d’été ensoleillé n’a pu qu’en garder un
souvenir éblouissant, papillons et fleurs confondant leurs couleurs en un
tableau impressionniste… Mais, le guide conçu avec science et pédagogie par
Gianluca Ferretti permettra justement de mettre un peu d’ordre dans ces
belles impressions, certes, mais demeurant le plus souvent vagues. Il est
vrai que les Alpes comptant plus de 200 espèces de lépidoptères, de quoi
faire un petit travail de révision sous la houlette de notre guide chevronné
Gianluca Ferretti. L’auteur, Milanais de naissance, est en effet un
passionné de cette faune de la chaîne alpine qu’il a parcourue de long en
large, et par un rigoureux travail, il entend aujourd’hui proposer dans les
pages de ce guide très complet une riche synthèse bénéficiant de très belles
photographies, certaines même prises sur le vif. Cet ouvrage clair et
accessible permettra ainsi aux néophytes de pouvoir identifier très
rapidement les principales espèces grâce aux caractéristiques concises et
précises rassemblées accompagnées de leurs visuels sur ces 238 espèces de
l’arc alpin. Outre ces caractéristiques principales, l’aire de distribution
et les périodes des stades de développement exposées permettront également à
l’amateur de partir au bon endroit et à la bonne époque à la recherche de
ces insectes sous la forme de chenille, chrysalide ou papillon. Le lecteur
aura grand intérêt à s’imprégner des premières sections offrant un rapide,
mais complet rappel sur la classification des lépidoptères, leur
morphologie, cycle de développement, répartition et observation. Cet ouvrage
pourra ainsi accompagner d’inoubliables randonnées en montagne pour les
grands comme les petits afin d’identifier le plus grand nombre des papillons
des Alpes et contribuer ainsi à leur préservation. Un émerveillement infini… |
| |
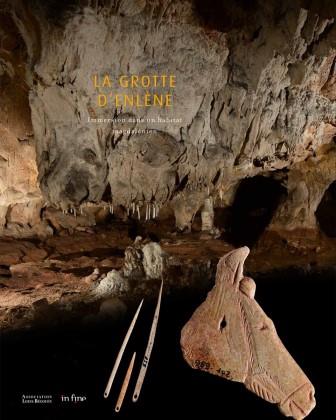 |
« La Grotte
d’Enlène », Sous la direction de Dr Andreas Pastoors, Robert Begouën et Jean
Clottes, In Fine éditions, 2019. Ce magnifique
volume, aussi beau que scientifique, vient compléter l’aventure consacrée
aux trois cavernes de Volp. Ainsi, après le Sanctuaire secret des Bisons
(2009), La Caverne des Trois-Frères (2014), c’est au tour de la grotte d’Enlène
de profiter de cette exceptionnelle étude entièrement consacrée à cet
habitat magdalénien trop peu connu du grand public. Avec 456 pages et autant
d’illustrations, cet ouvrage offre une immersion au sens propre comme figuré
dans cet habitat préhistorique unique pour en révéler tous les trésors.
Outre la beauté exceptionnelle du site, cette publication est, aussi et
surtout, l’occasion grâce à ses auteurs réputés de mieux comprendre le
quotidien de ces chasseurs il y a 17 000 ans…
C’est, en effet, un véritable travail de bénédictin a été mis en œuvre, un
travail minutieux que cet ouvrage recense et détaille page par page. Qu’on
en juge ! : Pas moins de 6 000 objets photographiés, sans compter le
lithique, quelque 60 000 coordonnées spatiales les plus divers enregistrées,
inventaire exhaustif de tout le mobilier présent dans la grotte… Robert
Bégouën souligne que cet immense travail qui constitue le plus souvent le
quotidien de l’archéologue, fut en ces lieux uniques l’occasion d’admirer et
d’apprécier la richesse, l’art et la spiritualité, une occasion
exceptionnelle qui devaient animer leurs auteurs. Une splendeur que transmet
idéalement ce remarquable ouvrage scientifique par son esthétique soignée
qui ravira l’amateur. Accessible tout en offrant une étude précise et
approfondie de cette culture magdalénienne, les auteurs ont fait choix de
commencer par l’historique d’Enlène depuis sa description en 1805 par Pierre
Dardenne. Le rôle essentiel joué par la famille Bégouën, avec ce rare souci
de conservation et de préservation des lieux lors des fouilles de 1911 à
1937, est également rappelé par Robert Bégouën. Robert Bégouën qui perpétue
cette belle aventure familiale jusqu’à nos jours. Sont ensuite présentées
les années de recherches menées de 1970 à 2018, un travail collectif,
notamment avec Jean Clottes, en une ambiance familiale assurant le gîte et
le couvert des fouilleurs…
L’analyse détaillée du site et de son environnement permet de mieux
comprendre la complexité de ce labyrinthe réunissant les trois sites des
Cavernes du Volp, et dont fait partie la grotte d’Enlène à son extrême Est.
Grâce à cette reconstitution exceptionnelle des différents espaces et de
leurs artefacts représentatifs, le lecteur aura l’impression de visiter
lui-même les lieux, salle après salle et détaillant les différentes zones
d’activité préhistoriques. Les photographies qui ont également fait l’objet
de tous les soins en remplaçant les appareils photo par les dernières
innovations révèlent des détails insoupçonnés comme ces nombreux os fichés
dans les fissures de certaines parois et dont la signification reste
mystérieuse. L’étonnement saisit le lecteur lorsqu’il comprend que les
habitants de ces grottes eurent à cœur de réunir de belles pierres et
minéraux qui n’avaient d’autres utilités qu’esthétiques et peut-être
magiques, une pratique qui nous rapproche ainsi de ces ancêtres pourtant si
éloignés de nous… Les objets décorés quant à eux inscrivent encore plus ces
Magdaléniens dans un processus créatif et artistique, allant de la plus
simple incision jusqu’à la représentation figurative élaborée.
Ce livre incontournable marque une étape essentielle quant à l’étude du
site, réunissant toutes les connaissances disponibles, et permettant, ainsi
dès à présent, d’ouvrir vers d’autres recherches notamment quant au
comportement et usages des Magdaléniens dans ces grottes. Passionnant. |
| |
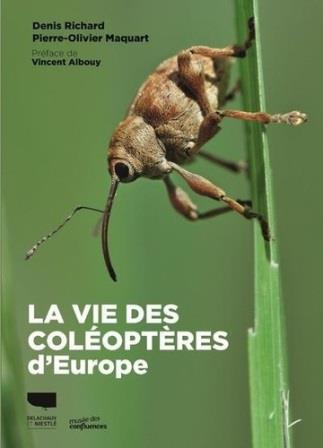 |
« La
vie des coléoptères d’Europe. », par Denis Richard et Pierre-Olivier
d’Europe ; Préface de Vincent Albouy, Éditions Delachaux et Niestlé, 2019.
Savez-vous que les coléoptères constituent l’animal le plus nombreux et le
plus diversifié habitant la planète avec plus de 450.000 espèces, dont
20.000 en Europe ? Qui ne s’est jamais arrêté pour observer avec étonnement
une de ces petites bêtes ? Deux « coléoptéristes », experts scientifiques,
Denis Richard et Pierre-Olivier d’Europe, auteurs déjà de nombreux ouvrages
en ce domaine, ont eu l’heureuse idée de nous conter avec passion leur vie.
Un livre extrêmement bien réalisé ayant pour objectif d’introduire à ce
monde fabuleux des coléoptères. Un univers fascinant dans lequel «
L’extraordinaire est certainement ce qui caractérise le mieux les
coléoptères », souligne Vincent Albouy dans sa préface. Ni encyclopédie ni
traité, écartant toute savante exhaustivité, les auteurs ont fait choix de
présenter les propriétés essentielles de ce monde vivant et d’en souligner
la singularité. Une approche attrayante, réservant une multitude de
surprises qui étonneront plus d’un lecteur, sans jamais négliger la rigueur
scientifique qu’exige, néanmoins, un tel ouvrage.
D’où proviennent leurs coloris ? Pourquoi les verres luisants luisent-ils ?
Pourquoi nos scarabées ont-ils des si belles cornes ? Autant de questions
que tout à chacun s’est déjà posé et se pose régulièrement observant ce
monde des plus fascinants et pourtant souvent bien mal connu !
Afin d’y remédier et de rendre accessibles au plus grand nombre les secrets
de cet univers merveilleux des coléoptères, l’ouvrage propose d’en décrypter
les comportements et de mieux comprendre leur rôle essentiel dans
l’équilibre de notre écosystème, un équilibre aujourd’hui des plus
menacés... Végétariens ou prédateurs, le lecteur découvrira aussi leurs
modes d’organisation, de défense, de communication ou encore de
reproduction. Douze chapitres, richement illustrés de photos couleur,
intégrants des encadrés instructifs et ludiques, dans lesquels le monde des
coléoptères se dévoile au sein même de leur milieu naturel aquatique ou
souterrain… Savez-vous cependant qu’il n’existe pas de coléoptères marins ?
Un ouvrage qui intéressera tout autant les entomologistes, naturalistes que
tout curieux, fruit d’un minutieux travail mené par Denis richard et
Pierre-Olivier d’Europe et largement salué par le monde scientifique et
Vincent Albouy : « Grâce à un travail patient et acharné, les auteurs nous
offre un livre qui fera date sur la biologie des coléoptères. Il est digne
de ceux publiés dans les années 1980 par Roy Crowson en anglais et Renaud
Paulian en français, par la qualité et l’accessibilité du texte comme par
l’originalité des illustrations. »
Après découverte et lecture de ce passionnant ouvrage, ce sera, donc, avec
impatience que nous retrouverons, lors des premiers jours du printemps, la
coccinelle qui dit le beau temps, le hanneton printanier ou le si majestueux
cerf-volant de nos contrées, et bien d’autres coléoptères encore ! Un
merveilleux monde aujourd’hui menacé si ne savons le comprendre et le
préserver. |
| |
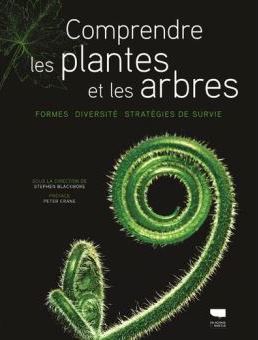 |
«
Comprendre les plantes et les arbres, Forme, diversité, stratégie de survie.
», Sous la direction de Stephen Blackmore, Préface de Peter Crane, Éditions
Delachaux & Niestlé, 2019.
Que faire de mieux en ces temps d’hiver que de préparer nos premières
escapades de printemps les premiers rayons de soleil venus ? C’est ce que
nous propose avec des pages emplies de merveilles scientifiques cet ouvrage
fort complet « Comprendre les plantes et les arbres » aux éditions Delachaux
et Niestlé, sous la direction de Stephen Blackmore, botaniste anglais
réputé, nommé botaniste de la reine d’Angleterre en Écosse depuis 2010. Un
ouvrage extrêmement bien réalisé, à la mise en page claire, livrant dans un
langage accessible et concis une multitude de précieuses informations que
l’on ignore le plus souvent sur le règne végétal. Un monde fascinant apparu
il y plus de 500 millions d’années sous formes d’algues et offrant une
diversité étourdissante, des plantes reproductrices de poisson aux plantes
urticantes ou carnivores, des mousses microscopiques aux arbres les plus
géants ! Le lecteur ne pourra que demeurer stupéfait devant tant de beauté,
de complexité et diversité…
Après avoir rappelé la morphologie des plantes, répondant ainsi à la
question fort simple en apparence, mais à laquelle peu savent répondre - «
C’est quoi une plante ? » ou encore « Pourquoi les plantes sont-elles vertes
» - ce sont les racines, tiges et troncs qui sont présentés, décortiqués et
expliqués. En deux chapitres, le lecteur découvrira avec étonnement le rôle,
la dynamique, l’adaptation de ces plantes… qu’il s’agisse de racines
enfouies ou aériennes, chacune livre leurs secrets.
L’étude des tiges et troncs apportera également son lot de surprises ;
Croissance, structures, apport de l’eau, mais aussi les limites de la
hauteur, les variétés de tiges. Servi par une très belle iconographie, le
chapitre consacré aux feuilles explose de toutes ses couleurs. L’auteur
souligne combien « Les feuilles vertes forment la trame de la vie sur terre
et en leur sein. L’activité silencieuse de la photosynthèse alimente la
majeure partie de cette vie. La photosynthèse est un remarquable exercice de
magie chimique… ». Une magie essentielle et source de vie tant pour le règne
végétal qu’animal, et donc pour l’homme. Formes, tailles, disposition,
couleurs et même transpiration… rien n’échappe à cette étude aussi claire
que complète. De nombreux encadrés viennent judicieusement offrir des focus
instructifs ou divertissants. Abordant, également la reproduction, puis les
cônes et les fleurs, c’est un incroyable royaume de formes et couleurs qui
s’ouvre alors au lecteur. Que de diversité et ravissements ! Parfum,
couleur, nectar qui donneront naissance aux graines et aux fruits,
apparitions, développement, conservations y sont abordés.
L’auteur a fait choix, enfin, de clore ce bel et riche ouvrage par un
dernier chapitre consacré à « L’homme et les plantes », conservation,
comestibilité, et surtout « La préservation de la diversité végétale », une
préservation plus qu’urgente dont dépend non seulement la survie du monde
végétal, mais aussi du règne animal, y compris de l’Homme.
Un ouvrage, célébrant toute la beauté du monde végétal, aussi scientifique
et encyclopédique qu’accessible, une merveille de réussite ! |
| |
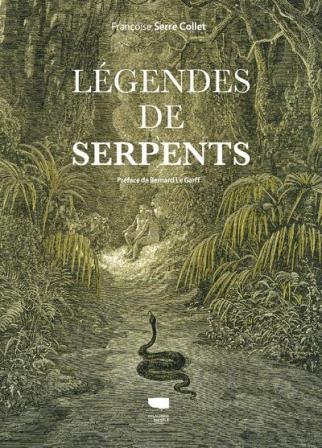 |
«
Légendes de serpents. », Textes et photographies de Françoise Serre Collet,
Éditions Delachaux et Niestlé, 2019.
« Quels sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes… » Ce pourrait bien
être ceux de ces belles « Légendes de serpents » que nous propose
aujourd’hui Françoise Serre Collet aux éditions Delachaux et Niestlé. Un
ouvrage fort documenté et passionnant qui se laisse approcher, apprivoisé
sans danger avec un rare bonheur. Rien d’étonnant à cela puisque Françoise
Serre Collet est une herpétologue réputée, auteur déjà de nombreux ouvrages
sur les reptiles, grenouilles ou encore salamandres. Autant dire que les
serpents n’ont pour elle guère de secret. Et ce sont ces mille et un secrets
que nous dévoile cet ouvrage sur plus de 250 pages.
Souvent redoutés, assimilés au mal et donc mal aimés, il n’en a cependant
pas toujours été ainsi ; Bernard Le Garff, qui signe la préface de
l’ouvrage, relève qu’ « Avec nos yeux d’Européens du XXIe siècle, on serait
tenté de croire que cette phobie est universelle et a toujours existé. Or –
souligne-t-il – elle est très spécifique de notre civilisation occidentale
et relativement récente ». On songe, effectivement, au fameux serpent
d’Esculape, serpent au pouvoir guérisseur qui se glissa jusqu’à Rome. De
même, encore aujourd’hui, le venin de serpent est utilisé en pharmacopée…
Mais, Bernard Le Garff souligne encore combien « les serpents ont le triste
privilège d’être les plus mal aimés du règne animal ».
Les serpents, il est vrai, ont toujours fasciné, et ce depuis les temps les
plus anciens. Présents dans la mythologie, on les retrouve dans quasiment
toutes les religions, vénérés ou relégués au royaume du mal. Très
représentés dans l’iconographie médiévale, ils ont toujours hanté les contes
et légendes avant que la littérature ou le cinéma plus récemment, ne les
convoquent… Et les Viperidés, Élapidés, Colubridés, Pythonidés ou encore
Boïdés habitent, encore de nos jours, sans que l’on ne les connaisse
précisément, bien des songes… Fort de sa puissance évocatrice, le serpent
fut même investi depuis toujours d’un vigoureux pouvoir symbolique. Qui plus
est, capable de changer de peau, l’image du serpent s’est bien souvent
métamorphosée, et il n’est pas rare ainsi de les retrouver dans la
mythologie ou les légendes en créatures hybrides chimériques fort étranges ;
Mais, par ces instructives et merveilleuses pages, le basilic, l’Ouroboros
ou encore le Tatzelwurm, n’auront plus de secret pour le lecteur… Ouvrage
écrit et réalisé scientifiquement, l’ouvrage permettra aussi de ne plus
mettre tous les serpents, nos serpents, dans le même panier, et de savoir
les différencier ; ce qui peut être bien utile et évitera de tuer pour rien
une inoffensive couleuvre.
Appuyé d’une belle et riche iconographie, dont l’auteur signe les
photographies, ce sont tous ces pouvoirs, forces et facettes de ce fabuleux
et fascinant animal, le serpent, que l’ouvrage aborde et déroule de chapitre
en chapitre. Et après lecture, il faut avouer, que Françoise Serre Collet
pourrait bien être une redoutable charmeuse de serpents ! |
| |
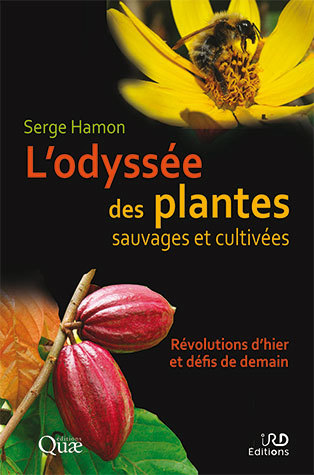 |
Serge
Hamon « L’odyssée des plantes sauvages et cultivées - Révolutions d’hier et
défis de demain », Editions Quae, 2019.
À l’heure de la biodiversité et de la prise en compte des méfaits de
l’activité humaine sur l'écosystème soulignés par le terme Anthropocène,
l’ouvrage de Serge Hamon publié aux éditions Quae offrira une réflexion non
seulement précieuse mais également enrichissante par son style accessible au
plus grand nombre. L’auteur, généticien à l’IRD et spécialiste de la
diversité et de l’adaptation des plantes invite son lecteur à explorer en
effet notre rapport au végétal et à ces liens souvent intimes unissant les
plantes et l’homme à commencer par la nourriture, mais aussi la santé, les
matériaux… Sans plantes, pas d’oxygène, faut-il le rappeler ! Le point de
départ est donc vital. Nous suivons ainsi cette extraordinaire odyssée des
plantes que l’auteur nous révèle avec un talent didactique indéniable
jusqu’à cette étape cruciale de la génétique avec la génomique qui pour la
première fois dans l’humanité fait entrer le scientifique au cœur de ce qui
constitue chaque plante. Des navigateurs rapportant dans la vieille Europe
des plantes aujourd’hui considérées comme communes jusqu’à l’agrobiodiversité
contemporaine, que de chemins parcourus par ces compagnes de l’homme. C’est
dans la seconde partie de l’ouvrage que se situent les principaux défis pour
l’homme dans son rapport au végétal, qu’il s’agisse de l’emprise génétique,
mais aussi des changements climatiques sans oublier les nombreuses questions
soulevées par la dégradation environnementale. Le lecteur y trouvera tous
les éléments nécessaires à une meilleure compréhension des défis qui
attendent notre planète et le monde végétal. |
| |
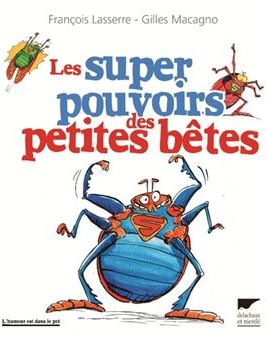 |
François Lasserre et Gilles Macagno : « Les super pouvoirs des petites bêtes
», Éditions Delachaux et Niestlé, 2019.
« Les super pouvoirs des petites bêtes » est un petit ouvrage
fourmillant de mille et une choses extraordinaires sur les insectes. Ces
derniers sont nombreux et variés sur terre, mais avouons que nous ne savons
souvent bien peu de chose d’eux ; quelques noms familiers que nous croisons
dans notre environnement, quelques espèces que nous trouvons belles,
surprenantes, parfois même un peu effrayantes, nous nous inquiétons aussi
pour certaines de leur possible disparition, mais après ? Et si nous
commencions par les connaître un peu mieux ? C’est à cette tache que se sont
attelés les auteurs de ce fabuleux petit livre, François Lasserre et Gilles
Macagno. Ces derniers, enseignant et professeur, tous deux très impliqués
dans l’environnement et les sciences de la nature, n’en sont pas à leur
premier coup de maître. Mais, ils fascineront, une nouvelle fois, tout
autant petits et grands, avec ce dernier ouvrage aussi charmant qu’avenant,
aux dessins et au style non dénués d’humour, et aux insolites connaissances…
Sait-on par exemple que certaines fourmis sont des agricultrices chevronnées
sachant avec science cultiver des champignons ? Et les amateurs gourmands de
miel de sapin savent-ils que ce miel si goûteux est en vrai un miel de
crottes de moucherons ? De même, savez-vous pourquoi nous ne sentons jamais
un taon sur nous avant que cette « sale bestiole » ne nous pique ? Mais
n’allons pas trop vite en qualificatifs, le lecteur découvrira aussi que
certains moustiques – certes pas nécessairement ceux de nos contrées et
chaudes nuits d’été, sont d’une rare beauté, « une forme animale »
que n’aurait très probablement pas reniée Adolf Portmann. Un ouvrage
passionnant à partager ! |
| SPORT
& SANTE |
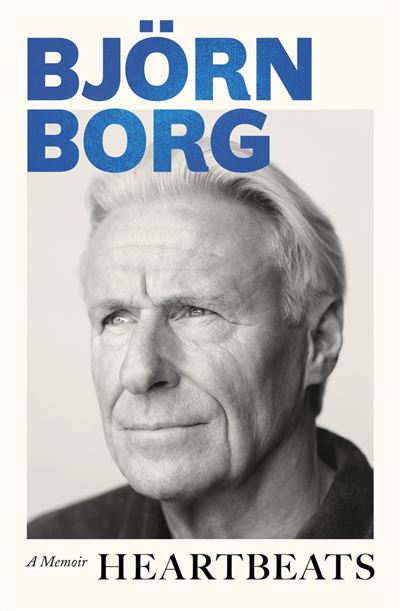 |
Björn
Borg « Heartbeats – A memoir » as told to Patricia Borg, translated by
Bradley Harmon, Sphere Editor, 2025.
Voici un récit saisi sur le vif, même s’il exigea de son auteur – le
champion de tennis suédois Björn Borg – plusieurs années de rédaction avec
l’aide de son épouse Patricia. « Heartbeats », tel est son titre
(littéralement : battements de cœur, le grand sportif étant notamment
caractérisé d’un battement de cœur très bas), se livre aussi à « cœur ouvert
» tel aurait pu être également le titre possible de cette confession
biographique. Nous retrouverons avec les premiers chapitres, les heures de
gloire du jeune prodige rapidement surnommé IceBorg, même si le lecteur sera
surpris d’apprendre que le garçon au début de son adolescence était plutôt
du genre colérique et s’était même fait exclure de son club pour avoir
manifesté plus que bruyamment son horreur de perdre… Rapidement, la gloire
internationale s’imposera sur cette personnalité que l’on devine secrète et
protégée par un cercle familial aimant et centré sur cet enfant unique. Les
victoires, nationales tout d’abord, puis internationales, s’accumulent avec
son lot de popularité et le début d’une Borgmania qui devait conduire le
jeune homme à fuir constamment médias et groupies s’agglutinant autour de
lui. A 26 ans, celui qui avait tout gagné, ou presque puisque l’open
américain lui échappera toujours, allait décider de tout plaquer pour mener
une autre vie, celle qu’il pensait être la sienne… Mais rapidement, le
destin devait le rattraper, la vie facile faite de vie nocturne et d’excès
en tout genre dérégla cette machine parfaitement rodée qu’était le corps et
l’esprit de l’athlète pour sombrer dans la drogue et l’alcool. Après de
sérieux ennuis de santé et une faillite financière, qu’allait être l’avenir
de celui qui avait tout maîtrisé dans ses jeunes années sur le court ? C’est
ce qu’apprendra le lecteur dans cette biographie rédigée avec sincérité
grâce à la plume de Patricia, son épouse et sa plus fidèle confidente,
protégeant et révélant l’homme dans ses années matures jusqu’à l’annonce de
la maladie et d’un nouveau combat… Un témoignage poignant et véridique afin
de mieux comprendre les à-côtés de la gloire et le quotidien parfois
chaotique d’un champion. |
| |
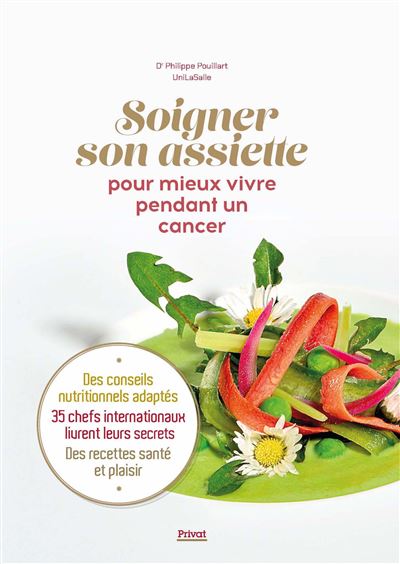 |
«
Soigner son assiette pour mieux vivre pendant un cancer » du Dr Philippe
Pouillart, Editions Privat 2025.
Le docteur Philippe Pouillart, spécialiste en immunopharmacologie, propose
avec ce dernier ouvrage « Soigner son assiette pour mieux vivre pendant un
cancer » une somme non seulement précieuse, car complète et instructive,
mais également très pratique avec à la clef menus et recettes. Ce guide
culinaire accompagnera ainsi patients et entourages durant les soins
éprouvants de cette maladie, mais aussi après la rémission grâce à une
réflexion générale sur la façon de mieux s’alimenter.
Fait original à noter : 35 chefs internationaux ont accepté de collaborer à
cette heureuse initiative et livrent chacun leurs recettes et secrets pour
des menus alliant plaisir et santé. Il est indéniable qu’une bonne
alimentation repose sur des fondamentaux, ce que l’ouvrage rappelle de
manière claire et accessible ; à ce titre, cet ouvrage sera l’allié
indispensable pour mieux vivre cette période difficile, physiologiquement,
mais aussi psychologiquement. Préserver le plaisir de cuisiner même lorsque
les effets secondaires des traitements se font ressentir, savoir quoi manger
afin de contourner les troubles de la digestion pouvant apparaître au cours
des soins, être capable d’établir soi-même ses apports nutritionnels grâce à
un équilibre protéines, glucides, lipides, vitamines et minéraux, tels sont
les nombreux points déterminants abordés dans cet ouvrage informé, et qui
plus est, plaisant à lire. |
| |
 |
« Energie ! 5
minutes par jour pour retrouver la forme et la conserver » du Dr Anne FLECK,
Coll. Questions de santé, Editions Actes Sud, 2025.
Surveiller sa santé - mentale et physique - n’est pas chose
évidente, surtout les années passant… Dans le contexte d’une vie de plus en
plus trépidante, et face aux multiples agressions du quotidien, notre corps
et notre esprit peuvent, en effet, flancher et nous lancer des alertes.
C’est à la recherche de l’énergie et d’une vitalité retrouvées que le
dernier ouvrage du Docteur Anne Fleck est consacré, « 5 mn par jour pour
retrouver sa forme et la conserver » annonce le sous-titre. Autant dire que
cette somme n’a rien d’un livre miracle de plus, il s’agit bien plutôt d’une
prise en charge et de reprendre conscience de son corps. À l’image d’un
coach, le livre propose une démarche progressive, et surtout sans excès,
revisitant les basiques (alimentation, sommeil, respiration, hydratation,
relaxation…) tout en les rendant accessibles et ludiques !
À chaque chapitre, une thématique interactive est proposée avec questions,
formulaires à remplir, encadrés à nourrir de sa propre réflexion. Ces
quelques minutes par jour permettront de rétablir des équilibres perdus, de
porter un regard sur soi-même et son entourage renouvelé et d’acquérir une
réserve énergétique de nouveau sur le vert fixe !
L’auteur nous offre avec cet ouvrage la synthèse de nombreuses années de
réflexion en la matière. |
| |
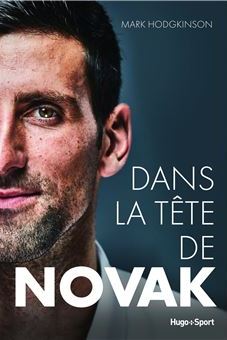 |
« Dans
la tête de Novak » de Mark Hodgkinson, Hugo Sport Editions, 2025.
La personnalité du meilleur joueur de tennis du monde Novak Djokovik
n’est guère des plus simples, et tout biographe, même chevronné, a rencontré
des difficultés à cerner cet esprit guère conventionnel… C’est tout le
mérite de Mark Hodgkinson que d’avoir relevé le défi avec succès, permettant
ainsi au lecteur de mieux connaître ce joueur un brin facétieux et néanmoins
d’une redoutable efficacité quant à sa préparation mentale et physique.
L’auteur a pu profiter de témoignages du cercle proche du tennisman natif de
Belgrade, évitant ainsi les légendes infondées et autres fake news
farfelues.
Novak n’a pas besoin de ces effets pour captiver ses contemporains, ce que
cette biographie parvient aisément à faire. Depuis ses débuts jusqu’à son
actuelle carrière en voie de conclusion (même si sur ce dernier point
l’ouvrage laisse encore quelques portes ouvertes), nous arpentons, chapitre
après chapitre, le long cheminement ardu et périlleux d’un jeune Serbe
terrorisé avec sa toute sa famille sous les bombardements subis par son pays
jusqu’à son ascension au pinacle de son sport. L’impressionnante
détermination du jeune sportif persuadé dès son plus jeune âge d’atteindre
les sommets de son art, la préparation indéfectible dans tous les aspects de
son sport, son ouverture d’esprit à des domaines souvent ignorés de ses
partenaires, font de Novak un esprit à part et, à ce titre, captivant à
découvrir.
Les passionnés de tennis seront bien entendu les premiers lecteurs de cet
ouvrage plus que complet, mais il devrait également attirer l’attention de
celles et ceux qui souhaitent réfléchir à leur propre cheminement de vie, un
exemple de motivation et de détermination pouvant également servir
d’inspiration. |
| |


 |
« La
Méthode Gérald » par Gérald Michiara, 3 volumes, Editions DDB, 2025.
Gérald Michiara sait de quoi il parle lorsqu’il nous propose - à partir de
trois ouvrages tirés de son expérience personnelle et professionnelle - de «
Se remettre en forme après 40 ans », d’ « Améliorer sa performance sportive
» et de « Maîtriser les techniques de combat et d’autodéfense ». L’auteur
est en effet militaire dans la célèbre Légion étrangère ainsi qu’un athlète
multisport éprouvé. Sa notoriété sur les réseaux sociaux sous le pseudo de
Major Gérald est venue asseoir sa popularité avec un grand nombre de vidéos
accessibles sur la chaine Youtube de la Légion. C’est cette expérience que
nous propose de partager Gérald Michiara dans ces trois ouvrages venant de
paraître aux éditions DBS, trois méthodes à la fois détaillées et
accessibles au plus grand nombre, malgré le palmarès et le gabarit imposant
de leur auteur… Car notre Major Gérald ne cherche pas à jouer les gros bras
– à l’image de la plupart des personnes sûres de leur force ! Dans « Se
remettre en forme après 40 ans », il confie même humblement avoir lui-même
connu des blessures musculaires lui interdisant d’ouvrir une porte, sans
parler du terrible constat d’arthrose avancée au niveau des cervicales à
presque 50 ans… Retrouver la forme et la force est un parcours du combattant
de tous les jours que l’auteur connaît donc bien pour l’avoir arpenté de
long en large et parfois dans la douleur.
Aussi nous fait-il partager son expérience à partir d’une méthode éprouvée,
repartant pour ainsi dire de zéro, soit après une longue inactivité de
sédentaire, soit après une blessure. 6 semaines sont proposées, avec une
progressivité mesurée et surtout raisonnable afin d’éviter l’écueil de
l’abandon. Notre mentor nous prend en main, depuis l’échauffement primordial
jusqu’aux fameuses pompes dont il nous dévoile toutes les variantes, sans
oublier le gainage et autres exercices avec pour seul matériel le poids du
corps et l’aide d’une sangle dans certains cas.
Cet ouvrage, vite indispensable, sera à compléter idéalement par le deuxième
guide « Améliorer sa performance sportive » ; une méthode également conçue
sur 6 semaines et dont l’objectif est de briser la monotonie de
l’entraînement et la stagnation qui en résulte la plupart du temps. Ce
programme intensif aidera non seulement à reprendre confiance en soi, mais
également grâce à une combinaison d’exercices de musculation et de courses à
dynamiser le corps pour améliorer l’explosivité, la puissance et la force.
Enfin, et en raison de la qualification professionnelle de l’auteur, le
troisième ouvrage intéressera celles et ceux souhaitant apprendre les
rudiments des gestes d’autodéfense indispensables en cas d’agression, une
manière d’anticiper en cas d’imprévu, même si, bien entendu, dans ce dernier
domaine, la pratique sur le terrain de ces mouvements demeure indispensable.
A relever : chaque ouvrage abondamment illustré est complété d’une série
de liens vers des vidéos inédites de l’auteur.
|
| |
 |
« Le
grand livre du Pilates » de Lynne Robinson , Nathan Gardner et Lisa Bradshaw,
Collection Hors collection bien-être, Mango Editions, 2024.
« Le grand livre du Pilates » porte bien son titre, et ce, au sens propre
comme au figuré. Au sens propre puisque cette somme de plus de 200 pages
avec son format généreux (28,5 x 23,5 cm) présente dans le détail cette
discipline en vogue depuis de nombreuses années qu’est le Pilates. Les
auteurs sont les ambassadeurs de choix de cette pratique permettant de
retrouver forme et tonicité du corps à partir d’exercices accessibles à la
plupart des pratiquants.
Au sens figuré, enfin, dans la mesure où cette somme repose sur des
principes fondamentaux de la pratique du Pilates rappelés dans le détail
dans un premier chapitre ; une pratique visant à allier concentration,
relaxation, alignement du corps, respiration, centrage, coordination,
fluidité des mouvements et endurance.
Fort de l’héritage laissé par son fondateur, Joseph Pilates au siècle passé,
les auteurs entendent partager ce legs de manière accessible et pratique à
partir de différentes approches de programmes au sol, du niveau débutant –
indispensable à la bonne compréhension des mouvements – jusqu’au niveau
avancé, beaucoup plus technique. Chaque étape de progression est
méticuleusement détaillée, à l’aide de conseils et de photos permettant de
mieux intégrer les mouvements. Objectifs de l’exercice, position de départ,
déroulement et points de repère sont rappelés de manière didactique sur
chaque page consacrée aux différents exercices.
Enfin, cette bible du Pilates rappelle, en dernier lieu, le matériel
nécessaire à sa pratique, un matériel somme toute assez minimaliste
permettant ainsi d’en élargir encore sa pratique au plus grand nombre.
|
| |
 |
« Le
Petit Larousse de L’herboristerie » de Carole Minker, Editions Larousse,
2024.
C’est un livre aussi pratique qu’esthétique que nous proposent avec « Le
Petit Larousse de L’herboristerie » les éditions du même nom. Une somme de
plus de 400 pages regroupant pas moins de 130 maladies courantes pouvant
être soignées avec un panier de 100 plantes médicinales. L’auteur, Carole
Minker, Docteur en pharmacie et en pharmacognosie, cultive pour ses lecteurs
en ces pages agréablement illustrées un véritable jardin des simples
regorgeant de conseils pratiques.
Extrêmement bien organisé, l’ouvrage regroupe ainsi dans une première partie
les troubles les plus courants : affections articulaires, osseuses et
musculaires ; fatigue ; problèmes de poids, etc. Maladies saisonnières ou
chroniques, maux ou petits bobos du quotidien, chacun y retrouvera
l’affection, trouble ou problème médical qui le préoccupe. L’auteur propose
plusieurs remèdes en phytothérapie-herboristerie, aromathérapie,
gemmothérapie ou encore argilothérapie, algothérapie, apithérapie … Des
remèdes accompagnés de recommandations quant aux précautions d’emploi, mais
aussi quant à la posologie et durée du traitement préconisé. L’auteur
suggérant également conseils nutritionnels, d’hygiène de vie et recettes
(infusions, décoctions, onguents, etc.).
Dans une seconde partie, les plus curieux découvriront une centaine de
plantes rangées selon un ordre pratique chronologique ; arnica, bluet,
eucalyptus… ; 100 plantes accompagnées de leur description, leurs usages et
précautions d’emploi (cet ouvrage ne remplaçant pas une consultation
médicale). Des pages pour approfondir agréablement ses connaissances en
herboristerie !
Un ouvrage incontournable et précieux . |
| |
 |
Kristina Campbell : « Prendre soin de son intestin », Coll. « Pour les Nuls
», Editions First, 2024.
Voici un ouvrage bien précieux, qui ne promet pas pour une fois des miracles
en ce domaine, mais fait - bien plus judicieusement, le point sur un sujet
toujours sensible : la santé de notre intestin. À partir de sa propre
expérience, Kristina Campbell synthétise et rend accessible en un ouvrage
clair et complet l’état des connaissances sur le microbiote intestinal et la
santé digestive. Organiser selon la logique de la fameuse collection « Pour
les Nuls », cet ouvrage rappelle au préalable le fonctionnement du système
digestif et les raisons pour lesquelles son bon état conditionne la santé de
l’organisme en son entier. Point de théories inaccessibles, mais des
explications claires sur les liens entre santé intestinale et santé globale.
La deuxième partie s’attache à identifier les troubles digestifs – sans se
substituer au médecin. Mais ce sont surtout les dernières parties de cette
somme qui apparaîtront très utiles au lecteur souffrant d’inconforts
chroniques des intestins en repensant non seulement sa diététique, mais
aussi de manière plus générale son mode de vie en termes d’hygiène. Ce
dernier point fait l’objet de recommandations précieuses et pleines de bon
sens, laissant de côté toute approche fantaisiste. La part du mental ainsi
que l’activité physique complètent idéalement l’ouvrage. |
| |
 |
Dr
Frédéric Saldmann : « Le Meilleur Médicament, c'est vous ! », Nouvelle
édition révisée, Editions Albin Michel, 2024.
Le Dr Frédéric Saldmann convie, une nouvelle fois, le lecteur à être le
principal acteur de sa santé à partir de recommandations à la fois
scientifiques et de bon sens pour cette nouvelle édition entièrement revue
et parue aux éditions Albin Michel. Cardiologue et nutritionniste, Frédéric
Saldmann part en effet du postulat - souvent oublié par les « recettes
magiques», que notre corps est la donnée essentielle de notre santé et de
nos guérisons, d’où le titre de l’ouvrage : « Le Meilleur Médicament, c'est
vous ! ». C’est à un véritable accompagnement pour être en meilleure santé
et guérir par soi-même auquel convie en effet le médecin à partir de
méthodes naturelles et éprouvées, sans automédication pour autant.
La prévention est bien entendu au cœur de cet ouvrage, notamment sur le plan
déterminant de l’alimentation dont les dangers sont soulignés dans ces pages
pratiques, mais aussi quant à la dynamisation de l’organisme avec l’activité
physique. Qu’il s’agisse du repos avec la question de plus en plus épineuse
du sommeil, des allergies, des troubles du transit ou encore du stress et de
la déprime, cet ouvrage fourmille de conseils pratiques et avisés, aisément
applicables dans notre vie quotidienne.
L’auteur invite son lecteur à une vie de bon sens dans cette gestion
quotidienne de sa santé, n’hésitant pas à aborder dans le dernier chapitre
des points rarement évoqués comme le magnétisme, la clairvoyance ou encore
les guérisons miraculeuses, en une démarche sans tabous. |
| |
 |
« Ma
bible de l'alimentation santé » de Laetitia Proust-Millon et Alix
Lefief-Delcourt, Collection « Ma Bible », Editions Leduc.
Avec cet ouvrage « Ma bible de l’alimentation santé », les auteurs -
diététicienne et spécialiste de l’alimentation - mettent à la disposition du
lecteur une somme quasi exhaustive sur l’alimentation analysée tout
spécialement dans l’optique de réduire les multiples inflammations causées
par des déséquilibres. Dès le début de l’ouvrage, nous réalisons en effet
combien l’alimentation « moderne » est la cause de multiples désordres dus à
des aliments trop transformés, salés et ou sucrés. En exposant les
conséquences d’un tel déséquilibre sur nos articulations et système
digestif, l’ouvrage propose de repartir sur des bases saines et naturelles
en apprenant la valeur des aliments qui permettront d’inverser cette
tendance inflammatoire et de retrouver un équilibre grâce aux nombreux
conseils prodigués. Quels sont les aliments à retenir ? Quels sont leurs
propriétés et nombreux bienfaits ? Comment déjouer les pièges que nous tend
la grande distribution et privilégier des aliments à cuisiner soi-même ?
Tels sont les thèmes abordés dans cette véritable bible que le lecteur aura
tout intérêt à garder dans sa cuisine puisque la deuxième partie propose
plus de 170 recettes saines et gourmandes permettant de redécouvrir le
plaisir de cuisiner et de déguster seul, en famille ou entre amis une
alimentation saine pour notre santé ! |
| |
 |
Laurent
Meseguer : « Gagne ! », Editions Eclevia, 2023.
« Gagne ! » est un impératif bien compris auquel nous convie
l’ancien champion de judo et préparateur mental, Laurent Meseguer, dans cet
ouvrage paru aux éditions Eclevia. L’auteur connaît en effet mieux que
quiconque les arcanes de la préparation physique et mentale pour avoir
lui-même gravi les marches du succès. Avec cet ouvrage, c’est un véritable
préparateur mental qui accompagnera le lecteur, page après page, alternant
entre vision d’ensemble et conseils des plus pratiques. Un livre qui
s’adresse aussi bien au monde sportif, de l’entreprise ou individuel.
Dès les premières pages, nous réalisons en effet qu’une véritable passion
anime l’auteur dont la maxime - qu’il nous encourage d’ailleurs à formuler
pour nous-mêmes - est « J’optimise le potentiel des personnes ! ». Ce
quasi-mantra s’observe d’ailleurs au fil des chapitres en une progression à
la fois logique et ouverte à toute la richesse de la matière humaine. Avec
Laurent Meseguer, chaque individu possède une personnalité propre, avec son
vécu, ses failles et forces, nulle recette magique et plan préétabli.
Les premiers chapitres convient le lecteur – qu’il soit sportif de haut
niveau, amateur, voire même pas sportif du tout ! – à déterminer son
objectif à l’aide d’une grille éprouvée permettant d’éviter de s’égarer avec
des formulations trop vagues, genre résolutions de début d’année… Mais
déterminer un objectif aussi précis et réaliste soit-il ne suffit pas, aussi
l’auteur nous encourage à mieux nous connaître afin de mieux percevoir les
qualités qui nous aideront à parcourir ce long chemin avant la réussite,
mais aussi à discerner les failles qui nous attendent et qui souvent
viennent de nous-mêmes. Un plan d’action, la gestion de son stress, se
forger un mental d’acier en travaillant avec des outils très concrets son
état d’esprit, rien n’est laissé au hasard dans cet ouvrage réaliste et
inspirant que tout à un chacun devrait garder à portée de main. |
| |
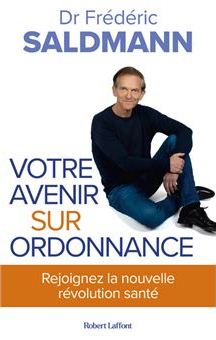 |
« Votre
avenir sur ordonnance » du Dr Frédéric Saldmann, 320 p., 15,3 x 24 cm,
Robert Laffont éditions, 2024. Voici un
ouvrage qui se doit d’être prescrit sans ordonnances pour éviter bien des
soucis ! Le docteur Frédéric Saldmann convie en effet ses lecteurs à
redécouvrir les principes traditionnels de la santé, des principes reposant
sur le bon sens et surtout l’écoute de son corps que l’on oublie si souvent.
À la fois informé et accessible, sérieux et ponctué d’humour, l’ouvrage de
Frédéric Saldmann foisonne de conseils allant de la tête (cerveau si
important à entretenir) aux pieds… C’est à une révolution de notre santé à
laquelle invite le médecin qui donne la priorité à la prévention par le
sommeil redécouvert et une alimentation repensée selon les règles les plus
naturelles qui soient. L’ouvrage n’écarte pas pour autant les avancées de la
science et fait état des dernières découvertes qui nous promettent des
années de longévité… Reste que c’est ici et maintenant qui importe pour le
docteur Saldmann, ce dernier nous enjoignant de ne pas perdre des années
précieuses et de préparer dès aujourd’hui notre santé de demain ! Une voie
rigoureuse, mais néanmoins accessible et rigoureuse pour retrouver et
conserver la santé. |
| |
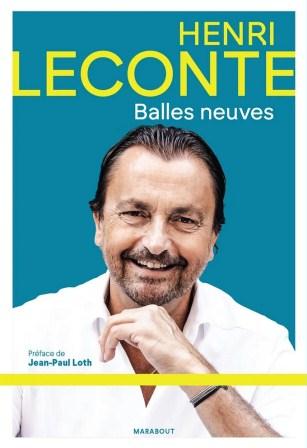 |
Henri
Leconte : « balles neuves », Éditions Marabout, 2023.
Avec « Balles neuves », le célèbre joueur de tennis français, Henri Leconte,
nous ouvre son cœur pour cet essai débridé. L’homme s’est assagi même si la
passion transparaît régulièrement au fil des pages pour cette âme sensible,
à fleur de peau et trop souvent incomprise. Si, depuis, Henri Leconte a bien
réfléchi sur la place des vedettes et le rôle souvent trop excessif supporté
par de jeunes personnes non formées à cet effet, il demeure que cela
n’enlève pas toutes les blessures qui peuvent émailler un parcours pourtant
prestigieux, finaliste de Roland Garros, 5e joueur mondial et vainqueur de
la Coupe Davis en 1991…
L’homme, une fois de plus généreusement, nous fait partager ses victoires et
ses blessures, ses instants de doute et de remise en question qui
profiteront à tout à chacun tant ce témoignage se veut sans fards et direct.
C’est la sérénité qui dorénavant guide cet homme qui ne renie rien de son
passé même si - en grand joueur – il a su profiter de ses erreurs et en
tirer des enseignements qu’il nous livre et qui pourront être suivis avec
profit.
Henri Leconte continue de nous faire vibrer dans ces pages d’une rare
sincérité, axées sur la résilience et la bienveillance qui le portent
aujourd’hui vers d’autres horizons où cependant la petite balle jaune n’est
jamais très loin ! Un témoignage inspirant qui dépasse largement la cible
des passionnés du tennis. |
| |
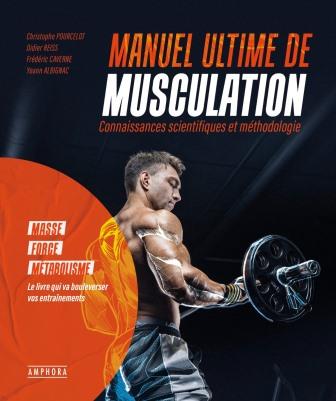 |
«
Manuel ultime de musculation - Connaissances scientifiques et méthodologie »
de Christophe POURCELOT, Didier REISS, Frédéric CAVERNE et Yoann ALBIGNAC,
Amphora éditions, 2023.
Nous sommes bien loin avec ce « Manuel ultime de musculation » des ouvrages
publiés il y a quelques décennies dispensant quelques programmes à partir
d’exercices plus ou moins efficaces. C’est à une véritable science de
l’entraînement musculaire à laquelle nous convient, en effet, les auteurs –
dont Christophe Pourcelot déjà présenté dans ces colonnes - de cette somme
impressionnante de 448 pages et près de 1,5 kg !
En ces pages est réuni l’essentiel des connaissances scientifiques et
pratiques sur la musculation à partir des dernières recherches en la
matière. Le lecteur aura grand profit à intégrer la première partie assez
ardue mais indispensable– oui, la muscu c’est également solliciter son
cerveau ! – à la compréhension du corps humain, de la force, hypertrophie et
endurance. La deuxième partie permettra ensuite de planifier idéalement son
entraînement en fonction de ses priorités (jeunes, santé, force, etc.) alors
que la troisième partie offre dans le détail une véritable méthodologie
quant à la pratique de la musculation.
L’ouvrage va dans le sens d’un entraînement aussi fréquent que possible, un
entraînement intensif et selon une exécution parfaite techniquement et en
amplitude maximale (entendu comme degré articulaire) dans la mesure du
possible, une notion très importante rangée sous l’acronyme ROM (Range of
Motion).
Tout est abordé dans ce précieux ouvrage avec 70 repères méthodologiques
structurés à partir de trois volets : la force, la masse et l’endurance de
force. Un manuel incontournable et indispensable à la compréhension et à la
bonne pratique de la musculation. |
| |
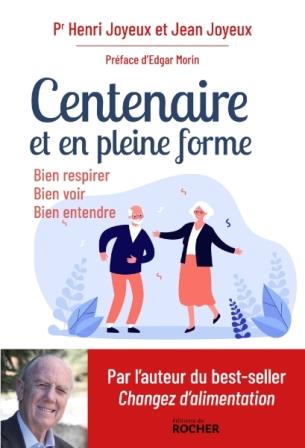 |
Pr
Henri Joyeux et Jean Joyeux : « Centenaire et en pleine forme - Bien
respirer, bien voir, bien entendre » ; Préface d’Edgar Morin, Editions du
Rocher, 2023.
C’est un centenaire alerte qui signe la préface de cet ouvrage en la
personne du célèbre penseur Edgar Morin ; Il est vrai que ce dernier, après
avoir dépassé le seuil symbolique du siècle, affiche une forme
intellectuelle toujours éclatante et impressionnante ! Le professeur Henri
Joyeux et son fils, Jean, lui-même talentueux nutritionniste, insistent dans
ces pages, à la fois accessibles et très complètes, sur le fait qu’un âge
avancé de qualité se prépare à l’avance par des pratiques saines et sur le
long cours. Le lecteur sera ainsi surpris parfois des conseils pourtant
simples et souvent négligés telles l’importance d’une mastication lente et
soignée, ou encore celle d’une respiration profonde et de qualité sans
oublier la place tenue par le contrôle de l’audition ou encore de la vue.
Ces sens qui constituent notre quotidien s’altèrent inexorablement avec le
temps et accélérent ainsi la dégénérescence du corps avec le poids des
années.
Si le vieillissement demeure encore incontournable, il est cependant
possible, insistent les Professeurs Henri et Jean Joyeux, d’en ralentir le
cours par des pratiques d’hygiène que rappelle cet ouvrage. La nutrition
apparaîtra avec la respiration et l’hydratation au cœur des priorités,
l’adage bien connu « creuser sa tombe avec ses dents » n’étant pas un vain
mot. Nul besoin de supplémentations complexes ou couteuses mais une
nutrition saine et équilibrée. Les conseils donnés par nos deux professeurs,
Henri et Jean Joyeux, abondent et permettront à chaque lecteur – jeune ou
moins jeune – de préparer avec connaissance et lucidité ses futures années
afin de conserver le plus longtemps possible le lien social et le plein
usage de ses sens.
Un ouvrage dont les conseils devraient figurer au sein de toute éducation et
à conseiller au plus grand nombre ! |
| |
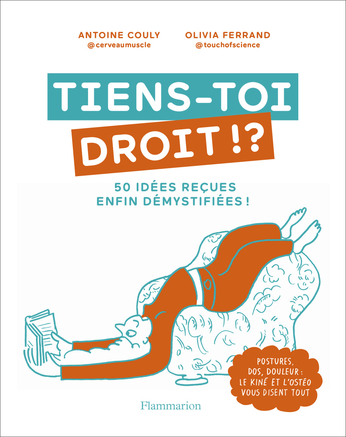 |
«
Tiens-toi droit !? » d’Antoine Couly et Olivia Ferrand ; Broché, 208 pages –
18,8 x 24 cm, Éditions Flammarion, 2022.
Voici un ouvrage décapant, dans tous les sens du terme. Les auteurs, tous
deux praticiens (masseur-kinésithérapeute et ostéopathe) s’attaquent en
effet dans cet ouvrage non dénué d’humour à un grand nombre d’idées reçues,
50 en l’espèce, sur notre forme et notre dos. S’appuyant sur un grand nombre
d’études scientifiques comparées et soumises au filtre d’une expérience en
cabinet, Antoine Couly et Olivia Ferrand passent en revue chaque thématique
de manière critique en relevant ce qui s’avère du mythe pur et simple ou de
l’assertion avérée selon les cas. Le propos est clair, argumenté et repose
sur une ligne directrice : la position et l’attitude à privilégier demeurent
liées à chaque personne et à sa propre histoire, plutôt qu’aux diktats
souvent trompeurs.
Le lecteur s’étonnera ainsi de lire qu’une position avachie n’est pas
forcément à bannir pour le dos, que plier les genoux pour soulever une
petite charge (- de 15 kg) n’est pas toujours indispensable, bien des idées
reçues qui ne résistent pas selon les auteurs à l’expérience des multiples
consultations en cabinet, le mal de dos étant le « mal du siècle » selon
l’expression convenue…
L’attitude primordiale sera donc de maintenir à tout prix le mouvement et
une activité suffisante pour que les chaines musculaires et tendineuses
soient régulièrement sollicitées et puissent contribuer au renouvellement
des cartilages et tissus.
Pour remettre en question un grand nombre d’idées reçues et réapprendre à
être à l’écoute de son corps et de ses douleurs en concertation avec son
praticien si nécessaire, la lecture de cet ouvrage dynamique et sans
complexe sera conseillée ! |
| |
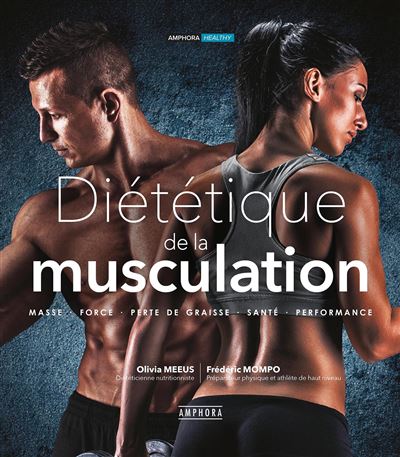 |
«
Diététique de la musculation - Masse, force, perte de graisse, santé,
performance » de Frédéric MOMPO et Olivia MEEUS ; Nouvelle édition
augmentée, 272 p. 21 x 24, Éditions Amphora, 2021.
Classique parmi les ouvrages de diététique sportive, « Diététique de la
musculation » fort de son succès a fait l’objet d’une nouvelle édition
augmentée chez Amphora. Cet ouvrage qui offre les bases, et plus encore, de
l’alimentation du sportif s’avère être en effet une mine incontournable pour
celles et ceux souhaitant s’entraîner dans les meilleures conditions. On
oublie trop souvent que le meilleur des entrainements peut être ruiné par
une mauvaise alimentation, de nombreux entraîneurs n’hésitant pas à dire que
celle-ci compte pour plus de 80 % de la réussite…
Or, une alimentation équilibrée et adaptée au sport, à l’âge et aux
caractéristiques de chaque individu ne s’improvise pas ainsi qu’il résulte
de la lecture de cet ouvrage passionnant et documenté. Ces principes ne sont
pas empiriques mais imposent le respect et la connaissance de règles
rappelées dans ces pages abondamment illustrées. Olivia Meeus, diététicienne
nutritionniste, et Frédéric MOMPO, entraîneur national de culturisme et
préparateur physique, ont ainsi réuni leurs savoirs pour composer cette
bible de la diététique du sportif.
Nul gavage désordonné comme cela se pratique malheureusement encore trop
souvent dans certaines disciplines mais une conduite rationnelle et
progressive pour garder en fil directeur l’idéal premier du sportif : la
santé. Qu’il s’agisse de prendre en masse, de perdre quelques kilos,
d’adapter son alimentation pour certaines disciplines exigeantes comme le
triathlon ou le marathon, ces pages offrent toutes les conduites à tenir et
personnalisables. Les dimensions que ce soit végétarienne ou végane ont même
été prises en compte, une mise à jour à saleur dans le domaine sportif !
Cet ouvrage demeurera de nombreuses années encore un classique à recommander
aux sportifs |
|
VIE PRATIQUE |
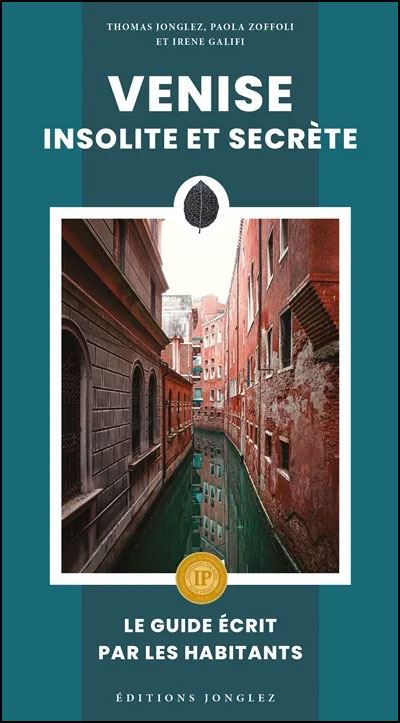 |
«
Venise insolite et secrète » de Thomas Jonglez, Paola Zoffoli et Irene
Galifi, Editions Jonglez, 2025.
Est-il encore nécessaire de présenter Venise ? La Sérénissime a certainement
fait couler plus d’encre que d’eau de ses canaux… Et pourtant, les auteurs
de « Venise insolite et secrète » font le pari réussi de nous faire
découvrir des lieux encore ignorés de la plupart des touristes qui
empruntent souvent les mêmes chemins. Thomas Jonglez, Paola Zoffoli et Irene
Galifi ont, en effet, retenu pour le lecteur la petite comme la grande
Histoire des différents sestiere de la ville lagunaire, qu’il s’agisse de la
tête d’or au Rialto, des impressionnants salons du Ridotto à l’Hôtel Monaco
et Grand Canal ou encore de la Barbacane, cet étalon qui servait de mesure
de référence pour les renforts muraux en saillie des bâtiments de la ville…
Ce précieux guide réservera bien des surprises et étonnements comme ce
surprenant jardin secret de la Scuola Vecchia delle Misericordia. Nombreuses
sont les promenades insolites suscitées par ce guide à emporter
impérativement dans sa poche lors de son prochain séjour à Venise ! |
| |
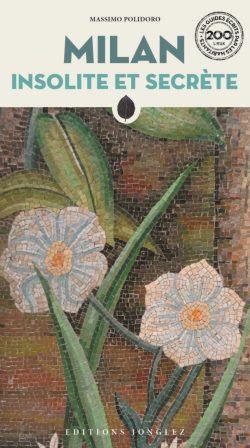 |
« Milan
insolite et secrète » de Massimo Polidoro, 400 p., 10.5 x 19 cm, Editions
Jonglez, 2025.
La désormais plébiscitée collection « Insolite et secrète » accueille deux
nouveaux titres consacrés à deux villes incontournable du nord de l’Italie,
à savoir Milan et Venise.
Milan, tout d’abord, capitale économique de l’Italie, réservera bien des
surprises à celles et ceux qui sortiront des sentiers battus et des
monuments bien connus. Le lecteur pourra ainsi découvrir une écluse conçue
par Léonard de Vinci tout en s’émerveillant sur les secrets de la célèbre
Cène qu’il faudra impérativement aller découvrir sur place… En déambulant
par quartier, le promeneur milanais aura avec ce nouveau titre de la
collection « Insolite et secrète », en un format réduit, un guide de choix
grâce à Massimo Polidoro, son auteur, qui connaît la ville mieux que
quiconque. Avec lui, il déambulera à la recherche des trésors cachés du
Palazzo Isimbardi abritant notamment l’admirable fresque méconnue de Tiépolo,
les vertus de la chapelle Portinari ou encore la maison du monstre de la via
Bagnera, tout un programme milanais !
Éclectique et pleine de charme, cette promenade « insolite et secrète »
signée Massimo Polidoro aux éditions Jonglez fera d’un séjour à Milan un
moment singulier et enrichissant. |
| |
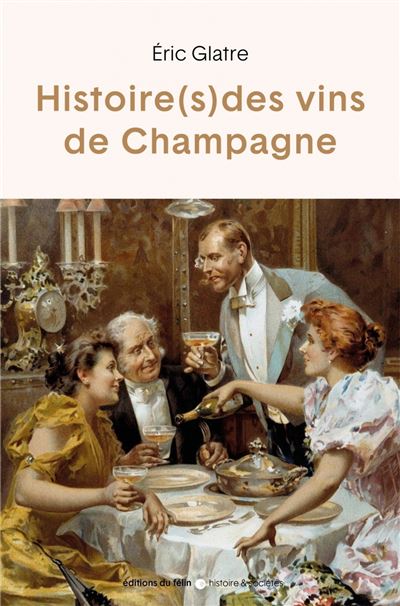 |
« Histoire(s) des vins de Champagne » d’Éric Glatre,
Éditions du Félin, 2025.
Si le célèbre nom de Champagne n’est plus à présenter, son histoire peut
sembler quelque peu plus obscure, ou du moins, quelque peu plus méconnue si
l’on songe que ses origines remontent au plus lointain Moyen âge… Eric
Glatre, historien et Champenois invétéré, nous conte justement cette
histoire dans une ouvrage qui tient à la fois de la culture et de la
viticulture, des traditions comme de l’Histoire.
C’est en effet au XIVe siècle que l’auteur nous transporte au commencement
de cet ouvrage, si nous faisons l’impasse des origines romaines bien plus
anciennes en ce terroir. Evêques, moines et négociants concoururent à la
naissance de ce vin bien particulier, dont les origines demeurent encore
controversées quant à son original pétillement. Eric Glatre nous explique en
ces pages à la fois savantes et alertes quelles ont été les grandes étapes
qui contribuèrent à façonner patiemment ce vin de champagne unique : le
terroir calcaire, la prise de mousse, les bouteilles, et bien entendu, ses
acteurs légendaires tels Dom Pérignon, Madame veuve Clicquot, Camille
Roederer et tant d’autres. Qu’il s’agisse des pages historiques ou des
chapitres faisant la part belle aux innovations les plus récentes, cette «
Histoire(s) des vins de Champagne » est en effet déclinée au pluriel à
l’image de son terroir qui déploie au-delà de ses vastes plaines calcaires
des identités bien particulières qui se retrouveront dans chaque cuvée.
Cette identité du terroir champenois passionnera les amateurs de traditions
culturelles, tout autant incontournables que les grandes maisons qui ont
contribué à la légende française du Champagne. |
| |
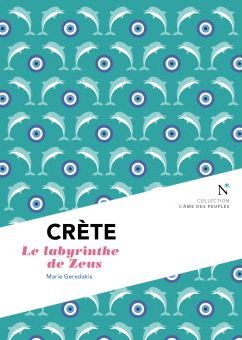 |
« Crète
- Le labyrinthe de Zeus » de Marie Geredakis, Editions Nevicata, 2025.
Voici un petit ouvrage qui tient plus de l’essai que du best-off des
adresses incontournables des guides usuels. Il est vrai que la collection
L’Âme des peuples aux éditions Nevicata nous a habitués à la qualité de ces
témoignages puisés auprès d’auteurs personnellement sensibilisés aux pays
présentés, ce qui est le cas de Marie Geredakis, l’auteur de ce dernier
guide, et dont une partie de la famille est originaire de Crète.
Ce regard à la fois extérieur et intérieur explique la tonalité
bienveillante et néanmoins réaliste sur l’âme crétoise, ce qui ressort
particulièrement de ces pages alertes et agréables à lire. Avec cet ouvrage,
Marie Geredakos propose à son lecteur de sortir des chemins battus pour
emprunter les véritables sentiers de la Crète. Ceux-ci permettront, au sens
propre comme au figuré, d’être en présence du cœur vibrant de cette île où
une petite table avec un verre d’ouzo et quelques olives a bien plus à
partager que les tour operateurs qui envahissent l’île chaque été…
Une belle réflexion complétée par des entretiens avec l’historienne
Eleftheria Zei, l’anthropologue Aris Tsantiropoulos et le musicien Ross Daly. |
| |
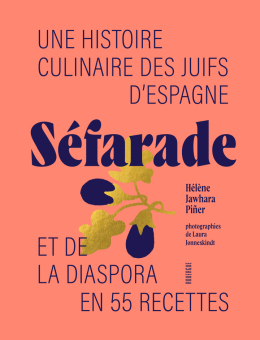 |
«
Séfarade - Une histoire culinaire des juifs d'Espagne et de la diaspora en
55 recettes » de Hélène Jawhara Piñer, Editions du Rouergue, 2025.
Le mot même de « séfarade » évoque un univers en soi qui, de nos jours,
relève des traditions ancestrales, celles trop peu connues des juifs
d’Espagne au XIIIe siècle. Hélène Jawhara Piñer, docteur en histoire
médiévale et chercheur au CESR, nous propose justement, à partir d’un
ouvrage aussi instructif que délicieux, de plonger dans l’origine et la
réalisation de savoureuses recettes dont elle nous offre une belle
sélection…
A la fois ouvrage d’histoire et de traditions culinaires, « Séférade » est
bien plus qu’un livre de recettes, mais plutôt une invitation aux
découvertes où cultures et héritages culinaires s’entrecroisent. 55 recettes
sont ainsi restituées avec soin selon les exigences scientifiques de
l’auteur. Que l’on retienne par exemple le Güesmo, ce plat de blettes
préparé traditionnellement pour Tou Bichvat et le renouvellement des
feuilles et des arbres, ou encore cet Adefina emblématique de la tradition
séfarade pour Shabbat, chaque plat fait sens sous la plume de Hélène Jawhara
Piñer. Chaque recette se trouve non seulement expliquée dans le détail et
mise en valeur par les photographies inspirantes de Laura Jonneskindt, mais
de plus, fait l’objet de commentaires instructifs dévoilant et rappelant le
sens de ces mets pour nombre d’entre eux tombés dans l’oubli. Avec «
Séfarade », plus d’excuses pour ne pas embarquer dans un merveilleux voyage
culinaire et culturel, honorant la mémoire d’une riche histoire marquée par
ces entrecroisements culturels… |
| |
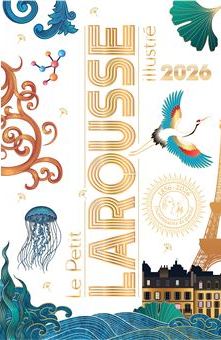 |
Le
Petit Larousse illustré – 2026
Le Petit Larousse illustré est une véritable institution et chaque
nouvelle édition est l’occasion de redécouvrir non seulement ce trésor de la
langue française, mais aussi d’ouvrir une véritable encyclopédie à part
entière servie par ses inoubliables illustrations. Ce millésime 2026 ne fait
pas exception et plus que jamais la devise de ce fameux dictionnaire «
Instruire tout le monde et sur toutes les choses » pourra être vérifiée page
après page par le lecteur. Les chiffres sont suffisamment éloquents pour
faire du Petit Larousse illustré 2026 son dictionnaire de référence : 64 500
mots, 125 000 sens, 20 000 locutions et 2 000 régionalismes et mots de la
francophonie…
Alliant le sérieux d’un dictionnaire manuel et le plaisir d’une approche
encyclopédique, le Petit Larousse illustré permet ainsi non seulement de
rechercher à tout moment le sens exact d’un mot, son orthographe ou un nom
propre, mais également de s’évader au fil des pages sans objet précis,
certainement l’une des meilleures approches pour enrichir encore son
vocabulaire et ses connaissances dans des domaines les plus variés.
Et parce que la langue française évolue, cette nouvelle édition intègre,
comme chaque année, des changements : 150 nouveaux mots, sens, locutions et
expressions, des évolutions signes de cette richesse non figée. Parmi les
nouveaux promus, citons parasport, verticalisation, biopesticide, free-style,
padel, téléprésentiel¸dénormaliser et bien d’autres découvertes encore…
Soulignons également combien les illustrations à elles seules enchantent le
regard avec 5 500 cartes, dessins, photographies et schémas ainsi que 150
planches illustrées. Enfin, le Petit Larousse illustré s’intéresse également
aux noms propres avec 28 000 lieux, personnalités et évènements, de quoi
alimenter de longues heures de lecture en compagnie de cette mine de savoir,
véritable mémoire de la langue. |
| |
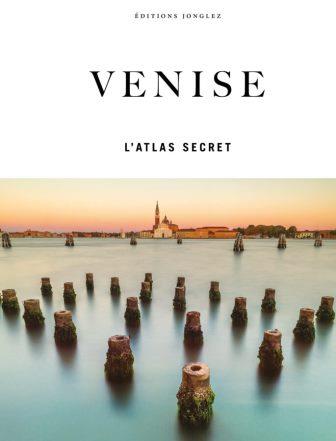 |
«
Venise – L’Atlas Secret » de Thomas Jonglez, Paola Zoffoli et Irène Galifi,
Editions Jonglez, 2024.
À celles et ceux qui pensaient bien connaître la Sérénissime, cet Atlas
Secret de Venise leur est assurément destiné ! Les lieux incontournables de
la Cité des Doges sont bien connus et souvent évoqués dans nos colonnes,
mais l’ouvrage concocté par Thomas Jonglez, Paola Zoffoli et Irène Galifi
révèlera cependant plus d’un trésor insoupçonné au visiteur occasionnel ou
régulier de Venise. Ces lieux insolites sont pourtant accessibles, libre à
nous de les découvrir après avoir refermé ce guide enchanteur servi par une
abondante iconographie, prémices du voyage à venir…
Observer le paysage urbain, s’imprégner de l’atmosphère de la ville qui ne
se résume pas – tant s’en faut – aux traditionnels clichés du Rialto ou de
la Piazza San Marco. Venise exige quelque peu du temps et de l’attention, et
si le dernier critère est facilité par ces pages nourries de découvertes
abondantes, il sera néanmoins indispensable d’ouvrir grand nos sens à ces
lieux méconnus de Venise. La ville, on le sait, est divisée en quartiers, ou
sestieri, et l’ouvrage révèle pour chacun d’entre eux des trésors
souvent ignorés des visiteurs même des plus audacieux ou avertis, qu’il
s’agisse de ce losange de porphyre de l’atrium de la basilique Saint-Marc
pourtant si souvent parcourue ou de ces vestiges sis dans le quartier Santa
Croce du Casino Tron, témoins vibrants des fastes d’antan au XVIIIe s.
Chaque découverte est accompagnée d’un texte à la fois complet et concis,
permettant d’aller à l’essentiel et de solliciter notre imagination chère à
nos auteurs-guides. Pour chacune de ces entrées inspirantes, une ou
plusieurs illustrations permettront de s’évader instantanément en ces lieux
improbables et pourtant bien réels, ainsi que le démontre cette étude
initiatique du plafond de la salle du Chapitre de la pourtant bien connue
Scuola Grande di San Rocco, fameuse pour ses précieux Tintoret…
Une évocation sensible et inspirante de la Cité des Doges à emporter avec
soi pour son prochain voyage.
À noter dans la même collection, la parution de l’Atlas Secret consacré
également à la ville de Paris. |
| |
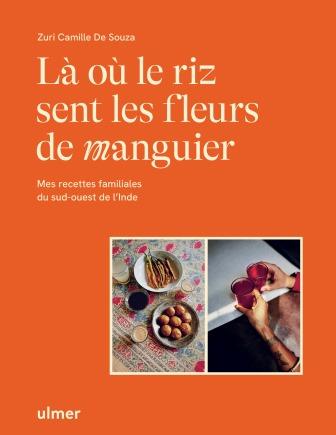 |
« Là où
le riz sent les fleurs de manguier - Mes recettes familiales du sud-ouest de
l'Inde » Zuri CAMILLE DE SOUZA, 192 pages, Format : 18 x 23,5 cm, Ulmer
éditions, 2024.
C’est à un merveilleux voyage des sens auquel nous convie cet ouvrage signé
Zuri Camille de Souza. Ses recettes familiales confiées de manière
esthétique et poétique constituent bien plus qu’un livre pratique, mais bien
une ode aux multiples saveurs de l’Inde. Nous atterrirons en effet dans le
sud-ouest de l’Inde pour emprunter des chemins inédits où les épices qui ont
fait la réputation de ce continent rivalisent avec les plus belles
photographies aux couleurs miellées… La cuisine de l’auteur ouvre
directement sur des mets singuliers qui, dès le petit-déjeuner, ravissent le
palais autant qu’ils surprennent nos sens. Gâteaux et friandises sustentent
dès le matin petits et grands, semoule d’épeautre sucrée au safran, Baath à
la noix de coco ou encore ces Jeera biscuits. Zuri Camille de Souza offre
avec ses recettes non seulement une manière originale d’aborder la cuisine
indienne, mais invite également le lecteur à s’immerger dans la culture de
son pays. Galette à la farine de riz, Curry de Goa à l’anis, salades aussi
belles que savoureuses enchantent ces pages rythmées des plus belles scènes
du quotidien de l’Inde. Un ouvrage assurément et savoureusement dépaysant !
|
| |
 |
Mélanie
et Arnaud Mathez : « Le Jardin sucré », Editions Albin Michel, 2024.
C’est une savoureuse excursion au pays des gourmands et gourmets que
proposent Mélanie et Arnaud Mathez avec ce premier ouvrage : « Le Jardin
sucré ». Ce couple, champions de France de macarons, livre en effet dans ces
pages plus tentatrices les unes que les autres des recettes accessibles, à
toutes les saisons et pour tous les goûts, certaines très peu sucrées,
d’autres encore sans gluten.
Le lecteur y retrouvera, bien sûr, leurs desserts signatures, ceux ayant
fait leur renommée et que Mélanie et Arnaud proposent dans leurs boutiques
parisiennes ou à Cernay-la-Ville dans les Yvelines, notamment leur si
fameuse tarte pistache et fleur d’oranger saluée par le chef Pierre Hermé.
Très joliment illustrées par les photographies de Guillaume Czerw, rangées
selon les quatre saisons, ce ne sont pas moins de 40 recettes de desserts
privilégiant les terroirs français qui sont, ici, explicitées avec pour les
textes la collaboration d’Hélène Luzin. Comment résister ?! |
| |
 |
«
Recettes asiatiques sans bla bla », Editions Larousse, 2024.
Envie d’un Chirashi de saumon, d’un Ramen végétarien ou encore de Yakisobas
? Ce sera chose aisée avec l’ouvrage « Recettes asiatiques sans Bla Bla »
qui vient de paraître aux éditions Larousse. 100 recettes précisément venant
d’Asie y ont été réunies sur deux critères : leurs saveurs et leur facilité
à concocter. Chaque recette fait en effet l’objet d’un descriptif plus que
détaillé, étape par étape et en images ! Impossible de se tromper avec cet
accompagnement pédagogique même pour les plus réfractaires au fourneau…
Variées et succulentes, ces recettes qui mettront sur chaque table toutes
les saveurs venues d’Asie sont présentées et organisées pour plus de
facilité encore en sections thématiques : viandes, poissons et fruits de
mer, végétariens, desserts. Rapidité et efficacité sont au cœur de cette
centaine de recettes la plupart du temps réalisables en moins de 30 min en
toute simplicité.
Brochettes satay, soupe aux wontons, canard laqué comme à Pékin, raviolis
aux légumes, la liste ne donnera qu’une seule envie : prendre son tablier et
réaliser chacune d’entre elles, page après page ! |
| |
 |
« 100
recettes à sauver » de Julie Andrieu, éditions Albin Michel, 2024.
Julie Andrieu, bien connue pour ses émissions de télévision, voue pour la
cuisine une véritable passion. Pour cet ouvrage, elle a choisi de partager
une sélection de recettes simples et emblématiques de la cuisine française
et internationale. Le critère retenu ? Leur authenticité et valeur
patrimoniale, le but poursuivi par l’auteur étant de préserver et
transmettre des plats parfois oubliés ou en voie de disparition, avec une
touche de modernité pour s'adapter aux cuisines et exigences nutritionnelles
d'aujourd'hui.
Les trésors culinaires de nos régions ont en effet malheureusement tendance
à disparaître de nos cuisines en raison de la mondialisation et d’un manque
de temps croissant. Julie Andrieu a décidé fort à propos d’offrir dès lors
un éventail diversifié de recettes, des mets savoureux allant des classiques
aux créations plus contemporaines, tout en restant accessibles pour les
cuisiniers de tous niveaux. Pommes soufflées, Farcement savoyard, Calalou au
crabe, Ogey ou encore pain de prunes transporteront le lecteur dans les
régions de France et de Navarre avec des recettes accessibles, aidées de
conseils pratiques et anecdotes, rendant encore plus plaisante leur
réalisation.
Les photographies transmettent la beauté de ces plats et l’ambiance
chaleureuse de la cuisine de Julie Andrieu. 100 plats à remonter le temps
comme le promet l’auteur qui nous invite à emboîter le pas des anciens qui
ont savoureusement tout inventé en ce domaine ! |
| |
 |
«
Cocotte » d’Amandine Bernardi, Editions Larousse, 2024.
Voici un livre de cuisine bien engageant ! Par sa couverture, déjà, des plus
réussies avec sa livrée originale en bois et motif fonte… Quant au sujet,
enfin ! Quoi de plus inspirant, en effet, que redécouvrir le plaisir de
cuisiner avec une cocotte, une pratique quelque peu tombée dans l’oubli mais
qui connaît ces derniers temps un – heureux -regain d’intérêt ainsi qu’en
témoigne cet ouvrage signé Amandine Bernardi, blogueuse remarquée (Amandine
Cooking) sur les réseaux sociaux.
L’ouvrage réunit pas moins de 100 recettes de plats mitonnés et sélectionnés
pour leur facilité et leurs saveurs. Après un rappel des fondamentaux
essentiels à connaître pour la cuisson en cocotte, ce livre se divise de
manière pratique en sections selon les différents mets cuisinés : bœuf,
veau, agneau, porc, volaille, mais aussi poisson et même plats végétariens !
Les explications sont clairement détaillées, préparation, ingrédients,
étapes, conseils et astuces pour réussir à coup sûr ces plats en cocotte.
Les photographies ajoutent encore au charme de ce mode de cuisson
traditionnel qui amplifie les saveurs et réjouira vos hôtes au lorsque vous
placerez au beau milieu de la table l’une de ces cocottes pleines de
promesses… |
| |

 |
« Dis,
on mange quoi ce soir ? » ; Collection Larousse, Editions Larousse, 2024.
La bien inspirée collection Larousse « Dis, on mange quoi ce soir ? » répond
à la sempiternelle question qui se pose chaque jour au cuisinier et à la
cuisinière de service à la maison… La solution est simple, directe et sans
chichis grâce à ces guides conçus pour être pratiqués sur le champ avec un
résultat accessible et savoureux !
Parmi les dernières parutions, soulignons : « Cakes salés » ; un titre qui
devrait retenir l’attention tant ses recettes sont non seulement faciles,
rapides, mais, qui plus est, surtout gourmandes. Ce guide offre en effet une
recette de pâte à cake de base à laquelle seront ajoutés deux ou trois
ingrédients accessibles pour offrir une touche des plus savoureuses.
Jugez-en ! Au menu de ce soir, un cake au brocoli (frais de préférence),
fromage et lardons ou bien une version au reblochon, jambon cru et
ciboulette…
Pour le déjeuner de demain ? Retenons ce cake au thon et courgette prêt en
10 min et 35 min de cuisson qui n’exigera qu’une boite de thon, une
courgette, 4 œufs, un peu de crème et de la farine ! C’est rapide, bon et
surtout inratable…
Dans le même esprit encore de cette collection « Dis, on mange quoi ce soir
? », ce nouvel ouvrage ; « Et hop au four ! » qui réunit également 50
recettes à partir de 5 ingrédients en 3 étapes maxi. On y trouvera bon
nombre de bonnes et savoureuses idées de recette dont ce saumon au sirop
d’érable et asperges vertes ou encore des tomates rôties au chèvre sec et
basilic, des patates douces gratinées au fromage… Des recettes pour tous les
jours de la semaine qui renouvelleront notre quotidien afin d’échapper
avantageusement aux surgelés et autres coquillettes jambon… |
| |


 |
Redécouvrir Paris avec les guides Jonglez
Les éditions Jonglez proposent avec trois récentes parutions de (re)découvrir
la capitale de manière plus singulière et originale, une heureuse initiative
après l’effet des JO 2024…
La désormais classique collection des villes méconnues
accueille, en effet, le « Paris méconnu » conçu par Thomas Jonglez, fruit de
cinq années de travail, ce qui n’étonnera pas le lecteur en feuilletant les
pages de cet imposant guide de 558 pages ! Un guide écrit comme à l’habitude
par ses habitants eux-mêmes, des habitants qui ont cœur de livrer et
proposer un autre regard sur leur ville telle qu’ils l’ont choisie, vécue et
aimée. Et le charme bien entendu opère spontanément avec un étourdissant
parcours par arrondissement. Le lecteur débutera sa visite par une curieuse
représentation d’un Napoléon… déguisé en Louis XIV ! Le ton est donné avec
des découvertes qui ne figurent dans aucun guide classique comme cette
intrigante et néanmoins imposante cheminée jouxtant la Tour Eiffel que la
plupart des touristes et parisiens ne remarquent guère et qui servit lors de
l’édification du célèbre édifice. Plus étrange encore, nous découvrirons
qu’il existe encore des stations de métro ne figurant plus sur les plans et
qui perdurent pourtant encore physiquement, soit qu’elles aient été
abandonnées ou transformées en un autre usage. Chaque arrondissement livre
ainsi ses secrets et ses trésors ignorés la plupart du temps des habitants
de la capitale.
Le guide « Paris – 30 expériences » complètera idéalement
cet ouvrage avec trente propositions d’adresses aussi secrètes
qu’inoubliables telles que la visite d’un des grands musées parisiens la
nuit, une croisière insolite sur la Seine ou encore l’exploration des
Beaux-arts de Paris. Cafés, glacier, restaurants, concerts ou tout
simplement promenades inoubliables fourmillent dans ce guide tout aussi
agréable à découvrir qu’utile.
Enfin, toujours aux éditions Jonglez, le guide « Grand
Paris insolite et secret » permettra d’élargir encore le rayon géographique
de ces découvertes dans les Hauts de Seine, Seine Saint-Denis et Val de
Marne. Autant prévenir que le rayon abordé couvre un important territoire
riche d’une histoire remontant parfois très loin dans le temps ainsi qu’en
témoignent cette Vierge noire de Paris ou cet étonnant moulin de Nanterre
datant probablement du XVe s. ! Chaque lieu est amplement documenté et
décrit, avec ses coordonnées complètes, site web et moyen de transport
indiqué pour s’y rendre. |
| |
 |
« Pêche
du jour » de Jordan Coube, 176 pages, couleur, Éditions Marabout, 2024.
Avis aux amateurs des produits de la mer, ce livre incontournable « Pêche du
jour » signé Jordan Goube. L’auteur, poissonnier de métier, Meilleur
Apprenti et Meilleur Ouvrier de France, a souhaité par cet ouvrage
transmettre toute sa passion et son goût pour les poissons, mais aussi les
coquillages et crustacés. Lieu en croûte de parmesan, encornets farcis ou
encore Porc aux coques, on y trouve des recettes comme on les aime, faciles à réaliser
pour le quotidien ou tables de fêtes avec pour chacune son mode de cuisson
et son budget afin de ne pas se ruiner, rien n’a été laissé au hasard. Comment
dès lors résister aux Tagliatelles aux palourdes ou à ces Boulettes
d’églefin à la tomate ?
Proposant pas moins de 60 recettes, le lecteur trouvera, en outre, en
ouverture de l’ouvrage dans un « Carnet pratique » mille et un conseils
allant de la saisonnalité ou comment choisir son poisson aux techniques de
base de découpage ou d’ouverture pour les crustacés. Rien n’a échappé à ce
pédagogue hors pair prônant une pêche raisonnable, les temps de cuisson et
surtout 60 recettes aussi délicieuses que simples. Rangées par grands
thèmes, apéro, poissons cuits ou crus, crustacés et coquillages ou dans un
astucieux index par ingrédients, le lecteur n’aura qu’une envie nouer son
plus beau tablier ! |
| |
 |
Le
Petit Larousse illustré – 1905/2025
Le Petit Larousse illustré est une véritable institution et chaque nouvelle
édition sera l’occasion de redécouvrir ce trésor de la langue française mais
aussi une encyclopédie à part entière servie par ses inoubliables
illustrations. Ce millésime 2025 – Le Petit Larousse fête ses 120 ans ! - ne
fait pas exception et plus que jamais la devise de ce fameux dictionnaire «
Instruire tout le monde et sur toutes les choses » sera vérifiée page après
page par le lecteur. Les chiffres sont suffisamment éloquents pour faire du
Petit Larousse illustré 2025 son dictionnaire de référence : 64 300 mots,
125 000 sens, 20 000 locutions et 2 000 régionalismes et mots de la
francophonie…
Alliant le sérieux d’un dictionnaire manuel et plaisir d’une approche
encyclopédique, le Petit Larousse illustré permet non seulement de recherche
à tout moment le sens d’un mot, son orthographe ou noms propres, mais
également de s’évader au fil des pages sans objet précis, certainement l’une
des meilleures approches pour enrichir encore son vocabulaire et ses
connaissances dans des domaines les plus variés.
Et parce que la langue française évolue, cette nouvelle édition intègre ces
changements : 150 nouveaux mots, sens, locutions et expressions, des
évolutions signes de cette richesse non figée. Parmi les nouveaux promus,
citons désanonymer, empouvoirement, détox digitale, platisme, mentorer,
fast-fashion ou encore masculinisme et bien d’autres découvertes encore. Les
illustrations à elles seules enchantent le regard avec 5 500 cartes,
dessins, photographies et schémas ainsi que 150 planches illustrées. Enfin,
le Petit Larousse illustré s’intéresse également aux noms propres avec 28
000 lieux, personnalités et évènements, de quoi alimenter de longues heures
de lecture en compagnie de cette mine de savoir, véritable mémoire de la
langue. |
| |
 |
« Cook
Color » de Maria Zizka ; Photographie de David Malosh ; Editions Marabout,
2024.
Cuisiner de bonne humeur et en couleur, c’est ce que nous propose Maria
Zizka avec cet ouvrage dénommé judicieusement « Cook Color » aux éditions
Marabout. On y découvre, en effet, pas moins de 100 recettes pleines de peps
et de couleurs pour un plaisir inégalé tant des papilles que des yeux. Du
rouge de la tarte à la tomate au jaune plein de soleil de la courge sans
oublier le violet, le blanc, le noir et même le bleu plus rare en cuisine,
tout semble permis avec Maria Zizka, du moment que les saveurs et couleurs
réjouissent et enchantent les mets. Il faut dire que l’auteur n’en est pas à
son premier ouvrage et s’impose aujourd’hui comme l’une des meilleures
influenceuses dans le monde de la cuisine.
Rangées par couleurs et illustrées pleine page par les photos de David
Malosh, les recettes défilent selon les couleurs de l’arc en ciel et nos
envies. Quinoa au radis pastèques et griottes séchées pour un savoureux
violet ou encore une salade monochrome d’endives au radis et à la ricotta
pour le blanc crème… Maria Zizka nous livre aussi ses secrets notamment
comment conserver le beau vert de printemps des petits poids ou comment
rehausser ces mets parfois trop fades…
Une mine d’idées, de recettes et de couleurs qui réveillent et enchantent
cuisine et assiettes ! |
| |
 |
« Paris
– A travers son histoire, ses quartiers, ses monuments » de Clémentine
Santerre, Editions Larousse, 2024.
Voilà un petit livre des plus attrayants et instructif nous dévoilant «
Paris, à travers son histoire, ses quartiers, ses monuments ». Clémentine
Santerre, spécialiste et passionnée de Paris, a avant tout souhaité nous
livrer ou nous rappeler à ceux qui se font fort de connaître la capitale
comme leur poche, les mille facettes et merveilles de la Ville lumière. Car
connait-on réellement chaque quartier de la capitale ? Ses trésors, mystères
ou secrets ? Connait-on ainsi « Les secrets de Notre-Dame », « Les trésors
du Louvre » ou encore « Les merveilles du Musée d’Orsay ». Illustré de
nombreuses photographies, l’auteur nous emmène tout d’abord dans ce Paris,
lointain, le « Paris médiéval », nous contant la vie au XIIIe siècle, mais
aussi sur les rives de la Seine, racontant l’histoire de quelques iles de
Paris… C’est un Paris au fil de ses ponts, de ses rues et des siècles que le
lecteur découvrira dans ces 126 pages. Musées, jardins, places, célèbres
restaurants ou encore le « Paris street art », rien n’échappe à Clémentine
Santerre, pas même la charmante impasse du Trésor... Le lecteur parmi mille
et un focus y retrouvera aussi de multiples conseils pour préparer ballades
et promenades parisiennes y compris autour de Paris, de Versailles à
Rambouillet. |
|
BD |
 |
« Le Serment » ; Scénario de Mathieu Gabella ;
Dessin de Mikaël Bourgouin ; 24 x 32 cm, 136 p., Editions Glénat, 2026.
Que diriez-vous en ce début d’année d’un fantastique thriller ou plutôt d’un
thriller fantastique aussi trépident qu’angoissant alliant sciences et
suspens… C’est ce que nous proposent avec maestria Mathieu Gabella et Mikaël
Bourgouin avec cet album intitulé tout simplement « Le Serment ».
L’histoire met en scène un médecin sulfureux radié de l’ordre et travaillant
désormais de manière obscure pour la pègre. Mais, un soir, alors que ce
dernier soigne un jeune braqueur, le « Docteur », ainsi qu’on le surnomme
dans le milieu, se retrouve nez à nez avec celui qui se présente comme un «
chasseur de vampires »… Un face à face durant lequel Alexandre jouera non
seulement sa propre destinée, mais aussi et surtout celui de l’humanité…
Glaçant.
Un one-shot mené de main chirurgicale par Mathieu Gabella, scénariste de BD
salué et reconnu pour sa passion pour l’histoire avec notamment la
collection « Ils ont fait l’histoire » chez Glénat, mais également son
penchant pour la science. Pour « Le Serment », Mathieu Gabella a su allier
avec doigté une incroyable créativité d’action et de suspense, sans oublier
le fameux mythe du vampire… Trahisons, manipulations et vérités historiques
s’entremêlent pour un huis-clos des plus effrayants…
Cela donne un récit captivant servi, qui plus est, par les dessins
fantastiquement réussis de Mikaël Bourgouin ; des dessins aux trait acérés
promus d’une énergie époustouflante et aux couleurs lugubres à souhait.
Un cocktail opérant merveilleusement et plongeant le lecteur dans une
atmosphère aussi envoûtante que menaçante. Reste au Docteur, « … une journée
pour empêcher ça. »
Gilles Landais
|
| |
 |
« Noir Horizon – Tome 3 – Shemot » ; Scénario de
Philippe Pelaez ; Dessin et couleurs de Benjamin Blasco-Martinez ; 24 x 32
cm, 56 p., Editions Glénat, 2026.
Le début de l’année était aussi attendu que ce troisième et dernier tome de
la trilogie « Noir Horizon », cette série de science-fiction déjà largement
saluée tant par la critique que par le public.
Dans cet ultime volume, le lecteur est de nouveau plongé littéralement dans
l’atmosphère apocalyptique de « Noir Horizon »… Retrouvant tous les
protagonistes des précédents volumes, Judith, Tobie, Ben, et surtout la
belle et rebelle Esther, la fille de l’horrible Gouverneur, le lecteur est
happé par le rythme effréné tant du scénario que par la succession
spectaculaire des planches.
Dans un alliage mêlant philosophie, religion, notamment l’Ancien Testament
et les sciences, « Noir Horizon » se veut surtout une allégorie
contemporaine de la tyrannie. Entremêlant pour cela avec un soin
particulièrement étudié récit de science-fiction et récit ésotérique,
Philippe Pelaez et Benjamin Blasco-Martinez s’imposent une nouvelle fois,
ici, en duo de choc ! Appuyant génialement tant la portée universelle que le
côté cinématographique de cette série plus que saluée, les dessins et
couleurs de Benjamin Blasco-Martinez sont sublimes et imposent à eux seuls
l’admiration.
Gilles Landais
|
| |
 |
« Albertine a disparu » ; Scénario de François
Vignolle et Vincent Guerrie ; Dessin de Vincenzo Bizzarri, Editions Glénat,
2025.
Pour cet album « Albertine a disparu », les auteurs, François Vignolle et
Vincent Guerrier, tous deux journalistes, et Vincenzo Bizzarri, pour le
dessin, se sont saisis d’un fait divers qui s’est réellement et tristement
passé en France. Bien que le titre de cet album puisse faire penser à Proust
et à sa chère Albertine, il ne s’agit cependant que d’un simple clin d’œil
puisqu’ici Albertine a 99 ans, c’est l’époque du Covid, la canicule règne…
Et «Albertine a disparu» !
Dès les premières pages, le lecteur est entraîné dans ce récit mené par les
deux journalistes-auteurs comme une enquête, enquête plus qu’un polar ou un
thriller ; Car, soulignons-le, de nouveau, François Vignolle et Vincent
Guerrier ont pour cette BD vraiment mené leur enquête ; On y entend la voix
du maire de la petite commune où habitait Albertine et qui s’inquiétait pour
ses administrés en cette période de canicule, la belle-fille d’Albertine,
mais aussi son fils, le seul à lui rendre régulièrement visite… Que s’est-il
passé ? Et pourquoi une telle découverte, une telle vérité ?
La disparition d’Albertine ou plutôt cet album « Albertine a disparu » (dont
les noms des véritables protagonistes ont été modifiés) soulève au-delà de
ce triste et consternant fait divers bien des thèmes sociétaux actuels : la
vieillesse, la solitude, les liens, notre rapport à la mort… Questionnements
que les dessins de Vincenzo Bizzarri par leur spontanéité et leur
sensibilité viennent parfaitement mettre en exergue et révéler, comme pour
mieux en souligner toute la pertinence et l’urgence.
Un bel album posant en ce XXIe siècle individualiste une réflexion
primordiale qu’on ne peut que saluer et proposant au lecteur de regarder la
réalité puisqu’« Albertine a disparu »…
Jules Buissonnet |
| |
 |
« Rectificando – Tome 4 – Pour quelques barils de
plus… » ; Scénario Didier Convard ; Dessin Denis Falque ; Couleur Angélique
Cénano ; 24 x 32 cm, Editions Glénat, 2025.
Dans les multiples épopées de l’incontournable « Triangle secret », était
vivement attendu le tome 4 de la série « Rectificando ». C’est chose faite
avec la parution de ce nouveau volume, quatrième donc de la série, intitulé
« Pour quelques barils de plus… » signé Didier Convard et Denis Falque.
Pour cette nouvelle aventure (qui peut se lire indépendamment des autres),
le lecteur sera confronté au froid glacial des forêts blanches de l’Alaska.
Là, dans ce décor des plus hostiles, la firme multinationale
Appaloosa-Energy tente sans merci ni concession, de retrouver un fameux
disque dur aux données sulfureuses, preuves accablantes pour la Firme et que
détient « L’Indien ». Le célèbre agent du Triumvirat, Jean Nomane, le
Rectificateur, a été désigné avec son équipe pour intervenir, protéger «
L’Indien », et surtout retrouver ce fameux disque dur aux si précieuses
données… Mais, en ce quatrième tome, le blanc des cimes se fait de plus en
plus sombre pour nos protagonistes : Nomane et son équipe, L’Indien » et la
communauté de ce village Inuit avec son révérant si trouble. Nomane
parviendra-t-il, en effet, à récupérer le disque dur, à sauver « L’Indien »,
et plus que tout, à sauver l’Alaska du pire désastre écologique ?...
Comme toujours, les lecteurs retrouveront avec Didier Convard, un scénario
des plus serrés ; Actions, intrigues sur fond de scandale s’enchaînent à un
rythme effréné n’épargnant rien ni Jean Nomane ni son équipe, et encore
moins le lecteur tenu en haleine… Un scénario servi – une nouvelle fois –
par les remarquables dessins aussi réalistes que soignés de Denis Falque
rehaussés des sombre camaïeux d’Angélique Cénano.
Une aventure entre espionnage et polar qui se laisse agréablement lire !
Gilles Landais |
| |
 |
« Alexandre VI - Tome 2 - Le règne des Borgia » de
Bernard Lecomte, ; Scenario de Simona Mogavino ; Dessin d’Alessio Lapo,
Editions Glénat, 2025.
Avant d’être une série télévisée, les Borgia furent surtout une célèbre et
véridique dynastie influente d’Italie aux XVe et XVIe s. Ce nom, aujourd’hui
synonyme d’excès en tout genre et d’intrigues les plus multiples et variées,
donna lieu à bien des fantasmes… C’est à ce mythe et à l’un de ses
principaux représentants, le pape Alexandre VI en personne, auquel se sont
intéressés le spécialiste des religions, Bernard Lecomte, ainsi que Simona
Mogavino et Alessio Lapo pour une BD associant histoire et fiction afin de
démêler au mieux avec le lecteur le vrai du faux. L’action se situe en 1495
à Rome alors que le pape Alexandre VI, récemment élu, doit faire face aux
troupes du roi Charles VIII menaçant Florence. C’est alors la diplomatie que
va retenir ce prélat à la réputation sulfureuse, thème développé par cette
BD particulièrement informée sans que cela ne soit au détriment de l’action,
particulièrement virulente en ces temps mouvementés…
Alessio Lapo fait merveille en cela avec des dessins hauts en couleur
révélant les plans « machiavéliques » de certains des protagonistes en une
ambiance clair-obscur digne du Nom de la Rose ! Ce récit servi par un
scénario de main de maître par Simona Mogavino est complété par un non moins
passionnant cahier documentaire sur Alexandre VI signé de l’incontournable
vaticaniste Bernard Lecomte !
Jules Buissonnet
|
|
|
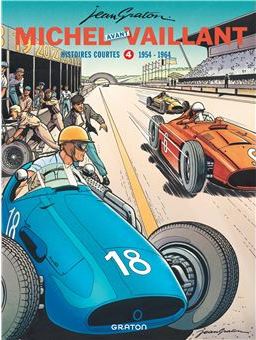 |
« Michel Vaillant Histoires courtes - Tome 4 –
Michel avant Vaillant (1954-1964) » de Jean Graton, BD, Editions Dupuis,
2025.
Petit retour en arrière qui ne rajeunira pas forcément les plus anciens
d’entre nous avec ce tome couvrant une décennie allant des années 1954-1964
et agrémenté d’histoires courtes initialement parues dans Tintin sur le
sport automobile, et ce, sans que le personnage de Michel Vaillant
n’apparaisse puisqu’il s’agit bien pour le plus grand bonheur du lecteur de
la genèse du fameux héros, de « Vaillant avant Vaillant » mais avec tout le
talent déjà de Graton !
En fait, ce dernier naîtra en 1957, certes initialement dans Tintin, mais ce
n’est que progressivement que le pilote automobile acquerra le statut de
héros qui sera le sien pour les décennies suivantes jusqu’à nos jours. Jean
Graton développe déjà sur ces planches tout l’éventail de son art et
parviendra même, comble de son génie, à inspirer la vocation de futurs
pilotes de course ! Il faut dire que le célèbre dessinateur est né quasiment
dans les moteurs, son père étant organisateur de courses régionales…
Voici donc réunies dans cet album, anticipant la genèse de cette série
légendaire, une série d’histoires courtes qui transporteront le lecteur dans
les heures mythiques du sport automobile, une époque vintage au regard des
monstres actuels, mais o combien réjouissante… « Le virage de la peur », «
Conducteurs de l’enfer » ou encore « Fangio, champion du monde » seront en
effet l’occasion de constater – et d’apprécier ! – l’art éprouvé du
dessinateur dans sa manière de rendre l’ambiance des courses et de ses
à-côtés.
Un savoureux album à déguster sans modération !
Jules Buissonnet
|
|
|
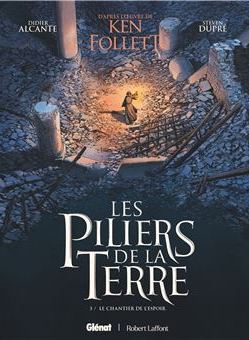 |
« Les Piliers de la terre – Tome 3 – Le Chantier de
l’espoir » d’après l’œuvre de Ken Follet ; Scénario de Didier Alcante ;
dessin de Steven Dupré ; 24 x 32 cm, 72 p., Editions Glénat, 2025.
« Le Chantier de l’espoir », troisième volet de la série « Les piliers de la
Terre », série offrant avec maestria une adaptation de la fameuse œuvre
éponyme de Ken Follett parue en 1989, était plus qu’attendu !
Les aficionados de cette saga plébiscitée retrouveront avec plaisir les
protagonistes de celle-ci avec notamment Tom, notre humble bâtisseur, qui
rêve toujours de réussir à bâtir la plus belle des cathédrales, et Ellen, sa
compagne de tous les périls et chemins… Avec ce nouveau volume, toujours
signé Didier Alcante pour le scénario et Steven Dupré pour les dessins,
c’est une atmosphère des plus sombres qui attend le lecteur ; Rappelons que
l’église de Kingsbridge a brûlé. Néanmoins, derrière Tom, les villageois et
les moines restent déterminés et l’aident à poursuivre son chantier. Et,
ainsi que le titre de ce troisième volet l’annonce, l’espoir va donc
renaître, c’est « Le Chantier de l’espoir »… Mais, les intrigues entravant
la réalisation du rêve de Tom demeurent encore bien nombreuses ; surtout,
une visite, le jour même de la Pentecôte, pourrait bien être déterminante…
Un nouveau volet ficelé, de nouveau, de main de maître par Didier Alcante
qui relève une nouvelle fois le défi d’adapter le si dense roman de Ken
Follett. Intrigues, drames et actions s’enchaînent, en effet, sans
discontinu, nous entraînant dans cette époque des bâtisseurs de cathédrales.
Les lecteurs apprécieront, toujours, la qualité exceptionnelle des dessins
de Steven Dupré. On retrouve mille détails des plus soignés les uns que les
autres et plongeant le lecteur dans cette atmosphère toute moyenâgeuse du
XIIe siècle propre à l’œuvre de Ken Follett.
Un troisième volume qui vient assurément confirmer la qualité de cette
adaptation en BD et rendant cette série incontournable.
Gilles Landais
|
| |
 |
« Largo Winch – Tome 25 - Si les dieux t’abandonnent…
» ; Scénario de Jérémie Guez ; Dessin de Philippe Francq ; couleur de
Bertrand Denoulet, 48 p., Dupuis éditions, 2025.
Voici, avec Jérémie Guez, une nouvelle plume pour le tome 25 de la célèbre
série Largo Winch avec pour titre « Si les dieux t’abandonnent… » ! Le
scénariste, par ailleurs connu pour sa participation à la série B.R.I. de
Canal+, a retenu pour ce nouvel épisode une action se déroulant au calme
d’un havre secret de l’Adriatique… Calme, un peu vite dit, si l’on considère
l’arrivée soudaine d’un yacht près de l’île paradisiaque de Sarjevane où
réside notre héros. Ce court temps de repos sera l’occasion pour Largo Winch
de questionner son rapport à la richesse, à ses engagements et au pouvoir.
Entre introspection et questions éthiques, ce nouvel album nous présente un
héros en proie au doute après sa rencontre avec le milliardaire Jarod. Afin
de dresser au plus près ce tableau atypique, Philippe Francq contribue à
cette évolution sensible par son trait à la fois assuré et d’une redoutable
précision, sans oublier la palette colorée de Bertrand Denoulet soulignant
encore ces nuances. Jeux de lumière et contrastes entrent en résonance avec
les dialogues concis marquant la gravité de certains questionnements. Grâce
à cette dimension psychologique introduite dans la série, Largo, en plus
d’être un homme d’action, apparaît également sous un autre visage en phase
avec notre époque, une évolution réussie et à retrouver dans ce tome qui
vient de paraître aux éditions Dupuis !Jules Buissonnet |
| |
 |
« La Tombe » d’après l’œuvre de H.P. Lovecraft ;
Préface de Christophe Thill ; Scénario de Bastian D.D. ; Dessin de Nino
Cammarata ; 22 x 29 cm, 72 p., Editions Les Humanoïdes Associés, 2025.
C’est avec un grand plaisir que nous avons découvert cette adaptation en BD
d’une nouvelle de l’écrivain américain Howard Phillips Lovecraft
(1890-1937), écrivain connu et salué pour ses récits fantastiques. Et, c’est
effectivement une nouvelle des plus étranges, intitulée « La Tombe » que
nous proposent de découvrir dans cet album Bastian D.D. et Nino Cammarata ;
une nouvelle peu connue, publiée pour la première fois en 1922, et préfacée
pour cette adaptation par Christophe Thill, spécialiste de l’œuvre de H.P.
Lovecraft.
Imaginez un jeune homme, Jervas, solitaire et rêveur, dernier descendant
d’une famille au passé trouble, découvrant son propre nom sur une tombe ;
Jervas va venir et revenir jusqu’à l’obsession sur cette tombe, sur ce
mausolée qui semble tant lui révéler de secrets sur sa famille… «
L’impatience de goûter à l’instant où je franchirais ce seuil et où je
m’aventurerais dans cet escalier sombre et humide », confessera-t-il...
C’est une atmosphère fantastique sombre et des plus mystérieuses qui
enveloppe planche après planche le lecteur. Une immersion aussi fascinante
qu’étrange rendue idéalement tant par le scénario travaillé et bien ficelé
de Bastian D.D. que par les dessins soignés et remarquables de Nino
Cammarata. Une mise en planche efficace entrecoupée de splendides
pleine-pages transmettant, avec les effets de style et les couleurs
également de Nino Cammarata, parfaitement cette ambiance fantastique si
singulière et propre à l’auteur américain Lovecraft.
Une adaptation fascinante des plus réussies que l’on ne peut qu’inviter à
découvrir !
Gilles Landais
|
| |
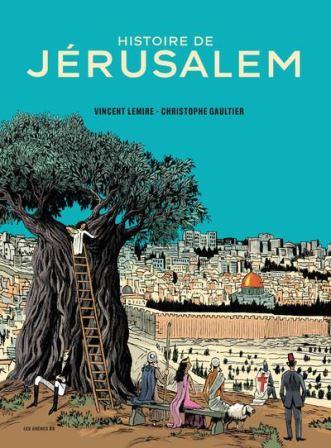 |
« Histoire de Jérusalem » ; Texte et scénario de
Vincent Lemire ; Dessin de Christophe Gaultier ; Couleur de Marie Galopin ;
Edition de luxe, 24,5 x 33,32 cm, Les Arènes Editions, 2025.
Parue initialement en 2022, la BD « Histoire de Jérusalem » de Vincent
Lemire et Christophe Gaultier fut à sa sortie plus que largement saluée tant
par le public que par la critique la plus exigeante ; qu’on en juge ! Elle
fut vendue en France à plus de 350 000 exemplaires et traduite dans plus
d’une dizaine de pays. Il est vrai que cette dernière retrace de manière
claire, objective et didactique la complexe et inextricable histoire de
cette cité millénaire, nommée Jérusalem, apportant ainsi bien des
éclaircissements face à une actualité qui demeure encore en 2025 brûlante.
Aussi, la parution aujourd’hui en grande édition de luxe de cette
incontournable BD réjouira plus d’un lecteur qui y retrouvera cette rigueur
historique parfaitement accessible. Ce travail en effet remarquable allie
rigueur et humour tant de Vincent Lemire, historien et professeur
d’Université Paris-Est, que celui pour les dessins de Christophe Gaultier,
bien connu du monde de la BD, et dont les dessins d’une efficacité
redoutable viennent illustrer l’histoire de cette cité sainte où se sont
mêlés et entrecroisés tant de prophètes, de rois et d’empires... Allant, en
effet, de la préhistoire à nos jours, en passant par la naissance de la
Jérusalem chrétienne, Al-Quods ou la ville sainte de l’Islam, les croisades,
Saladin, l’Empire Ottoman… Entre lieux saints qui se succèdent et lieux
saints partagés, c’est toute l’histoire passionnante de Jérusalem que les
deux auteurs, convoquant historiens, archéologues imaginaires ou non,
déroulent en dix chapitres pour la plus grande compréhension de leur
lecteur. On notera l’ajout appréciable pour cette nouvelle édition de luxe
de cartes dès le second de couverture, cartes multiples selon les époques et
périodes complétées par un repère chronologique très détaillé en fin de
volume.
Une BD incontournable
Gilles Landais
|
| |
 |
« Tous en ligne » de Saul Steinberg ;
Introduction de Liana Finck ; Postface de Iain Topliss ; 23 x 30.5 cm, 160
p., Hors collection, Editions La Table Ronde, 2025.
Comment ne pas craquer sur ce délicieux et incontournable album entièrement
consacré à Saul Steinberg ? Connu et reconnu comme l’un des plus grands
dessinateurs de l’après-guerre, Steinberg a su, en effet, s’imposer et
influencer d’illustres dessinateurs dont Cabu, Siné ou encore Sempé qui
avoue : « Je crois que les livres que j’ai le plus lus et regardés, ce sont
les albums de Steinberg » ! Steinberg, ce sont notamment ces inoubliables
dessins parus dans le New Yorker ou en ayant fait la couverture. Aussi,
comment résister à cet album inédit, « Tous en Ligne », son tout premier
album ? Un recueil jamais encore publié en France et retraçant son exil de
l’Italie Fasciste en 1941 vers les Etats Unis où il saura trouver sa
singularité.
Le lecteur y retrouvera déjà toute la force du dessinateur avec notamment
ces personnages à la fois aveugles et néanmoins si expressifs, son trait
frêle mais o combien efficace. N’épargnant aucun sujet cher à l’auteur, sans
complaisance et avec cette lucidité qui lui est si caractéristique, c’est un
album grand format de plus de 160 pages qui capte et happe littéralement son
lecteur l’amenant à sourire, rire, parfois grimacer ou pleurer, mais
toujours à questionner, à se questionner…
Rappelons que Steinberg fut exposé en France dès 1953 à l’initiative de la
Galerie Maeght, et le sera par suite jusqu’en 1988 régulièrement. Ce roumain
de naissance (1914), naturalisé américain et français de cœur, sera un
acteur majeur non seulement du monde du dessin, mais également par ses
sculptures, gravures ou encore collages de la vie artistique, et ce jusqu’à
sa mort en 1999.
Gilles Landais
|
| |
 |
« Buck Danny Origines - Tome 4 - Sonny Tuckson,
Lettres à Jo - 2/2 » de Frédéric Zumbiehl, Patrice Buendia (scénarios),
Giuseppe De Luca (dessin), Editions Dupuis, 2025.
L’histoire se déroule en 1941 et Sonny Tuckson affecté à Manille, juste
avant l’attaque de Pearl Harbor, entretient une correspondance avec son ami
Jo resté au Texas. Muté à Hong Kong, Sonny fait alors la connaissance de
Mary, la fille du gouverneur, point de départ de rocambolesques aventures…
Ce récit trépidant sur fonds d’espionnage de guerre, d’enlèvement et
d’attaque imminente est prétexte pour nos auteurs de livrer un récit à la
fois haletant et intriguant dans la tradition d’action de la série
originale.
Le mode épistolaire retenu par les scénaristes est convaincant et confère à
cette BD un style à la fois alerte et intimiste pour ce deuxième volet.
Guerres aériennes et romance s’entremêlent dans ce nouvel épisode et le
style graphique de Giuseppe De Luca, déjà salué dans ces colonnes, fait
mouche avec un trait précis conjugué à une atmosphère d’époque idéalement
restituée. La tension perceptible au fil des planches va crescendo avec des
scènes d’action virtuoses entrecoupées de moments plus intimistes.
Un nouvel épisode dans la lignée des Buck Danny tout en introduisant des
angles originaux !
Jules Buissonnet
|
| |

 |
« Neptune - Tome 5 » et « Vénus »- Tome 6 »,
Collection Système Solaire, Editions Glénat, 2025.
La collection « Système solaire » des éditions Glénat avec des contributions
d’astronomes de l’Observatoire de Paris s’enrichit encore pour le plus grand
plaisir des lecteurs de deux nouveaux volumes pour cette série plébiscitée
qui en compte huit au total. Neptune (tome 5) et Vénus (tome 6)
transporteront le lecteur aux confins de notre galaxie, dans des
environnements guère attractifs pour les humains que nous sommes, mais o
combien, en ces pages passionnants !
Pour le tome 5 consacré à Neptune, c’est sous la forme d’un voyage
interstellaire avec des scientifiques embarqués dans un vaisseau spatial que
le récit conçu par Bruno Lecigne et mis en dessin par Federico Dallocchio
débute ; En route donc vers Neptune !
La géante des confins à 4,5 milliards de km au couleur de jade est composée
essentiellement de gaz gelé… Le récit s’accélère rapidement lorsque d’autres
extraterrestres rejoignent le vaisseau et que l’un d’entre eux met fin à ses
jours.
Mêlant informations scientifiques de première source et narration romanesque
digne des meilleurs films de science-fiction, ce voyage vers Neptune est
tout sauf un voyage de tout repos. Parallèlement aux nombreuses découvertes
et présentations didactiques sur cette région reculée de l’univers, le
scénario conçu par Bruno Lecigne sait, en effet, tenir en haleine son
lecteur qui n’aura qu’une idée en tête : découvrir l’issue de cette
exploration aux confins de notre système solaire. A noter également les
dessins impeccables de Federico Dallocchio qui savent par leur perfection
technique et précision rendre les immensités stellaires tout autant que les
émotions qui peuvent saisir les protagonistes de ce récit trépidant.
Comme pour les autres volumes, un passionnant dossier sur Neptune a été
conçu par les astrophysiciens de l’Observatoire de Paris ; dossier qui
permettra de regarder autrement le ciel étoilé après sa lecture !
Jules Buissonnet |
| |
 |
« Astérix en Lusitanie » ; Texte de Fabcaro ;
Dessins de Didier Conrad, Editions Albert René, 2025.
Astérix et Obélix sont de retour ! Pour une nouvelle aventure, cette fois-ci
en Lusitanie, le Portugal manquant jusqu’alors aux pérégrinations de nos
deux héros gaulois… Une escapade dès lors fort attendue ! Et cet album n’a
pas pris une ride depuis la période Goscinny et Uderzo : même souffle
aventureux, toujours cet humour gaulois au fil des planches, même si
quelques références inhabituelles à l’actualité politique (la réforme des
retraites) introduisent de nouveaux angles… Fabcaro a manifestement pris un
plaisir à croquer l’âme portugaise dans ces aventures d’Astérix en Lusitanie
avec un goût évident dans son scénario pour la fameuse saudade comme fil
directeur des aventures de nos deux héros.
Didier Conrad quant à lui parvient à saisir les inoubliables décors et
paysages portugais, bien distincts de ceux du volume antérieur consacré à
l’Hispanie. Entre mer et terre, montagnes et villes bordant l’Atlantique,
notre dessinateur s’en donne à cœur joie et magnifie les couleurs pour le
plus grand plaisir du lecteur. L’hospitalité légendaire de nos voisins
lusitaniens, ainsi que les spécialités culinaires qui semblent parfois
déconcerter notre amateur de sanglier, Obélix, rythment de manière
jubilatoire ces planches alertes qui perpétuent la grande tradition des
Astérix !
A noter que pour les amateurs de numérique qu’une édition digitale existe
pour ce nouveau titre « Astérix en Lusitanie ».
Jules Buissonnet |
| |
 |
« Albert Kahn – L’archiviste de la planète » de
Didier Quelle-Guyot et Manu Cassier, Editions Glénat, 2025.
Albert Kahn fut un humaniste plus proche du XVIe siècle que de cette fin du
XIXe siècle dans laquelle il évoluera et dont les fondations se lézardent à
la veille des deux grands conflits mondiaux. Et pourtant, quelques hommes -
dont Albert Kahn - ont cherché un horizon meilleur reposant sur une
considération non plus utilitariste de l’occident industrialisé, mais sur
une collaboration réciproque. Projet de la SDN et vaste entreprise en vue de
recueillir les bribes de cultures en voie de disparition occuperont toute
l’énergie d’un philanthrope bien particulier, ce banquier dénommé Albert
Kahn, qui dédiera toute sa fortune à ce rêve de croisé des temps modernes.
C’est à cette figure singulière que se sont attachés Didier Quelle-Guyot et
Manu Cassier dans leur album « Albert Kahn – L’archiviste de la planète »
paru aux éditions Glénat. Ce personnage atypique, qui paradoxalement
n’aimait guère apparaître sur des clichés, sera à l’origine de l’une des
plus grandes collections mondiales de photographies aux quatre coins du
monde et qui prendra pour nom les Archives de la Planète. Grâce au scénario
habilement mené de Didier Quella-Guyot, spécialiste de l’univers de la BD
auquel il a consacré des travaux universitaires, le lecteur pourra suivre la
vie, les idéaux de cet homme marqué d’une soif intarissable de « saisir » et
conserver la mémoire de l’humanité, une tentative utopiste rendue possible
grâce à l’art photographique. Nous apprendrons ainsi en ces pages
subtilement colorées de sépia comment ce personnage redonna vie à des femmes
et des hommes de contrées lointaines ou proches, pris sur le vif par la
douzaine d’opérateurs, tous choisis à l’époque par Albert Kahn pour se
rendre en mission aux quatre coins du monde et collecter de quoi nourrir et
enrichir ces fameuses Archives de la Planète. Un archiviste de la planète en
avance sur son temps et anticipant les gigantesques bases de données
numériques et dont la mémoire hante encore si agréablement son Jardin de
Boulogne-Billancourt… (Lire notre reportage).
Jules Buissonnet |
| |
 |
« La ruée vers l’or » ; Scénario de Luca Blengino &
David Goy ; Dessin de Roberto Meli ; Conseiller historique Farid Ameur, 48
p., Coll. « La véritable histoire du Far-West », Editions Glénat, 2025.
Avec « La ruée vers l’or » de David Goy et Luca Blengino pour le scénario et
Roberto Meli pour le dessin, sans oublier Farid Ameur en tant que conseiller
historique, le lecteur aura l’impression de littéralement plonger au cœur de
l’une des plus fantastiques épopées de l’Ouest américain !
Point de départ en effet du fameux rêve américain, mais aussi de ses
désillusions, cette découverte de filons aurifères à Sutter’s Mill en 1848
eut un retentissement extraordinaire au point d’engendrer littéralement une
fièvre qui gagna des hommes venus de tous les horizons, y compris des plus
lointaines contrées. Le marchand Samuel Brannan contribua à révéler cette
découverte pour mieux en profiter en tant que revendeur de matériels
essentiels à la fouille qu’il revendait cent fois leur prix !
Cette passionnante BD qui adopte une démarche à la fois historique, mais
également attractive avec ces personnages dignes des héros des films de John
Ford, lève le voile sur cette incroyable aventure, à la fois idéalisée et
réaliste. Rien n’est en effet occulté dans ces planches au graphisme soigné
et aux couleurs dignes de l’Ouest américain, le mirage américain laissant
souvent l’impression de multiples exploitations et spéculations. Rythmes
acharnés et fulgurances de tout genre émaillent ce récit informé et
rigoureux tout en laissant place aux anecdotes, à l’humour et aux émotions
de tout genre. Une extraordinaire épopée à revivre « en direct » avec ce
trépidant album !
Jules Buissonnet |
| |
 |
« Bon Vent » de François Ravard ; Préface de ZEP ;
23,5 x 31,2 cm, 96 p., Editions Glénat, 2025.
Ouvrir « Bon Vent » de François Ravard, c’est faire entrer un grand bol
d’air frais de Bretagne. Qui mieux que cet illustre illustrateur sait, en
effet, croquer avec autant de sourire et de poésie cet air iodé à nul autre
pareil ? Comment résister effectivement à ces aquarelles emplies d’humour et
de tendresse, cet alliage précieux de charme et d’espièglerie auquel son
trait et ses couleurs donnent vie pour notre plus grand plaisir… Et dans
cette météo bretonne proposée en une cinquantaine d’aquarelles par François
Ravard, du lever du jour au coucher du soleil sur l’horizon… Que la Bretagne
est belle !
Si tous les âges de la vie - du gamin au petit bateau aux grands-parents
plus râteaux que gâteau, des amoureux transis dans leur ciré aux solitaires
endurcis aux crevettes – si tous y trouvent place, c’est surtout nos
vacances, nos souvenirs, mais aussi un peu de notre jeunesse et de nos
nostalgies que nous retrouvons avec émotion dans ces éclaircies du ciel
breton…
Et avouons qu’en ces mois d’hiver et de turbulences en tout genre, c’est si
bon de s’évader pour une échappée toute de couleurs aquarelles et de
tendresse bretonne avec François Ravard ! Un savoureux recueil à offrir à
tout breton de cœur !
(A noter que ses illustrations sont exposées à la Galerie Alfred à Dinard)
Gilles Landais |
| |
 |
« La Mise à mort du tétras lyre » de David Combet,
288 pages, Editions Glénat, 2025.
Voici un album à nul autre pareil, tant pour la thématique retenue que pour
son style graphique singulier. L’intrigue se concentre sur le personnage de
Pierre, un enfant sensible et rêveur subissant une éducation stricte fondée
sur les valeurs viriles de son père. Très rapidement, le jeune garçon
ressentira un décalage entre ces cadres formels et ses propres aspirations.
Poussé vers la découverte des arts et de la nature, Pierre ne ressent à
l’inverse aucune attraction pour la chasse et la discipline imposées. C’est
ce trouble grandissant d’une personnalité refoulant ses valeurs profondes
qui va tisser le fil de cet album intimiste où la solitude devient le
compagnon des jours et des nuits de cette âme blessée. Parvenu à la
trentaine, Pierre n’est pas – et le pouvait-il ? - un homme accompli,
accumulant déceptions et échecs professionnels. Il lui faudra alors ouvrir
son intériorité et dévoiler ce qu’il avait jusqu’alors refoulé, jusqu’à sa
propre masculinité.
David Combet parvient en ces pages d’une rare sensibilité à aborder des
thèmes souvent tournés en dérision ou occultés, surtout chez un jeune
garçon. A l’image de son personnage central, l’auteur lève les voiles sur
des thèmes des plus actuels, ce que rendent parfaitement les choix
graphiques retenus avec des couleurs alternant entre le monde de l’enfance
et l’univers adulte et qui ne laisseront pas le lecteur indifférent.
Une BD ultrasensible à découvrir !
Jules Buissonnet |
| |
 |
« Ils brûlent – Tome II – Prison et Ciel » d’Aniss
El Hamouri, Editions 6 Pieds sous terre, 2025.
Les fans de Dark Fantasy se réjouiront de découvrir le deuxième volet
de cette trilogie intitulée simplement et mystérieusement « Ils brûlent » ;
un deuxième tome fort attendu pour cette série largement saluée et primée
lors sa sortie et livrant, dans une atmosphère totalement gothique et
fantasmagorique, aux pires périls trois adolescents surnaturels…
Après avoir laissé, dans le tome premier dénommé « Cendre et rivière » et
paru en 2022, Ongl, Pluie et Georg à leur destinée face à Caphyre ou nommé
aussi Le Mage, le deuxième volume revient très habilement sur leur passé, un
monde des plus violents où règnent magie et inquisition et dans lequel ces
derniers vont se débattre corps et âme pour échapper au statut de sorcière…
Pour ce volet, Aniss El Hamourri révélé en 2018 pour « Comme un Frisson »,
et ici, toujours en auteur complet, a laissé libre cours à son imagination
et, il faut le souligner, surtout à son talent… on y retrouve cet univers
plus encore intime et introspectif cher à l’auteur. Côté graphisme, les
planches s’enchaînent à un rythme diabolique dans une dynamique efficace.
Ses dessins au trait exacerbé, et à l’image du scénario, viennent illustrer
à merveille dans de sombres camaïeux bruns, ce climat à la fois fabuleux,
violent et mystérieux qui caractérise cette trilogie menée telle une quête
non seulement de survie mais aussi d’identité.
Une série et surtout un univers en soi à découvrir en attendant le troisième
et ultime tome !
Gilles Landais |
| |
 |
« Boeing C-135 – des ravitailleurs pour l’Histoire »
d’Alexandre Paringaux et Frédéric Lert, Éditions Zéphyr, 2025.
Voici un album qui ne pourra que réjouir les amateurs d’aviation, et plus
spécialement encore celles et ceux passionnés de l’histoire aéronautique et
militaire de la seconde moitié du XXe siècle. Les deux auteurs, Alexandre
Paringaux et Frédéric Lert, grands spécialistes du sujet, nous livrent, ici,
une synthèse richement illustrée qui enchantera les plus exigeants tant
l’information détaillée sur le plan technique rivalise avec la rigueur du
récit historique. Car si le grand public associe la marque Boeing aux
célèbres 707 ou 747, il est une autre catégorie d’avions, certes plus
confidentielle, mais néanmoins déterminante : le C-135. Repensé à partir du
707 civil, le Boeing C-135 a, lui aussi, marqué l’histoire de l’aviation,
non seulement par sa durée d’activité, mais également par son large champ
d’action. Aussi à l’aise dans le ravitaillement en vol que dans la
reconnaissance stratégique, le C-135 sut jouer un rôle important lors de
missions scientifiques et autres transports de personnalités…
Depuis les premiers vols au début des années 1950 jusqu’à nos jours, le
lecteur découvrira dans le détail cette évolution sur le long terme replacée
dans les différents contextes historiques. Agrémenté de superbes
photographies d’époque, ce volume dépasse le simple cadre technique qui
aurait pu être le sien pour replacer cet avion dans un contexte plus général
géostratégique déterminant depuis près de 75 ans.
Jules Buissonnet |
| |
 |
« Tokyo Mystery Café - Tome 2 - Les Ombres de
Jimbocho » par l’ Atelier Sentô (Cécile Brun et Richard Pichard), Éditions
Dupuis, 2025.
Ce deuxième tome de « Tokyo Mystery Café » nous plonge dans l’univers
vibrant du manga et de la BD contemporaine sous l’inspiration de l’Atelier
Sentô, derrière cette vitrine se cache un duo de choc formé par Cécile Brun
et Olivier Pichard ; une association qui a su tirer profit de leur passion
commune pour le Japon.
Pour ce tome 2, nous voici plongés dans un curieux café dans une ruelle
discrète de Tokyo qui s’avère être un lieu singulier où chaque convive, en
plus de déguster une boisson, vient partager un secret ou un mystère,
sources de multiples récits entremêlés… Entre conte urbain et quartier
littéraire de Jimbocho, une enquête sollicitera la curiosité de nos
protagonistes Nahel, Soba et le Patreon, afin de comprendre qui a eu intérêt
à falsifier les pages d’un célèbre magazine de mangas et à commander les
assassinats qui en ont découlé !
Suivant une ligne claire matinée de modernité, ces planches d’une richesse
graphique remarquable parviennent à restituer le charme de certains aspects
de la capitale japonaise, notamment ce contraste entre le cosmopolitisme
foisonnant de Tokyo et l’intimité du café. L’Atelier Sentô réussit avec ce
nouveau tome à approfondir les notions de mystère et l’importance des lieux
participant à cette complexité, une réussite !
Jules Buissonnet
|
| |
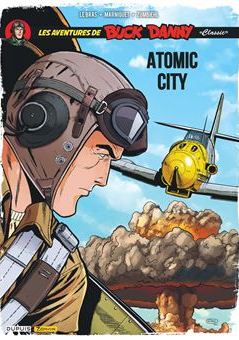 |
« Buck Danny Classic – Tome 12 – Atomic City” ;
Scénario de Frédéric Zumbreihl et Frédéric Marniquet; Dessins d’André Le
Bras ; Couleurs de Valeria Tenaga Romanazzi ; 24 x 32 cm, 48p., Edition
Dupuis / Zéphyr, 2025.
Dans le cycle « Raid sur Los Alamos » signé Le Bras, Marniquet et Zumbiehl,
nous retrouvons Buck Danny, de nouveau en cette année de Guerre froide 1947,
face à l’espion soviétique « L’Ombre rouge » alors que Buck, Tumbler et
Sonny, nos trois pilotes, ont été – rappelons-le - engagés lors d’une
permission sur le tournage d’un film. Pour ce tome 12, dénommé « Atomic City
», L’Ombre rouge qui a pour projet de voler les plans de l’arme atomique,
est prêt pour cela à aller jusqu’à kidnapper le frère de Buck Danny afin de
le contraindre à participer à l’attaque d’Atomic City, Los Alamos… Buck
Danny devra-t-il dès lors trahir son pays pour sauver son jeune frère ?
Pour ce volume qui vient conclure le dyptique « Raid sur Los Alamos », le
lecteur appréciera – comme pour les précédents tomes - les dessins au trait
reconnaissable d’André Le Bras. De leur côté, « les deux Frédéric »,
Frédéric Zumbiehl, ex-pilote de chasse de l’Aéronavale, pilote professionnel
et romancier (un talent que les lecteurs connaissent bien après ses
nombreuses séries consacrées à l’aviation « Rafale Leader », « Luftgaffe
»…), avec pour compagnon de choc, de nouveau, Frédéric Marniquet, régalent
également, ici, comme toujours, leur lecteur en qualité de scénaristes.
Une série qui ravie incontestablement tant par la qualité des dessins que
des scenarii sans oublier les couleurs de Valeria Tenaga Romanazzi !
Gilles Landais |
| |
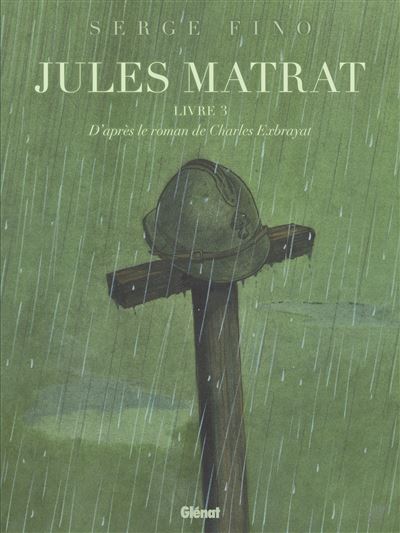 |
« Jules Matrat - Tome 03 » de Serge Fino, d’après
le roman de Charles Exbrayat, Editions Glénat, 2025.
Voici le terme de cette touchante aventure inspirée du roman de Charles
Exbrayat. Après la mobilisation à laquelle notre héros ne portait pas un
enthousiasme particulier, voici venu le temps du retour au pays, après
quatre terribles années passées dans les tranchées à côtoyer l’horreur et la
mort… Totalement transformé par ces évènements – ainsi que toute sa
génération fauchée par ce premier conflit mondial – Jules Matrat rentre chez
lui et aura encore à connaître des épreuves terribles comme la perte de son
fils. Peut-il encore espérer que la vie lui apporte quelque chose de
bénéfique ? C’est à cette dernière question que répond cette émouvante
fresque servie par l’art et le talent de Serge Fino qui parvient, avec
finesse, à esquisser sans emphase la perte progressive des repères du héros
principal que seule Rose, sa compagne, peut encore aider. La sobriété des
regards et des silences, la force de ces paysages de Haute-Loire irradiés
d’une lumière qui renforce l’intensité du récit contribuent à faire de ce
dernier tome un moment rare d’introspection et d’humanité que vient
souligner encore la présence symbolique du chien.
Une BD historique à partager entre générations.
Jules Buissonnet
|
| |
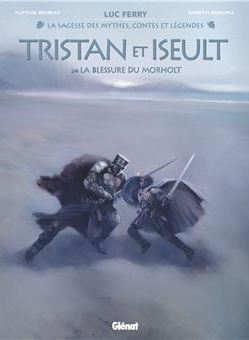 |
« Tristan & Iseult - Tome 2 – La blessure du
Morholt » de Clotilde Bruneau et Luc Ferry (scénario), Giuseppe Baiguera
(Dessinateur), Collection La Sagesse des Mythes, 48 p., 24 x 32 cm, Editions
Glénat, 2025.
Qui ne s’est jamais ému à l’évocation de la grande fresque de Tristan et
Iseult, monument de l’épopée médiévale ? La désormais classique collection
La Sagesse des Mythes a, bien entendu, ouvert ses colonnes à ce beau récit
épique, et dont le deuxième tome vient de paraître.
Tristan ne recule devant rien pour prouver sa bravoure et son amour. Notre
héros se trouve réfugié au château de Tintagel où il a tout le soutien de
son oncle le roi Marc. Un féroce combat va alors l’opposer au terrible
guerrier irlandais le Morholt au cours duquel Tristan triomphera, mais sera
grièvement blessé par la lame empoisonnée de son adversaire. C’est le début
d’une longue série de dangereuses péripéties qui le conduiront vers son
amour pour la jeune princesse Iseult…
Autant prévenir le lecteur : ce nouveau tome parvient, grâce au scénario
idéalement conçu par Clotilde Bruneau et Luc Ferry, à perpétuer le souffle
épique de cette éternelle histoire d’amour. Servie par un dessin incisif et
inspiré de Giuseppe Baiguera (remarqué notamment pour « Mocambique Blues »
et « Midway »), cette BD met en avant ce qui en constitue le fil directeur :
l’esprit chevaleresque et l’amour courtois. En effet, le courage et la
bravoure seront les qualités indispensables pour Tristan afin de surmonter
ces épreuves inimaginables dont nos auteurs nous laissent avec brio un petit
aperçu… avant de poursuivre, pour le plaisir des lecteurs, avec les deux
tomes suivants !Jules Buissonnet |
| |
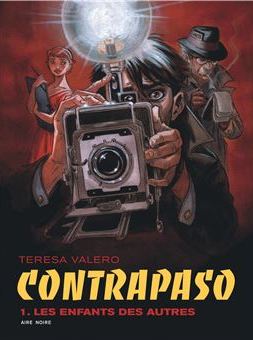
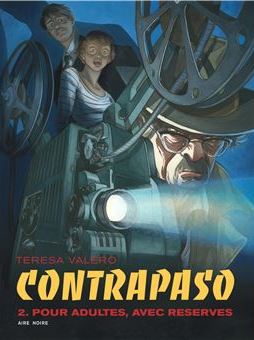 |
« Contrapaso » - Tomes 1 et 2 de Teresa Valero,
Coll. « Aire Noire », Dupuis éditions, 2025.
La dessinatrice et scénariste d’origine espagnole Teresa Valero s’est fait
remarquer depuis longtemps déjà pour la qualité de son graphisme et la
profondeur de ses analyses sociales. « Contrapaso » dont les tomes 1 et 2
viennent d’être édités dans la collection Aire Noire aux éditions Dupuis
confirment une nouvelle fois cette acuité à porter un regard digne de
meilleures enquêtes sociales, ici, sur l’Espagne de Franco.
Le premier tome s’ouvre sur le contexte plus que troublé de l’Espagne
franquiste à Madrid en 1956, lorsque deux journalistes au caractère opposé
s’associent afin d’enquêter sur la disparition mystérieuse de femmes pendant
la dictature… Cet univers pesant, et souvent macabre, conduira nos
enquêteurs vers de terribles révélations quant au sort des enfants de
Républicains…
Teresa Valero par son style graphique puissant et souple à la fois parvient
à se saisir, sans pathos, de ces épisodes sombres du fascisme et de cette
tragédie souvent méconnue ou tue. Un regard dramatique qui se poursuit sans
faiblir dans le tome 2 et le milieu du cinéma espagnol sous la férule de
l’idéologie franquiste. Nos deux journalistes, Sanz et Lenoir, croisent de
nouveau pour ce deuxième volume le terrible serial killer en une ambiance
digne des meilleurs films noirs…
Ce polar historique qui ne cède en rien à la facilité retiendra l’attention
des amateurs de récits poignants et engagés, une réussite.
Jules Buissonnet |
| |
 |
« SuperGroom - Tome 3 - La stratégie Gaïa » de
Vehlmann et Yoann, Editions Dupuis, 2025.
Nous revoici aux JO !... mais cette fois-ci en compagnie de notre héros
Spirou qui se cache sous l’identité de Supergroom, une nouvelle identité
dont seul le comte de Champignac a eu connaissance… En fait de JO, il s’agit
plus précisément de la World Olympic War réunissant les Superhéros sous
l’organisation d’un mystérieux clown… Mais il ne s’agira pas d’une ballade
de santé pour notre fameux personnage dans ce tome final puisque la Centaure
se sachant condamnée souhaite emmener en un voyage sans retour un certain
nombre de ses collaborateurs, mais aussi son pire ennemi : Supergroom !
C’est un curieux dénouement qui attend alors Spirou, alias Supergroom, sans
oublier le lecteur qui se retrouvera, lui aussi, pris dans les affres de ce
piège tendu…
Afin de maintenir tout le suspense promis par ce troisième tome intitulé «
La Stratégie Gaïa », nos auteurs, Fabien Vehlmann et Yoann, n’ont pas ménagé
leurs efforts en proposant un récit aussi haletant qu’assourdissant, les
effets spéciaux n’étant pas comptés, à l’image du 7e art ! Une climatisation
« plus froide » que nécessaire, des hypertechnologies aux robots remplis
d’acide et autres armures Gaw-Gaw, le futur ne semble guère engageant…
Quelle sera l’issue de cette trépidante aventure ? Le lecteur n’aura qu’une
hâte : la découvrir tout au long de ces 88 pages qui coupent littéralement
le souffle!
Jules Buissonnet
|
| |
 |
« La tête de mort venue de Suède » de Daria
Schmitt, coll. « Aire Libre », Editions Dupuis, 2025.
Voici une bien curieuse histoire ! Celle du crâne du philosophe et homme de
sciences René Descartes, un crâne faisant partie des collections de la
galerie d’Anatomie comparée du Jardin des Plantes à Paris… Nous sommes dans
les années 1930 et ce trésor de la collection Georges Cuvier se met
étrangement à dialoguer avec ses voisins ossements… Le doute le ronge, au
sens propre comme au figuré, et les restes honorables de notre vénérable
philosophe se trouvent soumis aux multiples questionnements sur son identité
!
Mêlant enquête historique et digressions fantastiques, Daria Schmitt que
l’on ne présente plus et dont le trait inspiré lui a valu prix et
reconnaissances, notamment pour « Le bestiaire du crépuscule », signe avec
cet album une belle réflexion sur les frontières entre science et
philosophie, fantastique et réalité. Par son approche sensible, cette BD
alternant noir & blanc crépusculaire et touches parcimonieuses de couleurs
happe le lecteur en un maelström passionnant !
Un récit saisissant en un décor frissonnant de musée…
Jules Buissonnet |
| |
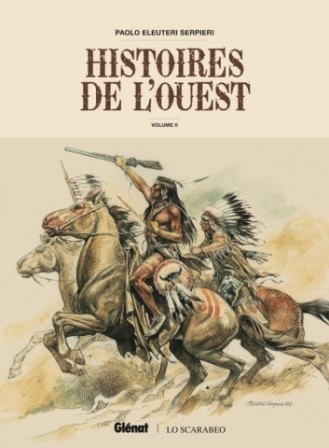 |
« Histoires de l'Ouest - Volume 02 » de Paolo
Eleuteri Serpieri ; 21,5 x 29,3 cm, 352 p. , Editions Glénat, 2025.
Voici publiée la suite de ces formidables histoires de l’ouest conçue par
Paolo Eleuteri Serpieri, bien connu des amateurs de BD et dont l’imagination
foisonnante s’est portée sur l’un de ses thèmes de prédilection : l’univers
du western. Cette fresque collant aux faits historiques transporte le
lecteur dès ses premières histoires, notamment celle intitulée « Chaman »
qui ouvre ce fort volume (352 pages). Avec une abondance de plans larges et
serrés à la manière du cinéma, l’auteur a recours à un dessin bien
spécifique d’une précision redoutable ainsi qu’à un coloris propre à lui
(certains récits sont quant à eux en noir et blanc). Cet album tient à la
fois d’une évocation enlevée de ces civilisations qui ne surent s’entendre
et parallèlement d’un récit incarné à partir de personnages qu’il sait
rendre avec un luxe de détails. Multiples cavalcades et autres embuscades
émaillent ces courts récits hauts en couleur où la force des éléments se
dispute avec celle de la haine exacerbée de deux peuples que tout opposa.
Entre enquêtes ethnographiques renseignées par une abondante recherche
documentaire et historique et un art de la fiction inspirée, Paolo Eleuteri
Serpieri réussit avec ces « Histoires de l’Ouest » un tour de force que seul
le 7e art a égalé !Jules Buissonnet |
| |
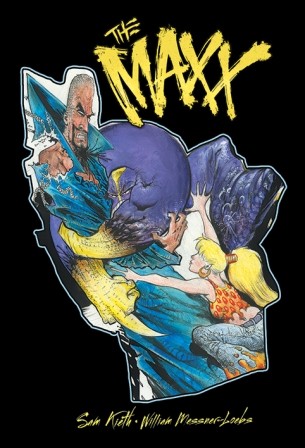 |
« The Maxx – Tome 5 - Sam Kieth », Editions
Reflexions, 2025.
The Maxx est un phénomène de société depuis 1993. Publiée à l’origine par
Image Comics, cette série s’articule autour d’un anti-héros un brin
difforme, plutôt SDF et à cheval entre deux mondes… Entre réalité urbaine et
domaine du rêve, son cœur balance… et celui du lecteur également !
Les coups ne manquent pas et la dimension psychologique de ce cinquième tome
devient de plus en plus prégnante, une réussite. Maxx, Julie, Sarah, nous
emportent chacun dans leur propre univers et Sam Kieth, l’auteur, n’a pas
son pareil pour en décliner toutes les variations, notamment quant aux
thèmes de la mémoire et de la culpabilité, et ce, grâce à un style graphique
bien à lui. Le graphisme de Kieth est, en effet, reconnaissable
immédiatement avec ses visages à la Francis Bacon, ses distorsions
traduisant les mouvements de l’âme jusqu’à l’angoisse. Introspection et
humour grinçant alliés à une richesse graphique quasi expressionniste sont
les traits marquants de ce cinquième tome qui ne laissera pas son lecteur
indemne…
Jules Buissonnet
|
|
|
 |
« Blanche » de Maëlle Reat avec Lolita Couturier
pour les couleurs ; 19,8 x 26,6 cm, 256 p., Éditions Glénat, 2025.
C’est un roman graphique poignant, tiré d’une histoire vraie, que nous donne
aujourd’hui à lire Maëlle Reat avec cet album dénommé « Blanche » tout
simplement.
Blanche collectionne les anges – les anges blancs, et cette obsession de
désinfecter encore et encore la maison ; Infirmière, divorcée, elle élève
seule ses enfants, dont cette adolescente à qui elle va révéler un lourd
secret, ce secret qu’elle porte depuis les années 1980, depuis 30 ans… Car
Blanche, cette mère si dévouée, sera à 19 ans l’une des premières victimes
du VIH ; se reconstruisant, refaisant sa vie, menant à bien ses grossesses,
Blanche a mené un combat de tous les jours, sans merci, contre la maladie,
mais aussi contre le corps médical, contre la société, contre elle-même
aussi et ses propres doutes ; C’est toute cette vie, sa vie et ce combat à
la vie, à la mort, qu’elle a vécus dans sa chair avec tant d’autres
également atteints du VIH ou d’hépatite que Blanche va raconter dans ces
pages à sa fille…
Un roman graphique puissant portant témoignage de ces années où le virus,
encore peu connu, était synonyme de nombre de préjugés ; De ces années où,
lorsque vous aviez le VIH, rien ne vous était épargné, ni les traitements
lourds et incertains, ni surtout les regards, préjugés et questions
inopportunes… Accompagnés, pour les couleurs, de Lolita Couturier et un
graphisme voulu parfois tel un cri de désespoir ou d'indignation, ce sont
des dialogues et dessins qui claquent souvent, emplis d’âpreté et de toute
l’incompréhension de ces années que l’on nomma sans aucune retenue ou
décence « les années Sida », titre que retient pour ce roman graphique
Maëlle Reat, déjà connue chez Glénat pour sa participation au collectif «
Mafaida, Mon Héroïne » paru en 2024.
Mais, Maëlle Reat, en auteur complet (ou presque…), transmet aussi et
surtout avec ce récit très personnel, un message d’espoir et de vie.
Gilles Landais |
|
|
 |
« Plus loin qu’ailleurs » de Christophe Chabouté ;
21.5 x 29.3 cm, 152 p., Editions Vents d’ouest, 2025.
On ne résiste jamais à un Chabouté ! Après « Yellow cab » en 2021 largement
récompensé et « Musée » en 2023 primé également, Chabouté nous invite
aujourd’hui à le suivre « Plus loin qu’ailleurs »… et à aller avec son
héros, Alexandre, jusqu’aux quatre coins de la rue pour y sonder
l’inépuisable banalité et à en saisir l’ultime poésie…
Lorsque qu’on rêve de partir, mais que l’on est contraint de rester, alors
il reste au rêveur de « Partir en restant »… « Partir en restant »,
traverser la nuit la rue, tel est le maître mot de cet album mené comme un
carnet de voyage, fait de collages et de ciseaux, et offrant à son lecteur
cette aventure à nulle autre pareille, celle d’un incroyable quotidien où
sont convoqués tant l’insolite que l’improbable. Pour ce rêveur d’ailleurs,
tout fait signe, surprend, étonne, car Chabouté attrape dans son filet la
poésie du quotidien, l’observe et la relâche pour mieux l’offrir encore à
son lecteur… un récit tout de noir & blanc comme pour mieux en saisir les
couleurs… et un graphisme aussi épuré qu’expressif à la Chabouté ! Un régal.
Chabouté, à n’en pas douter, nous entraîne « Plus loin qu’ailleurs », et
quel merveilleux voyage !
Gilles Landais |
| |
 |
« Downlands » de Norm Konyu ; Traduit de l’anglais
par Patrice Louinet ; 18.5 x 28.3, 304 p., Editions Glénat, 2025.
C’est une belle et touchante histoire que nous conte Norm Konyu dans ce
roman graphique dénommé « Downlands » : Celle de James, jeune adolescent de
14 ans, qui hanté par les dernières paroles de sa sœur jumelle et un étrange
présage va, pour tenter de les comprendre, explorer avec l’aide de sa vielle
voisine surnommée « la sorcière » les croyances et légendes de ce village du
sud de l’Angleterre… Il est vrai que chaque village a ses histoires et sa
propre mémoire ; qui, au fond de lui, l’ignore vraiment ?
On l’aura compris l’auteur Norm Konyu (plus connu jusqu’à présent en sa
qualité d’animateur) livre, ici, un roman graphique aussi captivant
qu’envoûtant. Deuxième roman graphique après « l’Appel à Cthulhu » et
premier coup de maître chez Glénat, « Downlands » entraine le lecteur dans
des contrées insoupçonnées alliant à la fois le deuil, l’introspection et
l’extraordinaire … Des univers inquiétants et mystérieux entre récit
d’apprentissage et récit fantastique idéalement rendus par les fabuleux
dessins d’une naïveté déconcertante de Norm Konyu. Un graphisme rehaussé,
qui plus est, par une belle palette de couleurs et une aussi superbe
qu’efficace mise en planche.
Un deuxième coup de maître dans le monde de la BD qui vient indéniablement
confirmer le talent de Norm Konyu !
Gilles Landais |
| |
 |
« Système solaire – Tome 4 – Uranus ; Le Cristal
bleu » ; Scénario de Bruno Lecigne ; dessins d’Alberto Foche Duarte ;
Couleurs de ; 24 x 32 cm, Editions Glénat, 2025.
Avec ce 4e tome consacré à la planète Uranus, Glénat poursuit – après Mars,
Jupiter et Saturne, son exploration du système solaire ; Une série
didactique largement saluée du public lui permettant de découvrir avec la
collaboration de L’Observatoire de Paris, notre système solaire, planète
après planète. Ici, c’est Bruno Lecigne, auteur prisé de SF, qui en écrit le
scenario, embarquant ses lecteurs vers « Uranus - Le Cristal bleu » à bord
d’un vaisseau spatial avec une équipe de scientifiques terriens et des
extraterrestres…
Mais alors, que le vaisseau approche de la fameuse planète glacée bleue,
cette boule de gaz gelé faisant pas moins de quatre fois la taille de la
terre, d’étranges perturbations apparaissent mettant en danger tout
l’équipage… Nos scientifiques terriens pourront-ils revenir indemnes de leur
mission vers Uranus, la 7e planète de notre système solaire ?
On ne présente plus Bruno Lecigne, cet essayiste, scénariste et écrivain de
polar et romans de science-fiction. Pour ce volume de pure conquête et
découverte spatiales, l’auteur a su allier suspens et mystère aux
connaissances actuelles sur le système solaire. Avec pour acolytes, Alberto
Foche Duarte pour les dessins, Flavia De Vita et Mauro Gulma pour les
couleurs, c’est à une incroyable et instructive croisière en orbite vers
celle que l’on appelle « La planète bleue » que nous offre Bruno Lecigne.
Des dessins, en effets, hors pesanteur et laissant place à l’imagination…
Avec ce volume que complète en fin d’album un riche dossier sur Uranus,
l’auteur régale une nouvelle fois ses lecteurs !
Gilles Landais |
| |
 |
« Frankenstein – Au nom du père » d’après l’œuvre
de Mary Shelley ; Scénario de Marco Cannavo ; Dessins et couleurs de Corrado
Roi ; 24 x 32 cm, Editions Glénat, 2025.
C’est un Frankenstein revisité que nous proposent aujourd’hui de découvrir
les éditions Glénat avec cet album signé Cannavo et Corrado Roi. Un one-shot
librement adapté de l’œuvre de Mary Shelley (1797-1851), œuvre que la
romancière anglaise écrivit à Genèvre au début du XIXe siècle encouragée par
son ami Lord Byron et qui sera publiée en 1818. Depuis, « Frankenstein ou Le
Prométhée moderne », son titre exact, n’a eu de cesse d’ensorceler et de
nourrir toutes les imaginations…
Ici, pour cette nouvelle adaptation par ce duo - Marco Cannavo et Corrado
Roi - déjà connu pour « Dracula ou L’ordre du Dragon » dans la série « Les
Classiques de l’horreur », le dessinateur italien Corrado Roi a fait le
choix du lavis noir et blanc pour des dessins sublimes, saisissants
d’horreur et d’effroi. Un graphisme ensorcelant des plus réussis, que l’on
ne peut que saluer, d’un réalisme époustouflant et fantasmagorique à souhait
mettant parfaitement en valeur le scénario libre et sombre signé Marco
Cannavo. Marco Cannavo connu dans le monde de la BD depuis plus de 10 ans
maintenant a opté, en effet, pour une relecture volontairement libre et
audacieuse de cette œuvre devenue un classique, redonnant ainsi un souffle
plus sombre à l’œuvre initiale.
Bien sûr, on y retrouvera la problématique majeure, à savoir la relation
étroite entre le créateur et « sa » créature, confrontée aux limites de la
science. Un thème qui n’a, au XXIe siècle, à l’heure des robots et de l’IA,
pris aucune ride ! Notons, enfin, que le lecteur découvrira avec profit en
fin de volume un dossier sur l’histoire de l’œuvre, sur cette fascination ou
mythe de Frankenstein qui n’a jamais cessé depuis deux cents ans alimentant
notamment le 7e art.
Gilles Landais
|
| |
 |
« Le Cahier à spirale » de Didier Tronchet, 192 p.,
Editions Aire Libre, 2025.
Didier Tronchet poursuit avec ce dernier volume – « Le Cahier à spirale »,
son introspection, une introspection à nulle autre pareille, aussi inventive
que captivante… Car loin, d’un journal intime, Didier Tronchet n’oublie
jamais qu’il écrit pour nous, lecteur !
Ici, c’est effectivement avec un « Cahier à spirale » en main que le génial
auteur a décidé de chercher qui se cache derrière tous ses personnages –
Jean-Claude Tergale ou encore Raymond Calbuth… - qu’il n’a eu de cesse
d’inventer et de faire vivre jusqu’à cette frontière diaphane où le vrai et
le faux se fondent et se confondent… « Et finalement, je me suis dit que je
n’avais qu’à sauter dans le vide et assumer mon histoire » avoue-t-il.
Une dimension introspective, passant d’ici à là, qui le mène en ces pages
dans le Nord (plus loin peut-être encore…) à questionner sa mère, à revenir
sur le décès de ce père disparu trop tôt et sur ces secrets et non-dits qui
l’ont accompagné tout au long de ses albums pendant 40 ans de carrière, sans
oublier – cela serait trop simple ! - ce personnage imaginaire, éditeur,
plus enclin pour sa part à la fiction qu’au réel et révélant à sa manière «
(…) notre besoin d’histoires et de récits pour éclairer le réel et en
révéler quelque chose. », confie encore Didier Tronchet.
Par ce récit graphique touchant, aux couleurs et mises en pages débridées,
Didier Tronchet clôt avec brio et doigté cette trilogie introspective
commencée en 2020 avec « Le Chanteur perdu » suivi de « L’Année du fantôme
».
Gilles Landais
|
| |
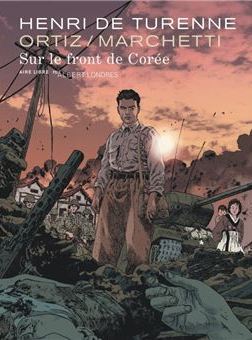 |
« Sur le front de Corée » de Stéphane Marchetti et
Rafael Ortiz, Coll. Aventure Histoire, 120 p., Aire Libre, 2024.
La guerre de Corée, moins connue que les conflits mondiaux précédents du XXe
s, fut pourtant un évènement des plus meurtriers sur fond de guerre froide.
C’est le thème retenu pour cette adaptation remarquable en BD des reportages
d’Henri de Turenne, lauréat du prix Albert Londres en 1951. Ce roman
graphique est signé Stéphane Marchetti pour le scénario, ce dernier ayant
lui-même reçu ce prix pour son documentaire sur Rafah en 2008. Avec Rafael
Ortiz, talentueux dessinateur argentin, nous voici bringuebalés sur les
routes chaotiques du Sud-est de la Corée, un 31 août 1950… Après un périple
éprouvant qui n’était qu’une introduction aux épreuves à venir, le groupe
des cinq correspondants de la presse internationale prend contact avec les
dures réalités de ce conflit fratricide aux enjeux internationaux opposant
la Corée du Nord communiste à la Corée du Sud soutenue par les États-Unis…
Véritable immersion dans l’univers complexe de la propagande militaire et de
la désinformation, « Sur le front de Corée » plonge le lecteur au cœur du
métier de reporter de guerre, avec ses scènes de combat et ses précieux
instants de fraternité, rendus avec sensibilité par nos deux auteurs. Le
trait incisif et sans concessions de Rafael Ortiz n’écarte aucune des dures
réalités de ce conflit injustement trop souvent oublié, alors même que
l’actualité nous le rappelle régulièrement, et que cet album permettra de
mieux comprendre.
Jules Buissonnet |
| |
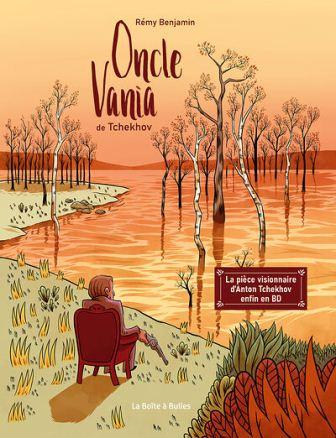 |
« Oncle Vania » de Rémy Benjamin d’après l’œuvre
d’Anton Tchekhov traduite du russe par André Markowicz et Françoise Morvan ;
Editions La Boite à Bulles, 2025.
La Boite à Bulles nous réjouit, une fois de plus, avec cette adaptation en
BD très réussie de la célèbre pièce de Tchékhov : « Oncle Vania », une
première ! Une adaptation d’après une traduction d’André Markowicz et
Françoise Morvan ; Signé, ici, en auteur complet, Rémy Benjamin, connu pour
son écriture et ses fabuleuses couleurs, et que nous avions déjà salué en
2010 pour « Un Jour sans fin » avec Olivier Perret (Ankara).
L’œuvre de l’écrivain russe parue en 1897 met en scène quatre personnages
principaux : Sonia, fille du professeur Sérébriakov, qui mène avec son oncle
Vania une vie paisible, gérant à eux deux le domaine familial. Mais,
l’arrivée du vieux professeur Sérébriakov accompagné de sa seconde, jeune et
belle épouse, Eléna, va bouleverser ce fragile équilibre dans lequel
s’invite également Astrov, médecin misanthrope, grand amoureux de la nature
et dont Sonia est secrètement amoureuse… Un univers qui bascule au gré des
passions avec pour point d’orgue le désir du vieux professeur de vendre le
domaine…
Pour cette adaptation en BD, Rémy Benjamin a retenu et idéalement mis en
lumière les points forts de cette pièce qui fut jouée pour la première en
1899 au théâtre de Moscou avec dans le rôle d’Elena, Olga Knipper, future
épouse de Tchékhov (1860-1904). Une œuvre dramatique qui n’a rien perdu de
son actualité et de sa force avec des thèmes existentiels majeurs tel que le
sens de la vie, le bonheur, les illusions, les échecs ou encore « l’écologie
»…
Avec des traits et personnages épurés mais non dénués – loin de là -
d’expression, cet album de plus 140 pages offre une mise en scène graphique
et des jeux de couleurs efficaces, traduisant avec un talent certain
l’univers de Tchekhov. Car c’est bien cet univers bien particulier de
l’écrivain russe, à la fois dénué d’action, sans héros, où les silences sont
plus forts que les mots, et pourtant si prégnant et absolument captivant que
retrouvera le lecteur de cet album soigné.
Comment dès lors ne pas en recommander la lecture !
Gilles Landais |
| |
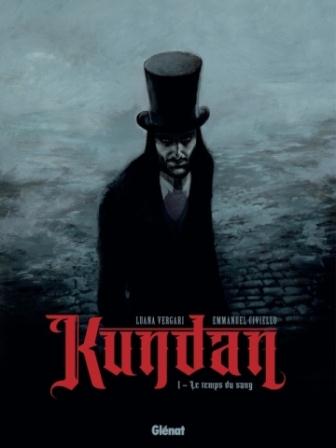 |
« Kundan – Tome 1 – Le temps du sang » ; Scénario
Luana Vergari ; Couleur et dessin de Civiello Emmanuel ; 24 x 32 cm, 64 p.,
Editions Glénat, 2025.
A ne pas manquer, ce tout premier volet de cette incroyable trilogie signée
Luana Vergari qui rejoint avec cet album les éditions Glénat en duo, ici,
avec Civiello Emmanuel !
En cette année 1910, Lord Benedict de la Brigade de nuit épaulé d’un nouvel
agent nommé Kundan ne peut que constater, dans une ruelle de Londres, cette
terrible et sordide scène : le corps d’un garçonnet retrouvé mort et
étrangement vidé de son sang… un crime des plus horribles qui
malheureusement va se répéter, inquiétant au plus haut point les Londoniens
et favoriser les plus folles rumeurs… N’est-il pas connu qu’en Inde, une
légende raconte qu’alors qu’un massacre opposa la déesse Durga et ses
prêtresses à de sanguinaires vampires, un jeune enfant survécut… Une légende
qui va prendre toute sa valeur dès lors que Lord Benedict sera envoyé en
Inde pour enrayer une rébellion et protéger la fille du roi ; il ne
demandera qu’une seule faveur : être accompagné de du fameux Kundan… nul
doute que le sang, une fois de plus…
Avec une imagination des plus débridées, Luana Vergari livre un premier
album aussi captivant qu’angoissant alliant enquête policière, héritage
vampirique et victorien de Bram Stoker aux légendes et bestiaire indiens.
Une atmosphère oppressante entre les sordides ruelles de Londres et la
chaleur des Indes coloniales rendue fabuleusement à la fois par les couleurs
choisies et soignées sans oublier les dessins réalistes et fantastiques de
Civiello Emmanuel. Une merveille ! Un dessinateur déjà salué chez Glénat
pour le fameux « Conan le Cimmérien » avec Doug Heading en 2021.
Un duo et un premier tome, donc, dès plus réussis qui ne peut laisser le
lecteur qu’impatient de découvrir la suite de cette nouvelle série
vampirique nommée « Kundan » !
A noter, enfin, pour la première édition le fabuleux Cahier graphique en fin
d’album.
Gilles Landais
|
| |
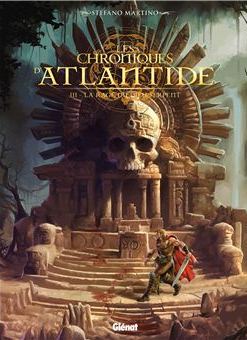 |
« Les Chroniques d’Atlantide- Tome 3 – La Rage du
Dieu serpent » ; Scénario et dessin de Stephano Martino ; Couleur de
Sébastien Bouet ; Consultante scénario : Théa Roizman ; 24 x 32 cm, 72 p.,
Editions Glénat, 2025.
Ce dernier et ultime tome de la fameuse série fantasy : « Les Chroniques
d’Atlantide » devrait retenir l’attention de tous les Bdphiles ! Son titre –
La rage du Dieu Serpent - en donne en effet le « la » ! Après la probable
mort d’Eoden, son frère Leoden et la Reine Naeel ne peuvent que mener combat
contre Thorunn. Mais si une probable victoire pour Leoden se profile, sa
perte ne semble pas non plus devoir être écartée…
Les aficionados des « Chroniques de l’Atlantide » retrouveront avec bonheur
pour ce dernier volume tous les ingrédients qui ont fait le succès de cette
trilogie revisitant le mythe de l’Atlantide : sorcellerie, intrigues en tous
genres, rebondissements infinis avec même des flashbacks revenant sur les
ancêtres des protagonistes…
Pour ce combat final, Stefano Martino a, quant au scénario, manifestement
fait preuve d’une imagination débridée servie, ici, merveilleusement par son
talent de dessinateur, talent reconnu également et largement salué dans la
série « Les Forêts d’Opales. Le lecteur appréciera indéniablement la force
de ses dessins mêlant expressivité, réalisme et fiction sans oublier les
couleurs de Sébastien Bouet.
Gille Landais
|
| |
 |
« Pitcairn – l’Île des révoltés du Bounty – Tome 4
– Sauver nos âmes » ; Scénario de Mark Eacersall avec en coauteur Sébastien
Laurier ; Dessin et couleur de Gyula Németh, 24 x 32 cm, 56 p., Editions
Glénat, 2024.
Nous retrouvons ce dernier tome – tant attendu, de « L’Île des révoltés du
Bounty » qui vient clore une série plus que plébiscitée tant pour sa qualité
graphique que pour l’extrême soin apporté aux recherches et renseignements
qu’a pu nécessiter ce récit, fruit en effet d’années de recherches et
d’enquêtes rigoureuses confrontant légendes, mythes et réalité…
Une histoire – est-il besoin de le rappeler, véridique, adaptée ici de
l’ouvrage de Sébastien Laurier – « La Bounty à Pitcairn » ; Prix du livre
insulaire de 2017 – et coauteur pour cette série avec Mark Eacersall ( chez
Glénat : « Tananarive », « Cristal 417 » et plus récemment « A mourir entre
les bars de ma nourrice »).
On l’aura compris ce quatrième et ultime tome « Sauver nos âmes » vient
clore une BD d’une extrême qualité que mettent parfaitement en valeur les
dessins extraordinaires aussi naturalistes que réalistes du dessinateur
hongrois Gyula Németh qui en signe également la colorisation, d’une beauté
et force époustouflante ! Une première pour Gyula Németh dans le monde de la
BD française que l’on ne peut que saluer et espérer retrouver très bientôt…
Un album ultime qui vient clore une série assurément magistrale.Gilles Landais |
| |
 |
« Franquin et moi - Entretiens avec Numa Sadoul » de Christelle
Pissavy-Yvernault et Numa Sadoul, Coll. »Les Cahiers de la Bande Dessinée »,
Editions Glénat, 2024. Les passionnés de BD – et
tout particulièrement de la légende de la bande dessinée franco-belge – se
réjouiront de ces « Entretiens Franquin et moi » parus aux éditions Glénat.
Cette captivante somme propose en effet d’explorer dans un dialogue nourri
l’intimité de ce maître de la BD qui donna vie à des œuvres majeures telles
que « Gaston Lagaffe », « Spirou » sans oublier « Idées noires ». Numa
Sadoul, critique et essayiste reconnu, a recueilli dans cet ouvrage le
précieux témoignage de Franquin (1924-1997) dès les années 70. Grâce à cette
relation de confiance entre les deux hommes, la personnalité riche et
complexe du dessinateur belge se dévoile au fil de ces pages enrichies d’une
abondante iconographie. Cette richesse, où l’humour pointe de manière
récurrente, n’écarte pas pour autant les aspects plus sombres de la
psychologie de Franquin, notamment son regard critique et parfois pessimiste
sur le monde. Au-delà des anecdotes qui auraient pu à elles seules justifier
un tel volume, ce recueil d’entretiens dévoile au lecteur de précieuses
confidences de cette personnalité décidément complexe disparue au tournant
du siècle dernier en 1997.
Les différentes étapes de son travail, le mécanisme de la création et
l’héritage légué aux jeunes générations offrent ainsi une trame captivante
sur ce métier de la BD. Dessins inédits et croquis accompagnent ces propos
sur l’art graphique et le neuvième art.
Une somme incontournable et précieuse pour tous passionnés de BD.
Jules Buissonnet |
| |
 |
« George Washington » ; Scénario de Wyctor ; Dessin
de Michael Malatini ; Historien : Farid Ameur ; 24 x 32 cm, Editions ayard
et Glénat, 2024.
Incontournable, cet album consacré au 1er président des
États-Unis d’Amérique : George Washington (1732-1799). Certes, nous
connaissons son nom et la ville de l’est américain portant encore son
patronyme de nos jours, mais son histoire demeure néanmoins en France, il
faut l’avouer, bien moins connue. Aussi cette BD est-elle bienvenue ; Et ce,
d'autant plus qu'elle est signée pour le scénario, Wyctor, et Michael
Malatini pour les dessins, auteurs biens connus pour leur succès dans cette
collection « Ils ont fait l’Histoire ».
Georges Washington sera réputé, avant sa carrière en politique, en tant que
militaire. En ce milieu du XIXe siècle, l’est des Est-Unis est en effet
encore sous domination britannique ; néanmoins sous la pression qu’exerce
l’empire sur ces treize colonies, un vent de révolte va commencer à souffler
aboutissant à la fameuse guerre d’indépendance. George Washington sera alors
en 1875 nommé à la tête de l’armée continentale… La légende du Virginien
commence, il vaincra les Tuniques rouges et sera élu quelques années plus
tard, en 1789, 1er président des États-Unis d’Amérique.
Grâce à des dessins d’un beau réalisme et un scénario serré, les auteurs
livrent, ici, un George Washington au caractère trempé, véritable héros
américain, mais demeurant néanmoins humain, laissant l’homme apparaître
derrière sa légende.
Les lecteurs auront effectivement plaisir à (re)découvrir cette grande page
de l’histoire par cette BD signée Mikael Malatini et Wictor, rédacteur
adjoint de la revue « Historia » et membre de la Société des Explorateurs
français ; un album particulièrement bien documenté et informé, notamment
sous la vigilance de Farid Ameur, historien, docteur en histoire
contemporaine et spécialiste des États-Unis qui signe le dossier « Ils ont
fait l’Histoire » en fin d’album.
Gilles Landais
|
| |
 |
« Les Tuniques Bleues – De l’or pour les Bleus –
N°68 » ; Scénario de Fred Neidhart ; Dessin de Willy Lambil, Dupuis, 2024.
Pour ce 68e album des Tunique Bleues, c’est Fred Neidhart qui en signe le
scénario (rappelons que l’on doit déjà à Fred Neidhart en 2020 le salué «
Spirou chez les Soviets »). Ici, c’est un scénario qui commence par une
honorable promesse pour nos Tuniques Bleues. Fred Neidhart, après un tout
début des plus classiques, a choisi de relater une promesse ou méprise qui
va déboucher sur une incroyable aventure pour le caporal Blutch et le
sergent Chesterfield, mieux encore que la ruée vers l’or !
En effet après avoir entendu les dernières volontés de deux soldats
sudistes, nos deux comparses se dirigent vers le Sud… déguisés en Mexicains
! Bien mal leur a pris, car ils vont alors être pris pour les Confédérés
décédés et sont entraînés dès lors dans une extraordinaire histoire secrète
d’or… Mettront-ils la main sur ce fabuleux butin ? Dans le Sud, et qui plus
est, flanqués du fils du fameux général Lee, rien n’est moins sûr !
On l’aura compris, c’est un scénario en or que signe avec ce nouveau tome
Fred Neidhart avec en duo, toujours pour les dessins, notre infatigable
Willy Lambil. Une aventure dans laquelle les mauvaises rencontres et les
péripéties en tout genre se succèdent à un rythme effréné jusqu’à la
dernière planche. Action, rebondissements et humour sont assurément au
rendez-vous pour ce 68e album, sans oublier les décors et couleurs très
réussis.Gilles Landais |
| |
 |
« Calamity Jane » ; Scénario de Marie
Bardiaux-Vaïente ; Dessin de Gaëlle Hersent ; Conseiller historique Farid
Ameur, Editions Glénat – Fayard, 2024.
Qui ne connaît pas le nom de Calamity Jane ?! Même les plus réfractaires au
genre western ont en mémoire ce surnom devenu célèbre et attribué à Martha
Jane Cannary, femme libre avant l’heure en plein XIXe s. américain.
C’est à ce mythe, pourtant bien réel, auquel s’attache avec brio cet album
retraçant les frasques de cette héroïne des plaines. L’aventurière fut
toujours éprise de liberté, ainsi que le souligne le captivant scénario de
Marie Bardiaux-Vaïente qui fait débuter cette histoire par une scène épique
où Calamity Jane évoque ses faits héroïques – plus ou moins avérés – contre
un verre à boire dans un saloon du Dakota du Sud… ll faut avouer que
Calamity Jane a fait tous les métiers, ne s’encombrant pas des conventions
sociales qu’elle s’amuse à braver. Bagarres et récits hauts en couleur
alternent dans cet album inspiré qui ne laisse guère de répit au lecteur
grâce également au dessin précis et faisant mouche de Gaëlle Hersent.
Le lecteur complétera cette passionnante évocation de notre héroïne par le
dossier conçu par Farid Ameur, historien et spécialiste des États-Unis du
XIXe s. Ce complément indispensable permettra de mieux apprécier le rôle et
la place singulière de cette femme à nulle autre pareille auquel cet album
rend hommage.
Jules Buissonnet |
| |
 |
« Spirou et Fantasio – La Mémoire du Futur » ;
Olivier Abitan, Sophie Guerrive et olivier Schwartz ; Coll. « Tous Public »,
21.8 x 30 cm, 64 p., Editions Dupuis, 2024.
Plaisir que de découvrir qu’après « La mort de Spirou », ce dernier est
encore bien là, et de découvrir dans cette suite avec Spirou et Fantasio
cette « Mémoire du futur », un album (N°57) fourmillant d’inventions et de
créativité !
En effet, en ces pages fabuleusement décalées, après avoir été assommé,
Spirou se réveille rien que moins qu’en 1958 dans le salon d’Herbert D’Oups
; 1958, eh ! oui, l’année même de l’Exposition universelle de Bruxelles ;
surtout, là même, où fut présenté le futur, du moins ce qui se présentait à
l’époque comme le futur… Mais, Spirou n’a-t-il pas rêvé ce futur ? N’a-t-il
pas gardé « La mémoire du futur » ? Mais, il faut avouer qu’avec Fantasio,
rien n’est moins sûr…
C’est un fabuleux album que nous proposent aujourd’hui sous ce titre Bejamin
Abitan en coauteur avec Sophie Guerrive, tous deux aux manettes du scénario
avec une succession de dessins tous plus fabuleux et inventifs les uns que
les autres signés Olivier Schwartz… On se régale de retrouver dans ce
télescopage des espaces-temps « notre » célèbre groom !
Gilles Landais |
| |
 |
« La Veuve » de Glen Chapron ; N&Blc, 21.5 x 29.3
cm, 176 p., Editions Glénat, 2025.
Il faut découvrir cet audacieux roman graphique signé Glen Chapron et
offrant une belle adaptation du roman de l’écrivain et poétesse canadienne
Gil Adamson ; un western au féminin dès plus captivant.
Nous sommes au début du siècle dernier, en 1903 précisément, dans les
Rocheuses canadiennes ; Mary, jeune veuve, fuit deux hommes bien déterminés
à venger la mort de leur frère… Dans cette chevauchée effrénée, Mary va
cependant faire de multiples rencontres, des rencontres qui changeront sa
vie autant qu’elles révéleront son histoire et secret, mais qui lui
permettront surtout de choisir, en fin de compte son destin, un destin hors
normes de femme libre…
On l’aura compris dans ces confrontations au cœur même des grandes forêts
canadiennes, c’est un beau récit d’émancipation que nous propose tout de
noir et blanc Glen Chapron, ici, en auteur complet (Glen Chapron que l’on
connait déjà en dessinateur pour « Une Histoire corse » avec Dodo chez
Glénat ou encore la série « Les Dragons de Nalsera »).
Un récit fort, aussi captivant qu’empli d’émotion, qui tient son lecteur en
haleine jusqu’à la dernière planche. On soulignera pour l’adaptation de ce
roman paru en 2009 le beau travail de dessin réalisé alternant
merveilleusement à la fois lignes épurées et densité du trait ou encore la
force des silences du blanc avec la violence du fusain noir… Une puissance
du graphisme qui donne toute sa force au récit à l’instar de la nature
sauvage des Grandes Rocheuses.
Une belle réalisation qui ne manquera pas assurément d’être pleinement
saluée.
Gilles Landais
|
| |
 |
« Michel Vaillant - Légendes - Tome 3 - Effroyable
saison » de Lapière et Dutreuil, Editions Graton, 2024.
Le troisième tome des « Légendes Michel Vaillant » intitulé « Effroyable
saison » porte malheureusement un titre approprié si l’on considère l’année
1970 qui fut pour la F1 une annus horribilis avec l’accident de Jacky
Ickx et les décès de Bruce McLaren, Piers Courage et Jochen Rindt… C’est cet
ensemble de disparitions et d’accidents dramatiques qui vont conduire notre
héros, Michel Vaillant, à alerter les autorités de la F1 sur les conditions
de sécurité des pilotes, tout en s’engageant une nouvelle fois dans un
nouveau défi : celui de remporter la course au volant d’un nouveau bolide…
Si le légendaire Michel Vaillant apparaît sur la première planche de ce
nouvel album avec une boule de neige entre les mains, très vite, il
découvrira les pages suivantes sa nouvelle monture, un impressionnant bolide
qui le laissera – avec le lecteur !- tout simplement interloqué. Le banc
d’essai ne tardera pas sur le circuit de Kyalami, premier Grand Prix de la
saison, sur lequel un abasourdissant bruit de moteurs se fera vite entendre
grâce au redoutable dessin de Dutreuil rehaussé des couleurs inspirantes
d’Isabelle Charly nous faisant entrer de plain-pied dans l’ambiance du
circuit. Le scénario de Lapière est d’une efficacité redoutable avec une
narration alternant entre action, vitesse et aventure sentimentale, Michel
Vaillant connaissant aussi des problèmes de cœur !
Un album non seulement vrombissant, mais également captivant pour les
passionnés de sports automobiles et d’aventures.
Jules Buissonnet
|
| |
 |
« Collection La Sagesse des Mythes, contes et légendes » dirigée par Luc
Ferry, Editions Glénat. Cette BD consacrée à «
Tristan et Iseult » conçue d’après le scénario de Clotilde Bruneau
transportera son lecteur dans l’univers onirique des récits des temps
anciens ayant traversé les siècles avec la fertilité que l’on sait. Pour ce
« Tristan et Iseult », c’est Giuseppe Baiguera qui par son dessin incisif et
expressif évoque ce récit dramatique incontournable de la culture
occidentale. Nous découvrirons pour ce premier volume Tristan de Loonois,
mais aussi le menaçant duc Morgan sans oublier le roi Marc… signant ainsi le
début des nombreuses péripéties du héros jusqu’à sa rencontre avec la belle
Iseult… Comme à l’accoutumée, nous retrouverons en fin de volume un
passionnant dossier synthèse retraçant les grandes lignes historiques à
connaître afin de mieux apprécier la lecture de ces contes et légendes. En
l’espèce, une évocation de l’amour-passion et de l’amour courtois, la
légende de Tristan et Iseult et ses influences sur la culture occidentale,
le tout signé Luc Ferry !
Jules Buissonnet
A souligner également la parution dans cette collection « La Sagesse des
Mythes » dirigée par le philosophe Luc Ferry, du troisième tome consacré au
héros de la Table Ronde Lancelot du Lac et à la reine Guenièvre. |
| |
 |
« Jules Matrat – Tome 02 » de Serge Fino, 24 x 32
cm, Editions Glénat, 2024.
Comment ne pas souligner et saluer la parution tant attendue du deuxième
tome de « Jules Matrat », cette adaptation par Serge Fino du roman de
Charles Exbrayat publié en 1942, et contant le destin d’un jeune poilu hanté
par la boucherie de la Première Guerre mondiale.
Ce deuxième volume s’ouvre sur l’année 1918, mars précisément, en cette
année où son ami Louis disparaîtra… après quatre années déjà de tueries, de
tranchées et de barbarie, Jules retrouve aussi Rose… Mais le monde peut-il
reprendre comme avant ? Jules pourra-t-il réussir à se réinsérer dans la vie
de tous les jours…
Serge Fino, ici, en auteur complet offre tant à la lecture qu’au regard une
formidable et très belle adaptation de cet incontournable roman du XXe
siècle. Alliant dans une subtile alchimie réalisme et finesse, traumatismes
et sentiments, souvenirs de poilus de la guerre de 14 et vies brisées, Serge
Fino entraine son lecteur par des découpages, dialogues et dessins d’une
maîtrise et beauté implacables dans cette atmosphère d’après-guerre, face à
ces destins à jamais broyés …
On ne peut qu’attendre avec impatience le dernier volume de cette magistrale
trilogie menée de main de maître par Serge Fino.
Gilles Landais |
| |
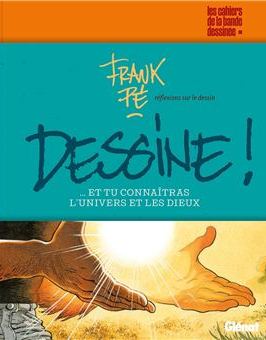 |
« Dessine ! …Et tu connaîtras l’Univers et
les Dieux – Réflexions sur le dessin» de Frank Pé, Coll. « Les Cahiers de la
bande dessinée », 16 x 20 cm, 200 p., Editions Glénat, 2024.
Les amateurs et passionnés du 9e art salueront, à n’en pas douter, ce
formidable témoignage de l’un des plus grands créateurs d’album, Frank Pé.
Artiste au talent incontesté, Frank Pré livre dans cet ouvrage à la
couverture stylisée et originale une analyse passionnante sur la place et la
puissance du dessin. C’est donc un one-shot hors-norme et exceptionnel que
découvriront les lecteurs avec « Dessine ! ». L’auteur revient sur une
multitude de points et questionnements, tous plus captivants les uns que les
autres, livrant même ses « Trucs de magicien » !
Rappelons que Frank Pé est entré professionnellement dans le monde de la BD
dès ses 19 ans, et a commencé sa carrière en 1973 avec une collaboration
dans le « Journal de Spirou ». Très vite, il saura s’imposer avec des albums
devenus iconiques, « Broussaille », « Zoo »…, accumulant récompenses et prix
dont l’Alph’Art en 1990 au festival d’Angoulême. Pour le bonheur des
amoureux de BD, il livre dans ces pages une réflexion à la fois captivante
et accessible sur le dessin, la création et la bande dessinée.
Exceptionnel, car ainsi que le souligne l’artiste : « Le dessin est, en soi,
un domaine vaste comme le cœur. Je vais me pencher sur lui, approcher la
loupe et le questionner ». Aujourd’hui, parallèlement aux albums, Frank Pé
réalise également de magnifiques fresques témoignant de sa passion et amour
des animaux… « Je veux la beauté et la grâce en plus » écrit-il encore…
Quelle plus belle confession et programme pouvait-on souhaiter de celui qui
de son art a marqué le monde de la BD ?!
Un album qui fera assurément référence et qui initie - 50 ans après leur
création par Jacques Glénat - le lancement de la nouvelle collection aux
éditions Glénat des « Cahiers de la bande dessinée » consacrés aux grands
auteurs et artistes du 9e art.
Gilles Landais
|
| |
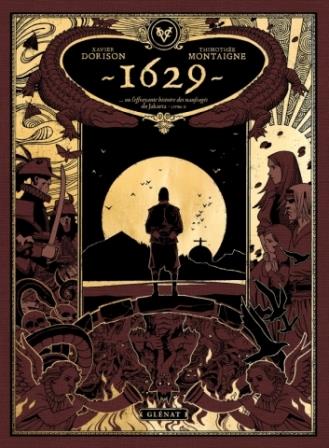 |
« 1629, ou l'effrayante histoire des naufragés du
Jakarta - Tome 2 » ; Scénariste Xavier Dorison ; Dessinateur Thimothée
Montaigne ; Couleur Clara Tessier, Editions Glénat, 2024.
Impossible à celles et ceux ayant débuté la lecture de l’effrayante histoire
des naufragés de Jakarta aux éditions Glénat de manquer la suite de ce récit
plus qu’impressionnant. Grâce à cette seconde partie, le lecteur retrouvera
les protagonistes échoués sur les récifs des îles Abrolhos au large des
côtes de l’Australie en 1629. 260 survivants dépendent ainsi de la survie
organisée par Jéronimus Cornélius, second du subrécargue Pelsaert parti sur
une chaloupe à la recherche de secours à Java.
Ce récit inspiré de faits réels relate la lutte pour la survie de ces
naufragés après la mutinerie survenue sur le navire Batavia.
L’impressionnant dessin réalisé par Timothée Montaigne servi par des
couleurs soulignant la force de ce récit poignant tiendra en haleine le
lecteur de la première à la dernière planche. Grâce au scénario de Xavier
Dorison reposant sur des recherches historiques d’une grande rigueur, ce
récit des naufragés du Jakarta apparaîtra encore plus vrai que nature avec
ces mines patibulaires des matelots plus effrayantes les unes que les
autres, la carcasse échouée du navire tel un sépulcre béant, et cette
solitude qui gagne certains des protagonistes face à l’adversité et à un
avenir plus que sombre…
Cette évocation tragique demeure cependant aux dires des auteurs bien
en-dessous de la cruauté vécue réellement par les naufragés du Jakarta.
Cette sombre page de l’histoire maritime invitera le lecteur à méditer plus
encore la citation placée en exergue de ce remarquable album : « Pour que le
mal triomphe, il suffit que les hommes de bien ne fassent rien » (Edmund
Burke)…
Jules Buissonnet
|
| |
 |
« Inhumain – tome 2 – Quintessence » de Denis, Valérie Mangin et Thibaud de
Rochebrune ; 23.7 x 31 cm, 112 p., Éditions Aire Libre, 2024.
C’est avec un très vif intérêt que les lecteurs découvriront
ce deuxième volet de la série « Inhumain » qui après s’est arrêtée pour son
ouverture sur la notion de liberté se penche, ici, sur les liens tout aussi
complexes que ténus entre individualité et société.
Ainsi qu’aiment à le souligner les trois auteurs : « Même terminée une
histoire continue à chuchoter à l’oreille (…) Il y avait tant à dire sur
notre humanité, sur notre inhumanité ». Tout est dit ou presque ! Le lecteur
aura compris que de bien belles et grandes questions existentielles sont
posées de nouveau avec ce deuxième tome dénommé « Quintessence » par nos
trois acolytes : Denis Bajram – que l’on ne présente plus ( Cryozone avec
Thierry Cailleteau ; Universal War One), Valérie Mangin et Thibaud de
Rochebrune.
Dans ce nouvel album, alors que les humains sont devenus maîtres de leur
conscience après le départ du l’île du Grand Tout, des tensions commencent
déjà à paraître. Parallèlement une expédition est envisagée hors de l’île…
Retrouveront-ils trace du Grand Tout ; surtout, sauront-ils mieux faire
cette fois-ci ?
Un thriller SF captivant alliant philosophie et poésie soutenu par un
graphisme époustouflant, des paysages magistraux, des personnages expressifs
à souhait, une mise en planche et des couleurs plus que superbement pensées.
Décidément, rien ne semble pour ce second souffle avoir été laissé au hasard
par nos trois comparses.
Un trio de choc pour un album magistral !
Gilles Landais
|
| |
 |
« Le Roi Cerf – Tome 2 » de Jean-Claude Servais ;
Préface de Benjamin Nollevaux ; Couleurs de Guy Raives, Coll. « Grand public
», 24 x 32 cm, 80 p., Editions Dupuis, 2024.
C’est toujours un évènement et un immense bonheur que de découvrir un nouvel
album signé Servais avec- qui plus est – une préface de l’auteur de
l’ouvrage « Les arbres qui cachent la forêt », Benjamin Nollevaux !
L’auteur a retenu cette fois-ci comme héros pour ce deuxième tome de la
série « La faune symbolique, après « Le renard rusé », le roi de la forêt :
le cerf. Un splendide et imposant animal présent dans bien des mythologies
et qui hante également bien des légendes ; depuis l’aube des temps n’est-il
pas considéré comme le roi des forêts ?!…
Aujourd’hui, Servais avec son talent incontesté tant de conteur que de
dessinateur, a choisi par le truchement du jeune Édouard d’ajouter sa griffe
à ces mythologies avec non pas seulement un cerf si beau soit-il, mais bien
le roi des animaux : un magnifique et mystérieux cerf blanc… Servais s’est
appuyé pour ce nouvel album à la fois du texte d’Adrien de Prémorel (« La
merveilleuse histoire du grand cerf de Freyr » dont le lecteur retrouvera
les premiers chapitres en fin de volume) et sur les photographies de Thierry
Creton et de celles de Pierre Thaymans. Est-ce dès lors une nouvelle légende
qui commence ?...
Peut-être, peut-être même certainement, tant il est vrai que sous la plume
de Jean-Claude Servais, sous son trait si précis, soigné et fabuleusement
maîtrisé, le plus bel animal des forêts est magnifié pour devenir
mystérieusement « Le Roi Cerf ».
Que dire de plus ? Splendide !Gilles
Landais |
| |
 |
« L’Aventurier », librement inspiré du texte
inachevé d’Arthur Schnitzler ; Scénario d’ Alessandro Tota ; dessin et
couleurs d’ Andrea Settimo ; Traduction de Laurent Laget ; 184 p., Editions
Glénat, 2024.
Adapté librement du captivant roman du célèbre écrivain autrichien Arthur
Schnitzler (1862-1931), « L’Aventurier » signé aujourd’hui Alessandro Tota
et Andrea Settimo aux éditions Glénat doit assurément retenir l’intention
tant cette adaptation BD se révèle passionnante et soignée.
L’histoire se déroule en Italie au XVIe siècle. Une époque marquée
douloureusement par une épidémie de peste. Après la mort de ses parents,
Anselmo Ringardi, un noble, va fuir la ville… Le début de multiples
aventures et surtout de rencontres notamment avec la belle et séduisante
Lucrezia, la fille de Géronde, ce sage qui détient le pouvoir de prédire la
mort… Anselmo Ringardi demeurera-t-il maître de son destin, dès lors, face
aux prédictions de Géronde ? Lui accordera-t-il enfin la main de sa si jolie
fille ou Géronde a-t-il menti à Anselmo pour la garder près de lui ?
C’est une belle adaptation que nous livrent avec « L’Aventurier » Alessandro
Tota et Andrea Settimo allant jusqu’à imaginer la fin de l’histoire d’après
les notes mêmes de l’écrivain autrichien ; Arthur Schnitzler n’ayant pas en
effet achevé ce récit aussi haut en couleur que tragique. Le lecteur
appréciera pour cette libre adaptation tout particulièrement le dynamisme du
scénario, allant de rebondissement en rebondissement ; un efficace synopsis
parfaitement rendu tant par la vitalité de la mise en page que par
l’esthétique du graphisme, sans oublier la belle déclinaison des couleurs.
Le lecteur est littéralement immergé dans cette Italie sans concession du
XVIe siècle.
Une merveille ! Que dire de plus…
Gilles Landais
|
| |
 |
« Buck Danny –Origines – Tome 3 – Sonny Tuckson,
Air Race Pilote 1/2 » ; Scénario de Patrice Buendia et Frédéric Zumbeihl ;
Dessin de Guiseppe de Luca ; Couleurs de Ketty Formaggio ; Coll. « Grand
public », 24 x 32 cm, 48 p, Editions Dupuis, 2024.
Après être revenu sur les origines de Buck, le premier volet de « Sonny
Tuckson - Air Race Pilote », nous entraîne maintenant sur les traces et
secrets de Sony Tuckson… Car avant devenir le célèbre acolyte de Buck Danny,
celui-ci connut dans sa jeunesse dans les années 1929 une vie mouvementée ;
marqué par la mort accidentelle de son père, il fut en effet recueilli par
un oncle revêche et confronté à l’ennui de l’Amérique profonde de ces années
30… Heureusement après les courses automobiles, c’est tout l’univers de
l’aviation que Sony Tuckson allait devoir découvrir…
Ce nouvel album complétant le triptyque « Buck Danny - Origines » proposera
au lecteur, on l’aura compris, actions, aventures et rebondissements de haut
vol ! « Sonny Tuckson - Air Race Pilote » offre surtout l’opportunité dans
un scénario signé Patrice Buendia et Frédéric Zumbiehl de découvrir sous un
angle moins habituel le fameux acolyte de Buck. Rappelons que Frédéric
Zumbiehl a déjà signé quelques scénarii de Buck Danny- Classique ou Buck
Danny-Origines. Le lecteur appréciera enfin et surtout les dessins
inimitables de Guiseppe de Luca laissant à cet opus de « Danny Buck -
Origine » ce style à la fois précis, soigné et idéalement vintage. On plonge
ou plutôt s’envole avec délice dans l’Amérique des années 1930 !
Gilles Landais |
| |
 |
« Ce que les Corbeaux nous laissent » de Sophie
Leullier, Coll. « Grand Public », 20 x26.8 cm, 160 p., Editions Dupuis,
2024.
Nous sommes au IXe siècle en contrée normande et le jeune Tarik est prêt à
tout pour venger la mort de son frère, Adairik, assassiné. Hanté par cette
mort, incapable de faire son deuil, plongeant dans l’alcool et les mauvaises
affaires, Tarik ne pense qu’à une seule chose : retrouver les coupables.
Mais parallèlement, sa mère – Galwinthe - sorcière, espère par l’étude de
parchemins et des croyances celtes et vikings parvenir à guider Tarik dans
le royaume des morts… Ensemble, chacun à sa façon, ils découvriront « ce que
les corbeaux nous laissent »…
Sophie Leullier signe, ici, en auteur complet son premier roman graphique.
Un album livrant un récit puissant et tragique consacré au deuil, à la
culpabilité, à la vengeance et au pardon dans une atmosphère médiévale
idéalement propice aux rites et légendes… Un sujet difficile et délicat où
luisent cependant des lueurs d’espoir et d’amour…
Au-delà, de la force indéniable de ce roman graphique, le lecteur appréciera
particulièrement les dessins de Sophie Leullier joliment stylisés et acérés
rehaussés par des couleurs magnifiquement changeantes, le tout dans une mise
en page des plus énergiques.
Un premier album des plus prometteurs qui ne laisse pas indifférent…
Gilles Landais |
| |
 |
« Noir Horizon – Tome 02 – Hosanna » ; Scénario de
Philippe Pelaez ; Dessin et couleur de Benjamin Blasco-Martinez, Editions
Glénat, 2024.
Après « Sitra Ahara », le deuxième tome de la série de SF « Noir Horizon »
signée Philippe Pelaez et Benjamin Blasco-Martinez - était plus que vivement
attendu ! Le voici, et il ne déçoit pas…
Souvenons-nous, nous sommes toujours dans ce monde post-apocalyptique et la
planète Kepler K452-b demeure une énigme… En effet, les quatre survivants
qui y ont été envoyés en expédition et qui ont réussi à passer le mur « Noir
Horizon », sont de retour à Kádingirra… Mais, contre toute attente, ils ne
veulent rien dire de ce qu’ils ont découvert… Aussi, le gouverneur et ses
trois autres acolytes vont-ils réserver aux récalcitrants, et plus
particulièrement à Esther qui va se révéler être sa propre fille, un sort
bien peu enviable… Repartiront-ils dès lors vers Kepler 452-b ? Là où, «
Au-delà du mur, l’enfer » !
Les lecteurs retrouveront dans ce nouveau et deuxième album le côté aussi
déconcertant qu’époustouflant de cette trilogie sans merci ni concession qui
s’interroge sur la force et puissance de la tyrannie. S’appuyant sur un
scénario bien ficelé et maîtrisé de Philippe Pelaez, les lecteurs
apprécieront une nouvelle fois le graphisme particulièrement soigné et
grandiose de Benjamin Blasco-Martinez, ici, en dessinateur et coloriste. Se
succédant à un rythme effréné, les planches aux visages expressifs et aux
environnements incroyables retiennent le lecteur sans faillir jusqu’à la
dernière page.» On retrouve également dans ce nouveau titre « Hosanna »
cette étrange alchimie entre le monde biblique et celui des sciences qui
fait de ce récit ésotérique une aventure de SF captivante, et dont on ne
peut qu’attendre une nouvelle fois avec impatience la suite et fin.
Gilles Landais |
| |
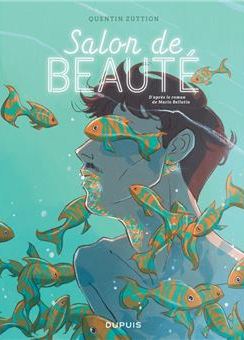 |
« Salon de Beauté » de Quentin Zuttion d’après le
roman de Mario Bellatin ; 20 x 26.8 cm, 184 p., Coll. « Grand Public »,
Editions Dupuis, 2024.
On appréciera cette belle adaptation en BD du roman «Beauty Salon » de Mario
Bellatin, finaliste du Prix Médicis en 2000. Est-il besoin de rappeler la
trame de ce récit fort salué lors de sa sortie ?!
Jeshua est connu pour son agréable salon de beauté où il prodigue avec
bienveillance à une clientèle exigeante coiffure, manucure et soins… Reste
que ses journées sont plus longues que l’on pourrait le penser, car la nuit
c’est lui-même, Jeshua, qui se coiffe et se maquille et devient avec ses
deux amis travestis. Une vie bien rythmée, mais qui va se trouver
bouleversée par l’arrivée de cette redoutable épidémie, ce virus
sexuellement transmissible… Jeshua va alors prendre la décision de
transformer son salon pour y accueillir des malades ; une décision qui ne
pourra devant la maladie et la violence sociale laisser ni lui ni ses amis,
ni surtout son lecteur indifférent…
C’est en effet avec sensibilité et pudeur que Quentin Zuitton (auteur de «
Les Princesses meurent après minuit – Prix spécial jeunesse du festival
d’Angoulême 2023) a souhaité adapter, ici, en auteur complet, ce beau roman
de l’écrivain mexicain, Mario Bellatin, consacré au VIH qui dans les années
80 – 90 a décimé la communauté homosexuelle. Le VIH qui par pudeur et
respect ne sera volontairement pas – comme dans le roman - nommé.
Le lecteur par la délicatesse du dessinateur qu’est Quentin Zuiton
retrouvera dans cet album toute la force métaphorique et onirique du roman
avec ce Salon de beauté et ces hommes sirènes... Un défi relevé avec une
belle sensibilité que cela soit dans le dessin, les couleurs ou la mise en
planche ; Une jolie manière aussi poétique que délicate de raconter, dire,
ce que furent dans ces années les désirs d’une communauté et la mémoire
d’une tragédie… Un bel hommage.
Gilles Landais
|
| |
 |
« Kaya » ; Scénario Paola Barbato ; Dessin et
couleur Emmanuele Tenderini et Lorrenzo Lanfranconi ; Scénario, dessin et
couleur Linda Cavallini ; 24 x 32 cm, Editions Glénat, 2024.
Une ambiance apocalyptique, une atmosphère toxique, des ressources épuisées
et des animaux mutants… Sur cette terre devenue invivable et vidée de la
moitié de ses habitants, Rio et Kaya, sa petite sœur, tentent de rejoindre
le sud de la planète et d’échapper aux bio-brigades chargées d’enrôler les
survivants dans les mines…
On l’aura compris c’est dans un univers redoutable dans lequel nous entraîne
cet album ; un monde où le chaos règne implacablement et dans lequel
pourtant on se laisse prendre au piège tout comme la petite Kaya avec cette
louve géante… Signé à 8 mains italiennes, et non des moindres -dont la
romancière Paola Barbato - ce one-shot happe littéralement le lecteur tant
le graphisme est merveilleusement soigné et réaliste, tant les couleurs ne
retiennent pas, mais ouvrent au contraire l’imaginaire… Un album qui
soulève, qui plus est, de belles et fortes questions existentielles. Et si
certains ont pu parler pour cet album de « graphisme proche de l’animation »
c’est sans usurpation mais bien à juste titre…
Le plus, enfin, très original : cet album est accompagné de QR codes qui
offrent au lecteur la possibilité d’entendre régulièrement au fil des pages et
de la lecture la bande originale écrite par Paola Barbato et Linda Cavallini
avec en arrière-fond une musique de Remo Baldi ; absolument inédit, ludique
et réjouissant !
Gilles Landais
|
| |
 |
« Jean Monnet » de Marie Bardiaux-Vaïente
(scénario), Sergi Gerasi (dessin) et Eric Roussel, Editions Glenat, 2024.
Voici une BD des plus pédagogiques destinée aux jeunes, comme aux moins
jeunes, souhaitant revenir aux origines de la construction de l’Europe et de
ses institutions. Jean Monnet peut être en effet présenté comme
l’inspirateur d’une Europe unie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
Européen convaincu dès les premières heures, Jean Monnet comprend très
rapidement (dès la Première Guerre mondiale) que sans interdépendances
étroites entre les peuples voisins de l’ouest de l’Europe, les conflits
demeureraient inévitables.
Marie Bardiaux-Vaïente (scénario), Sergi Gerasi (dessin) et l’académicien
Eric Roussel ont su rendre accessible une thématique quelque peu austère
grâce à un propos à la fois clair et accessible, les dessins entretenant des
liens très didactiques avec le texte. L’histoire commence par un flash-back,
celui d’un homme âgé en 1975 revenant sur ses jeunes années, notamment en
1905, début d’une longue route qui le mènera aux plus hautes instances
internationales. Ce personnage discret et modeste saura donner naissance aux
idées déterminantes pour les relations internationales, notamment celle
essentielle de l’union des hommes afin de rapprocher les nations.
Véritable fresque allant de la SDN à laquelle Jean Monnet participera très
activement jusqu’à la création de CECA (Communauté européenne du charbon et
de l’acier) en 1951, sans oublier le traité de Rome de 1957 et du Marché
Commun européen en 1968 ! Nous suivons, planche après planche cette
captivante aventure sans laquelle nous ne pourrons comprendre pleinement les
atouts, mais aussi les faiblesses de la Communauté européenne du XXIe. |
| |
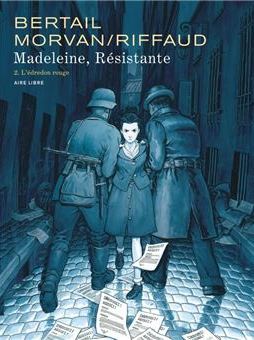 |
"Madeleine, résistante -Tome 3 - Les nouilles à la
tomate » de Bertail - Jean-David Morvan - Riffaud, Editions Dupuis, 2024.
Nos lecteurs connaissent bien déjà cette fameuse série BD « Madeleine,
Résistant » (lire nos précédentes chroniques), une série au thème pourtant
toujours délicat à traiter surtout dans le contexte de la Bande Dessinée… Et
pourtant le pari est réussi tant l’évocation du difficile chemin et combats
menés par la grande Résistante Madeleine Riffaud se trouve parfaitement
rendue dans ces volumes aussi soignés que poignants.
Il faut avouer que le parcours de Madeleine - son jeune âge, arrêtée pour
avoir éliminé un officier allemand avant d’être torturée par la Gestapo et
la non moins redoutable police de Vichy - aurait dû s’interrompre devant le
peloton d’exécution et pourtant… Jean-David Morvan (scénario) et Dominique
Bertail (dessin) signent une nouvelle fois en une collaboration
exceptionnelle avec Madeleine Riffaud en personne - qui vient tout juste de
fêter sa 100e année - ce troisième tome.
Les premières planches débutent par la situation dramatique des terribles
geôles dirigées par le commissaire Fernand David, tristement surnommé «
David les Mains Rouges »… évocations terribles sans verser néanmoins dans le
voyeurisme, avant la Libération inimaginable ! Les illustrations
remarquables des rues de Paris dont nous commémorons à cette occasion le 80e
anniversaire de sa libération, la force du témoignage rendu avec le ton
juste par le scénario évitant tout pathos, font de ce troisième tome une
évocation poignante et indispensable de la Résistance à partager avec le
plus grand nombre, notamment avec les plus jeunes lecteurs.
Jules Buissonnet
|
| |
 |
"L'Arche de Noé et le Déluge" ; Scénariste Clotilde
Bruneau et Luc Ferry, Dessinateur Gianenrico Bonacorsi, Directeur artistique
Didier Poli, Collection « Sagesses des Mythes », Editions Glénat, 2024.
L’histoire de l’Arche de Noé remonte à la plus ancienne histoire, celle du
Déluge et de la dévastation de la terre suite aux excès de l’homme… Ce récit
légendaire trouve ses racines dans l’ancienne mythologie de la Mésopotamie,
évènement extraordinaire ayant inspiré directement la Bible et plus
précisément l’Ancien Testament. C’est cette terrible histoire qui fait
l’objet d’un album tout aussi impressionnant dans la collection « La sagesse
des mythes » dirigée par Luc Ferry selon un scénario de Clotilde Bruneau et
Luc Ferry, le dessin de Gianenrigo Bonacorsi et la direction artistique de
Didier Poli.
Si l’histoire est bien entendu connue, les faits évoqués – comme à
l’accoutumée dans cette collection – permettront au plus grand nombre de
rafraîchir ou d’enrichir leur mémoire historique sous la forme d’un récit à
la fois captivant et enlevé. L’album débute par l’inconduite et la
perversité du peuple de Mésopotamie bientôt condamné par le Seigneur qui en
une révélation nocturne intimera l’ordre à Noé de bâtir une gigantesque
arche avant la destruction de toute l’humanité…
Si le récit biblique diffère du mythe mésopotamien, ce dernier étant plus
centré sur la tranquillité des dieux perturbée par le bruit causé par les
hommes, cet album reste fidèle aux Écritures par l’évocation de l’immense
arche dessinée par Gianenrico Bonarcorsi, ainsi que par le grandiose déluge,
dignes de ses prédécesseurs dans l’art du péplum !
Jules Buissonnet
|
| |
 |
"Ayrton Senna Histoires d'un mythe" ; Scénariste
Lionel Froissart, Dessinateur Christian Papazoglakis et Robert Paquet,
Editions Glénat, 2024.
Le célèbre coureur automobile brésilien est entré depuis longtemps dans la
légende et il fallait bien un album digne de cette figure mythique de la F1
pour lui rendre hommage. C’est chose faite avec cette BD signée Lionel
Froissart pour le scénario, et Christian Papazoglakis et Robert Paquet pour
le dessin.
Autant prévenir le lecteur que cette histoire sera menée tambour battant,
les bruits des bolides concurrençant la vitesse de leur passage au fil des
planches. Le rythme trépidant débute lors de cette fameuse course du Grand
Prix de Monaco en 1984 lors de laquelle le futur prodige des pistes menace
de rafler la place de leader d’Alain Prost dans les conditions d’un
effroyable mauvais temps…
Ce sera le point de départ de la légende Ayrton Senna évoquée avec brio par
les auteurs de cette BD passionnante… même pour les non passionnés de
courses automobiles ! Les planches parviennent à reproduire vitesse, bruit
et action en une vrombissante épopée qui tient en haleine jusqu’à la
dernière planche malheureusement trop connue de ce triste jour de 1er mai
1994 qui mit fin à une carrière fulgurante d’une courte mais dense décennie.
Jules Buissonnet |
| |
 |
« Requiem – Tome 12 – « La Chute de Dracula » ;
Scénario de Pat Mills ; Dessins et couleurs d’Olivier Ledroit, 24 x 32 cm,
Editions Glénat, 2024.
On ne résiste pas au tome 12 de la fameuse série culte « Requiem » !
Pour ce nouvel épisode, le lecteur est invité – rien que moins - à la table
de Dracula ; ce dernier envisage, en effet, afin de fêter la victoire de ses
preux chevaliers vampires d’organiser un banquet… Une incroyable occasion
pour Requiem de vaincre à jamais Dracula ? Assurément, et pour cela Requiem
se voit remettre par Black Sabbat le Marteau du Thurim. Mais, c’est sans
compter Deucalion et l’ange de l’antimatière qui, eux aussi, risquent de
sauter sur cette unique occasion… Requiem arrivera-t-il à temps au Banquet ?
Rien n’est moins sûr !
Il faut dire que cet avant-dernier volume de l’une des séries dark fantasy
les plus plébiscitées, après maintenant 12 ans d’existence, se doit être à
plus d’un titre souligné :
Parce que, comme toujours, au scénario Pat Mils ne tarit pas de créativité
et d’une fertile imagination pour cet avant dernier tome préparant avec brio
le dernier et ultime volume !
Parce que, également, et comme toujours ce volume signé en duo avec le
dessinateur Olivier Ledroit donne, on s’en doute, un album
extraordinairement illustré avec des dessins soignés et à nuls autres
pareils. Les amateurs retrouveront en effet un fantastique graphisme digne
de cette série culte dans une mise en planche aussi dynamique que grandiose.
Bref, comme toujours, rien n’a été laissé au hasard pour ce tome 12… Et «
Que sonne de nouveau le glas ! Que toute la Draconie sache… »
Gilles Landais |
| |
 |
« La Vie rêvée d’un Papillon » ; Scénario de
Sylvère Denné ; Dessin Sophie Ladame ; Cartonné, 19 x 26.5 cm, 128 p.,
Éditions La Boite à Bulles, 2024.
Plaisir que de retrouver en BD cet incontournable récit du fameux bagnard «
Papillon » inspiré de l’ouvrage d’Henri Charrière et porté au cinéma avec le
succès que l’on sait avec Steve McQueen et Dustin Hoffman.
L’album « La Vie rêvée d’un Papillon » revient en effet sur la vie d’Henri
Charrière - de son vrai nom, qui envoyé à perpétuité au bagne de Guyane dans
les années 1930, n’eut de cesse de vouloir s’évader et qui y réussit au bout
de treize années d’enfermement…
Cette vie rêvée, fantasmée, fut effectivement relatée par l’ancien bagnard «
Papillon » ou Henri Charrière qui l’écrivit d’une traite avant d’envoyer son
manuscrit à Robert Laffont ; idée de génie puisque l’ouvrage sera un succès
éditorial incroyable avec plus de 15 millions d’exemplaires vendus, avant de
connaître un non moins grand succès au cinéma avec le fameux film « Papillon
» qui sortira le lendemain même de sa mort en 1973…
Pour ce roman graphique, le lecteur sera conquis par le scénario signé
Sylvère Denné. Un scénario admirablement illustré avec sa complice Sophie
Ladame. Un duo qui avait déjà fait ses preuves avec « Bleu Amer » en 2018.
On notera également une très belle mise en page aussi dynamique
qu’esthétique qui n’est pas sans rappeler celle des beaux carnets de voyage
avec ces jeux de graphisme et de couleurs. Il fallait assurément tous ces
ingrédients pour offrir au lecteur en roman graphique l’incontournable
légende – entre mythe et réalité - du fameux bagnard « Papillon »… Un joli
défi relevé !
Gilles Landais
|
| |
 |
« Outlaws- Tome 2 – Les Rivages de Midaluss » ;
Scénario de Sylvain Runberg ; Dessin d’Éric Chabbert ; Coll. « Grans Public
», 24 x 32 cm, 56 p., Editions Dupuis, 2024.
Nous étions nombreux à attendre la sortie du deuxième tome « OutLaws »,
c’est chose faite avec ce nouvel opus intitulé « Les Rivages de Midaluss ».
Rappelons qu’en 2779, la jeune terrienne, Kristina, après avoir fugué et
voyagé illégalement grâce aux passeurs galactiques qui transportent des
clandestins de divers univers, se retrouve sur une planète inconnue. Là,
confrontée au racisme anti-humain, Kristina doit survivre et travailler pour
le cartel des Cimes… Avec son nouveau compagnon, Zachary, sur la planète
Drenn à Madaluss, cité balnéaire tentaculaire où prisons dorées de
richissimes et bidonvilles coexistent, Kristina a décidé de devenir voleuse
de voitures de luxe… et pourquoi pas, même, de devenir la reine de la pègre
galactique ? Mais, la guerre des gangs et le Cartel des Cimes vont les
rattraper…
Avec un scénario signé de nouveau Sylvain Rumberg – « Wonder Woman », «
Orbital », ce deuxième volet d’un spin-off d’Orbital embarque son lecteur
dans l’univers sans merci des mafias galactiques, un univers sanglant qui
pourrait bien nous rappeler le nôtre… À l’instar du premier volet, cette
critique sociétale interplanétaire est également servie de nouveau de plume
de maître par les dessins soignés, expressifs et dynamiques d’Éric Chabbert.
Pour conclure, on ne doute pas que le lecteur saluera la belle créativité de
ce duo de choc, Rumberg / Chabbert !
Gilles Landais |
| |
 |
« Les Ennemis du peuple » ; Scénario d’Emiliano
Pigani ; Dessin de Vincenzo Bizzarri ; Traduction Hélène Dauniol-Remaud ;
19.8 x 26.6 cm, 136 p., Editions Glénat, 2024.
C’est un roman graphique engagé que signent chez Glénat Emiliano Pagani et
Vincenzo Bizzarri pour les dessins et couleurs. « Les ennemis du peuple »
plonge en effet littéralement son lecteur dans la crise économique et
sociale, quelque part en Italie, avec son usine et ses grilles fermées, ses
travailleurs en grève, ces habitants en colère ou désabusés face à cette
délocalisation inhumaine… Au cœur de cette multitude de personnages,
Emiliano Pagani, qui fut lui-même un ouvrier, dessine avec minutie le climat
lourd et tendu d’une crise tout autant économique que sociale, une crise
telle que l’on en connait tant aujourd’hui entrant dans tous les foyers et
relayée par les médias… C’est la découverte d’un homme sans vie et d’un
revolver - découverte sur laquelle le récit s’ouvre - que se révèlent les
caractères, les psychologies de chacun et où « Les ennemis du peuple » se
dévoileront plus encore…
On l’aura compris un one-shot dramatique et sans concessions qui happe son
lecteur avec cependant ce doigté de comédie comme pour servir mieux encore
de révélateur. Un regard aussi aiguisé que profond que Vincenzo Bizzarri a
su merveilleusement illustrer et traduire sans jamais trahir cet espoir du
désespoir qui semble battre au cœur même de cet album qui n’est pas sans
rappeler les atmosphères lourdes et engagées des films de Stéphane Brizé
avec Vincent Lindon.
Gilles Landais |
| |
 |
« Bâtardes de Zeus » d’Agnès Maupré ; Coll. « Grand
public », 24 x 32 cm, 208 p., Editions Dupuis, 2024.
Dans une petite île grecque, deux amie d’enfance, Physalis et Britomartis,
n’ont jamais connu leur père ; un père qui n’est autre que Zeus, lui-même !
Et effectivement, bien malin celui qui saura nous dire combien d’enfants et
bâtards ce haut dieu de la mythologie grecque a eus… Reste que, dans ce
roman graphique, Physalis et Britomatis partent toutes deux sur les routes à
la recherche de ce père absent avec pour sac à dos leur colère. Mais bien
des vicissitudes attendent en chemin nos deux comparses ; outre les autres
bâtards de Zeus qu’elles seront amenées à rencontrer, elles seront surtout
confrontées à la domination et violence des Dieux…
Avec ce volume signé en auteur complet, Agnès Maupré connue dans le monde de
la BD et qui fait, ici, son entrée chez Dupuis. Une entrée plus que réussie
puisqu’elle nous offre un opuscule féministe et débridé à souhait avec un
scénario bien ficelé qui nous promène dans toute la mythologie grecque. Le
lecteur appréciera également la mise en page des plus dynamiques pour un
roman graphique et les dessins souvent irrésistibles avec couleurs
illuminant les pages.
Un coup de maître et un nom à retenir assurément !
Gilles Landais |
| |
 |
« Les Tribulations de Félix Mogo » de Christian
Cailleaux, 15.5 x 21.8 cm, 616 pages, Editions Glénat, 2024.
Il se présente comme un livre avec son format, sa jolie reliure de garde et
son ruban de marque-page, mais il cache en réalité quatre fort beaux récits
graphiques signés Christian Cailleaux aux éditions Glénat. L’histoire d’un
jeune homme aussi élégant que triste, Félix Mogo, qui ne peut résister pour
le meilleur et le pire à l’amour des jolies femmes… et aux voyages !
Il y a effectivement, aussi et surtout, dans ce beau récit un vent du large,
des rêves de voyages et d’exotisme qui ne sont pas sans faire penser à
quelques célèbres « écrivains voyageurs », on songe bien sûr à Kessel, mais
aussi à Conrad ou Blaise Cendrars. Il faut dire que Christian Cailleaux,
auteur bien connu dans le monde de la BD depuis les années 90, on lui doit «
Les Imposteurs » ou plus récemment « Le Passager du Polarlys », et ici, en
auteur complet, est lui-même un fameux globe-trotter ayant sillonné terres
et mers notamment pour des missions scientifiques…
Derrière la mise en page soignée, aussi originale que dynamique, et des
dessins en noir et blanc attachants, expressifs et aux lignes épurées, le
lecteur retrouvera cette poésie si chère à l’auteur, celle de l’Afrique, de
l’Inde, de l’Asie, mais aussi celle de New York… Quatre continents pour
quatre récits et époques pour ce one-shot inédit regroupant, en fait, quatre
récits déjà publiés, mais depuis longtemps épuisés : « Harmattan, le vent
des fous », « Le Café du Voyageur », « le Troisième Thé » et « Tchaï Masala,
monologue hindi».
« Invitation au voyage », rêves et imagination, mais aussi humour et
dérision, rien ne manque à ces récits délicieux dont on se saurait se priver
!Gilles Landais |
| |
 |
« Birdking – livre 1 » ; scénario Daniel Freedman ;
Dessin et couleur CROM ; Design original de Diana Ortiz ; Cartonné, 18.8 x
27 cm, 160 p., Les Humanoïdes Associés, 2024.
Un univers Dark Fanstasy empli de légendes, de rois, de lointaines contrées
et d’épée offrant un imaginaire archétypale débridé…
Bianca, jeune apprentie forgeron, est contrainte de fuir la Colline aux
Plumes et son pays en guerre. Elle et son maître, après avoir forgé la lame
spectrale d’Aduren pour le roi Aghul, ont en effet été trahis. Fuyant seule
avec l’épée et cherchant dès lors désespérément, l’Atlas, une terre
légendaire, elle n’aura d’autre choix que de livrer bataille sur bataille et
de percer le mystère d’un roi déchu, celui de Birdking…. Fantôme guerrier
qu’elle a réveillé…
Un premier livre qui ne manque ni d’action ni de rebondissements et encore
moins de piquant. Avec un scénario captivant haut en couleur signé Daniel
Freedman, le lecteur est, en effet, entraîné dans un monde des plus
fantastiques illustré merveilleusement par le dessinateur CROM. Un duo bien
connu du monde de la BD depuis « Raiders » et que nombre d’entre nous auront
plaisir à retrouver de nouveau réunis pour « Birdking ».
Le lecteur appréciera, enfin, le riche dossier graphique accompagnant ce
livre premier.
Gilles Landais |
| |
 |
« La Callas et Pasolini, un amour impossible » de
Briotti – Dufaux, Air Libre, 2023.
Pasolini et Maria Callas demeurent deux icônes de la culture italienne
passées à la postérité chacune dans leur art. Et pourtant, leur éphémère
relation intime est moins connue de ce côté-ci des Alpes, thème d’une
remarquable BD chez Air Libre. Jean Dufaux (scénario) et Sara Briotti
(dessin) ont en effet uni leur talent pour retracer cette singulière
aventure entre deux artistes que rien ne semblait pourtant réunir. D’un
côté, l’écrivain-poète-réalisateur, plus tourné vers les conquêtes
masculines que féminines, de l’autre côté la célèbre cantatrice à la
carrière éclatante et vie tourmentée… La rencontre se fera lors du tournage
de « Médée », Pasolini ayant choisi la cantatrice grecque pour interpréter
le rôle du personnage de la mythologie. L’amour platonique qui résultera de
cette union atypique sera aussi éphémère qu’intense ainsi qu’il ressort de
cet album non seulement informé, mais également d’une rare beauté dans le
cadre féérique d’un voyage au Brésil réunissant les deux protagonistes.
Une belle préface de l’écrivain italien Emanuele Trevi et un passionnant
essai d’Alain Duault sur « Les hommes de Callas » complètent cet album en
hommage au centenaire de la diva…
Jules Buissonnet |
| |
 |
« Eden Corp » ; Alain Bismut, Abel Ferry, Christopher Sebela et Marc Laming
; Cartonné, 20.9 x 31.8 cm, 112 p, Editions Humanoïdes Associés, 2024.
Que diriez-vous de partir à bord d’un vaisseau spatial vers
un monde meilleur ? C’est l’opportunité qui s’offre justement à Gabe et sa
famille… Une opportunité offerte à très peu d’élus et d’autant plus
attrayant, que sur la Terre surpeuplée qu’ils habitent seule la violence
règne et que cette famille ne doit sa survie qu’à de petits larcins et
cambriolages… Alors comment refuser de faire tourner « la chance » de son
côté ? Mais, Gabe, Morgan et leur fille vont lors de leur voyage faire une
terrible et bouleversante découverte qui va transformer tragiquement leur
rêve de paradis en véritable cauchemar.
Signé pour l’idée originale à quatre mains, d’une part, par le réalisateur
Abel Ferry, auteur déjà de « Piège Blanc » en 2014 et du « Saut du Diable »
en 2002, et d’autre part, Alain Bismut pour la première version scénarisée
née en 2011, ce one-shot réjouira bien des amateurs de récits de
science-fiction. Et ce d’autant plus, que le scénario proprement dit est
signé pour cet album par Christopher Sabela, auteur incontournable dans le
monde de la BD et nominé quatre fois aux Eisner Awards.
Cet album offre également de fantastiques dessins de la plume de Marc Laming
que l’on ne présente plus tant son talent est depuis plus d’une décennie
reconnu par tous ; des dessins réalistes extrêmement bien maîtrisés
rehaussés des couleurs de Lee Lougridge et par lesquels le lecteur se laisse
très volontiers entraîner avec Gabe et sa famille dans cet extraordinaire
voyage aussi effrayant que captivant.
Gilles Landais |
| |
 |
« Don Juan – Tome 2/2 – L’Invité de pierre », Coll.
« La sagesse des mythes, contes et légendes » sous la direction de Luc Ferry
; Scénario de Clotilde Bruneau, Dessin et story-board de Diego Oddi ;
Direction artistique par Didier poli ; Couleurs de Ruby, Couverture de Paolo
Grella ; 24 x 32 cm, 48 p., Editions Glénat, 2024.
Nombreux seront ceux qui auront plaisir à découvrir ce second volet de « Don
Juan » dans cette collection toujours aussi plébiscitée « La Sagesse des
mythes, contes et légendes » dirigée par le philosophe Luc Ferry. Rappelons
que pour ce diptyque, Luc Ferry a souhaité retenir le Don Juan du moine
espagnol Tirso de Molina (1579-1648), auteur incontournable du Siècle d’or
espagnol. Une version injustement moins connue en France et pourtant à
l’origine du non moins célèbre personnage de Don Juan, avant qu’il ne soit
repris en Italie, puis par Molière.
Dans ce second tome, Don Juan est avec son serviteur Catalinon désormais à
Séville. Là, il tuera le père de Dona Ana qui voulait défendre l’honneur de
sa fille que Don Juan avait séduite. Aussi, fuira-t-il de nouveau et
séducteur impénitent, ne pourra s’empêcher de porter son dévolu sur la belle
Aminta qui pourtant va se marier. Mais, un soir, il aura la terrifiante
visite d’un défunt, une statue de pierre, « L’invité de Pierre » qui donne
son titre à cet ultime album car l’heure sera venue pour Don Juan de rendre
des comptes…
Dans cet album et version,le lecteur aura tout le loisir de mesurer combien
le personnage de légende de Don juan est aussi complexe que démoniaque. Et
c’est bien cette complexité, ayant inspiré tant d’auteurs et d’artistes, que
le lecteur retrouvera, ici, parfaitement rendue dans ce scénario signé de
nouveau Clotilde Bruneau et ces dessins réalistes également toujours aussi
soignés de Diego Oddi.Gilles Landais |
| |
 |
« Sol-13 » inspiré de l’œuvre de Julia Verlanger ;
Scénario d’Harry Bozino ; Dessin de Federico Dallocchio ; Couleur de d’Aratha
Battistutta et Annelise Sauvêtre ; 24 x 32 cm, 112 p., Les Humanoïdes
associés, 2024.
Un album de pure science-fiction à ne pas rater !
Inspiré en effet de l’univers de Julia Verlanger, auteur français
incontournable dans le domaine de la science-fiction, « Sol-13 » entraîne
son lecteur dans ce monde extra-planétaire à nul autre pareil…
Jatred a été nommé à la tête d’un commando pour retrouver Eiko, un agent de
la Confrérie des Étoiles, envoyée en reconnaissance sur la planète Sol-13 et
qui a mystérieusement disparue. A sa recherche, Jatred découvre alors que
règnent sur cette planète des plus inhospitalières des êtres aux pouvoirs
psychologiques terrifiants possédant par ailleurs une très haute technologie
et ayant réduit les humains en esclavage… Pourront-ils sans risque les
libérer ?
Le scénario bien ficelé offre une intrigue de haut vol, faite de guerres, de
stratégies et d’action tout azimut. Rien d’étonnant à cela puisque le
scénario inspiré de l’univers de Julia Verlanger est signé Harry Bozino, un
auteur reconnu et entré chez Les Humanoïdes associés depuis maintenant plus
de cinq années, et qui a déjà été remarqué et salué pour sa précédente
adaptation de l’œuvre Julia Verlanger : « Planètes orphelines ».
Pour le plus grand plaisir de ses lecteurs, il récidive, ici, avec au
dessin, Federico Dallocchio, tout aussi connu dans le monde de la BD.
Collant au plus près au scénario, Fedérico Dallocchio réjouira les amateurs
les plus difficiles avec des dessins extrêmement soignés alliant créativité,
réalisme et finesse des détails ; des dessins époustouflants offrant de
véritables et incroyables paysages de science-fiction rehaussés par les
couleurs d’Aratha Battistutta et Annelise Sauvêtre. On relèvera également un
beau travail dynamique et efficace de mise en planche.
Gilles Landais |
| |
 |
« Petit pays » Sylvain Savoia et Marzena Sowa,
adapté du roman de Gaël Faye, 23.7 x 31 cm, 128 p, Aire Libre, Editions
Dupuis, 2024.
C’est assurément une poignante et très réussie adaptation du roman de Gaël
Faye « Petit pays », que le lecteur pourra découvrir aujourd’hui chez « Aire
Libre », un album revenant sur le génocide des Tutsi par les Hutu mais vu
par le regard de deux enfants franco-rwandais. Exilés au Burundi, Gaby et sa
petite sœur Ana ont effectivement de leur petite hauteur vu à la fois leur
famille se déchirer, le génocide des Tutsi et le Burundi basculer dans la
guerre civile… Comment dès lors ignorer que c’est toute leur enfance et leur
innocence envolées à jamais…
Alors que se multiplient les commémorations marquant les trente années du
génocide des Tutsi au Rwanda, cette adaptation aussi sensible que soignée
signée Sylvain Savoia et Marzena Sowa pour le scénario ne saurait laisser
indifférent. Aussi respectueux du roman de Gaël Faye que de l’Histoire,
c’est en effet une adaptation des plus puissantes que le lecteur découvrira
; est-il besoin de rappeler que ce premier roman de Gaël Faye, auteur et
chanteur, sorti en 2016 s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires, a été
traduit dans 35 pays, primé par plus de dix prix, dont le Prix Goncourt des
lycéens en 2016. Objet déjà de nombreuses adaptations pour le cinéma ou au
théâtre, l’auteur rwandais a pour cet album étroitement collaboré avec
Sylvain Savoia et Marzena Sowa, un duo déjà connu et apprécié dans le monde
de la BD (on se souvient de la série « Marzi » également chez Dupuis).
Autant dire que cette adaptation était attendue !
Aujourd’hui, on ne peut que souligner la fidélité du scénario non seulement
quant au récit de Gaël Faye, mais aussi quant à la langue même de l’auteur.
Une gageure réussie confirmée par la justesse et grande sensibilité des
dessins de Savoia – mais pouvait-il en être autrement ?
Assurément, une adaptation qui ne peut qu’être vivement saluée.
Gilles Landais |
| |
 |
« Le Nom de la Rose » - Tome 01 » de Milo Manara
d’après l’œuvre de Umberto Eco, Editions Glénat, 2023.
Même celles et ceux qui n’ont pas lu le célèbre roman médiéval de Umberto
Eco connaissent l’intrigue du Nom de la Rose, ne serait-ce que grâce à sa
version pour le grand écran réalisée par Jean-Jacques Annaud avec le génial
Sean Connery… C’est cette incroyable enquête que reprend pour le 9ième art
Milo Manara, un autre géant italien de la BD !
Plus connu pour ses productions érotiques, c’est à un autre genre plus
austère auquel s’attache pour cet album notre auteur à partir du célèbre
roman d’Umberto Eco. Même si l’histoire est connue, rappelons l’intrigue qui
se déroule en plein cœur du XIVe s. dans une abbaye bénédictine du nord de
l’Italie. Plusieurs moines sont retrouvés morts dans des circonstances plus
qu’inquiétantes. C’est alors que le frère Guillaume de Baskerville (à ne pas
confondre avec le chien du même nom !) est appelé afin de mener une enquête
et résoudre cette étrange série mortelle…
Ce premier tome débute par une introduction imaginaire en noir et blanc
d’Umberto Eco rappelant l’origine de son célèbre roman avant de placer le
cadre de l’action dans les escarpements abrupts menant à l’abbaye : neige,
pénombre et hauteurs vertigineuses du bâtiment campent un décor des plus
angoissants, et ce, grâce au dessin incisif de Milo Manara et à son art
éprouvé des contrastes entre lumière et pénombres. L‘atmosphère inquiétante
pour ne pas dire oppressante gagne rapidement le lecteur happé littéralement
par cette action policière menée tambour battant.
Une véritable réussite qui s’inscrit en droite ligne du célèbre roman !
Jules Buissonnet |
| |
 |
« Philiations – Tome 1 » de Gwen de Bonneval ; 19.5
x 25.8 cm, 224 p., Coll. « Aire Libre », Editions Dupuis, 2024.
Quelle surprise des plus agréables que de retrouver chez Dupuis Gwen de
Bonneval vu et raconté par Gwen de Bonneval lui-même ! Auteur complet,
dessinateur et/ou scénariste que l’on ne présente plus dans le monde de la
BD, il a été primé en 2000 au Festival d’Angoulême et a collaboré avec des
noms non moins connus tels que F. Vehmann, H. Tanquerelle, H. Micol… On se
souvient de « Messire Guillaume » en version intégrale avec au dessin
Matthieu Bonhomme et présenté, ici, il y a peu.
Aujourd’hui, dans le premier tome de ce diptyque nommé avec humour «
Philiations », Gwen revient sur son enfance, une enfance quelque peu
chahutée par une mère violente, un grand-père à la personnalité écrasante et
un père absent… Une fine introspection emplie d’amour et une « Philiation,
qu’il poursuit au présent en interrogeant son rôle de père dans notre monde
d’aujourd’hui tel qu’il ne va pas…
On l’aura compris, c’est aussi et surtout le lecteur que cet album aussi
tourné vers soi que vers les autres interroge. Qui a vraiment compté dans
notre passé, dans notre construction d’homme ou de femme ? Que veut-on,
peut-on transmettre ? Ce sont ces liens qui intéressent Gwen de Bonneval,
ainsi que l’annonce la construction originale du titre « Philiations » et
dont s’explique en ouverture l’auteur.
On soulignera également une mise en planche extrêmement attrayante et
sympathique, intercalant photographies d’époque et portraits tout de
rondeur. On sourit à l’empathie de l’auteur et à cette tendresse du récit
graphique. Le volume se referme sur ce mois d’octobre de 1979, Gwen à 6 ans…
en attendant avec une vive impatience le second tome.
Gilles Landais |
| |
 |
« Visage – Ceux que nous sommes » - Tome 4 –
Soleil, cou coupé » ; Scénario de Nathalie Ponsard-Gutknecht et Miceal
Beausang-O’griafa ; Dessin et couleurs Aurélien Morinière ; 24 x 32 cm,
Editions Glénat, 2024.
Quatrième et dernier tome de la série « Visages » déjà largement saluée, «
Soleil cou coupé » tient une nouvelle fois ses promesses. Inspiré de faits
réels et bouleversants, ce dernier volume entraîne son lecteur en 1944 dans
les sombres années de la Seconde Guerre mondiale et les camps de
concentration : Un orphelin, enfant de la honte, Georg, devenu sniper dans
l’armée allemande retrouve son père. Ensemble, ils partent à la recherche de
sa mère. Mais, celle-ci, journaliste opposante vient d’être arrêtée et
enfermée à Dachau…
Avec une mise en planche des plus dynamiques, des visages réalistes et
acérés et des jeux de couleurs que l’on doit à Aurélien Morinière, ce tome
tient son lecteur dans les griffes de l’Histoire et de l’intime,
entrecroisant les histoires et la complexité des liens tant familiaux
qu’humains.
Se développant sur trois générations, c’est avant tout la question de
l’identité qui a guidé les auteurs et scénaristes, Nathalie
Ponsard-Gutknecht et Miceal Beausang-O’griafa, pour cette série et ce volume
: ce que nous sommes ou plus subtilement « ceux que nous sommes »,
sous-titre de cet album. On l’aura compris, cet ultime volume ne saurait
laisser indifférent et entend bien questionner son lecteur sur les liens qui
nous unis aux autres et à nous même…
Gilles Landais
|
| |
 |
« Barcelona, âme noire » ; Scénario de Denis
Lapière et Gani Jakupi ; dessin de Rubén Pellejero, Martin Pardo et Eduard
torrents ; 23.7 x 31 cm, 148 p., Aire Libre, 2024.
A noter sur sa tablette, ce très bon récit graphique signé de pas moins de 5
auteurs, deux scénaristes et trois dessinateurs dont Denis Lapière et Rubén
Pellejero ; rien de moins pour cette extraordinaire saga débutant à la
sortie de la guerre civile espagnole lors des premières années de la
dictature franquiste jusqu’à sa mort en 1975 ; un récit familial dramatique
nous contant le triste destin d’un jeune homme, Carlitos Moreno, tiraillé
entre ce qu’il est et ce que l’atavisme familial aimerait qu’il soit…
148 pages dans lesquelles le lecteur se retrouve littéralement immergé,
happé par ce récit à la fois historique, familial et psychologique où
l’amour et l’aventure se côtoient pour mieux encore donner vie aux
personnages dans cette « Barcelona, âme noire ». Un très bel album que cela
soit la construction du récit que le traitement graphique de ce dernier ; Il
faut dire que le duo – Lapière / Pellejero n’en est pas chez Aire Libre à
ses débuts ; est-il besoin de rappeler : « Un peu de fumée bleue… », « Le
tour de valse » ou encore « L’impertinence d’un été »… Ils sont, ici,
rejoints par trois autres acolytes : Gani Jakupi pour le co-scénario, auteur
également bien connu chez Aire Libre avec « Le retour au Kosovo », et pour
les dessins Martin Pardo et Eduard Torrents, bien connu aussi chez Air Libre
pour avoir réalisé également en duo avec Denis Lapière « Le convoi »,
diptyque aujourd’hui réédité chez Dupuis en version intégrale. Une
association de dessinateurs de haut vol, donc, donnant pour cet album des
dessins nets et épurés d’une redoutable efficacité.
On l’aura compris rien ne semble avoir été laissé au hasard par nos cinq
comparses pour cette « Barcelona, âme noire ».
Gilles Landais |
| |
 |
« Les plus chouettes Histoires du Petit Spirou ––
Tome 1 – Tu racontes n’importe quoi ! » de Tome et Janry, Coll. « Tous
publics », 21,8 x 30 cm, 64 pages, Editions Dupuis, 2023.
On ne résiste pas à retrouver pas moins de neuf histoires du fameux « Le
Petit Spirou ». On y retrouve en ces pages toute la signature du duo de
légende, Tome et Janry, avec ce brin d’humour et de fraîcheur offrant au
Petit Spirou des aventures pleines de surprises ; des histoires choisies
quelques peu déconcertantes, saugrenues ou encore cocasses pour ce gamin
plein de candeur découvrant le monde des adultes… Et quelle émotion
effectivement lorsqu’on se retrouve dans le même lit que Zoé qui - du même
âge - ne sait pas viser lorsqu’elle embrasse sur la joue !
Ce sont véritablement « Les plus chouettes histoires du Petit Spirou », des
histoires drôles juste pour rigoler que nous offre avec bonheur cette
nouvelle série. Et il est si plaisant pour ce premier volume, que l’on soit
petit ou grand, d’entendre dire encore par Philippe Tome (Philippe
Vandervelde) parti trop tôt en 2019 et Janry : « Tu racontes n’importe quoi
! » -
Gilles Landais
|
| |
 |
« Les Grandes Batailles navales – Opium War » ;
Scénario de Jean-Yves Delitte ; Dessin de Q-HA ; Couleurs de Hiroyuki
Ooshima ; Co-édition Musée national de la Marine / Editions Glénat, 2023.
À noter la parution dans la fameuse et aujourd’hui incontournable série «
Les Grandes Batailles navales » de ce nouveau volume nommé l’ « Opium War ».
Mené, comme toujours, de mains de maître par Jean-Yves Delitte et Q-HA pour
les dessins. Est-il encore besoin de rappeler que Jean-Yves Delitte, peintre
officiel de la Marine, est aujourd’hui membre Titulaire de l’Académie des
Arts et Sciences de la mer ?!
Par les dessins soignés, le souci du détail et ces visages si expressifs, le
lecteur plonge littéralement dans cet univers particulier de l’Empire
chinois en ce milieu du XIXe siècle ; une période plus que troublée marquée
par des révoltes, des crises tant économiques que sociales et surtout une
impitoyable guerre de l’opium entraînant de nombreux affrontements avec le
Royaume-Uni, mais aussi la France et les États-Unis d’Amérique qui
déboucheront sur une guerre devenue alors inéluctable ; ce que les
historiens nommeront la Guerre de l’opium avec notamment cette célèbre
bataille navale de Fasthan Creek en 1857, le 1er juin précisément… Une
guerre qui ne s’arrêtera que 3 années plus tard en 1860 avec la convention
de Pékin.
Gilles Landais
|
| |
 |
« Spirou et la Gorgone Bleue » ; Scénario Yann ;
Couleur et dessin Dany ; Coll. « grand Public », 24 x 32 cm, 88 p., Editions
Dupuis, 2023.
Et si l’envie vous prenait de vous retrouver embarqué sur un porte-avion
avec Spirou et Fantasio ?! C’est dans cette étrange et divertissante
aventure que vous les retrouverez embarqués à leur insu sur ce porte-avion
de la US-Navy face à l’un des plus grands pollueurs, un producteur d’engrais
chimiques bien décidé à éradiquer un groupe d’écolo-terroristes financés par
- tenez-vous bien, rien que moins par le Comte de Champignac ; Eh Oui !,
lui-même ! Qui plus est, ce groupe est constitué à 100 % d’agents féminins
et son nom « La Gorgone Bleue » donne son titre à ce turbulent volume… signé
Dany et Yann !
Un duo de choc, donc, pour une aventure de Spirou dans l’esprit de la
légende et de Franquin, loin d’être - on l’aura compris - de tout repos…
péripéties, intrigues, rebondissements, humour et jolies filles, sans
oublier des thèmes d’actualité.
Est-il besoin de rappeler que Yann est présenté comme l’un des plus complets
scénaristes : « Véritable homme-orchestre du scénario, Yann est
insaisissable. » On le connaît, effectivement, pour son humour souvent
décapant et son insatiable curiosité. A ses côtés, aux couleurs et dessins,
le lecteur retrouvera avec bonheur, une nouvelle fois, Dany avec des dessins
dynamiques et explosifs à souhait !
Un régal… en attendant impatient « Le retour de la Gorgone noire ».
Gilles Landais |
| |
 |
« Lucky Luke – Tome 05 – Nouvelle Intégrale » René
Goscinny et Morris ; Coll. « Patrimoine », 21,8 x 30 cm, 208 p., Editions
Dupuis, 2023.
À noter absolument la parution du Tome 05 de l’incontournable « Nouvelle
intégrale – Lucky Luke », on ne doit pas en effet manquer un tel volume !
C’est avec un plaisir inégalé que le lecteur retrouvera dans ce nouveau
volume de prés de 210 pages, pas moins de trois récits, des récits parmi les
plus célèbres de Lucky Luke : « Le Juge », « Ruée sur l’Oklahoma » et « L’Évasion
des Dalton ». Des albums mythiques signés Goscinny et Morris parus à la fin
des années 50 – 60 après la publication des « Cousins Dalton » dans le «
Journal de Spirou » ; époque durant laquelle Morris eut l’heureuse idée de
choisir Goscinny pour scénariste avec le succès que l’on connaît…
Avec ces trois aventures, les iconiques personnages que sont Lucky Luke, les
Dalton et le non moins fameux juge avec son chapeau s’affirment et
s’imposent donnant à la série une originalité indépassable. Clins d’œil,
subtilités et humour donnent alors le ton et ouvrent l’espace du monde de la
bande dessinée aux adultes et par là même à tout public. Et quel régal de
retrouver aujourd’hui cette époque bénie et ces indémodables aventures du
monde de la BD !
À ces trois albums, le lecteur aura, qui plus est, la joie de découvrir en
ouverture un riche et instructif dossier réalisé par Bertrand
Pissavy-Yvernault dévoilant plus d’un secret…
Gilles Landais |
| |
 |
«
Michel Vaillant – Légendes -Tome 2 - L'âme des pilotes » de Lapière et
Dutreuil, Graton, 2023. Le duo Lapière et Dutreuil perpétue le souffle Michel Vaillant avec cette
nouvelle parution « L’âme des pilotes » Tome 2 parue chez Graton. Autant
dire que le rythme sera enlevé et la puissance des grosses cylindrées au
diapason de ce nouvel opus faisant revivre la magie du Grand Prix de Monaco
en 1971, nostalgie, nostalgie… Mais tout ne baigne pas dans l’huile… de
moteur !
Dans le camp Vaillant, de nombreux problèmes techniques du moteur ont même
été la cause d’un accident en Espagne lors d’une course hantant encore
Michel. Nous retrouvons dans ces pages au dessin d’une haute virtuosité une
mise en planche toujours aussi attractive, véritable plaisir des yeux
renouvelé avec ces couleurs chatoyantes, ces bolides dont nous percevons
presque le bruit et le vent laissés par leur passage…
« L’âme des pilotes », c’est également un scénario serré qui ne laisse pas
de place au hasard avec une intrigue des plus séduisantes et qui tiendra le
lecteur en haleine jusqu’à la dernière planche. Pour quelles raisons ces
moteurs percent-ils si rapidement après une heure de course ? Quel est le
rôle de ce mystérieux Américain aux abois ? La course ne se jouera pas que
sur le circuit de Monaco, tant s’en faut, pour une aventure trépidante au
sens propre comme au figuré !
Jules Buissonnet
|
| |

|
«
L’Aigle à deux têtes - Tome 5 - « Le dernier des aigles » de Wallace et
Julien Camp, Zéphir, 2023.
« « L’Aigle à deux têtes - Tome 5 - Le dernier choix » de Patrice Buendia et
Damien Andrieu, Zéphyr, 2023.
Avec Adler et
Eagle, les deux séries jumelles à succès, rangées toutes deux sous la
dénomination « L’Aigle à deux têtes », trouvent leur conclusion avec ces
deux derniers tomes (5).
Pour quelles raisons proposer deux séries conjointes ? Tout simplement afin
d’offrir sur le même thème – la Seconde Guerre mondiale – le point de vue
d’un pilote allemand et d’un pilote américain ! Cet angle fécond et
particulièrement bien traité des deux côtés de chaque camp tiendra le
lecteur en haleine grâce au talent conjugué de Wallace et Julien Camp côté
américain et Patrice Buendia et Damien Andrieu côté allemand…
Le débarquement de Normandie est déjà bien entamé lorsque le pilote James O’Brady
pose le pied en France avec le souhait de retrouver Esther, son amour… Mais
son éternel rival Hans demeure en lien étroit avec James, car si chacun a
retrouvé son corps, leur identité demeure toujours aussi étroitement
associée !
Cet imbroglio ne pourra que conduire à un ultime combat afin de départager
les deux prétendants. Deux numéros à dévorer conjointement pour des scènes
aériennes époustouflantes et un suspens unique.
Jules Buissonnet |
| |
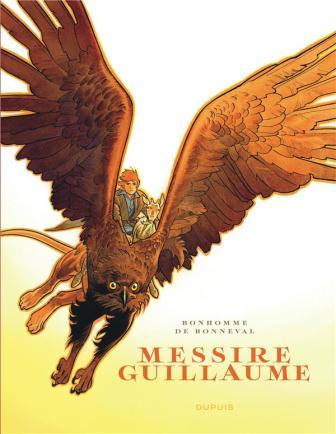 |
« Messire Guillaume – Récit complet » ; Scénario
Gwenn de Bonneval ; Dessins Matthieu Bonhomme, Coll. « Grand Public », 24 x
32 cm, 168 p., Editions Dupuis, 2023.
Nous sommes nombreux à nous réjouir et à saluer la parution chez Dupuis de
l’intégralité de « Messire Guillaume », cette fois-ci en couleur, et quel
plaisir !
Ce récit inspiré et initiatique d’un orphelin, Guillaume, donné pour
inconsolable, mais qui mènera cependant sa destinée jusqu’au plus fabuleux
des mondes a, en effet, lors de sa sortie en trois tomes véritablement
enchanté. Donné aujourd’hui pour encore plus de rêve et d’évasion à
découvrir en couleurs et plongé dans un univers médiéval et fantastique, le
lecteur suivra les fantastiques aventures vers l’âge adulte de cet
adolescent « Messire Guillaume » désirant faire le deuil de son père…
Signé Gwen de Bonneval, ici, au titre de scénariste, cet album intégral
offre un extraordinaire voyage entraînant son lecteur dans des contrées
aussi diverses que lointaines. Pour ce voyage en un seul volume paru
initialement seulement en noir et blanc en 2006, Gwen de Bonneval était
rejoint par Mathieu Bonhomme pour les dessins ; un duo sans faute. Le
lecteur pourra apprécier, outre l’expressivité des personnages, la variété
et diversité des trouvailles graphiques aujourd’hui rehaussée par la non
moins fantastique mise en couleurs de Walter. Le lecteur y découvrira
également des planches inédites, ainsi qu’un très bel et long entretien tout
aussi inédit avec les auteurs.
Un fabuleux album intégral couleur, donc, pour un extraordinaire voyage en
compagnie de « Messire Guillaume » ! Est-il besoin de rappeler que ce
fantastique récit a reçu le prix Intergénérations au festival international
d’Angoulême en 2010 ?Gilles Landais |
| |
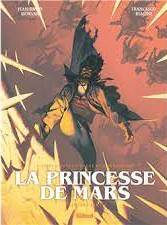 |
« La princesse de Mars – Tome 01 » d’après l’œuvre
d’Edgar Rice Burroughs ; Scénario de Jean-David Morvan ; Dessin de Francesco
Biagini ; Editions Glénat, 2023.
Nombreux seront ceux qui seront ravis de découvrir en BD « La Princesse de
Mars », cette incontournable histoire signée au siècle dernier par le fameux
auteur américain Edgar Rice Burroughs (1875-1950). C’est en effet une
heureuse initiative qu’ont eue les éditions Glénat d’adapter ce roman
indémodable, précurseur de la science-fiction, avec aujourd’hui aux
commandes pour ce diptyque, Jean-David Morvan pour le scénario et Francesco
Biagini pour les dessins.
L’histoire de « La Princesse de Mars » est le récit fantastique d’un soldat,
John Carter, propulsé sur la planète Mars et confronté aux différentes
tribus habitant la planète rouge ; là, il découvre un monde des plus
déroutants et mystérieux qu’il tente de comprendre et d’apprivoiser… Captif
des cruels martiens verts, il saura cependant sauver sa peau en s’imposant
avant de tomber amoureux d’une belle et séduisante prisonnière, la princesse
Dejah Thoris de la tribu rouge... Carter apprendra alors l’histoire de la
fameuse planète rouge nommée pas ses habitants, Barsoum...
C’est une adaptation à la fois fidèle et revisitée des plus réussies que
nous propose pour ce premier volume Jean-David Morvan, que l’on ne présente
plus dans le monde de la BD ! Avec, ici, une mise en planches éblouissante
aussi originale que dynamique, le célèbre roman d’Edgar Rice Burroughs
trouve incontestablement une version de choix ; une adaptation que viennent
admirablement illustrer les dessins soignés de Francesco Biagini. Cela donne
un album véritablement flamboyant !
L’auteur américain de ce fantastique récit, Edgar Rice Burroughs, auteur
également de « Tarzan seigneur de la Jungle », est considéré comme l’un des
plus grands auteurs américains populaires, précurseur de la science-fiction,
à l’origine de nombre de courants que ce soit le genre planet-opera ou de la
fantasy… Le récit de la « princesse de Mars », deuxième roman de Burroughs,
fut publié d’abord en feuilleton en 1912 aux États-Unis ; devant le succès
du roman, il deviendra le premier d’une longue série publiée et connue sous
le nom du « Cycle de Mars ». Il sera publié en France en 1938 et ne cessera
depuis de connaître versions et adaptations que ce soit pour le cinéma ou
aujourd’hui le monde la BD. L’histoire d’un succès que le lecteur retrouvera
dans le riche dossier signé Patrice Louinet en fin de volume.
Une série à ne pas manquer et dont on attend en piaffant le second tome !
Gilles Landais |
| |
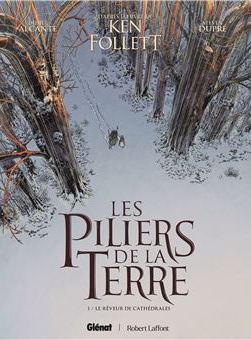 |
« Les Piliers de la Terre - Tome 1/6 – Le Rêveur de
Cathédrales » ; Scénario Didier Alcante ; Dessin de Steven Dupré ; 24 x 32
cm, 104 p., Editions Glénat, 2023.
« Les Piliers de la Terre » - Un titre qui sonne bien sûr immédiatement à
l’oreille pour cette nouvelle série en six tomes au succès assuré tant ses
atouts sont nombreux, jugez-en !
Cette série au nom si connu est effectivement inspirée du célèbre roman
historique de Ken Follett ; Adaptée aujourd’hui pour la première fois en BD,
cette nouvelle série chez Glénat est par ailleurs et surtout signée Steven
Dupré pour les dessins et Didier Alcante pour l’adaptation et le scénario.
Entre ce duo gagnant le traducteur, Jean Rossenthal, Nicolas Ruffini-Ronzani
de l’Université de Namour au titre de conseiller historique, le coloriste
Jean-paul Fernandez, sans oublier Q. Swysen pour la modélisation 3D et P.
Chailleux pour le lettrage, avouez que le générique présage du meilleur !
Et tel est bien le cas, avec ce premier tome « Le Rêveur de Cathédrales ». A
peine ouvert, la magie opère, le lecteur se retrouve transporté au XIIe
siècle, au temps des bâtisseurs de cathédrales. Il y retrouvera les fameux
personnages de la célèbre saga et croisera, Tom, modeste bâtisseur dans un
Royaume d’Angleterre englué dans les guerres et la famine. Supportant misère
et deuils et échappant lui même de peu à la mort grâce à la jeune et rebelle
Ellen, Tom rêve de construire la plus belle et la plus grande des
cathédrales…
C’est effectivement une adaptation des plus réussies que nous livre, ici,
Didier Alcante de la fresque historique du célèbre auteur britannique. Avec
un scénario pensé, une mise en planche dynamique et pleine de contrastes, le
lecteur retrouvera tout l’univers de cette œuvre de Follett au succès
mondial, un univers à nul autre pareil mais reposant cependant sur des
fondements historiques et ayant inspiré bien des adaptations pour le cinéma,
la TV ou encore les jeux vidéo depuis sa publication en 1989. A l’instar de
l’œuvre de l’auteur toujours extrêmement bien informé, documenté et
conseillé, nous retrouvons de la part des auteurs pour ce premier volume le
même souci de l’Histoire avec pour conseiller le professeur Nicolas
Ruffini-Ronzani spécialiste de l’époque médiévale, mais aussi de fidélité au
récit avec ses tensions, ses rebondissements et ses si célèbres personnages…
Un univers en soi que les splendides dessins de Steven Dupré, toujours aussi
soignés et maîtrisés, restituent plus admirablement. Le lecteur est
littéralement happé !Gilles Landais |
| |
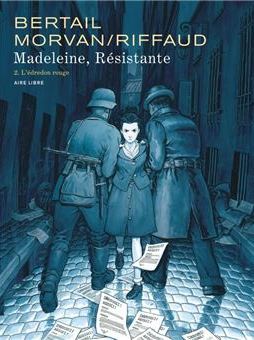 |
« Madeleine, Résistante – Tome 2 – L’Édredon rouge
» de Madeleine Riffaud ; scénario de Jean-David Morvan ; Dessin de Dominique
Bertail ; 23.7 x 31 cm, 136 p., Éditions Aire Libre, 2023.
Le tome premier de cette trilogie, « Madeleine, Résistante », a été l’un des
albums les plus salués de l’année 2021, aussi est-ce avec impatience et
émotion que nous retrouvons le deuxième volet de la vie de Madeleine Riffaud,
véritable résistante durant la Seconde Guerre mondiale, torturée et
plusieurs fois condamnée à mort. Ce sont, en effet, les vrais souvenirs de
Madeleine jeune fille lorsque cette dernière entre à Paris en 1944 dans la
résistance que le lecteur découvrira, ici, dans ce deuxième tome « L’Édredon
rouge » avec un scénario de Jean-David Morvan et toujours au dessin,
Dominique Bertail.
Madeleine aura maintenant pour nom de code « Rainer », et témoigne dans cet
album de la barbarie nazie et du combat mené par la Résistance ; son maquis
sera Paris – « Moi, je vous raconte mon maquis. Et mon maquis, c’est Paris.
», dira-t-elle. Elle se souvient de ce quotidien fait de discrétion, bien
sûr, mais aussi d’actions et de risques ; Elle se souvient aussi de ses
compagnons : Picpus, surtout, avec qui elle partagea son amour de la poésie
et de sa rencontre avec le célèbre Réseau de Résistance Manouchian… une
mémoire sans faille donnée à lire avec émotions par Jean-David Morvan et à
voir avec le même souci du détail et de vérité par les dessins de Dominique
Bertail.
La rudesse du quotidien, des joies, des victoires, mais aussi des drames et
des deuils que Madeleine Riffaud entend bien aujourd’hui dans notre ce XXIe
siècle chaotique rappeler à ceux qui, trop jeunes, ne peuvent se souvenir,
mais ne doivent pas pour autant oublier, et à ceux ayant aussi
malheureusement la mémoire trop courte… Madeleine Riffaud continue ainsi de
nos jours son engagement avec, ici, pour complices Jean-David Morvan et
Dominique Bertail pour ses splendides dessins réalistes si bien maîtrisés
notamment ces vues de Paris avec ses pavés mouillés, Montmartre, la Sorbonne
ou encore Courbevoie…
A lire absolument, que dire de plus !
Gilles Landais |
| |
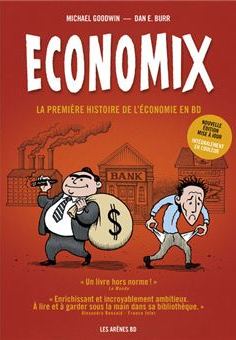 |
« Economix » de Michael Goodwin et Dan EE. Burr ;
Traduit de l’américain par Hélène Dauniol-Renaud, 352 p., Editions Les
Arènes BD, 2023.
On ne peut que saluer cette nouvelle édition augmentée et colorisée de la
fameuse BD « Economix ». Si ceux qui en connaissent le succès depuis sa
première édition en 2013 n’hésiteront sûrement pas à actualiser avec cette
nouvelle version leurs connaissances, on ne peut cependant qu’inviter ceux
qui ne la connaissent pas encore à courir la découvrir ! Car, force est de
constater que cette première histoire en BD de l’économie, qui fête donc
aujourd’hui ses dix ans, est une véritable réussite. Les auteurs, Michael
Goodwin et Dan E. Burr pour les dessins, ont par un tour de force de
pédagogie et d’ingéniosité graphique réussi à relever une fois de plus un
beau défi, celui de raconter de manière claire, ludique et accessible plus
de quatre siècles d’économie...
Dans cette nouvelle version, le lecteur découvrira ainsi pas moins de 40
nouvelles planches notamment le Brexit, la montée de populismes ou encore la
guerre en Ukraine, mais aussi la problématique du réchauffement climatique
sans oublier le caustique épilogue… Nous avons particulièrement apprécié les
citations, les données des sources et autres précisions ou astérisques…
Certes, certains trouveront toujours quelques points à développer ou
souligneront les analyses parfois trop américaines ou engagées. Reste que
cette dernière version, s’attaquant aussi bien à l’histoire de l’économie, à
l’économie politique qu’aux politiques économiques notamment de nos
dernières décennies, œuvre incontestablement pour une meilleure
compréhension de l’histoire de l’économie, et par là même de notre monde
d’aujourd’hui, celui avec lequel nous préparons l’avenir… Une belle gageure.
Gilles Landais |
| |
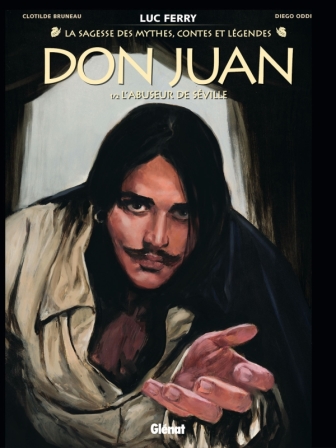 |
« Don Juan – Tome 1/2 – L’abuseur de Séville »,
Coll. « La sagesse des mythes, contes et légendes » sous la direction de Luc
Ferry ; Scénario de Clotilde Bruneau, Dessin et story-board de Diego Oddi ;
Direction artistique par Didier poli ; Couleurs de Ruby, Couverture de Paolo
Grella ; 24 x 32 cm, 56 p., Editions Glénat, 2023.
Dans la série si plébiscitée « La sagesse des mythes, contes et légendes »
sous la direction du philosophe Luc Ferry, c’est avec plaisir que les
lecteurs découvriront le célèbre et incontournable personnage de légende : «
Don Juan », présenté, ici, en 2 volumes.
Pour ce premier tome - intitulé « L’abuseur de Séville » - nous retrouvons
pour commencer les frasques de ce séducteur impénitent qu’est Don Juan
parcourant les routes d’Italie, de Naples, mais aussi d’Espagne… Sans
scrupules, accumulant les conquêtes, promettant le mariage et s’enfuyant
jusqu’à Séville…
Soulignons que pour ce diptyque, Luc Ferry a fait choix de revenir et de
retenir, non la célèbre pièce de Molière, mais celle de Tirso de Molina
(1579-1648), grand auteur du Siècle d’or espagnol, moine de son état ; un
choix en faveur d’une version, certes, moins connue en France et pourtant à
l’origine du non moins célèbre personnage de Don Juan, avant qu’il ne soit
repris en Italie, puis par Molière. Avec un découpage et des dessins
soignés, réalistes et sans merci de Diego Oddi, le lecteur découvrira dans
ce scénario signé Clotilde Bruneau un Don Juan plus démoniaque encore que le
séducteur sans scrupules, sans loi ni morale de Molière…
Don Juan est un personnage assurément de légende et cet album accompagné de
son dossier « Énigmatique Don Juan, démoniaque ou libertin ? » en témoigne !
Gilles Landais |
| |
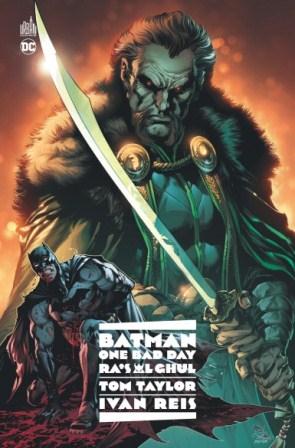 |
« Batman – One bad day : Ra’s al Ghul » ; Scénario
de Tom Taylor, Dessin d’Ivan Reis ; Coll. DC Deluxe, 72 p., Urban Comics
Editions, 2023.
La série « One bad day » s’enrichit encore avec un nouvel album mettant en
scène Batman et Ra’s al Ghul ; c’est dire combien ce nouvel opus promet
d’être décapant !
Ra’s al Ghul a pendant des siècles tenté de sauver la Terre de la perdition
en éliminant tous les responsables de cette inexorable destruction ; mais,
en vain, tant les obstacles étaient et sont encore nombreux… Cependant,
aujourd’hui, après une nouvelle renaissance et se souvenant des drames de
son passé, Ra’s al Ghul a décidé, quoi qu’il arrive, d’apporter paix et
prospérité à la Terre et d’éliminer s’il le faut le fameux détective du
Gotham…
Signé Tom Taylor pour le scénario et Ivan Reis pour les dessins, « Batman –
One bad day : Ra’s al Ghul » se veut – on l’aura compris - un hommage au «
Killing Joke » d’Alan Moore et de Brian Bolland. Mettant en scène l’un des
plus mystérieux ennemis de Batman, Tom Taylor a retenu, ici, un scénario des
plus explosifs illustré à merveille par un découpage et des dessins non
moins hallucinants d’Ivan Reis. On doit à ce dernier, ici encore, des
cadrages magnifiques avec un ancrage de Danny Miki et idéalement rehaussés
par les couleurs de Brad Anderson.
Bien qu’implacable, le lecteur retrouvera dans cet album les valeurs –
écologie, transmission, filiation - pour lesquelles Taylor s’est fait
connaître dans l’Univers DC.
Gilles Landais
|
| |
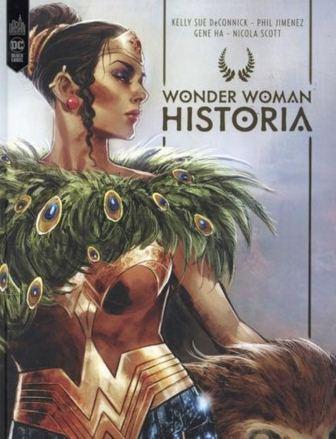 |
« Wonder Woman Historia » ; Scénario de Kelly Sue
DeConnick ; dessin de Phil Jimenez, Gene Ha et Nicola Scott ; Coll. « DC
Black Label », 256 p., Editions Urban Comics, 2023.
Un album véritablement inouï ! avec des pages, une mise en planche, un
découpage et des dessins effectivement époustouflants dans des couleurs
choisies pour un scénario captivant signé Kelly Sue DeConnick.
« Wonder Woman Historia » offre, ici, une réinterprétation libre et
audacieuse de la mythologie grecque et des fameuses Amazones de la Grèce
antique, livrant au lecteur des déesses très décidées à revoir le genre
masculin que ce soit celui des Dieux ou des hommes. Avec un programme donné
pour infaillible, la reine Hera et ses déesses projettent ainsi un monde
inédit, un monde d’Amazones… Mais, un tel plan ne pouvait, on s’en doute,
que susciter la colère des Dieux…
Avec un scénario des plus dynamiques reprenant les 3 tomes de « Wonder Woman
Historia », Kelly Sue DeConnick, qui livre avec cet album son premier grand
récit chez DC, donne à découvrir un récit bien rythmé et haut en couleur de
la guerre entre Amazones et Dieux. Une guerre sans merci qu’ont su rendre à
merveille Phil Jimenez, Gene Ha et Nicola Scott. Une complicité de plume que
le lecteur appréciera à sa juste valeur.
Avec, qui plus est, son « Guide des Tribus Amazones » en fin de volume, cet
album de plus de 250 pages ne pourra qu’émerveiller !
Gilles Landais |
| |
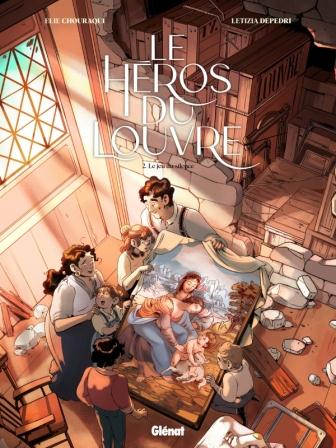 |
« Le Héros du Louvre – Tome 2 – Mon Grand-père, ce
héros ! » d’Elie Chouraquie avec des dessins de Letizia Depedri ; Cartonné,
Coll. « Hors Collection », 21.5 x 29.3 cm, 64 p., Editions Glénat, 2023.
C’est une belle histoire que nous compte le scénariste Elie Chouraqui, celle
de son grand-père, Babi Maklouf, arrivé en France dans les années 30…
Souvenons-nous que devenu gardien de nuit au Louvre, et alors que la Seconde
Guerre mondiale a éclaté, le conservateur du musée, Jacques Jaujard lui a
demandé de fuir la capitale avec femme et enfants en emportant avec lui à
bord d’un camion les plus grands chefs d’œuvres du Louvre…
Ici, dans ce second tome, Babi est enfin sur les routes de France… mais
mille soucis et dangers l’attendent, l’armistice annoncée par Pétain, une
France occupée et divisée sans oublier le quotidien, trouver à manger,
s’occuper des enfants ; bref, survivre coût que coût avec pour bagage des
chefs-d’œuvre… Babi arrivera-t-il avec sa famille et les tableaux à bon port
?...
Appuyé, pour cette première BD chez Glénat, par des dessins joliment
expressifs de Letizia Depedri, c’est un récit véridique et un grand-père
assurément amoureux de la France, de la culture de la France, plus que
courageux et loyal que le lecteur découvrira dans ces pages tirées de
l’Histoire, de son histoire, le titre de ce second tome « Mon grand-père, ce
héros ! » n’étant en rien usurpé. Et c’est avec émotion que l’on cède
volontiers à l’injonction de l’auteur, Elie Chouraqui : « Imaginer le
grand-père parfait et vous verrez apparaître devant vos yeux, Babi. »
Un très bel hommage à partager avec le plus grand nombre, petits et grands !
Gilles Landais |
| |
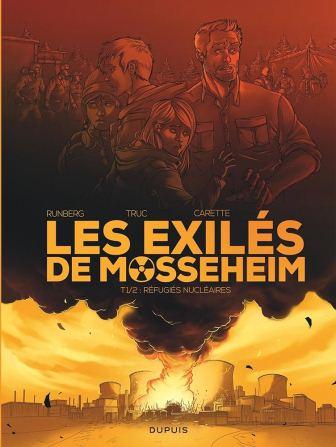 |
« Les Exilés de Mosseheim – Tome 1 – Réfugiés
nucléaires » de Sylvain Runberg, Olivier Truc et Julien Carette ; Coll. «
Grand Public », 24 x 32 cm, 88 p., Éditions Dupuis, 2023.
Un diptyque des plus tragiques qui a décidé de ne rien nous épargner ! Cela
commence, en effet, par un attentat suicide sur la centrale de Mosseheim en
Alsace, une catastrophe nucléaire comme on en a jamais vue en France (et
qu’on espère ne pas en voir !...), cinq millions d’Européens ont ainsi
basculé en quelques minutes dans un véritable cauchemar… C’est dans ce
contexte d’effondrement général, des frontaliers et de l’Europe que la
famille Murat et leurs enfants, fuyant la zone radioactive, va prendre le
chemin de l’exil pour un des camps géants de Suède où les tensions
diplomatiques et humaines seront à leur comble…
Signé à six mains, ce premier épisode retiendra assurément l’intention tant
le déroulé est d’un réalisme époustouflant avec un découpage fonctionnel et
un centrage sur les personnages. Nos compères et auteurs, Sylvain Runberg,
Olivier Truc et Julien Carette affichent pour cette réalisation une belle
complicité avec un récit non dénué de valeurs et de questionnements ; sur
fond de crise sécuritaire, nucléaire et migratoire, notre petite famille
exilée et dorénavant au statut de « réfugiée » en pays étranger aura bien du
mal à se frayer un digne chemin, et le lecteur ne sortira peut-être pas
indemne de sa lecture… Eh, oui, vous, qu’auriez-vous fait ?... Vous
exaspérez, certes, peut-être, mais après ?!...
On ne peut qu’avec impatience attendre le second tome de ces « Exilés de
Mosseheim » !
Gilles Landais
|
| |
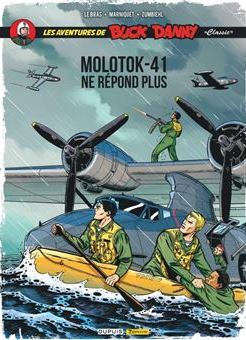 |
« Buck Danny Classic – Tome 10 – Molotok 41 ne
répond plus » ; Scénario de Frédéric Zumbielh et Frédéric Marniquet ; Dessin
d’André Lebras ; Coll. « Zéphir », 24 x 32 cm, 48 p., Editions Dupuis, 2023.
Rien ne va plus avec le tome 10 de Buck Danny Classic - suite et second
volet du diptyque débuté par « Le Vol du Rapier », « Molotok 41 ne répond
plus »!
Nous sommes maintenant en 1958, Buck Danny n’a toujours pas réussi à
délivrer nos savants atomistes américains enlevés par l’URSS, 7 ans
auparavant. Mais, il faut avouer que rien ne se passe comme prévu :
revirements, situations désespérées et incroyables échappées aériennes ou
autres… Buck Dany arrivera-t-il à déjouer les redoutables sbires du SMERSH,
le service de contre-espionnage de l’armée rouge… ?
Rappelons que pour ce nouveau diptyque, Frédérique Zumbielh et Frédéric
Marniquet se sont documentés auprès de Samuel Prétat et inspirés de faits
historiques, la disparition réelle en Atlantique Nord de savants atomistes
en 1951, une histoire toujours pas à ce jour élucidée.
Appuyé par les dessins à la ligne claire toujours impeccablement soignés
d’André Lebras, ce second volet qui vient clore le cycle « Dans les griffes
du SMERSH » offre une nouvelle poursuite époustouflante dans laquelle le
lecteur tenu en haleine devra bien s’accrocher…
Gilles Landais |
| |
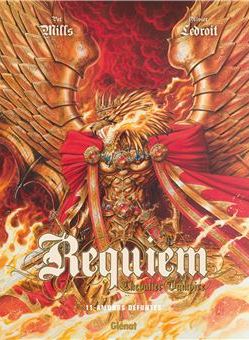 |
« Requiem – Tome 11 – Amours défuntes » ; Scénario
de Pat Mills ; Dessin et couleur d’Oliver Ledroit ; Cartonné, 24 x 32 cm, 56
p., Coll. « 24x32 », Editions Glénat, 2023.
« Requiem, Chevalier Vampire » continue pour le plus grand bonheur de ses
aficionados avec un tome 11 très réussi intitulé « Amours défuntes » et dans
lequel ce dernier poursuit son désir de retrouver Rebecca, alors qu’elle
erre en enfer… Dans un Berlin dévasté, Rebecca croise Dragon, un ami a
priori de Requiem, mais tel le scorpion au milieu du fleuve, celui-ci
pourra-t-il faire fi de sa nature de vampire ? Alors qu’une tempête des
limbes sur Résurrection vient de séparer dans leur combat Requiem et Leah,
réapparaissent aux abords du château de la comtesse Bathory, non seulement
Dame Mitra, mais aussi Dame Vaudou…
Le lecteur habitué à Requiem appréciera une fois de plus la qualité et le
dynamisme de la mise en planche de ce nouveau volume. Les couleurs et
dessins d’Oliver Ledroit, travaillés et soignés, impressionnent encore, même
après plus de 10 tomes ! Décidément, Requiem est un monde en soi à nul autre
pareil… Un tome venant compléter sans rupture une série devenue culte.
Gilles Landais |
| |
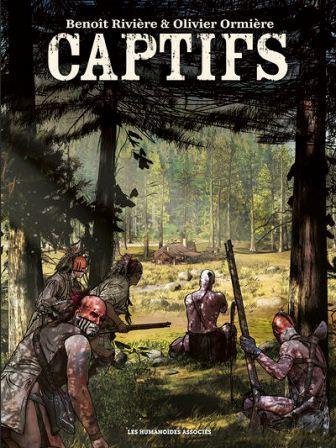 |
« Captifs » ; Scénario de Benoît Rivière ; Dessin
d’olivier Ormière ; Couleur de Silvia Fabris ; Cartonné, 24 x 32 cm, 112 p.,
Éditions Les Humanoïdes Associés, 2023.
A souligner la parution chez Les Humanoïdes associés d’une captivante
fiction inspirée d’une histoire vraie vécue par une famille anglaise dans
l’Amérique du XVIIIe siècle. Elle commence précisément à l’été 1754 en
Nouvelle-Angleterre lorsque les Johnson - des colons et fermiers anglais -
sont attaqués par des Indiens ; James Johnson et son épouse enceinte,
Susanna, seront capturés avec leurs trois enfants et emmenés par cette tribu
dénommée Abénaquis ; ils seront alors réduits en esclavage avant d’être
vendus à Montréal aux Français alors que ces derniers s’opposent à cette
époque aux Anglais pour ce Nouveau-Monde… « Captifs », les Johnson et leurs
trois - et peut-être quatre - enfants pourront-ils tous survivre à ce
véritable cauchemar?
Inspiré librement d’une histoire de captivité et d’esclavage dramatique
réellement vécue dans cette Amérique du Nord au XVIIIe s., cet album retient
indéniablement son lecteur en haleine jusqu’à la dernière des 112 pages.
Traité sous forme de fiction, les auteurs - Benoît Rivière au scénario et
Olivier Ormière pour les dessins – se sont inspirés du « Récit d’une captive
en Nouvelle-France 1754-1760 » écrit réellement par Susannah Johnson à la
fin du XIXe siècle et traduit seulement en 2005 en français. Le lecteur
trouvera un extrait de ces mémoires dans le dossier « Dans l’atelier des
auteurs » en fin de volume.
Le scénario, mené de mains de fer par Benoît Rivière, est mis en valeur par
une mise en planche minutieuse dans laquelle s’intègrent parfaitement les
dessins réalistes et tout aussi soignés d’Olivier Ormière. Mille détails
retiennent le regard sans oublier le travail de colorisation de Silvia
Fabris.
Tribu amérindienne, colonisation du Nouveau-Monde, guerre entre les Français
et les Anglais…ce sont bien des thématiques porteuses que le lecteur
découvrira au fil de cette aventure dramatique et de cet album informé et
soigné.
Gilles Landais |
| |
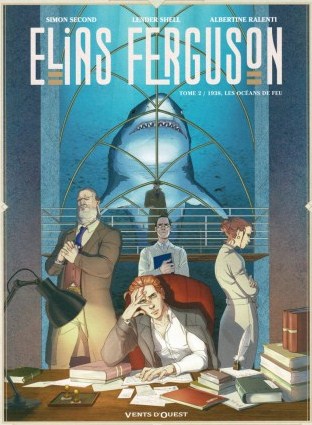 |
« Elias Ferguson – Tome 2 – 1938, Les Océans de feu
» ; Scénario de Simon Second ; dessin de Lender Shell ; Couleur d »Albertine
Ralenti ; Coll. « 24x32 », Éditions Vents d’Ouest, 2023.
Après l’heureuse découverte de « L’Héritier », premier album de cette
nouvelle série - « Elias Ferguson » - aux éditions Vents d’Ouest, c’était
avec impatience que nous attendions déjà le tome 2 ; c’est chose faite avec
ce deuxième volume intitulé « 1938, Les Océans de feu ».
Comme son titre l’indique, nous sommes maintenant en 1938, en hiver 1938,
Ferguson a repris l’entreprise familiale et les ambitions de son cher père :
la construction d’un incroyable train sous-marin reliant les USA à l’Europe
progresse… Mais c’est sans compter les embuches, sabotages, difficultés et
intimidations qu’Elias devra subir et braver ; Ferguson arrivera-t-il à
mener à bien cet extraordinaire rêve paternel ? Pour l’heure, il se propose
de mettre à la disposition du savant allemand juif Kurt Spire le
Transatlantique afin de l’amener aux États-Unis, ce dernier détenant des
informations capitales qui pourraient bien changer le cours du monde en
cette année 1938… Une traversée qui ne va pas être sans périls tant pour le
scientifique juif que pour Elias… Arriveront-ils à sortir indemnes des
abysses de ces « Océans de feu » ?
Avec un scénario bien ficelé et maitrisé signé de nouveau Simon Second, ce
nouvel album continue à tenir son lecteur en haleine du début jusqu’à la
fin. Suspens, actions et rebondissements sont au rendez-vous avec une mise
en planche efficace servie par la plume de Lender Shell ; les dessins au
trait sec, aux portraits expressifs et à la gestuelle étudiée offrent, en
effet, une belle mise en action alors qu’en cette année 1938 le cours de
l’Histoire se joue…
Un deuxième album qui vient agréablement confirmer le succès rencontré dès
le premier volume par cette nouvelle série « Elias Ferguson ». À suivre
donc…
Gilles Landais
|
| |
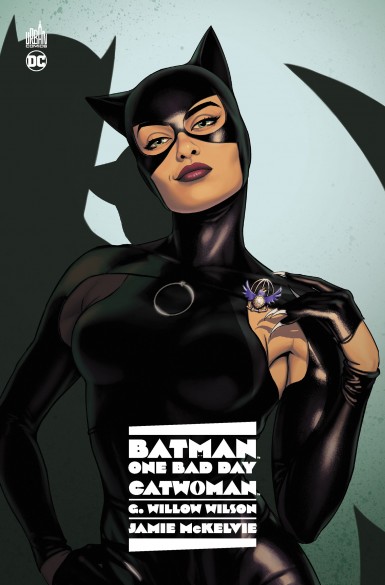 |
« Batman – One bad day : Catwoman » ; Scénario de
G. Willow Wilson; Dessin de Jamie Mckelvie; Coll “DC Deluxe”, 72 p.,
Editions Urban Comics, 2023.
On ne résiste pas à une plongée des plus folles dans l’univers le plus
ambivalent de Batman, celui de Catwoman…
Car, c’est bien dans cet univers avant tout féminin que nous entraîne avec
cet album intitulé à juste titre - « Batman – One bad day – Catwoman » - la
scénariste G. Willow Wilson connue dans le monde de la BD et du DC pour ses
héroïnes féminines et engagements. Un scénario complet tendant à nous
révéler comment une mauvaise journée, « One bad day », peut parfois suffire
à faire basculer la vie d’une femme, en l’occurrence de Selina Kyle /
Catwoman … Car lorsque Catwoman apprend que sa mère, lorsqu’elle était
encore adolescente, a dû laisser à un prêteur à gage un bijou de famille
aujourd’hui donné pour inestimable, Catwoman décide alors de reprendre ce
trésor coût que coût et quoiqu’il arrive… Une décision qui pourrait bien
déterminer le cours de son existence…
Car « A un moment donné, on comprend que personne ne nous rendra ce que
l’histoire nous a pris », ainsi commence l’album, ouvrant sur un scénario
sans merci, ambivalent et félin, servit avec brio, ici, par les dessins,
l’encrage et les couleurs tout aussi impitoyables de Jamie McKelvine.
Comment effectivement résister à cet album voulu tel un hommage à Alan Moore
et Brain Bolland pour leur « Killing Joke » ?
Gilles Landais |
| |
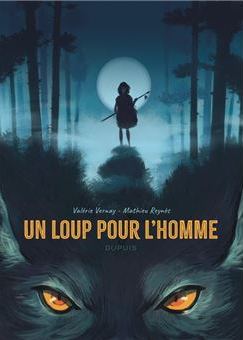 |
« Un Loup pour l’homme » ; scénario Mathieu Rynès ;
Dessin et couleur Valérie Vernay ; Coll. « Grand Public », 21.8 x 30 cm, 184
p., Editions Dupuis, 2023.
C’est une captivante et bien étrange fable que nous livrent aujourd’hui aux
éditions Dupuis Mathieu Reynès et Valérie Vernay après le succès de «
Mémoire de l’eau » : Celle d’un étrange animal rodant, dans la France rurale
des années 20, sur les terres d’un riche et terrible propriétaire terrien,
Léopold Baron, qui voit se succéder soucis et problèmes… N’a-t-il pas, il
est vrai, quelque temps auparavant agressé une de ses employées et fait
chasser la petite fille de celle-ci, Maya ; Maya qui dès lors devra vivre ou
plutôt survivra dans la forêt avec les loups… Que penser, que déduire ?
Simples coïncidences, sortilèges ou autre chose encore… ?
On l’aura compris cet album merveilleusement illustré par les dessins et
couleurs de Valérie Vernay pose le fameux débat du « Loup pour l’Homme »…
Fort de ses 184 pages, « Un loup pour l’homme » entraîne son lecteur sans
répit dans cette mystérieuse fable servie par un scénario bien pensé et
construit par Mathieu Reynès. Le lecteur se laisse surprendre, absorber par
cette forêt aux étranges et envoûtantes couleurs… Que lui cache-t-elle ? Qui
protège-t-elle ?
Un album qui devrait être largement plébiscité !
Gilles Landais |
| |
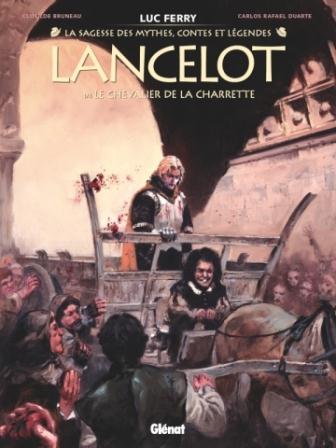 |
« Lancelot -
Tome 1 - Le Chevalier de la charrette », Clotilde Bruneau, Luc Ferry ,
Carlos Rafael Duarte, Didier Poli ; Coll. « La Sagesse des mythes, contes et
légendes », Editions Glénat, 2023. La
collection - désormais incontournable - « La Sagesse des mythes, contes et
légendes dirigée par le philosophe Luc Ferry compte aujourd’hui une nouvelle
série dont le tout premier tome est consacré au héros de la quête du Graal,
le fameux Lancelot. Didier Poli, auteur de BD, Clotilde Bruneau, scénariste
et Carlo Rafael Duarte au dessin ont conjugué leur savoir afin de produire
une aventure digne du preux chevalier du roi Arthur. Le récit fabuleux
débute, en effet, par un défi, celui porté par un chevalier masqué de son
heaume et s’infiltrant à la cour du roi Arthur pour lui faire savoir qu’il
détient des membres de sa cour…
En un récit graphique rendant à la perfection l’ambiance de ces temps
médiévaux et la fougue des chevaliers épris d’amour courtois quelque peu
réinterprété par ces pages parfois cocasses… Ce premier volume ne manque
assurément pas d’action, à l’image de ces anciens films ayant par le passé
évoqué la légende arthurienne et le lecteur aura bien du mal à patienter
pour découvrir la suite… au prochain numéro !
À noter comme à l’habitude dans cette collection didactique, le dossier bien
ficelé relatant l’origine et le développement du roman courtois et
permettant de mieux apprécier le contexte de cette nouvelle série.
Jules Buissonnet |
| |
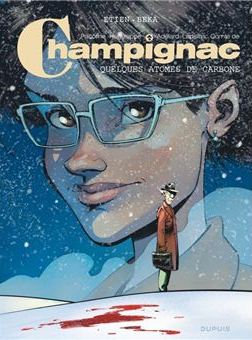 |
« Champignac – Quelques Atomes de carbone » ; BEKA
et David Etien ; 24 x 32 cm, 56 p., Éditions Dupuis, 2023.
Plaisir toujours renouvelé de découvrir une nouvelle aventure de Champignac
!
Pour ce dernier album ou pour « Quelques Atomes de carbone », c’est une
Américaine, infirmière new-yorkaise quelque peu excentrique qui débarque au
château de Champignac, avide de connaître les recherches et avancées de
notre fameux Compte de Champignac en matière de contraception… un sujet
sensible qui le touche particulièrement, un passé et des années qui pèsent
qui l’amèneront en 1951 à accompagner Margaret Sanger, personnage historique
fondatrice du planning familial, à Boston, non sans péripéties… Mais, Pacôme
Hégésippe Adélard Ladislas, comte de Champignac n’ignore pas que la science
n’est pas de tout repos !
Une nouvelle aventure audacieuse s’appuyant sur des faits et personnages
réels signée, de nouveau, BEKA et David Etien. Mené rondement, l’album offre
un scénario des plus dynamiques tendu par une mise en plage également des
plus alertes. Une histoire alternant drames, émotions, rebondissements et
courses-poursuites pour un album abordant des thèmes essentiels mais
toujours délicats et sensibles même au XXIe siècle.
Gille Landais |
| |
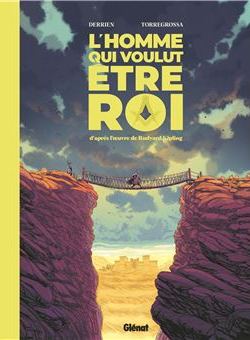 |
« L’Homme qui voulut être roi » ; Adaptation de
l’œuvre de Rudyard Kipling avec une préface de Didier Convard ; Scénario de
Jean Christophe Derrien ; Dessin de Rémi Torregrossa ; couleurs d’Albertine
Ralenti ; Cartonné, Coll. 24x32, 72 p., 24 x 22 cm, Editions Glénat, 2023.
La célèbre et captivante histoire de « L’Homme qui voulut être Roi » écrite
par l’écrivain britannique Rudyard Kipling en 1888 fait l’objet d’une belle
et très réussie adaptation en BD signée Derrien et Torregrossa aux éditions
Glénat.
Rappelons brièvement histoire : Fin XIXe siècle aux Indes, deux amis, Daniel
Dravot et Peachy Carnehan, tous deux anciens officiers britanniques et
francs-maçons, projettent après un long périple de se rendre au Kafiristan,
une contrée lointaine où aucun Européen n’est encore entré depuis Alexandre
Le Grand ! leur but ? Tout simplement, y devenir Roi, rien de moins ! Dravot
y réussira presque… mais c’était sans…
C’est l’adaptation en BD de cette incroyable aventure écrite par le célèbre
écrivain et journaliste britannique que nous offre donc de découvrir
Jean-Christophe Derrien au scénario et Rémi Torregrossa pour les dessins. Le
duo n’en est pas à son premier coup de maître puisqu’ils ont déjà ensemble
signé l’adaptation très saluée de « 1984 » de George Orwell. Ils récidivent
donc aujourd’hui pour le plus grand plaisir des lecteurs avec cette œuvre
littéraire non seulement haute en couleur, mais surtout haute en valeur
ajoutée, codes, analyses et fine observation sans concession de l’espèce
humaine tel était le grand talent du célèbre écrivain, Prix Nobel de
littérature en 1907 et auteur également du « Livre de la Jungle » ou encore
de « Kim ». Plus d’un siècle après, l’œuvre de Kipling n’a jamais, de
génération en génération, pris une seule ride !
Ici, avec un scénario et une mise en page des plus serrées, des dessins
rendant parfaitement l’ambiance et le climat tant du roman que de cette fin
de siècle en Orient, ce One shot livre une adaptation passionnante et
captivante de ce récit mythique ayant déjà fait l’objet dans le passé, en
1975, d’une fameuse adaptation cinématographique par John Huston avec Sean
Connery et Michael Caine. En 2023, c’est donc une belle adaptation en BD
avec une préface de Didier Convard que les Éditions Glénat nous proposent ;
A découvrir sans tarder.
Gilles Landais
|
| |
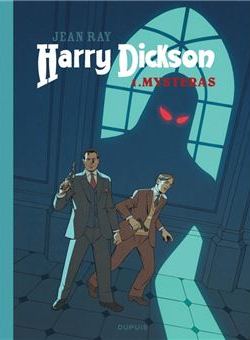 |
« « Harry Dickson – Tome 1 – Myteras » ; Scénario
de Doug Headline et Luana Vergari ; Dessin de Onofrio Catacchio ; 24 x 32
cm, 64 p., Coll. « Grand-Public », Editions Dupuis, 2023.
Qui ne se réjouira de retrouver le fameux détective américain, Harry Dickson
!
Pour ce retour en BD et en beauté, Doug Headlin et Luana Vergari ont fait
choix de retenir un récit plus que haut en couleur adapté d’une histoire
originale du célèbre auteur fantastique Jean Ray ; qu’on en juge :
Un condamné à mort exécuté qui s’évade, et à sa place, l’inventeur du
prototype de la chaise électrique ayant servi à l’exécution retrouvé mort
dans un bureau pourtant fermé de l’intérieur ; à cela s’ajoute une
romancière enfermée, elle aussi, dans sa luxueuse tour observant la scène au
télescope et qui disparait également le plus mystérieusement possible… Pas
moins, donc, de trois passionnantes mais délicates énigmes – un ressuscité,
un meurtre et une disparue, trois énigmes tout aussi inexpliquées
qu’inexplicables, - confiées par Scotland Yard au plus fantastique des
détectives, celui de l’étrange et du surnaturel : Harry Dickson, bien sûr,
accompagné de son inséparable acolyte et assistant, Tom Wills... Mais, ici,
devant cette complexité et ces énigmes multiples, réussira-t-il à nous
impressionner, relèvera-t-il le défi de ce retour en BD ? Assurément, et ce
premier tome porte bien son titre : « Mysteras » !
Adapté du maître donné en la matière, Jean Ray, l’album offre un fantastique
de haut vol où créatures maléfiques, spectres et puissances occultes règnent
sans partage. Angoisse, peur, épouvante et suspens sont au rendez-vous, exit
le rationnel laissé à Sherlock Holmes ou à Arsène Lupin… Figure
incontournable du « vrai » fantastique avec Poe et Lowecraft, Jean Ray
donnera naissance à Harry Dickson dans les années 1930 avec plus d’une
centaine d’aventures. Ce héros internationalement connu que l’on
redécouvrira dans les années 1960, peu de temps avant la disparition de son
créateur, entrera dans le monde de la BD dès les années 1986.
Les lecteurs apprécieront pour ce premier volume l’élégance des dessins et
une mise en page à la fois dynamique et des plus soignées, signés Onofrio
Catacchio.
Lorsque l’on connait le succès de Jean Ray et de son héros – Harry Dickson –
on ne saurait douter du succès de ces retrouvailles tant avec ses fans et du
réel plaisir qu’ils en éprouveront que de l’émerveillement des heureux
chanceux qui aujourd’hui en feront la découverte en BD !
Gilles Landais |
| |
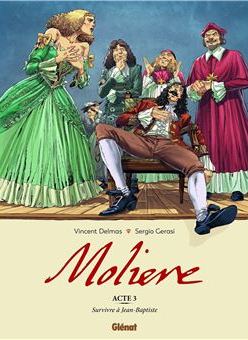 |
« Molière – Acte 3 – Survivre à Jean-Baptiste » ;
Scénario de Vincent Delmas ; Dessin de Sergio Gerasi ; Cartonné, 24 x 32 cm,
48 pages, Coll. 24x32, Editions Glénat, 2023.
A noter sur vos tablettes, la parution du troisième et dernier volume de
l’excellence série « Molière ». Une trilogie commencée en 2022 pour le 400e
anniversaire de son baptême plus que saluée par la critique et le grand
public, et qui s’achève en cette année 2023 marquant le 350e anniversaire de
sa mort.
Pour cet acte 3, signé de nouveau pour le scénario Vincent Delmas et Sergio
Gerasi pour les dessins, nous sommes en ce funeste soir de février 1673, le
17 précisément. Jean-Baptiste Poquelin dit Molière s’effondre sur scène en
pleine représentation du Malade imaginaire… En ces heures et minutes qui
comptent, le dramaturge revoit sa vie pendant que ses proches, son épouse
Armande Béjart et son ami La Grange, tentent de convaincre un prêtre de lui
donner la confession… Au-delà, c’est toute la question de la survie et
notoriété de l’œuvre de Molière qui se pose…
Un ultime acte que tant Vincent Delmas que Sergio Gerasi par leur symbiose
réussissent avec beaucoup de doigté. Molière y revit une dernière fois pour
ses lecteurs avant que la postérité ne le fasse vivre à jamais avec des
œuvres qui n’ont jamais cessé d’enchanter les scènes, le Français et surtout
des générations…
On ne peut pour cette excellente trilogie que souhaiter et attendre avec
impatience le coffret !
Gilles Landais
|
| |
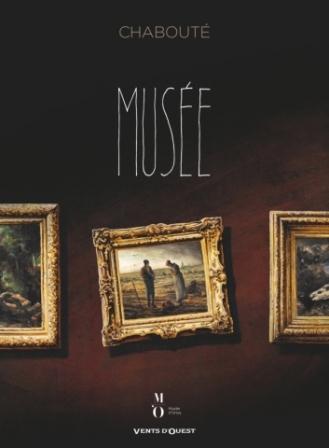 |
« Musée » de Christophe Chabouté ; Coll. «
Hors Collection », cartonné, 21.5 x 29.3 cm, 192 pages, Vents d’Ouest
éditions, 2023.
Chabouté a décidé de tout chambouler, et c’est tant mieux ! Car cela donne
un album des plus réussis, tout de noir et blanc, où bousculant tous les
codes, l’humour, l’art et la poésie s’allient pour le plus grand bonheur des
spectateurs… mais aussi celui des chefs d’œuvres du fameux Musée d’Orsay,
heureux de se trouver ainsi réunis, plein de vie.
Christophe Chabouté, que l’on ne présente plus, a en effet, pour ce nouvel
opus décidé de mettre la plus grande pagaille au Musée d’Orsay en permettant
aux œuvres d’art, statues, peintures ou autres chefs-d’œuvre de nous
raconter – une fois n’est pas coutume – ce qu’elles se disent la nuit entre
elles, lorsque le musée a fermé ses portes à triples tours… Que
d’expressions et de regards différents selon les âges ou caractères !
Dubitatifs, admiratifs ou encore scrutateurs, c’est ce que nous rappellent
les premières planches de cet album - à la mise en page impeccable - aussi
décapant que captivant… Car a-t-on imaginé, un jour, déambulant dans un
musée, juste une seconde, ce que peuvent bien penser de nous ces statues et
modèles des plus grands chefs-d’œuvre lorsqu’elles nous écoutent et nous
regardent les regarder ?! Que pense sous son chapeau et le pinceau de Manet
Berthe Morisot ? Ou encore van Gogh dans cet autoportrait de 1889 ?
Au-delà de cette pertinente question, c’est bien notre rapport à l’art
qu’interroge Christophe Chabouté dans ce turbulent musée imaginaire … Un
indiscret et savant désordre des plus instructifs, interpellant le lecteur…
avant que l’aube n’invite statues, bustes et modèles à regagner leur place
respective et à regarder de nouveau, inflexibles, les visiteurs du Musée
d’Orsay passer…
Gilles Landais
|
| |
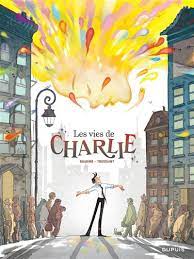
|
« Les Vies de Charlie » ; Scénario de Kid Toussaint
; Dessin d’Aurélie Garino ; 24 x 32 cm, 128 p., Coll. « Grand Public »,
Editions Dupuis, 2023.
Que deviennent les âmes des défunts ? Une question que tout à chacun s’est
un jour posé et à laquelle tente de répondre Charlie, employé modèle de la
société « Recycle & Ternel ». Tout un programme… que Charlie tente avec zèle
par téléphone d’expliciter aux familles qui souhaitent savoir comment et en
quoi pourrait être transformé leur défunt. Naïf, émotif et empathique, plus
que zélé mais plein de cœur, Charlie est – et ses collègues le savent bien –
l’employé idéal pour résoudre les cas les plus délicats…
Signé Kid Toussaint (Magic 7 » ; « Télémaque » ou encore « Animal Jack »
chez Dupuis…) et Aurélie Garino pour les dessins, cet album de plus de 120
pages aborde avec délicatesse et poésie bien des questions : la mort, bien
sûr, mais aussi et surtout la vie après la mort sans oublier la puissance de
l’amour. Que répondre en effet à ce jeune garçon qui demande à Charlie ce
que va devenir l’âme de sa petite maman récemment décédée ?
Une fable-enquête sensible dans laquelle se lance et nous entraîne Charlie.
Philosophie, théologie, croyances, coutumes et pratiques funéraires ouvrent
bien des pistes et questionnements auxquels va se confronter Charlie. Kid
Toussaint aborde, ici, avec doigté des thèmes délicats, la vie après la
mort, le paradis et l’enfer que partagent bien des religions et croyances
avec le christianisme ou encore la réincarnation et le bouddhisme…
Côté dessin, Aurélie Garino connue surtout dans le milieu « jeunesse » avoue
avoir pour ces « Vies de Charlie » changé quelque peu son approche graphique
: plus de relief et de profondeur souligne-t-elle. On appréciera
effectivement la diversité de ses visages et expressions, tout autant que la
redoutable mise en page, également efficace et dynamique, sans oublier enfin
de judicieux gros plans ou de belles pleines pages.
Bien des atouts, donc, pour ces « Vies de Charlie » à découvrir !
Gilles Landais |
| |
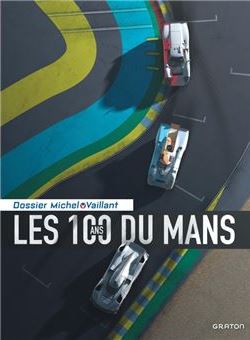 |
«
Dossier Michel Vaillant - Les 100 ans du Mans », Editions Graton, 2023.
À l’occasion du centenaire des mythiques 24 Heures du Mans, le Dossier
Michel Vaillant constitue un bel hommage en revenant dans le détail sur les
origines de ce parcours et de cette course appelée à un avenir que leurs
fondateurs ne pouvaient imaginer… Laurent Beauvallet, Christophe Bourgeois,
Jean-Philippe Doret et Guillaume Nédelec signent cet album qui deviendra
assurément un collector tant sa mise en page que les informations réunies et
détaillées permettent de plonger son lecteur littéralement dans cet univers
où défis et innovations ne feront que s’accélérer au rythme des années et
des bolides…
Entre fiction et réalité, notre héros Michel Vaillant se fait, ici, à la
fois témoin et acteur de cette riche histoire qui débute en 1923 avec 33
voitures affrontant des conditions climatiques extrêmes. Dès cette première
course, la dimension sportive concurrencera les innovations technologiques,
la course servant également de banc d’essai unique pour les inventions les
plus folles. Au fil des pages, le lecteur pourra découvrir cette riche
histoire parsemée d’anecdotes, de drames, parfois aussi, mais toujours
animée à chaque épreuve de cette passion indéfectible !
À noter pour cette occasion la sortie du tome 12 La Cible de la Saison 2
– Michel Vaillant
Jules Buissonnet
|
| |
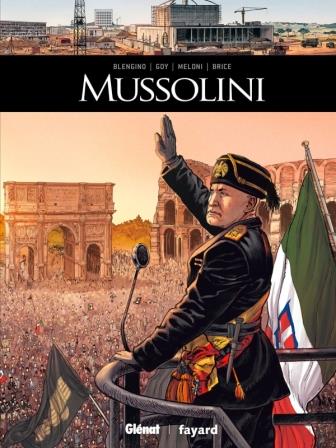 |
« Mussolini » de Luca Blengino, Davide Goy, Andrea
Meloni, Conseiller historique Catherine Brice ; Coll. « Ils ont fait
l'Histoire », 24 x 32 cm, 56 p., Editions Glénat, 2022.
Si le personnage de Mussolini peut sembler bien connu avec ses fameuses
diatribes, ses postures viriles et autres pantomimes, l’Histoire a légué
cependant une réalité quelque peu plus complexe que ces images convenues. Et
c’est l’un des intérêts de cet album signé Luca Blengino, Davide Goy, Andrea
Meloni et Catherine Brice que de livrer une réalité moins caricaturale par
le truchement de la BD.
A l’image de ce qui se passa en Allemagne, la Première Guerre mondiale a
provoqué en Italie un mécontentement d’une partie de la population,
population qui se regroupera rapidement sous la nouvelle bannière fasciste
qui émergera alors au début des années 20. C’est en effet en 1922 que Benito
Mussolini prendra la tête du gouvernement et imposera sa vision fasciste du
pouvoir, vision faite de multiples références à l’identité nationale et au
riche passé légué par l’antiquité… C’est ce chemin vers une Italie plus
forte, xénophobe, antisémite et renaissant des cendres de sa gloire mythique
qu’abordent nos auteurs dans ce récit graphique d’une rare qualité tant
historique qu’esthétique. Plus qu’un énième documentaire, ces pages font
entrer pleinement le lecteur dans l’Histoire aux côtés de ce personnage
complexe que ces pages dessinées avec talent ont le mérite de rendre plus
familier jusqu’à sa chute en 1945. A prolonger par le dossier très complet
réuni en fin d’album par l’historienne Catherine Brice.
Jules Buissonnet |
| |
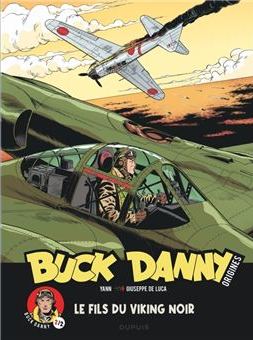 |
« Buck Danny – Origine – Tome 2 – Le fils du Viking
noir » ; Scénario de Yann ; Dessin de Giuseppe De Lucas ; 24 x 30 cm, 48
pages, Coll. « Grand Public », Editions Dupuis, 2023.
Les aficionados de Buck Danny seront assurément ravis de découvrir dans ce
second tome d’un diptyque incontournable consacré aux origines de Buck la
jeunesse du légendaire pilote.
Nous sommes pour ce volume dénommé – Le fils du Viking noir – en plein cœur
du Pacifique alors qu’en cette année 1943 la Seconde Guerre mondiale
s’impose au monde entier. C’est dans ce contexte que le lecteur suivra les
multiples exploits de Buck Danny affirmant autant son engagement que son
talent, mais aussi et surtout découvrira par ses songes et réminiscences ses
premiers vols et amours de jeunesse. Cependant derrière ces exploits et
jolis souvenirs se cache aussi un sombre secret jamais révélé… Mais, le
lecteur est-il prêt à le découvrir ? Il ne faut jamais juger trop vite…
Un second volume venant après « Le pilote à l’aile brisée » clore le premier
diptyque consacré aux origines de Buck Danny. Un tome signé Yann de nouveau
pour le scénario. Un scénario joliment serré appuyé par des dessins
dynamiques et sans répit de la main de Guiseppe De Luca. Un album qui offre
un plein d’actions, de revirements et suspens. Des batailles, des défaites
et victoires et même des miracles. On y retrouve un Buck Danny entouré de
ses compagnons sans oublier la séduisante et charmante Moira, mais aussi sa
mère… On y retrouve surtout notre héros, ce légendaire pilote infatigable «
au cœur posé sur un nuage »…
Gilles Landais
|
| |
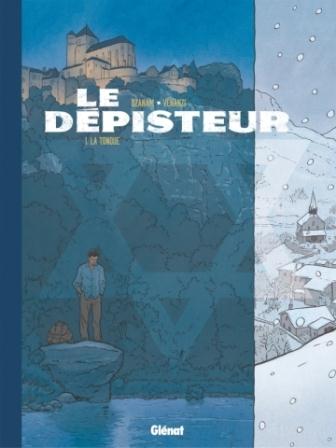 |
« Le Depisteur – Tome 1 – La Tondue » ; Scénario de
Ozanam ; dessin de Marco Venanzi ; Cartonné, 24 x 32 cm, Coll. 34x32 cm,
Editions Glénat, 2023.
Avec « Le Dépisteur », c’est un bien bel album que nous livrent Ozanam et
Marco Venanzi aux éditions Glénat ; premier tome d’un excellent diptyque
consacré aux enfants juifs rescapés de la Seconde Guerre mondiale.
Nous sommes, en effet, en 1951 et les « Dépisteurs », anciens scouts juifs
regroupés sous le nom justement « Des Dépisteurs » dont fait partie Samuel,
cherchent désespérément dans la campagne française les enfants juifs ayant
été cachés et séparés de leurs parents pendant la guerre avec cet espoir
inespéré de les ramener auprès de leur famille… C’est ainsi que Samuel part
dans le Lot à la recherche de cette petite fille qui, en 1943, avait tout
juste 1 an… Mais, lorsque Samuel arrive, tout semble perdu ! Personne ne
semble se souvenir d’une enfant cachée et, aux dires d’un paysan, la famille
d’accueil aurait été exécutée sous l’occupation… Derrière tous ces non-dits
et secrets à démêler, Samuel retrouvera-t-il trace de cette petite-fille ?
Reposant sur un scénario certes fictionnel, mais fondé sur des faits
historiques, Ozanam (reconnu chez Glénat pour « We are the night » et «
Mauvaise réputation) signe, ici, avec « Le dépisteur » un premier tome
travaillé et émouvant qui ne saurait laisser son lecteur indifférent. On y
retrouve toute l’horreur, l’ignominie, mais aussi le désespoir, la
solidarité et l’amour dont peut être capable la nature humaine… Des
contrastes, secrets, découvertes et révélations qu’a su rendre avec talent
Marco Venanzi au dessin. Des visages expressifs, des traits acérés, révélant
cette France rurale d’après-guerre où sur la neige demeurent parfois « Les
traces des enfants rescapés de la Shoah », des traces certes ténues, mais
qu’il convient encore de nos jours de ne jamais oublier…
Gilles Landais |
| |
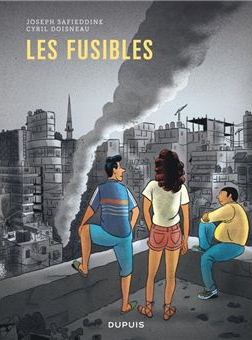 |
« Les Fusibles » ; Scénario de Joseph Safieddine ; Dessin de Cyril Doisneau
; Couleurs d’Isabelle Merlet ; Typographie de Jean-François Rey ; 20 x 26.5
cm ; 176 p., Coll. « Grand Public », Editions Dupuis, 2023.
Un très bel album engagé sur la force des liens qui nous
relient à nos racines et sur la transmission intergénérationnelle.
Trente ans plutôt, dans un Liban (jamais nommé cependant) en effervescence,
trois ados – Abel, Georges et leur amie Sarah - insouciants mais désirants
rendre service décident de constituer une équipe secrète et de choc chargée
de remettre en fonction les trop nombreux compteurs électriques coupés
quotidiennement. Ce sont ces ados que nous retrouvons plus tard ; Abel,
d’abord, installé depuis en France, entrepreneur et vivant avec sa fille,
Billie, qu’il n’a jamais envisagé d’emmener au Liban et Georges qui débarque
un week-end lui rendre visite… Dans ces souvenirs qui ressurgissent, Abel
prendra-t-il conscience qu’il s’est toujours placé en « Fusible » entre ses
racines, son père, sa vie et sa fille…
Mené de mains de maître par Joseph Safieddine au scénario, cet album revient
sur les liens complexes qui se tissent entre ceux qui quittent leur pays,
liens entre vie familiale et identité, entre enfance et vie actuelle… Joseph
Safieddine n’en est pas à son premier coup de maître et a déjà avec succès
abordé ces thèmes et le Liban ; Des thèmes dont celui essentiel de la
transmission qui lui tiennent à cœur, on se souvient ainsi de « Yallah Bye »
ou encore de « Monsieur Coucou ». Ce « Fusible », son père a toujours voulu
l’être justement… Mais, très vite, Joseph Safieddine souligne cependant : «
Finalement, la fiction me permet de parler de choses plus personnelles, de
laisser l’inconscient s’exprimer, sans être inhibé par le besoin de coller à
mon histoire familiale. La fiction, c’est très puissant ! ». Et dans cet
album, effectivement, le mot fusible se conjugue au pluriel…
Des sentiments complexes et ambivalents qui interpellent et ne laissent
indifférent, rendus ici avec beaucoup de sensibilité par le dessinateur
Cyril Doisneau. Des dessins touchants en noirs et blanc faussement simples
et épurés traduisant avec subtilité, nuances et humour la puissance des
ressentiments, sans oublier ces pages choisies en couleur et la typographie
respectivement d’Isabelle Merlet et de Jean-François Rey.
Une belle réussite qu’il convient de saluer.
Gilles Landais |
| |
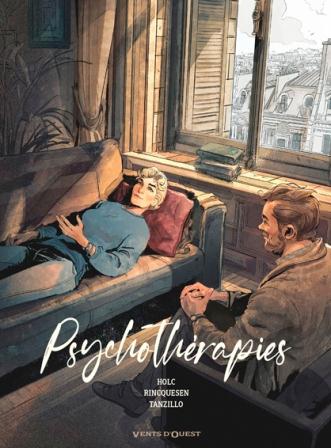 |
« Psychothérapie – Paula et Gaby vont chez les psy
» ; Scénario de jessica Holc et Ghismain Rincquesen ; Dessin et couleurs d’Emilano
Tanzillo ; Cartonné, 19.8 x 26.6 cm, 80 p., Coll. Hors Collection, Editions
Vents d’Ouest, 2023.
Une BD comme introduction, au sens premier du terme, à la psychothérapie.
Signé par une psychologue de formation et psychothérapeute, Jessica Holc, et
Ghislain de Rincquesen, analyste psycho-organique, l’album entend en effet
dévoiler et initier aux différentes voies de la psychothérapie ou plus
exactement aux « Psychothérapies » au pluriel tel que l’annonce le titre
même de ce roman graphique.
En ces pages, le lecteur y découvrira, d’une part, Gaby, la trentaine. Lui,
ne connait rien en psy ; c’est la première fois qu’il se rend dans le
cabinet d’un psy, mais épuisé, il sent qu’il a plus que besoin de comprendre
ses cauchemars et peurs qui l’assaillent ; d’autre part, Paula en thérapie
depuis les attentats de Nice dont elle a vécu l’horreur…
C’est une véritable plongée dans l’univers des « Psychothérapies » que nous
proposent avec cet album les auteurs. Un monde proposant, chacun à leur
manière, un chemin de transformation intérieure affrontant larmes, peurs et
cauchemars. Appuyé par les dessins réalistes et méticuleux d’Emiliano
Tanzillo, le lecteur découvrira, en effet, les affres, émotions et
difficultés de cette confrontation avec soi-même, mais aussi cette
résiliente compréhension libératrice que peuvent offrir les thérapies, ce
que reflètent parfaitement les couleurs retenues également par Emiliano
Tanzillo, cette alternance de couleurs sépia et de bleu lavis…
Le lecteur découvrira également avec intérêt le dossier-postface «
Exploration en terre intérieure » d’Éric Champ, psychologue clinicien,
psychothérapeute et superviseur et formateur d’analystes psycho-organiques ;
un dossier clef venant souligner toute la force de cette « parole qui guérit
» lors d’une « relation thérapeutique ».
Un album dans la ligne de la série culte « En thérapie » qui ne saurait
laisser son lecteur indifférent.
Gilles Landais |
| |
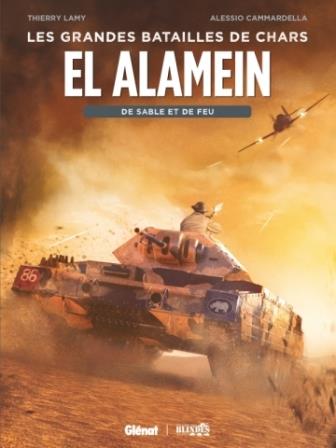 |
« El Alamein - De sable et de feu » ; Scénario de
Thierry Lamy ; Dessin d’Alessio Cammardella, Col. « Les Grandes batailles de
chars », 24 x 32 cm, Editions Glénat, 2023.
Rien ne prédestinait El Alamein, petite ville côtière égyptienne, à passer à
la postérité dans les archives mémorables de l’Histoire, si ce n’est ce 1er
juillet 1942, date à laquelle la guerre du désert fit rage en Afrique. En ce
mois d’été, les troupes italo-allemandes dirigées par le maréchal Rommel
menacent, en effet, l’armée anglaise malmenée à Tobrouk et retranchée sur
une ligne entre El Alamein et le désert de Qattara pour un affrontement
ultime… Tel est le thème de cette impressionnante collection « Les grandes
batailles de chars » selon un scénario époustouflant de Thierry Lamy et le
dessin fiévreux d’Alessio Cammardella qui parvient dès les premières
planches à plonger le lecteur dans les sables et la chaleur implacable du
désert libyen.
Avec une mise en planche haletante ne laissant guère de répits dans cet
enfer mécanique, cette BD montre combien les chars d’assaut jouèrent un rôle
déterminant sous la conduite du maréchal Romel face au général anglais
Auchinleck, un homme austère mais d’une probité exceptionnelle. Histoires
d’hommes et de machines, « El Alamein » impressionnera tant pour sa
dimension historique que pour sa conception graphique de tout premier plan !
(À compléter impérativement par le dossier instructif réuni par Stéphane
Dubreil intitulé « Le renard du désert pris au piège »).
À découvrir dans la même collection « Les Ardennes » de Dobbs et Fabrizio
Fiorentino.
Jules Buissonnet |
| |
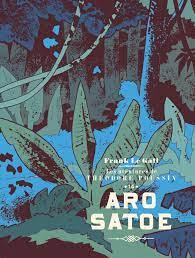
|
« Les aventures de Théodore Poussin – Tome 14 – Aro
Satoe » de Frank Le Gall ; Coll. « Grand Public », 24 x 32 cm, 80 p.,
Editions Dupuis, 2023.
Théodore Poussin revient et n’en finit pas de nous enchanter en nous
emmenant, cette fois-ci, sur l’île d’Aro Satoe dans la mer de Chine.
Pour le quatorzième épisode de cette fabuleuse et mythique série, après le «
Dernier voyage de l’Amok », notre héros infatigable s’est, en effet, réfugié
sur l’île de la séduisante Aro Satoe alors que son équipage, celui de L’Amok,
est emprisonné pour acte de piraterie à Singapour. Là, il y découvre de
troublants secrets le concernant…
Alors même que l’on croyait tout savoir sur Théodore Poussin, celui-ci
réserve à ses lecteurs encore aujourd’hui, sous la signature de Frank Le
Gall, en auteur complet, bien des aventures et péripéties sur fond de
savoureuses révélations… Ce personnage emblématique des éditions Dupuis, né
dans le « Journal de Spirou » en 1984, n’a en effet pas pris une ride depuis
que le jeune employé de bureau, réservé et timide, s’est embarqué en 1928
sur le fameux Cap Padaran vers l’Indochine ! Que d’aventures pourtant…
Pour ce voyage quelque peu crépusculaire aussi que captivant qu’initiatique,
Théodore Poussin devra affronter tout à la fois les autorités de Singapour
et l’armée britannique ; rien de moins ! À moins qu’il ne s’enfonce dans les
méandres de cette île si mystérieuse, l’île d’Aro Satoe…
Coup de théâtre garanti pour notre attachant héros !
Gilles Landais |
| |
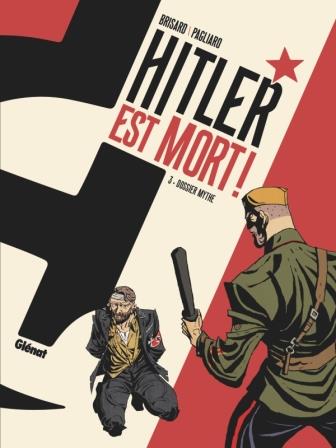 |
« Hitler est mort ! - Tome 3 » ; Jean-Christophe Brisard (scénario), Alberto
Pagliaro (Dessin), Collection 24x32, 72 p., Editions Glénat, 2022.
La mort d’Adolf Hitler demeure un mystère depuis sa
disparition en 1945 qui a été traditionnellement présentée, à défaut de
certitude, comme un suicide. Mais derrière l’Histoire officielle se cachent
bien d’autres hypothèses et notamment celle retenue pour ce Tome 3 selon
laquelle le terrible Führer aurait été retrouvé vivant d’après les enquêtes
menées par une unité d’élite de l’Armée rouge.
Loin d’être un scénario fantaisiste, Jean-Christophe Brisard, ici, au
scénario, a lui-même enquêté et les pièces qui ressortent du dossier secret
réuni en fin d’album sont impressionnantes… Le lecteur découvrira avec
intérêt et suspens cette aventure folle réunissant hypothèses de sosie,
médecins légistes, prothésistes et autres nombreux mystères !
Alors que le chaos règne en cette fin de Troisième Reich sur fond de
décombres, la disparition de celui qui initia une nouvelle et tragique
vision du monde quelques années auparavant constitue un enjeu de taille que
cet album présente avec brio et intelligence. Le dessinateur Alberto
Pagliaro a su saisir ces enjeux avec ces visages taillés au couteau, ces
couleurs contrastées et sombres. Le doute s’immisce et la paranoïa gagne le
lecteur, et si l’Histoire n’était pas celle qui a jusqu’alors été écrite ?
Jules Buissonnet |
| |
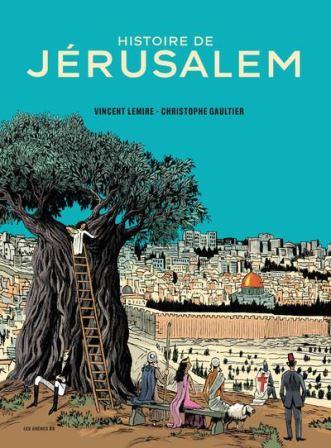 |
« Histoire de Jérusalem » de Vincent Lemire et
Christophe Gaultier, Les Arènes BD, 2022.
Jérusalem n’a pas fini de faire couler de l’encre depuis des millénaires et
de susciter de belles évocations ainsi que le démontre cette première
histoire de la Ville Sainte en BD ! Vincent Lemire, grand spécialiste de la
ville et Christophe Gaultier dessinateur également inspiré ont uni, ici,
leur talent pour offrir au lecteur pas moins de 4000 ans d’Histoire en
quelques 256 pages, un pari plus que réussi :
Depuis les débuts de cette bourgade entre Méditerranée et désert et la
grande cité actuelle, phare de cette région, que d’Histoire et d’histoires
relatées dans ces pages enlevées et colorées au soleil d’Israël. Chaque
grande étape se trouve rappelée par une synthèse remarquable rappelant les
grandes sphères d’influence - égyptienne, perse, juive, grecque, romaine et
bien d’autres encore…, ayant façonné et influencé la célèbre ville, tout en
lui gardant cette identité parvenue jusqu’à nous. Admirée, redoutée,
combattue, pillée, Jérusalem a connu tous les outrages et admirations
imaginables. Cœur des plus grandes religions qui se disputent depuis l’aube
des temps ses quartiers et monuments sacrés, Jérusalem est une ville de
passions…
C’est cette « Histoire de Jérusalem » faite de passions, de croyances, de
royautés et pouvoirs, que les auteurs donnent à lire en ces pages avec
talent et humour; Convoquant historiens, archéologues d’hier et
d’aujourd’hui et même guides imaginaires contemporains, la complexité et
l’histoire de Jérusalem s’y dévoilent avec fluidité et un rare bonheur de
lecture !
Une évocation en BD fidèle à l’Histoire qui devrait captiver et susciter
bien des envies d’aller découvrir cette ville à nulle autre pareille !Jules Buissonnet |
| |
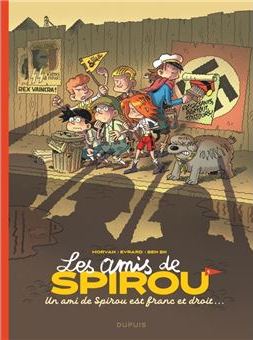 |
« Les amis de Spirou – Tome 1 – Un ami de Spirou
est franc et droit… », Jean-David Morvan, David Evrard et Ben BK ; Coll. «
Tous publics », 24 x 32 cm, 72 p., Editions Dupuis, 2023.
Voilà un premier album d’une nouvelle série jeunesse qui devrait captiver
autant les jeunes que les plus grands ! Signé par Jean-David Morvan avec
David Evrard et Ben BK, cet album , premier donc d’une nouvelle série
consacrée à l’Histoire de Spirou, s’inspire de vraies vies et de la grande
Histoire notamment celle du premier rédacteur de Spirou, Jean Doisy,
résistant lors de la Seconde Guerre mondiale et créateur du Club des Amis de
Spirou, réunissant de nombreux jeunes lecteurs dont certains sont morts pour
la Résistance.
Ouvrons ce premier album ! Nous sommes en 1943 et l’occupant nazi vient
d’interdire la parution du « Journal de Spirou ». Les jeunes du Club des «
Amis de Spirou », le club des AdS, sont littéralement atterrés. Vont-ils, en
réponse, oser défier l’occupant nazi en éditant un nouveau journal de BD
satirique antinazi ? Leur devise « Spirou, ami partout toujours ! ». Mais
ont-ils conscience des réels dangers qu’ils encourent en ces temps de guerre
? Une histoire véridique et malheureusement tragique…
Jean-David Morvan, auteur notamment de « Madeleine Résistante » accompagné,
ici, de David Evrard signe avec ce premier tome un album chargé d’Histoire,
celle de la Seconde Guerre mondiale, celle de la Résistance belge, celle de
l’Histoire du « Journal de Spirou » et celle tout aussi véridique, des «
Amis de Spirou » créé en 1938 quelques mois après la création de Spirou,
mais aussi celle de la fameuse imprimerie Marcinelle qui imprimera le
célèbre « Journal de Spirou ». Les références aux dessinateurs de Spirou
défilent en autant de clins d’œil et d’hommages, tout comme les références
empreintes d’humour à cette aventure éditoriale ancrée dans l’Histoire ;
l’Histoire tragique de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, du nazisme
et de la Résistance…
Pour cette nouvelle série consacrée à l’Histoire de Spirou, Jean-David
Morgan ne cache pas, tant au titre de nostalgie que d’hommage, son souhait
d’une réelle filiation. Le lecteur retrouvera aussi dans les dessins de
David Evrard offrant rondeur, chaleur et humour cette filiation graphique
souhaitée.
Action, rebondissements et humour égrènent cet album tragique mais captivant
à ne pas manquer !Gilles Landais |
| |
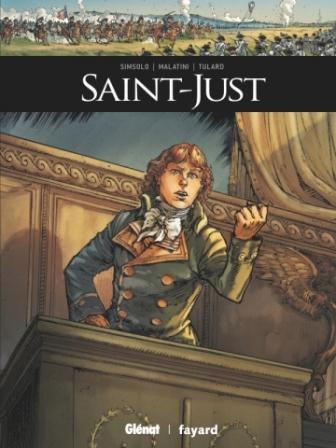 |
« Saint-Just » ; Scénario Noël Simsolo et Jean
Tulard ; Dessin de Mickaël Malatini ; Coll. « Ils ont fait l’Histoire », 24
x 32 cm, 56 p., Éditions Glénat, 2022.
Les férus d’Histoire seront ravis de découvrir ce nouvel album de la
collection « Ils ont fait l’Histoire » consacré à l’une des plus grandes
figures de la révolution en la personne de Saint-Just (1767-1794). Aux
manettes de ce nouveau tome, Noël Simsolo et le réputé historien Jean Tulard,
un gage assurément de sérieux.
Le lecteur découvrira tour à tour les différentes facettes de celui que
Michelet surnomma « L’archange de la Terreur » ; proche de Robespierre qu’il
admire, faisant partie des Montagnards, il votera l’abolition de la royauté
; tout à la fois, révolutionnaire, plus jeune député de la Convention,
membre du Comité de salut public et chef de guerre… C’est un destin
fulgurant et bref qui l’attend puisqu’il sera guillotiné, lors de la crise
du 9 thermidor, le même jour que Robespierre. En ce 28 juillet 1794, il a 26
ans.
Ce grand et jeune orateur notamment au club des Jacobins, qui votera la mort
du roi, qui inspirera la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de
1789, se rendra surtout célèbre pour l’intransigeance de ses principes, mais
aussi pour ses nombreuses missions auprès des armées de la Révolution avec
notamment la fameuse victoire de Fleurus...
Appuyé par les dessins acérés et reconnaissables de Mikaël Malatini, un
habitué de la collection « Ils ont fait l’Histoire », cet album livre les
pages les plus tumultueuses et captivantes de la Révolution française. Le
lecteur retrouvera en fin de volume un concis mais efficace dossier
historique.Gilles Landais |
| |
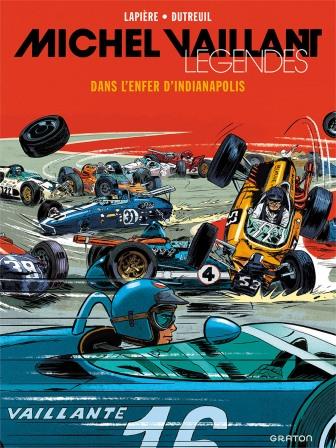 |
« Michel Vaillant – Légendes – Tome 1 – Dans
l’Enfer d’Indianapolis », 24 x 32 cm, 64 pages, Graton, 2022.
Le mythique parcours d’Indianapolis, comme si vous étiez ! Le tome 1 de la
non moins mythique collection Michel Vaillant nous invite en effet à
découvrir cette course emblématique en compagnie de Michel Vaillant, ce
héros des courses automobiles. Autant dire que les vrombissements et autres
effets de vitesse seront les invités d’honneur de cette BD signée Lapière et
Dutreuil. Nous sommes en 1966 et l’édition de cette année resta gravée dans
les mémoires non seulement pour les multiples incidents de course mais
surtout pour la lutte acharnée entre Graham Hill et Jim Clark jusqu’à la
victoire contestée de Graham Hill au final… C’est justement dans les arcanes
de cette course légendaire que nous invitent nos deux auteurs avec un récit
graphique époustouflant parvenant presque à reproduire les sons
assourdissants des moteurs et des tôles froissées ! Mais « Dans l’enfer
d’Indianapolis », ce sont également les coulisses de la course, avec
l’enquête menée par notre héros afin de révéler les tenants et aboutissants
des courses automobiles. Grâce à une intrigue captivante et un dessin des
plus réussis, ce tome 1 des Légendes devrait réunir plus d’un aficionado !
Jules Buissonnet |
| |
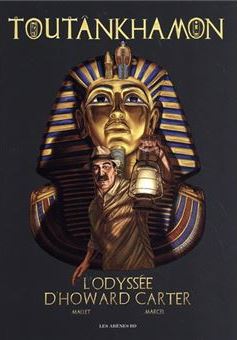 |
« Toutankhamon, l’odyssée d’Howard Carter » de Paul
Marcel et Patrick Mallet, Les Arènes BD, 2022.
L’album « Toutankhamon, l’odyssée d’Howard Carter », publié aux éditions Les
Arènes BD, transporte le lecteur dans l’univers fascinant de l’illustre
personnage, Toutankhamon, l’un des pharaons les plus connus au monde, un
pharaon incontournable qui faillit pourtant bien tomber dans l’oubli… sans
la si fameuse « Odyssée d’Howard Carter », cet archéologue et égyptologue
anglais (1874-1939) qui fut l’une des plus grandes découvertes archéologique
du XXe siècle.
Le pharaon qui succéda au célèbre Akhenaton en -1336 av. J.-C. ayant fait
vaciller les fondements de la religion égyptienne en célébrant le dieu
unique du soleil, Aton, avait fort à faire en souhaitant restaurer la
religion égyptienne classique. Mais la célébrité de Toutankhamon aurait-elle
pour autant si bien traversé les siècles et millénaires ? Sa célébrité,
au-delà de son règne, a surtout été due à la redécouverte de sa tombe par le
non moins fameux Howard Carter en 1922, dont nous avons fêté l’anniversaire
l’année dernière.
C’est cette incroyable découverte ou odyssée qui se trouve être le sujet de
cette passionnante BD conçue par Patrick Mallet pour le scénario et Paul
Marcel pour le dessin. En ces pages mouvementées où l’action et les mystères
foisonnent au fil des planches, les trésors du pharaon scintillent avec
notamment ce célèbre masque mortuaire d’or et ce mobilier funéraire éclatant
de pierres précieuses… Le pharaon représentant l’intermédiaire entre les
dieux et ses sujets, son inhumation donnait lieu à d’innombrables rites et
surtout à la présence de trésors plus précieux les uns que les autres… Mais
cette découverte n’allait pas aller de soi et c’est un véritable roman
d’aventure que signent nos deux auteurs avec cette BD aussi instructive que
passionnante sur le célèbre pharaon redécouvert, Toutankhamon !
Jules Buissonnet |
| |
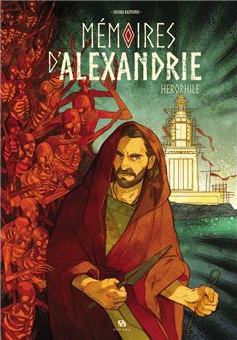 |
« Mémoires d’Alexandrie – Hérophile » de Chiara
Raimondi ; Cartonné, 46 p., Editions Ankama, 2022.
Le premier album de la série les « Mémoires d’Alexandrie » est consacré à
Hérophile. Personnage véridique et historique, plus précisément médecin grec
réputé, Hérophile de Chalcédoine méritait bien de figurer dans les tomes de
la mémoire de cette fameuse bibliothèque d’Alexandrie, celle qui fut l’une
des plus grandes et imposantes bibliothèques du monde en Égypte au IIIe
siècle av. J.-C.
Hérophile fut, en effet, un personnage hors du commun, un médecin audacieux,
ne reculant devant rien pour faire avancer le monde des connaissances, de la
science et des médecines. Né en Asie mineure, il s’installa à Alexandrie où
il entreprit notamment de comprendre le fonctionnement du corps humain,
disséquant et observant de nombreux organes. Cependant, dans cette Égypte du
IIIe siècle av. J.-C., où Dieux et Déesses sont omniprésents, sa curiosité,
son talent et audace n’est pas sans inquiéter voire être condamnée par
l’élite pensante entourant le roi Ptolémée…
Bien que médecin et auteur grec célèbre à son époque, ces nombreux traités –
donnés au nombre de neuf - furent malheureusement perdus lors de l’incendie
de la Bibliothèque d’Alexandrie.
Un premier album signé Chiara Raimondi instructif et bien mené offrant un
récit quelque peu fictionnel mais captivant !
Gilles Landais
|
| |
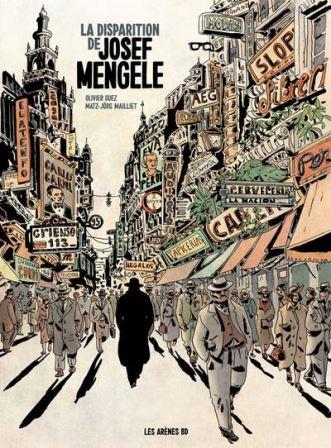 |
Jörg Mailliet, Matz, Olivier Guez : « La
disparition de Josef Mengele », Éditions Les Arènes, 2022.
Voici une adaptation en BD et haute en couleur du fameux roman d’Olivier
Guez, Prix Renaudot, sur la cavale du grand criminel de guerre, le médecin
Joseph Mengele, tortionnaire d’Auschwitz, celui que l’on avait surnommé
l’Ange de la Mort pour ses pseudo et effroyables expériences scientifiques
sur les détenus des terribles camps de la mort. Au lieu d’être jugé pour ses
multiples crimes à la sortie de la guerre, ce dernier pu mener une vie
tranquille de longues années en Argentine grâce à la bienveillance du couple
Peron. Mais une traque incessante rattrapera le tortionnaire dans sa
retraite dorée, Mengele devant fuir son pays d’adoption pour le Paraguay,
puis le Brésil, avant une issue aussi fatale que mystérieuse sur une plage
en 1979…
Autant dire que cette BD composée à 6 mains captivera tous lecteurs
passionnés d’Histoire et d’histoires. Véritable nœud inextricable, le
contexte de l’après-guerre s’avère plus que complexe à l’égard des anciens
bourreaux qui ont joui souvent pour un grand nombre d’entre eux d’une
nouvelle vie dans des dictatures accueillantes. Restituant la dynamique du
grand succès d’Olivier Guez en des planches à la fois saisissantes et
sombres, cette adaptation graphique convaincante devrait rencontrer un franc
succès.
Jules Buissonnet |
| |
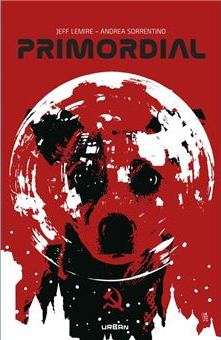 |
« Primordial » ; Scénario de Jeff Lemire ; Dessin d’Andrea Sorrentino ;
Cartonné, 176 pages, Urban Editions, 2022.
Un album passionnant revisitant la conquête spatiale. Sur fond de
concurrence acharnée entre les États-Unis et ce qui se nommait à l’époque
l’URSS, c’est un thriller captivant que découvrira le lecteur. Mettant les
projecteurs sur les malheureux animaux ayant servi de cobayes pour les
premiers vols spatiaux, la chienne Laïka pour l’URSS qui a cessé de donner
signe de vie au bout de quelques heures ou encore Able et Baker, les deux
singes envoyés dans l’espace par les États-Unis, l’album relance la fiction…
Car sait-on vraiment de quoi sont morts ces animaux ? Et est-on même sûrs
qu’ils soient bien morts ?
Avec talent, l’auteur canadien Jeff Lemire aux manettes du scénario livre,
ici, un récit sur fond de guerre froide entre histoire et fiction, entre
science et complotisme. Un déroulé serré habillement servi par les dessins
de son fidèle complice Andrea Sorrentino et une colorisation de Dave
Stewart. Un duo de choc dont on ne présente plus les coups de maître ; qui
ne se souvient du « Mythe de l’ossuaire » ! Pour ce dernier album, leur
complicité fonctionne à merveille avec un découpage et une mise en planche
aussi originaux que dynamiques. Les visages sont superbement expressifs et
on craque littéralement sur Laïka… On l’aura compris un album de 176 pages à
réserver !
Gilles Landais
|
| |
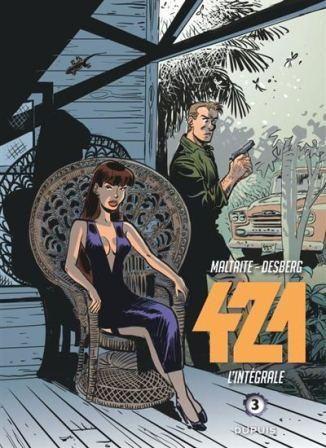 |
« 421 – L’Intégrale – Tome 3/3 – 1988-1990 » de
Stéphen Desberg et Eric Maltaite, 21.8 x 30 cm, 264 p., Coll. « Patrimoine
», Editions Dupuis, 2022.
Nombreux seront ceux qui se réjouiront de découvrir le troisième et dernier
volume de l’intégrale des aventures de 421, cet espion so british si
séduisant ayant marqué des générations…
Une série d’espionnage et d’action emplie d’humour imaginée par le duo de
choc Maltaite au scénario et Desberg pour les dessins, initialement pour le
journal de Spirou en 1980, mais qui n’a pas pris une seule ride. Il est vrai
que la fameuse série a su au fil des décennies largement évoluer,
s’éloignant quelque peu de Spirou pour capter sa propre personnalité et
s’imposer en tant que tel dans l’univers de la BD.
Les aficionados seront ainsi assurément heureux de retrouver dans ce dernier
et troisième volume de l’intégrale des albums aussi fétiches que « Falco »
sorti en 1988, « Les années brouillard » de 1989 ou encore « Morgan » et «
Le seuil de Karlov » sortis respectivement en 1990 et 1992.
A ces souvenirs ou heureuses découvertes, c’est selon, viennent pour ce
dernier tome s’ajouter de multiples images d’archives offrant ainsi un joli
prologue ; prologue lui-même complété par de nombreuses propositions de
suite pour cette célèbre et incontournable série 421.
Gilles Landais |
| |
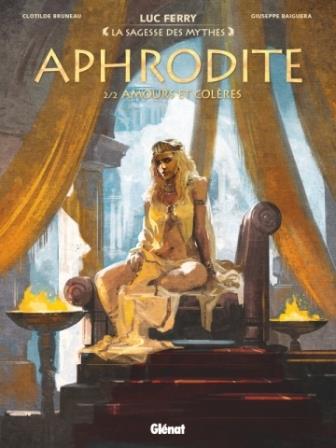
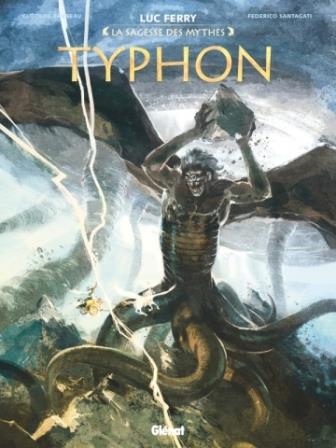 |
Collection « La sagesse des mythes » dirigée par
Luc Ferry BD, Editions Glénat, 2022.
Retrouvons le charme de la mythologie avec la collection « La sagesse des
mythes » dirigée par le philosophe Luc Ferry ! Cette heureuse initiative qui
rencontre un franc succès permet en effet d’allier l’utile à l’agréable en
revisitant en docte compagnie les plus grands mythes que l’Antiquité nous a
livrés et qui, il faut bien l’avouer, se trouvent quelque peu négligés par
notre culture contemporaine…
Fort de ce constat Luc Ferry a souhaité rendre accessible, sans pour autant
les réduire à de la Fantasy pure, ces histoires souvent hautes en couleur et
qui ont envouté des siècles durant leurs lecteurs. Dorénavant, avec cette
collection riche de nombreux volumes, il sera loisible à tout à chacun non
seulement de lire, mais également de voir ces mythes mis en planche grâce à
des scénaristes et dessinateurs talentueux tels Didier Poli, Clotilde
Bruneau, Federico Santagati, Carlos Rafael Duarte, Guiseppe Baiguera et bien
d’autres encore.
Le mythe de la déesse de l’amour Aphrodite en deux tomes, le règne des
terribles Géants et du redoutable Typhon, fils de Gaia, sans oublier les
innombrables amours de Zeus qui donnent naissance à tant de manœuvres et
métamorphoses pour parvenir à ses fins, tels sont quelques-uns des thèmes
passionnants abordés dans cette collection à recommander aussi bien aux
adultes qu’aux plus jeunes.
A noter, à la fin de chaque album, le cahier philo préparé par Luc Ferry
rappelant les grandes lignes du mythe traité, et offrant une synthèse rapide
mais néanmoins complète, synthèse dont le philosophe a le secret.
Derniers volumes parus : « Aphrodite tome 2/2 - Amours et colères » ; « Les
amours de Zeus » ; « Typhon ».
Jules Buissonnet |
| |
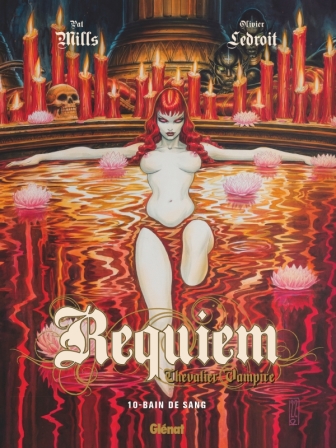 |
« Requiem – Tome 10 – Bain de sang » ; Scénario Pat
Mills ; Dessin et couleurs olivier Ledroit ; Cartonné, 24 x 32 cm, 62 pages,
Coll.24x32, Editions Glénat, 2022.
Pour ce dixième tome (Eh oui !, déjà), Pat Mills a opté pour un scénario
dark fantasy ancré sur un récit véridique, celui de la comtesse Báthory. Un
personnage cruel et mythique puisque la comtesse Báthory, obsédée par son
souhait de jeunesse éternelle, avait choisi pour soin de beauté de se
baigner dans le sang de vierges…
Ce nouveau volume réjouira assurément par ses pages et découpages énergiques
et hauts en couleur. Le rythme dark fantasy, noir et cruel à souhait, signé
Pat Mills est ici renforcé par les dessins et couleurs inimitables d’Olivier
Le droit, sans oublier le côté envoutant imprimé par cette fameuse comtesse
hongroise ayant réellement existé au XVIe siècle.
On l’aura compris le duo n’a pas lésiné sur les moyens et atouts pour ce
nouvel opus de « Requiem » qui porte bien son triste nom !
Gilles Landais |
| |
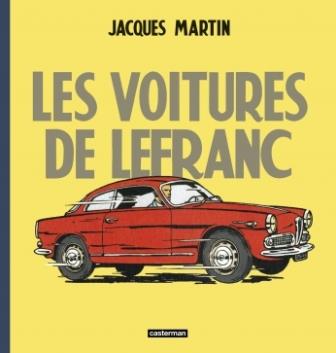 |
« Les voitures de Lefranc » ; Scénario de Xavier
Chimits ; Dessin de Jacques Martin ; Intégrale - Éditions spéciale, Coffret
Univers d'auteur, BD, Editions Casterman, 2022.
Lefranc dans l’univers de la BD, c’est un mythe, une légende créée sous
l’inspiration du génial Jacques Martin. Ce héros moderne à la mise
impeccable déjoue, en effet, toutes les intrigues, même les plus
machiavéliques, et ce depuis 1952, début d’une longue série de 33 albums
plus captivants les uns que les autres…
Confronté à son adversaire de toujours, le terrible Axel Borg, le
journaliste Guy Lefranc a fort à faire afin de déjouer toutes sortes de
plans diaboliques inventés par Jacques Martin bientôt secondé par Bob de
Moor avant que Gilles Chaillet ne reprenne graphiquement la série.
Avec l’album « Les voitures de Lefranc », Xavier Chimits rend hommage à la
passion de Jacques Martin pour les plus beaux bolides. La place en effet des
voitures demeure indissociables ?? des multiples pérégrinations de notre
héros, des véhicules qui font l’objet d’ailleurs de courses-poursuites
mémorables. Chimitz, lui-même, est un passionné d’automobile et de l’univers
de la F1, univers qu’il parvient parfaitement à rendre dans ces pages
trépidantes, réunissant les meilleures pages d’anthologie sur ce thème
porteur dans la deuxième moitié du XXe s.
Jules Buissonnet |
| |
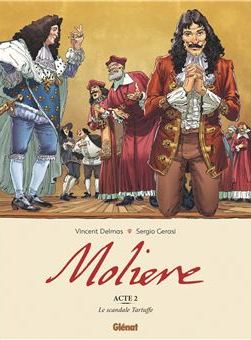 |
« Molière – Acte 2 – Le scandale tartuffe » ;
Scénario Vincent Delmas ; Dessin Sergio Gerasi ; Cartonné, 24 x 32 cm, 48
pages, Coll. 24x32, Editions Glénat, 2022.
Il était plus qu’attendu… Voici, en cette fin d’année 2022, le deuxième tome
consacré à « Molière ». Signé de nouveau Vincent Delmas pour le scénario et
Sergio Gerasi pour les dessins, ce nouvel album débutant après un
flash-back, en 1664, met les projecteurs sur la nouvelle pièce de Molière «
Tartuffe »… Avec cette nouvelle création, Jean-Baptiste Poquelin devenu
Molière attise définitivement, malgré sa belle notoriété et la protection du
roi, les foudres de l’Eglise… « Tartuffe », et ce même si le roi a ri, fait
plus encore que scandale ! C’est « Le scandale Tartuffe ».
La pièce est dès lors interdite par le roi et certains réclameront même pour
Molière le bûcher. Les oppositions, avertissements et conseils de ses
proches s’accumulent… Pourtant, jamais Molière ne cèdera et mènera ce combat
qui a toujours été le sien, celui de la liberté d’expression.
Un album bien mené dans lequel le lecteur retrouvera les atouts du premier
volet avec cette symbiose réussie entre le scénario de Vincent Delmas et les
dessins au trait caractéristique de Sergio Gerasi notamment ces gros plans.
Le lecteur y retrouvera surtout le grand Molière, celui qui jamais ne déçoit
et s’impose comme l’un des plus grands auteurs de la littérature française.
Incontournable Molière, surtout en cette année 2022 marquant le 400e
anniversaire de son baptême.
Gilles Landais
|
| |
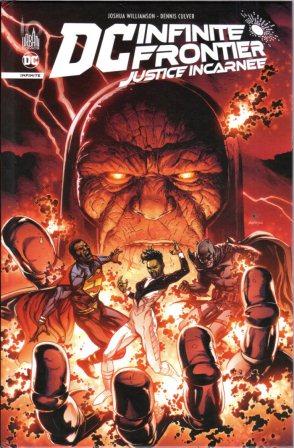 |
« DC INFINITE FRONTIER – JUSTICE INCARNEE » ;
Scénario de Joshua Williamson et Dennis Culver ; Dessin collectif ; 176
pages, Coll.DC INFINITE, Urban Comics, 2022.
Un incroyable DC signé d’un non moins incroyable duo de choc pour le
scénario – Joshua Williamson épaulé par Dennis Culver - et accompagné d’une
kyrielle de dessinateurs ! Eh oui, il n’en fallait pas moins pour revisiter
de fond en comble le Multivers…
La Ligue de justice Incarnée est amenée à enquêter sur la menace que fait
peser Darkseid sur l’ensemble des réalités pour devenir maître du Multivers.
A cette fin, le président Superman Calvin Ellis de Terre-23 et le Batman de
la chronologie Flashpoint, Thomas Wayne, entraînent les membres de la Ligue
dans un vertigineux périple traversant une multitude de Terres parallèles,
des univers tous plus déroutants et dangereux les uns que les autres…
Arriveront-ils pour autant à réunir les plus grands héros issus de toutes
les Terres du Multivers ? Surtout la Justice Incarnée pourra-t-elle faire
face à une menace plus grande et dangereuse encore tapie dans l’ombre depuis
des années et sortie tout droit des Ténèbres ?
Nous l’avons dit avec ce dernier DC INFINITE FRONTIER –JUSTICE INCARNEE,
Joshua Williamson a entrepris de poursuivre sans état d’âme la refonte de
l’univers DC déjà précédemment entamée. Pour cela, ce dernier a convoqué à
ses côtés Dennis Culver et surtout une myriade de dessinateurs tous plus
talentueux les uns que les autres. Le lecteur découvrira ainsi dans cette
intrigue ficelée serrée une multitude de Terres parallèles au Multivers, des
univers également tous plus étonnants les uns que les autres, entraînant
rebondissements et de nombreux personnages connus ou revisités.
Un DC INFINITE FRONTIER incontournable qui annonce déjà une profonde crise
de l’univers DC…
Impatience quand tu tiens le lecteur !
Gilles Landais |
| |
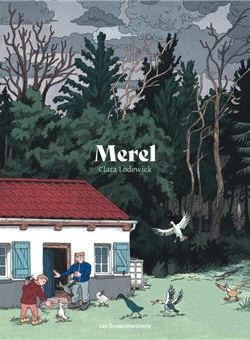 |
« Merel » de Clara Lodewick, Coll. « Les Ondes
Marcinelle », Editions Dupuis, 2022.
À souligner un récit graphique doux-amer signé Clara Lodewick paru dans la
nouvelle collection « Les Ondes Marcinelle » des éditions Dupuis.
Un premier récit très réussi dépeignant la dureté sociale dans un petit
village flamand à notre époque. L’histoire commence banalement : Merel,
quadra, qui se dit femme libre, sans enfants ni mari, semble heureuse entre
son écriture, l’élevage de ses canards et le club de football, tout serait
au mieux si… un soir, lors d’une soirée, cette dernière n’avait eu la bêtise
de faire une blague grivoise quelque peu douteuse sur le mari d’une de ses
voisines… Que n’avait-elle dit ! De là, Merel sera l’objet de tous les
ragots et diffamation de ce village campagnard des Flandres faisant de la
vie de Merel un véritable cauchemar…
La critique a largement salué la belle maturité tant du scénario que
graphique de cette jeune bruxelloise, Clara Lodewick, pour ce premier et
gros roman graphique. Il est vrai que l’auteur, ici en auteur complet,
présente en ces pages un certain talent pour faire vivre ses personnages et
leur accorder leur juste place, couleur, dureté ou hypocrisie dans ce rude
milieu rural… Son héroïne, Merel, la quarantaine est attachante et
l’ensemble de la narration ironique et sans merci sonne juste ; entre
frustration et haine, le thème central du bouc émissaire est habilement
exploité. À ces atouts, il faut ajouter une harmonie et dynamique des
dessins très réussies.
Un roman graphique attachant gardant cette note d’espoir qui semble si chère
à l’auteur !
Gilles Landais
|
| |
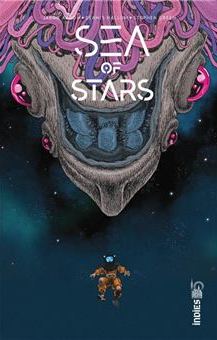 |
« Sea of Stars » ; Scénario Jason Aaron et Dennis
Hallum ; dessin de Stephen Green ; Couleur de Rico Renzi ; 288 p.,
Coll.Urban Indies, Editions Urban Comics, 2022.
Un récit spatial grandiose et haut en couleur signé d’un trio-choc : Jason
Aaron, Dennis Hallum pour le scénario et Stephen Green pour les dessins :
Le jeune Kadyn s’ennuie fort dans le vaisseau convoyeur que pilote son père
Gil… Soudain, l’idée lui vient d’explorer sans le dire la fameuse cargaison
provenant d’un musée alien ; de là, que d’évènements, rebondissements, de
créatures et suspens !
Les scénaristes, Jason Aaron (auteur notamment de « Thor » et « Southern
Bastards ») et Dennis Hallum, auteur pour sa part de Dark Visions, ont
décidé d’emmener pour cet album loin, très loin dans l’univers leurs
lecteurs… Un voyage interstellaire incroyable rendu merveilleusement tant
par les dessins de Stephen Green que par le choix des splendides couleurs de
Rico Renzi. On ne peut que souligner les merveilleuses pleines-pages qui
égrènent cet album ; une odyssée ou plutôt une double odyssée, celle de
Kadyn et celle de Gil cherchant désespérément son fils après la rencontre
d’une mystérieuse et dangereuse créature et l’explosion du vaisseau spatial.
Séparés, seront-ils condamnés à errer éternellement ?
On ne ressort pas facilement de ce récit alternant entre l’univers des
enfants et celui des adultes, associant mondes mythologiques, oniriques,
science-fiction et tenant son lecteur en haleine. Actions, surprises et
découvertes s’enchainent à une vitesse vertigineuse… On demeure étourdi,
perdu dans l’immensité galactique, la tête pleine de couleurs, et ravi de
cet album des plus divertissants !
Gilles Landais |
| |
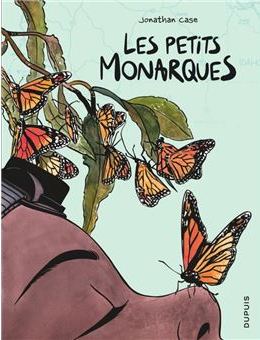 |
« Les petits Monarques » de Jonathan Case, 19.1 x
24.8 cm, Coll. « Grand public », 256 p., Editions Dupuis, 2022.
Signée par Jonathan Case, ici, en auteur complet, cet album réjouira à n’en
pas douter avec son orientation écologique petits et grands lecteurs de BD.
Ayant échoué à réguler la crise climatique, l’humanité s’est vue décimée par
la maladie du soleil ; Les rares survivants vivent dorénavant sous terre,
fuyant le jour et le soleil. Mais, aussi surprenant que cela puisse
paraître, Elvie et Flora, une biologiste, se sont risquées avec succès à
sortir en plein jour… Leur secret ? Un antidote issu des écailles des jolis
papillons Monarques. Mais, pourront-elles en trouver assez pour sauver
l’humanité ? D’où le titre de cet album « Les petits Monarques »…
C’est toujours un plaisir de découvrir les albums signés Jonathan Case. Il
faut dire que ce dernier n’en est pas à ses débuts, loin s’en faut – auteur
notamment de « Dear Creature » ou encore « House of Night », il a toujours
su afficher une belle indépendance. Ici, il opte pour un récit de fiction
post-apocalyptique qui lui permet d’associer à merveille ses convictions et
engagements écologiques avec un fécond imaginaire. Une maîtrise que le
lecteur retrouvera pour ce récit graphique tant pour le scénario construit
que pour les dessins et surtout le choix des couleurs. Le tout selon une
mise en page des plus efficaces. Pas moins de douze chapitres qui
s’enchaînent selon la migration dans l’Ouest américain et le rythme «
papillonnaire » de ces jolis lépidoptères que sont les Monarques.
Gilles Landais
|
| |
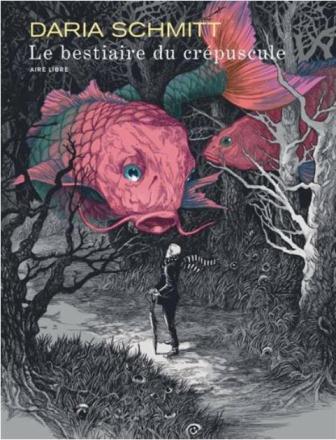 |
« Le bestiaire du crépuscule » de Daria Schmitt,
23.7 x 31 cm, 120 pages, Editions Aire Libre, 2022.
C’est un fort joli et fantastique album que nous livre avec « Le bestiaire
du crépuscule » Daria Schmidt chez Aire Libre avec pour toile de fond un
étrange et mystérieux jardin public… Car si pour les enfants du quartier, ce
jardin est une jolie aire de jeux colorée de rires, celui-ci se révèle
cependant pour Providence, son gardien, lorsque la nuit s’avance et que la
lune se lève, un étrange repère d’horribles et crépusculaires créatures, un
monde terrifiant qu’il est seul à voir… Et dans ce monde, son monde empreint
de rêveries, Providence s’est donné pour mission de protéger malgré eux les
enfants et promeneurs de ce parc. Mais pourra-t-il y arriver alors qu’une
nouvelle directrice férue de management est nommée, qu’émerge du lac un
étrange et terrifiant bestiaire et que le reflet d’une mystérieuse maison
l’attire plus que tout...
Daria Schmidt a convoqué pour cet album un fabuleux monde imaginaire
horrible et plein de poésie. Véritable hommage à Lovecraft, l’auteur n’a
d’ailleurs pas hésité à se référer expressément dans son extraordinaire
récit à une des nouvelles du maître incontesté de l’horreur. À ce talent de
Daria Schmidt indéniable et salué par Philippe Druillet, vient s’ajouter un
non moins fabuleux travail graphique, un trait sombre impressionnant et des
plus soignés entre jeux d’ombres et de couleurs. Assurément, Doria Schmidt
est à son tour une bien jolie conteuse de mondes fantastiques. On ne résiste
pas !
Gilles Landais
|
| |
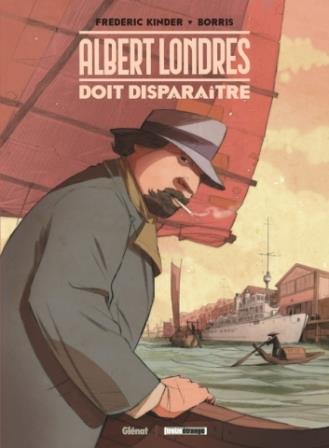 |
"Albert Londres doit disparaître" ; Scénariste
Frédéric Kinder ; Dessinateur Borris ; Coll.Treize étrange, 21,8 x 29,5 cm,
Editions Glénat, 2022.
Passionnante et incontournable, cette BD consacrée au journaliste Albert
Londres se devra de figurer parmi les prochaines lectures ! Ce récit est
focalisé sur le dernier voyage en Chine qu’entreprendra le célèbre
journaliste qui a donné son nom au Prix annuel récompensant le meilleur
reporter francophone de moins de 40 ans. Il faut dire que ce parrain de
choix aura toute sa vie durant choisi les thèmes et sujets les plus
délicats, ce dernier voyage entrepris en Chine alors qu’il pensait par la
suite se retirer du journalisme s’avérant en effet plus qu’épineux.
Borris et Frédéric Kinder, tous deux aux manettes, ont su conjuguer leur
talent pour livrer un récit et un style qui aurait à n’en pas douter plu au
célèbre journaliste… À partir d’une histoire véridique – l’étrange
disparition du journaliste lors d’un naufrage alors qu’il enquêtait sur les
liens troubles entre la Marine française et des trafics d’armes et d’opium
en Chine – cette BD propose une version à mi-chemin entre enquête et fiction
afin de retracer avec pertinence le caractère et courage de ce journaliste
prêt à tout pour faire éclater la vérité, fut-ce au prix de sa vie.
En un passionnant voyage dans la Chine interlope des années 30, nos deux
auteurs parviennent dès les premières planches à planter le décor de cette
époque exotique sur fond de conflit sino-japonais. Shanghaï plus étrange que
jamais, représentants de la communauté internationale cherchant pour chacun
à tirer la couverture pour leurs intérêts plus ou moins troubles, et
omniprésente, enfin, cette sourde angoisse de complots et secrets que notre
journaliste cherchera à démêler jusqu’au bout forment les ingrédients de
cette histoire captivante.
Ce récit sur plus de 90 pages et complété par un dossier nourri devrait en
effet tenir en haleine tous les passionnés d’enquêtes et d’aventure !
Jules Buissonnet |
| |
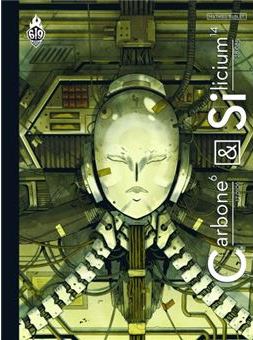 |
« Carbone et Silicium » de Mathieu Bablet ; Edition
spéciale – Or Noir ; 24 x 32 cm, 272 pages, Coll. 619, Editions Ankara,
2022.
C’est avec beaucoup de plaisir que les fans pourront découvrir cette
nouvelle version 2022 de « Carbone & Silicium » dans une édition spéciale -
tout de noir, blanc et or ; Cette nouvelle édition était, il faut l’avouer,
largement plébiscitée puisque « Carbonne & Silicium » signé en auteur
complet par Mathieu Bablet, sortie initialement en 2021, fut un franc et
réel succès récompensé par le Prix BD Fnac / France Inter. C’est donc chose
faite avec cette nouvelle édition luxueuse et limitée particulièrement
réussie !
Le lecteur pourra en effet redécouvrir (ou pour les plus chanceux encore
découvrir tout simplement) « Carbone & silicium » dans cette splendide
version à laquelle un soin tout particulier a été apporté. Un plaisir pour
les yeux ! Il est vrai que les dessins aux détails impressionnants de
Mathieu Bablet se prêtent merveilleusement à cette version luxueuse et
stylisée. Cette version « Or Noir » offre un écrin de choix pour le récit de
« Carbone & Silicium ». Rappelons que nous sommes en 2046, et que nos deux
super robots après avoir été élevés dans un cocon hautement protecteur se
sont évadés et ont été séparés, chacun découvrant alors un monde à bout de
souffle où catastrophes et crises s’enchaînement…
Avec, nous l’avons souligné, ce splendide travail de dessin minutieux et
original, appuyé ici par une édition limitée non moins travaillée et
soignée, cette version spéciale de « Carbone et Silicium » ne manquera pas
assurément de faire date dans le monde de la BD.
Gilles Landais |
| |
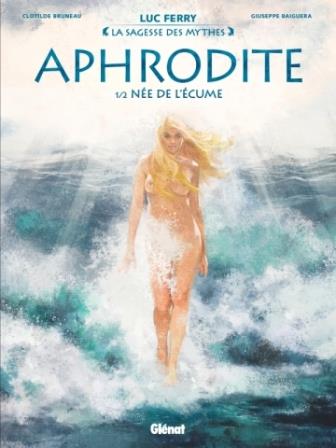 |
« Aphrodite - Tome 1 » de Clotilde Bruneau et Luc
Ferry (scénario), Dessinateur Giuseppe Baiguera, Directeur artistique :
Didier Poli, Collection : La Sagesse des mythes, BD, Glénat, 2022.
La désormais classique collection « La Sagesse des mythes » dirigée par le
philosophe Luc Ferry accueille avec ce premier tome un album consacré à
l’une des déesses les plus attractives puisque selon la mythologie grecque,
elle symbolise l’amour, la beauté et le désir. Reprise dans le panthéon
romain sous le nom de Vénus, cette jeune femme qui a fait l’objet des plus
belles représentations par les plus grands artistes est pourtant née de
manière violente du membre d’Ouranos tranché par Cronos et lancé à la mer…
Son destin scellera celui des femmes et des hommes qui rencontreront son
chemin, la blonde déesse si bien évoquée par Botticelli abordera l’île de
Cythère avant d’être présentée à l’Olympe… C’est le début d’une longue et
riche histoire, mouvementée à souhait et dont les différents épisodes ont
été retracés avec une fidélité adaptée à la forme BD de manière attractive
et réussie. Le dessin et les couleurs retenus par Giuseppe Baiguera
contribuent au charme de cette épopée divine, la couleur étincelante de la
blonde chevelure d’Aphrodite alternant avec la pénombre des forges
d’Héphaïstos. Un récit haut en couleur qui sera suivi d’un prochain tome
plus qu’attendu !
Jules Buissonnet
À noter dans la même collection, le troisième et
dernier tome qui vient de paraître sur la fameuse épopée de Gilgamesh. |
| |
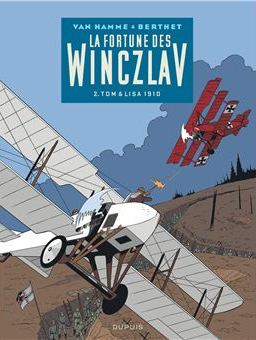 |
« La Fortune des Winczlav – Tome 2 – Tom et Lisa »
; Scénario de Jean Van Hamme ; Dessins de Philippe Berthet ; 23,7 x 31,10
cm, 56 p., Éditions Dupuis, 2022.
Nous retrouvons avec un plaisir attendu et certain la suite de « La Fortune
des Winczlav » avec ce nouvel album « Tom et Lisa », deuxième tome de cette
fameuse trilogie révélant pour la première fois les origines de l’empire de
Largo Winch, légende incontournable du monde de la BD.
Nous sommes en 1910 et Thomas Winczlav vient de découvrir qu’il est
l’héritier avec sa sœur jumelle, Lisa Lafleur, de la fortune des riches
Whiskies O’Casey. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, Thomas adopte
le nom de « Winch » et tente tant bien que mal de faire fructifier ses
affaires, alors que sa sœur Lisa s’imposera en pilotant avec le fameux Baron
Rouge…
Jean van Hamme, de nouveau aux commandes du scénario pour cet album, a
retenu pour dérouler la saga familiale Winch la période de la Première
Guerre mondiale. Là, deux destins que tout oppose, celui de Tom et de sa
sœur Lise, emmenée encore enfant par sa mère en France, vont se croiser dans
un scénario finement serré. Les dessins de Philippe Berthet rendent de
nouveau avec talent et complicité tant la puissance des caractères des
personnages que l’atmosphère de cette période troublée.
Un deuxième volume qui vient confirmer toute la force de cette grande saga
familiale en trois actes révélant les origines de la fortune du fameux et
célèbre Largo Winch.
Gilles Landais
|
| |
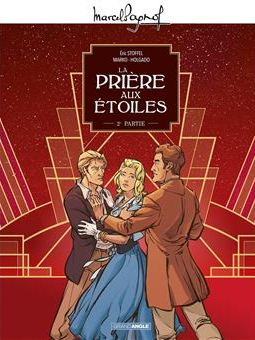 |
« La Prière aux étoiles - 2ère partie » ; Serge
Scotto, Eric Stoffel, Marko et Holgado ; Editions Grand Angle, 2022.
Attendu avec impatience, le volume 2 de « La Prière aux Etoiles » est enfin
disponible aux éditions Grand Angle !
Rappelons que la série « La Prière aux Étoiles » est l’adaptation en BD d’un
film jamais sorti de Marcel Pagnol. Signée Eric Stoffel pour le scénario,
Marko pour le storyboard et Inaki Holgado pour les dessins, cette belle
adaptation a déjà été, dès le tome 1er, largement plébiscitée.
Il est vrai que cette aventure dessinée redonne vie à ce film perdu que
Marcel Pagnol avait refusé de terminer sous l’occupation et qu’il avait
détruit. Une belle aventure, donc, surtout lorsque l’on se souvient que
l’écrivain et réalisateur perdit également durant cette noire période sa
femme et ses studios…
L’histoire n’est pas sans rappeler la vie même de Marcel Pagnol, et pour ce
second et dernier tome, le lecteur retrouvera la belle et jeune actrice,
Florence à Cassis, entre son passé avec Dominique son protecteur et amant,
et Pierre dont elle est tombée éperdument amoureuse, mais qui jaloux ne peut
entendre et supporter ce passé… L’amour triomphera-t-il ?
L’on retrouve pour ce second tome avec plaisir les jolies nuances de
l’adaptation et les dessins stylisés d’Inaki Holgado.
Une série qui relève un beau défi de mémoire et qui, à ce titre, mérite
d’être plus que saluée !
Gilles Landais
|
| |
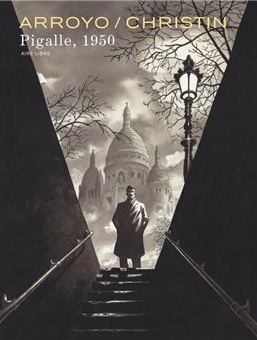 |
« Pigalle, 1950 » ; Scénario de Pierre Christin ;
Dessin de Jean-Michel Arroyo ; Relié, 23.7 x31 cm, 152 pages, Éditions Aire
Libre, 2022.
La parution aux éditions Aire Libre de « Pigalle, 1950 » offre un
irrésistible polar signé d’un duo de choc - Pierre Christin / Jean-Michel
Arroyo – et ayant pour toile de fond ou prétexte le Pigalle des années 1950.
Antoine, le jour même de ses 18 ans, décide de plaquer son Aubrac pour
s’aventurer dans la grande capitale. Là, il y découvre tous les charmes et
multiples fréquentations de Pigalle. Le cabaret « La Lune bleue » avec son
patron « Beau-Beb » et ses danseuses, mais aussi « Pare-brise » ou encore «
Poing-barre »… On l’aura compris il y a dans ce one shot toute la gouaille
et l’ambiance aux néons des nuits chaudes du Pigalle des années 50.
Pierre Christin, également romancier et scénariste, sait à merveille
entraîner son jeune Antoine devenu « Toinou » et son lecteur dans les
arrières cours et sombres ruelles de ce Pigalle aux mille tentations, mais
aussi mille dangers du grand banditisme… Un traitement digne des grands
films noirs ! Une atmosphère à nulle autre pareille que Jean-Michel Arroyo
fait revivre de plume de maître avec de superbes dessins soignés et
stylisés. Optant paradoxalement, mais judicieusement, pour ce récit haut en
couleur pour des camaïeux sépia, se sont de splendides planches - pour
certaines pleines pages – et un découpage travaillé des plus réussis que le
lecteur sous le charme découvrira.
« Pigalle, 1950 », un album à ne pas manquer !
Gilles Landais |
| |
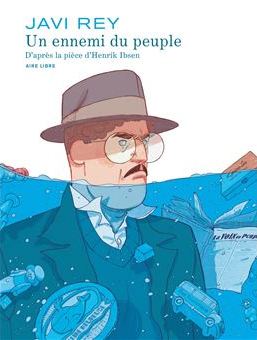 |
« Un ennemi du peuple » de Javi Rey d’après la
pièce d’Henrick Ibsen, 152 pages, Éditions Aire Libre, 2022.
À ne surtout pas manquer, le dernier album de Javi Rey « Un ennemi du peuple
» aux éditions Dupuis d’après la pièce du célèbre auteur norvégien Henrik
Ibsen (1828-1906).
Alors que la toute nouvelle station thermale de l’île de la Baleine s’attend
à accueillir ses nombreux touristes, le docteur Stockmann découvre que l’eau
de la station est contaminée. Mais alors qu’il en informe le maire, son
propre frère, et entend rendre l’affaire publique, les autorités, la presse
et sa ville se dressent contre lui ; Stockmann est devenu l’ennemi à
abattre, « Un ennemi du peuple »…
Pièce majeure du dramaturge norvégien avec notamment « La maison de poupée
», « Un ennemi du peuple » fut publié en 1882, il y a donc 140 ans, soit
presque un siècle et demi. Aussi, bien que gardant tout sa force, le
dessinateur Javi Rey (« Un Maillot pour l’Algérie » ; « Violette Moris »),
ici en auteur complet, a-t-il fait choix pour cet album d’adapter la pièce
et de livrer un récit graphique quelque peu recontextualisé et revisité.
Aux faiblesses de la démocratie soulignées par Ibsen lui-même – corruption,
manipulation, populisme, démagogie, etc., Javi Rey a entendu « greffer »
l’impuissance des démocraties occidentales modernes face aux injustices, aux
inégalités et aux affres des crises financières. Ainsi que l’auteur a pu, à
juste titre, le souligner : « C’est la force d’un classique d’être
intemporel. Ibsen nous fait réfléchir sur des problématiques très
contemporaines. » Et effectivement, face à cette étrange contamination, le
Docteur Stockmann n’est-il pas, en effet, devenu un dérangeant « lanceur
d’alerte » ?... comme un écho de notre société moderne.
Certes, l’absolutisme ou la radicalité du Docteur posés par Ibsen ont pu et
peuvent encore apparaître ambigus ; aussi Javi Rey a-t-il également choisi
-comme bien des metteurs en scène avant lui - de réécrire notamment le
discours final du Docteur et de rappeler en exergue concernant la démocratie
la fameuse phrase de Churchill : « C’est le pire système de gouvernement
conçu par l’homme. À l’exception de tous les autres. »
Rey livre ainsi un récit graphique actualisé à la fois fluide et construit,
tout en offrant un rythme et une dynamique propres avec des dialogues forts
répondant à merveille aux dessins épurés volontairement rendus dans la ligne
claire et aux couleurs réfléchies. « J’ai pensé toute la mise en scène
graphique au service de la narration, en simplifiant le trait au maximum. »
souligne le dessinateur. Une inclinaison que bien des lecteurs apprécieront
et salueront.
Javi Rey parvient avec ce fabuleux album « Un Ennemi du peuple » travaillé
et pensé à transmettre réactualisées l’atmosphère et la puissance de cette
œuvre incontournable du grand dramaturge norvégien du XIXe siècle que fut
Henrick Ibsen.
Gilles Landais |
| |
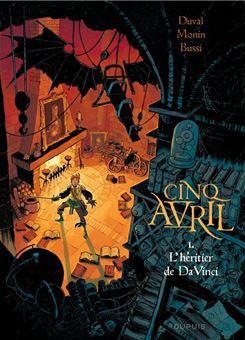 |
« Cinq Avril – Tome 1 – L’Héritier de Da Vinci »;
Fred Duval, Michel Bussi et Noë Monin ; 21.8 x 30 cm, 64 pages, Coll. «
Grand Public », Editions Dupuis, 2022.
Nous sommes au XVIe siècle, le 5 avril précisément, et un nouveau-né est
déposé aux portes du fameux château du Clos Lucé où réside depuis 1516,
appelé par François 1er, le célèbre peintre italien Léonard de Vinci. Il a
pour seul bagage un étrange collier d’or. L’enfant adopté par les
cuisinières et surnommé comme il se doit « Cinq Avril » sera pris sous
l’aile protectrice de Léonard de Vinci lui-même et initié par ce dernier à
de nombreux secrets… Entre le mystère de ses origines et le legs initiatique
de son maître italien, « Cinq Avril » va découvrir à la mort de son
protecteur qu’il a l’étrange pouvoir de changer le cours de l’Histoire !
C’est un fabuleux récit divertissant mêlant aventure et Histoire que nous
propose avec cet album le trio Fred Duval, Michel Bussi et Noë Monin. Pour
cette première série de Michel de Bussi, géographe, professeur à
l’Université de Rouen et écrivain que l’on ne présente plus, rien ne semble
avoir été omis : actions, complots, secrets font de ce dynamique récit de
cape et d’épée haut en couleur et rebondissements un captivant album happant
le lecteur. Aux bases historiques se mêlent humour et clins d’œil. Il est
vrai que le scénariste reconnu Fred Duval et Michel Bussi n’en sont pas à
leur première association à succès, on se souvient avec plaisir de «
Nymphéas noir » récompensé en 2011.
Pour ce trépidant récit, leur talent ont rencontré celui du dessinateur Noé
Monin (notamment « Les Larmes d’Âpretagne »). Des dessins présentant une
énergie toute en rondeur attachante et ancrant joliment ce palpitant premier
récit dont les lecteurs ne pourront qu’attendre avec impatience le prochain
tome !
Gilles Landais
|
| |
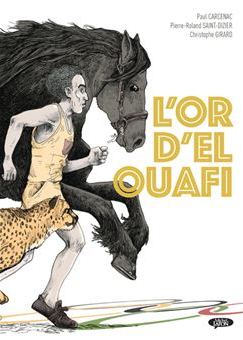 |
« L’Or d’El Ouafi » de Paul Carcenac et
Pierre-Roland Saint-Didier (scénario) et Christophe Girard (dessin) ; Relié,
128 pages, Editions Michel Lafon, 2022.
A souligner ce bel et captivant album nous contant l’histoire trop peu
connue du premier marathonien français médaillé d’or olympique aux éditions
Michel Lafon. C’était à Amsterdam en 1928 et il s’appelait Boughera El Ouafi.
Mais se souvient-on aujourd’hui vraiment de lui ?
Né dans le désert du Sahara en Algérie bien loin des pistes et stades
olympiques, son histoire n’est pourtant pas des plus banales. Et c’est en
hommage et pour réparer cet oubli injustifié de l’histoire du sport que Paul
Carcenac, journaliste et passionné d’athlétisme, Pierre-Roland Saint-Didier,
son petit-fils, et Christophe Girard ont souhaité associer leurs talents
pour raconter la destinée de Boughera El Ouafi.
Au travers de ce récit mené pour le scénario à quatre mains par Paul
Carcenac et Pierre-Roland Saint-Didier (auteur engagé ayant déjà signé
notamment « Le Signal de l’Océan », « Le dernier Refuge » ou encore « Les
adieux du rhinocéros), ce sont aussi les préjugés, les injustices, mais
aussi la persévérance et le courage qu’ont entendu raconter nos deux
scénaristes. Car El Ouafi ne fut pas seulement le premier marathonien
africain médaillé d’or olympique, il fut également tirailleur algérien,
ouvrier à l’usine Renault à Boulogne-Billancourt ou encore employé dans un
cirque américain… Une destinée hors-norme joliment rendue par le trait et
les couleurs inspirés et alertes de Christophe Girard. On se souvient dans
le domaine sportif de ses deux albums avec Raymond Poulidor.
En refermant cet album aussi passionnant qu’émouvant, on ne peut que saluer
l’initiative de Paul Carcenac, Pierre-Roland Saint-Didier et Christophe
Girard d’avoir fait résonner une nouvelle fois la Marseillaise pour le
marathonien El Ouafi en mémoire de cette médaille d’or olympique gagnée en
1928 !
Gilles Landais
|
| |
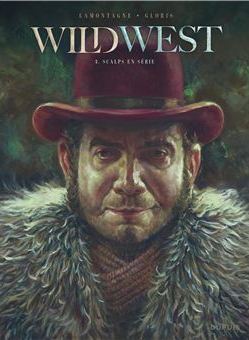 |
« Wild West – Tome 3 – Scalps en série » ; Scénario
de Thierry Gloris ; Dessins de Jacques Lamontagne ; Relié, 24 x 32 cm, 48
pages, Éditions Dupuis, 2022.
Chacun se souvient de cette géniale et historique légende du western
dénommée « Wild West » tant sa parution fut saluée !
Après le succès indéniable de ce premier diptyque ( Camamity Jane et Will
Bill), les auteurs - Thierry Gloris au scénario et Jacques Lamontagne pour
les dessins - poursuivent pour la plus grande joie de leurs lecteurs leur
féconde complicité en livrant aujourd’hui de nouvelles aventures de leur
fameux duo.
Charlie Utter, un homme généreux et droit, a recueilli Martha Jane Cannary
après la mort de son mari, abattu en légitime défense par Wild Bill Hickok ;
Celle-ci noie son chagrin dans l’alcool et rumine sa vengeance… Mais, sur le
chantier du nouveau chemin de fer en construction, Bill doit d’autre part,
faire face à un mystérieux tueur, un tueur en série scalpant ses victimes…
Les aficionados de la série retrouveront dans ce nouvel album ce qui a fait
le sel et la réussite incontestable de « Wild West ». Thierry Gloris y
déploie un scénario bien ficelé qu’il déroule avec ingéniosité. Bill sera
cette fois-ci accompagné d’un nouveau personnage, Charlie Utter, un
personnage également historique de la légende de l’Ouest américain. Jacques
Lamontagne livre, pour sa part, de nouveau, de fabuleux dessins aussi
soignés et puissants que réalistes.
Un nouvel album offrant un plaisir de lecture rare.
Gilles Landais |

|