|
Hommage Jean
Malaurie (1922-2024)
Interview du
7 mars 2008
Paris, EHESS

|
|
Jean
Malaurie
en quelques dates
Né le 22 Décembre 1922 à Mayence Allemagne). Fils d’Albert
Malaurie, Professeur agrégé, et de Mme Isabelle Regnault. Marié le 27
Décembre1951 à Mlle Monique Laporte (2 enfants: Guillaume, Éléonore).
Études : Lycées, Condorcet, Henri IV et Faculté des lettres de Paris.
Diplôme : Docteur d'État ès lettres.
Carrière: consacrée à des études de géomorphologie, météorisation,
structures dynamiques d'éboulis, d'anthropogéographie arctiques et d'étude
de développement des populations esquimaudes et nord-sibériennes. Attaché
puis Chargé de recherches au Centre national de la recherche scientifique
(CNRS) (1 948-57), Directeur d'études de géographie arctique à l'École des
hautes études en Sciences sociales (EHESS) (1957), Directeur-fondateur du
Centre d'études arctiques au CNRS et à l’EHESS à Paris (depuis1957),
Président de la Fondation française d'études nordiques (1964-75) et de la
Société arctique française (1 980-89). Directeur-fondateur collection
Terre humaine aux Éditions Pion (depuis 1955), de la revue inter-Nord
depuis 1963), Président de la Commission nationale de géographie polaire
(1974-89), directeur de recherche (1979-92) puis Directeur de recherche
émérite (depuis 1992) au CNRS. Président du Centre de formation des cadres
autochtones du nord de la Sibérie et de l'Extrême-Orient, du Cercle
polaire Saint-Pétersbourg (Russie) (1992-94), Président du comité de
défense des peuples arctiques de la Russie au Fonds de la culture à Moscou
(Russie) (1990). Doyen d'honneur de la faculté des peuples du Nord de puis
de l’Université Herzen à Saint-Pétersbourg (1991). Président (1994) puis
président d'honneur de l'Académie polaire à Saint-Pétersbourg, Membre
titulaire de l'Académie des sciences humaines de e(1996), Président du
Fonds polaire Jean Malaurie du Muséum national d'histoire naturelle de
Paris (depuis 1992).
Jean Malaurie en livres...





Coffret Jean Malaurie
la saga des inuit ; les derniers rois de Thulé,
INA, 2008
 |
LEXNEWS a eu le privilège de pouvoir interviewer le
grand explorateur, scientifique et écrivain, Jean Malaurie. Il est
toujours difficile de présenter un homme de cette envergure. Pionner des
expéditions, Jean Malaurie est le premier Français à avoir atteint et en
traîneau à chiens, le 29 mai 1951, le Pôle géomagnétique Nord (78°29'N,
68°54'O). Le geomorphologue est également un cartographe réputé puisqu'il
a levé la carte géomorphologique et topographique au 1 : 100 000 en 5
feuilles, en avril, mai, juin 1951 sur la côte nord-ouest du Groenland.
Mais Jean Malaurie est également anthropogéographe avec ses fameuses
études sur les Derniers Rois de Thulé, écrivain et fondateur de la célèbre
collection Terre Humaine qui éditera le fameux "Tristes Tropiques" de
Lévi-Strauss... La liste de ses qualités serait encore longue à énumérer,
la première d'entre elles étant la passion, qu'il a bien voulu nous faire
partager !

Mayence
I° Partie
LEXNEWS : "Comment êtes-vous devenu géographe et pourquoi ?"
Jean Malaurie :
Je suis né à Mayence, sur les bords du Rhin, où j’ai passé huit années de
ma vie. Toute mon enfance a été bercée par des légendes de la Forêt noire.
Le livre que j’écris en ce moment a pour titre Uummaa et pour
sous-titre Ils sont innocents. Uummaa désigne le coeur,
c’est-à-dire la force principielle, qui vient symboliquement aussi bien de
la pierre que de la glace. Je me souviens sûrement des récits entendus
pendant mon enfance : le Dieu Odinn, avec ses deux corbeaux qui observent
et qui rapportent tout, m’a peut-être initié à la mythologie du Grand
Nord. Quand la France a quitté militairement l’Allemagne rhénane le 1er
juin 1930, je suis rentré à Paris où j’ai fait mes études. Mon père, qui
était professeur agrégé d’histoire, est mort avant la guerre, quand
j’avais 17 ans et ma mère lorsque j’avais 20 ans. Je suis donc orphelin
lorsque je prépare le concours de l’École Normale Supérieure au Lycée
Henri IV, durant la Seconde Guerre mondiale, après l’armistice de 1940.
LEXNEWS : "Quand avez-vous, Jean Malaurie, entendu pour la première fois
« l’appel du Nord » ?"
Jean Malaurie :
Je pense que c’est, sans le savoir, à cinq ou six ans, la main dans celle
de mon père – qui était officier français à Mayence, pendant l’occupation
de nos armées après la Première Guerre mondiale -. J’ai été si heureux de
traverser avec lui, en plein hiver, le Rhin gelé... Né en Rhénanie, j’ai
été aussi toute mon enfance bercé par les récits et les grandes musiques
que me contait et me chantait une vieille femme allemande, Frau Leonardt,
qui s’occupait des enfants dans notre maison de Mayence, Mathilden Strasse
14. Le 5 novembre 2004, le bourgmestre de la ville m’a d’ailleurs fait le
grand honneur d’apposer une plaque commémorative à l’entrée de ma maison
natale, saluant l’explorateur polaire et le premier homme à avoir atteint
le pôle géomagnétique nord en deux traîneaux à chiens le 29 mai 1951.
Mais, dois-je vous confier que j’ai souvent la sensation d’avoir subi,
inconsciemment – « je » étant (aussi) un autre – la volonté implacable
d’une sorte de « double » résolu à me faire répondre d’emblée à cet
« appel du Nord » ? Comment en effet mieux m’expliquer l’élan vital
intuitif, quasiment irraisonné, qui m’a saisi de manière irréversible,
pour me faire prendre une voie imprévisible que j’allais suivre toute ma
vie, sans la moindre réticence et surtout, surtout, sans retour ?
Cela dit, je demeure pourtant convaincu que le nord de l’Écosse, dont ma
mère était originaire, a joué aussi un rôle, certes moins étrange, mais
tout aussi probable, dans cet « appel du Nord ». Comme elle allait
disparaître – trois ans après mon père, me laissant orphelin à 22 ans -,
je n’ai jamais su si le fond de son coeur était tendre car, de toute mon
enfance, je n’ai jamais ressenti d’elle, que beaucoup de froideur – elle
ne m’embrassait jamais -. Était-ce par pudeur ou bien (mais, de cela,
comment ne pas lui en être reconnaissant !) pour, comme on disait alors,
me « former le caractère » ? Toujours est-il que c’est peut-être grâce à
cette « formation du caractère » que j’ai pu réussir à franchir tous les
obstacles pour obtenir de l’Université – ce qui était vraiment une
« première » à l’époque – ma mission initiale dans l’extrême Nord.
Peut-être aussi cette « formation » m’a-t-elle aidé à résolument refuser
le Service du Travail Obligatoire (STO), décrété par Vichy, qui obligeait
tous les jeunes français de ma classe, 1922, à partir comme des conscrits
travailler en Allemagne. Je rappelle que près de 800 000 ont répondu à
cette convocation. L’atmosphère régnante était celle de l’attentisme,
d’autant que Pierre Laval, dans le souci d’encourager ces jeunes à
collaborer, a inventé la politique scandaleuse dite de la relève : pour
trois STO partants, un prisonnier serait libéré.
Toujours est-il que ma volonté de « résister » a accompagné depuis lors –
à tort ou à raison d’ailleurs – un grand nombre d’événements importants de
ma vie.
LEXNEWS : "À qui, à quoi d’autre alliez-vous encore résister ?"
Jean Malaurie :
D’abord à peu près à tout ce qui constituait mon environnement de jeunesse
et, pour commencer, à mon milieu, puis à l’Université. Ma famille
bourgeoise, catholique, et mon père, qui était professeur agrégé
d’histoire, m’ayant tacitement, au restant, tracé d’avance les grandes
lignes de mon avenir. À moins, peut-être encore, que ma mère, dans le
secret de ses rêves « highlanders », ait contrecarré soigneusement cette
influence et ait contribué aussi à me faire résister et à conforter chez
moi une tendance à priori résolument réfractaire à me plier à ce à quoi je
n’adhère pas totalement.
Peut-être enfin que, préparant l’École Normale Supérieure au lycée Henri
IV à Paris, l’enseignement philosophique kantien que j’y ai reçu a-t-il
contribué, à son tour, à me faire ressentir le besoin, quand les durs
moments passés dans la clandestinité et les épreuves qui venaient de faire
de moi un orphelin, de mettre ma vie en question en devenant réfractaire,
clandestin et résistant en 1943-1944, et de chercher à lui donner son sens
propre. J’avais en tout cas saisi une fois pour toutes ce qu’était
l’intelligence, l’ouverture d’esprit, l’importance essentielle de la
lucidité et le besoin impérieux de ne jamais refuser de combattre pour la
liberté de penser, de croire et de faire.
LEXNEWS : "Est-ce cette liberté-là qui vous a donné la force de convaincre
l’Université et le CNRS de concrétiser vos études de géomorphologue, en
allant étudier les pierres dans un désert ?"
Jean Malaurie :
Oui. Devenu étudiant géographe à l’Université de Paris et décidé à
m’attacher à l’origine du monde, les pierres, la vie des pierres, ont
soudain exercé sur moi une étrange fascination. Leur érosion, en
particulier, qui les fait se détacher des falaises, toute leur vie
organique si mystérieuse à travers leurs canalicules, leurs micro
canalicules, l’eau géologique qui les habite depuis quelques 500 millions
d’années... Toutes ces questions allaient devenir pour moi un exaltant
sujet de recherche : je devenais en somme un « éboulologue », un nouveau
programme de recherche, dont je serais peut-être l’unique représentant au
Groenland.
Au départ, j’ai cherché à quantifier l’érosion dans un temps donné, 15 000
ans, dans un climat extrême, celui des très hautes latitudes froides.
Puis, peu à peu, je me suis attaché aussi à la morphologie de ces éboulis,
apparemment informes, chaotiques et que la géographie avait totalement
négligés jusqu’alors, dans le nord du Groenland. Et je me suis passionné à
leur endroit, sur les plateaux précambriens du nord du Groenland, leur
découvrant une forme particulière, un âge et même, ce fut ma première
grande découverte, des structures stratées résultant de combinaisons
géocryologiques, qui ne peuvent être saisies que dans la durée et
répondant à des lois complexes de la gravité, compte tenu des données
climatiques, de l’exposition et naturellement de la résistance des
matériaux qui varie selon les pétrographies.

© Extraits de Carnets de Jean Malaurie (tous droits
réservés)
LEXNEWS : "C’est alors qu’un premier appel concret du Nord s’est ébauché
pour vous quand, sous la recommandation de votre maître Emmanuel de
Martonne, vous avez été nommé géographe des Expéditions Polaires
Paul-Émile Victor ?"
Jean Malaurie :
Oui. Et c’est avec enthousiasme que j’ai participé à cette expédition qui
se proposait d’étudier l’épaisseur du glacier au Groenland, le profil du
sous-sol, par écho sismique, la météorologie anticyclonique complexe, en
installant une Station centrale, dans l’esprit du grand scientifique
allemand Alfred Wegener, père de la tectonique des plaques et qui est mort
sur ce glacier, en décembre 1930, avec son compagnon groenlandais Rasmus.
Pour ma part, j’étais chargé d’étudier les pierres et la géocryologie sur
les falaises basaltiques et gneissiques de la côte, avec un petit groupe
de naturalistes. J’allais durant deux ans participer à ces expéditions
françaises. Et comment le regretter ? Elles allaient me faire découvrir
des pistes de recherche nouvelles, mais très particulièrement, elles
allaient me permettre de mieux m’interroger sur moi-même.
L’une fut le fait de réaliser que je n’ai pas suffisamment l’esprit
d’équipe pour travailler en permanence avec d’autres (du moins avec
d’autres Blancs !) et que j’ai besoin d’une concentration très difficile à
atteindre en groupe ; bref, que je me découvrais, en tant que naturaliste,
incontestablement heureux dans la solitude au sein de la nature arctique.
L’autre découverte fut celle des Inuit, avec lesquels une sorte d’affinité
secrète s’est immédiatement imposée. J’ai cru comprendre alors une partie
des raisons qui m’avaient obligé à – en quelque sorte – « m’enfuir » de la
vie dite civilisée qui m’était dévolue. J’ai su aussitôt aussi que le
climat du Nord était le mien. J’avais la sensation, surtout, que j’avais
trouvé le sens de mon existence, ma géographie intérieure, et d’avoir
peut-être cherché ce que j’avais inconsciemment déjà trouvé.
Ma décision d’aller le plus au nord du monde est née, sans nul doute, à
l’occasion de ces Expéditions Polaires, à ma rencontre avec le Grand Nord
et ses habitants que j’allais vivre, convaincu que, coûte que coûte, je
parviendrai à ce qui devenait indispensable à ma vie future. Ces
Expéditions Polaires françaises dirigées par Paul-Émile Victor s’étaient
assigné, parce que sous la tutelle et la dictature des sciences dures, de
la glaciologie et de la géophysique, d’étudier les problèmes arctiques en
parallèle avec les problèmes antarctiques et, parce qu’il n’y avait pas de
population dans l’Antarctique, l’Académie des Sciences, qui patronnait ces
expéditions, prit l’absurde décision de ne pas avoir de programme
ethnologique, sociologique et historique dans cette expédition du
Groenland. Et c’est la raison pour laquelle, sur le conseil de mes
maîtres, les historiens Lucien Febvre et Fernand Braudel, après deux ans
de fraternité avec mes camarades de l’expédition Victor que, fin 1949, je
démissionnais de ce programme et revins à mon corps d’origine, le CNRS,
pour assurer dans l’Arctique des missions tout à la fois de géographe
physicien et d’ethnohistorien. Et c’est ainsi que fut décidée, par la
Commission de géographie du CNRS, la « Première expédition géographique
et ethnographique française dans le nord du Groenland en 1950-51 ». Je
la dirigeais et j’étais seul.

LEXNEWS : "Mais avant de savoir si la mission que vous proposiez au CNRS
pour vous rendre dans la mythique Ultima Thulé avait quelque chance d’être
acceptée, c’est bien dans les montagnes sahariennes que vous avez exercé,
pour la première fois, votre métier d’éboulologue ?"
Jean Malaurie :
Absolument. Seul au milieu des Touaregs, ces princes du désert et leurs si
sympathiques esclaves noirs. J’y ai aussi appris, avec une petite mission
d’un Touareg et d’un harratin, ou fils d’esclave noir, à poursuivre à 2500
mètres d’altitude des études comparées géocryologiques dans les pierres
des éboulis sahariens. J’assurais ces missions les hivers 1948-49 et
1949-50, c’est-à-dire immédiatement au retour de mes missions
groenlandaises.
LEXNEWS : "N’est-ce pas au coeur du Sahara, avec votre mission chamelière,
que vous avez reçu un télégramme de Copenhague ?"
Jean Malaurie :
Ce télégramme de Copenhague m’annonçait à mon vif étonnement : « Mission
Malaurie Thulé autorisée » ! Si le mot destin à un sens, il l’a pris pour
moi à cet instant crucial ; je l’ai profondément senti, comme on dit, se
« sceller ». Mais hélas, si mon destin se scellait, c’était sans se
préoccuper des questions financières ! Mon autorisation ne valait en effet
que pour six semaines... et autant dire qu’elle ne valait rien, ou presque
rien ! De surcroît, j’apprenais que les crédits que m’allouait le CNRS ne
me seraient versés qu’à la cession de l’année suivante, en automne. Mais
qu’importe, me dis-je, j’improviserai ! Mon intuition, alors que j’étais
dans ces montagnes du Hoggar, à haute altitude, à 2500 mètres, où certains
hivers il tombait de la neige, était qu’il ne fallait pas attendre ces
crédits et me rendre immédiatement à Thulé, site inuit de l’Arctique le
plus au nord du monde. J’avais le pressentiment assez extraordinaire
qu’une grande menace planait au-dessus de ce peuple unique et qu’il me
fallait arriver avant qu’elle ne le frappe. C’est la raison pour laquelle
cette mission s’est déroulée quasiment sans crédit (votée au printemps,
mais créditée seulement à l’automne, c’est-à-dire alors que j’étais déjà
en expédition, coupé du monde), sans équipement, sans nourriture, dans la
tradition inuit la plus archaïque. J’envoyais aussitôt une réponse à
Copenhague : « C’est décidé, j’hivernerai ! ». C’était sans compter sur sa
réaction quasi immédiate : « Dans ce cas, caution d’au moins 25 000 francs
indispensable. » Une somme que, bien entendu, je ne possédais pas ! Mais,
me souvenant alors d’un grand explorateur danois, le Comte Eigil Knuth,
qui me connaissait et faisait des recherches archéologiques au nord-est du
Groenland, je l’appelais pour lui demander de bien vouloir avancer, à ma
place, cette caution. Je me souviens, non sans une vive émotion, de sa
réponse télégraphique : « Naturellement, je vous la donne : honneur à un
géographe français solitaire à Thulé ! ». J’allais enfin, enfin, connaître
non seulement le jour mais... la nuit polaire !

© Jean Malaurie (tous droits réservés)
LEXNEWS : "Voulez-vous évoquer maintenant, Jean Malaurie, votre arrivée
chez les derniers rois de Thulé ?"
Jean Malaurie :
Je l’ai décrite longuement dans le livre qui a ce titre. Un seul navire
atteignait ces immenses rivages une fois par an, à Siorapaluk. Je trouvais
le village vide, puisque tous les Esquimaux étaient à la chasse à ces
petits oiseaux, les mergules, qui nichent, au printemps, sur leurs
falaises. C’est ainsi que, seul durant quelques heures, j’ai pu largement
découvrir l’environnement qui allait être le mien durant de longs mois et
me sentir profondément saisi par sa beauté, sa miroitante blancheur qui
semble refléter ce que fut, je crois, à sa création, la pureté originelle
d’une planète que notre civilisation dite « avancée » n’a pas su protéger
et nous transmettre intacte.
La première question que les Esquimaux m’ont posée, quand ils m’ont
rencontré au retour de leur chasse, est la suivante : « Mais où sont donc
les autres Blancs ? ». À l’aide de quelques mots de leur langue que je
connaissais, je leur ai dit que j’étais seul, ce qui aussitôt m’a fait
passer comme « un cas tout à fait à part ». Que venait donc faire cet
homme qui n’appartenait pas à une expédition polaire ? Que cherchait-il à
apprendre ?
Mais, très vite, ils ont compris, quand j’ai commencé à partir sur les
falaises avec mon matériel géologique – palmer, décamètre, altimètre -,
que je m’intéressais à leur environnement et que j’avais souvent besoin de
leur présence et de leur aide pour me seconder dans mon travail de
géomorphologue et de cartographe.
Quoique j’aie bien évidemment aussi assuré des recherches « humaines » -
microéconomie, démographie -, concernant leur isolat d’une cinquantaine de
familles, survivant à peu près de la même manière que leurs ancêtres de la
préhistoire dans ces mêmes lieux, ce n’est pas par là que nos relations
ont commencé. Elles se sont nouées, et cela est très important, car il n’y
a aucune similitude possible sur ce plan avec les rapports d’un sociologue
ou d’un ethnologue qui, dès son arrivée, s’affirme en observateur, et que
le comportement d’un observateur évoque toujours celui d’un voyeur et d’un
espion. Nos relations allaient se nouer d’abord, exclusivement, grâce à
notre travail commun en sciences de la Terre. Et, on le sait, il n’est de
meilleur moyen pour créer de vraies relations entre les hommes que de
travailler ensemble : manger, dormir, vivre, rire aussi ensemble, d’égal à
égal, et non d’observateur à observé. Très vite, de surcroît, ces hommes
si proches de la nature se sont passionnés pour mes recherches dans
« leurs » éboulis, et se sont sentis honorés d’y être mêlés et de pouvoir
y jouer un rôle. Lever la carte avec moi les passionnait. Rechercher les
anciens noms toponymiques ensemble alors même que je donnais de nouveaux
noms français et de l’histoire polaire.
Tout en faisant des progrès quotidiens dans leur langue, c’est donc, tout
naturellement, que j’ai pu entreprendre par la suite leur généalogie, car
j’étais alors devenu l’un des leurs. Ma présence, je le vérifiais à chaque
instant, n’était plus celle d’un étranger. Chaque jour, je constatais un
peu plus qu’ils ne se « gênaient » pas avec moi, qu’en quelque sorte ils
oubliaient ma présence, et ne craignaient plus l’insistance de mes
regards. Il est vrai que je m’efforçais de tout faire avec eux et comme
eux ; habillé en peaux de bête, mangeant comme eux, mêlé à leur vie la
plus quotidienne et la plus intime. Ce qui a souvent été dur, car je ne
suis pas naturellement ni chasseur, ni manuel. Pourtant, j’ai, peu à peu,
réussi à diriger mon traîneau avec mes sept chiens, à nourrir, à manger de
la viande crue, et cela sous leur regard attentif et souriant, quoique
parfois ouvertement goguenard.
Le plus difficile, cela dit, fut certainement – mais cela ne l’est pas
moins entre « civilisés » - de parvenir, en même temps, à me faire
respecter. Un respect qui m’était indispensable puisque je voulais avoir
assez d’autorité sur eux pour entreprendre une difficile expédition,
durant laquelle je lèverai la carte au 1 : 100 000 des plateaux tragiques
de la Terre d’Inglefield encore très mal connue, et qui fut publiée par
l’imprimerie nationale au 1 :200 000 et couvrant 300 kilomètres de côtes
sur trois kilomètres d’hinterland.
Je suis l’un des derniers « explorateurs » à avoir vécu parmi les
Esquimaux Polaires de Thulé une vie à peu près totalement « primitive »,
puisque seul l’usage du fusil, importé quelques soixante ans plus tôt par
le célèbre Peary, pseudo vainqueur du Pôle Nord, avait modifié leur
manière de chasser et que seule, aussi, la présence de missionnaires avait
commencé à les christianiser (ou, au moins, à faire croire qu’ils
commençaient à être christianisés !). Mon passage auprès d’eux a pris un
sens tout à fait particulier parce que, m’intéressant à tous niveaux à
leur existence primitive, ils ont commencé à découvrir qu’eux aussi
pouvaient susciter pour les Blancs autre chose que de la curiosité et de
l’aimable condescendance.
 |
LEXNEWS : « Comment avez-vous vécu cet hivernage ? »
Jean Malaurie :
Cet hivernage
allait changer entièrement ma vie. Geboren ! Je suis né à nouveau.
Je suis là, devant des hommes d’un autre âge avec des peaux de bêtes, qui
mangent parfois crue leur viande, qui ont des métaphores extraordinaires
sur les oiseaux qui viennent du Sud pour se faire manger parce qu’il y a
une alliance entre l’oiseau et les hommes... Conscients avant Lamarck
qu’ils ont eu un passé animal, qu’ils sont hybrides et qu’il était un
temps où, à la place du nez, ils avaient un bec de corbeau et des pieds en
nageoires de phoques. Et peu à peu, après m’avoir longuement observé, ils
cherchent à ce que je sois à leur service. Ils m’expliquent, m’apprennent
la langue (j’apprends dix mots par jour), j’ai ma base que j’ai
reconstruite moi-même, avec l’aide des Inuit, à Siorapaluk à 150
kilomètres au nord du Thulé ; il y a là six familles et pas un Blanc. Pour
se déplacer, il n’y a ni boussole, car le géomagnétisme est majeur, ni GPS
alors inconnu et pas de carte, je la dresse moi-même.
Ils ont compris que je pouvais peut-être les aider, car ils avaient un
problème important de stérilité dans leur groupe. Il ne faut pas oublier
qu’ils ont une bonne connaissance des questions de biogénie, car ils en
ont l’expérience également avec leurs chiens. Ils les croisent dans les
accouplements, cherchant, avec succès, à avoir des animaux plus forts. Je
leur ai dit qu’il fallait en fait réaliser leur généalogie sur trois
générations. J’avais d’ailleurs cela en tête, car j’avais vu le grand
démographe Alfred Sauvy avant mon expédition, de même que les célèbres
historiens Fernand Braudel et Lucien Febvre… Tous avaient insisté sur le
fait que la société que j’allais étudier était isolée depuis 1600, et
n’avait été découverte que le 10 août 1818. C’était donc un isolat avec
50-60 familles et pour eux, c’était un mystère que cette société ne se
soit pas déjà effondrée. L’histoire et des hommes et des espèces montre
qu’une société hyper spécialisée devient inféconde. C’est ce qui est
arrivé à l’espèce des mammouths en Sibérie. De fait, ce peuple, au statut
très précaire, ne se renouvelait qu’à 0.8% par an et 16% des couples
étaient inféconds. J’avais également consulté des psychiatres avec toute
une série de tests à pratiquer et j’avais naturellement tout le matériel
géomorphologique de ma discipline. Cette expédition était donc très bien
préparée. Pendant tout l’hiver, j’ai ainsi travaillé sur cette généalogie,
tout en apprenant la langue. Il faut imaginer la difficulté face à des
hommes et femmes qui ont horreur de répéter les noms des morts ! De plus,
leur ironie est redoutable et lorsque je me trompais dans leurs liens de
parenté, ils montraient mon front de leur doigt en disant : -« Tu n’es pas
un savant »… J’étais sans cesse jugé. Peu à peu, tout en étant maître de
ma discipline pour relever une carte, j’ai du m’habituer à la dimension
humaine qui était leur spécialité avec leur manière d’enseigner qui ne se
fait pas avec des mots mais bien par la vie commune et l’action. Après ce
travail généalogique qui m’a pris quatre mois, j’établirais à Paris avec
le démographe Léon Tabah et le généticien Jean Sutter, à l’Institut
national d’études démographiques, une carte qui démontre de façon très
précise qu’ils ont une politique démographique, une planification évitant
les mariages jusqu’au 5ème degré comme l’imposait au Moyen-âge
l’Église de nos sociétés occidentales, et même parfois plus encore.
Ils ne restent avec moi que parce que je les intéresse ; et ce, parce
qu’ils réalisent que je crois en eux et en leur histoire. Je les aide peu
à peu à redécouvrir qu’ils ont une pensée et une philosophie animiste très
complexes. Ils ont un code mental presque de mathématiques naturelles, et
dont ils n’avaient pas pris pleinement conscience. J’entends par
mathématiques naturelles qu’ils ont une connaissance des nombres sacrés
qui les renvoient à une lecture cosmodramaturgique quasi bachelardienne.
Je suis là, à leur donner de nouvelles forces, alors même qu’ils venaient
d’être convertis au christianisme, même s’ils n’y croyaient que
partiellement. Notre rencontre est devenue passionnée et passionnante
parce que j’étais un Occidental qui doutait des vertus du progrès, après
les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, qui allait vers eux et les
confortait dans leur pensée sauvage alors même qu’avec le fusil et la
rencontre avec les Blancs, eux-mêmes commençaient à en douter.

© Jean Malaurie (tous droits réservés)
LEXNEWS : "Avez-vous donc tant appris, vous-même, Jean Malaurie, de la
civilisation Inuit ?"
Jean Malaurie :
Oui, vraiment beaucoup et, plus je vais, plus je continue à apprendre de
ces civilisations arctiques méconnues. J’ai découvert, en particulier, que
ces sociétés ont un véritable code mental, une perception aiguë des lois
des nombres et, notamment, une lecture du ciel extrêmement complexe. Je me
référerais à mon dernier livre l’Allée des baleines : « Les sens
de ces chasseurs, au fil de leur marche, se glissent dans les
anfractuosités de ce décor, dans ses mystères. Ils cherchent à en décoder
les formes ; à l’écoute du rythme chtonien, ils vivent une musique
intérieure. Parce qu’ils ont une ouverture d’esprit géopoétique, ils
s’insèrent entre les notes de la symphonie de l’univers et tentent d’en
lire la partition. Il est des parcours visibles et invisibles, et on n’en
ressort pas indemne. Nombre d’expéditions en témoignent, si athées et
volontairement rationalistes qu’en aient été les acteurs. Au fil des
jours, des mois, des années, des siècles, il est chez ces civilisations
plurimillénaires une hybridation de l’homme avec la matière : l’eau, la
glace, la roche, mais aussi avec toute la nature et ses espèces vivantes.
Eugène Marais, naturaliste et célèbre poète sud-africain, descendant d’une
vieille famille huguenote française, qui a fait des recherches solitaires
sur les singes et les fourmis, pose des questions essentielles et très
profondes sur l’évolution de la conscience rationnelle chez l’homme et
chez l’animal, et surtout, sur l’existence chez l’homme d’une strate
subconsciente, enfouie, trace de sa parenté avec l’animal, restes
primitifs de sensibilité animale, d’une sensorialité primitive. »
(Jean Malaurie, L’Allée des baleines,
Paris, Mille et une nuits, 1ère édition, 2003 ; 2° édition
augmentée, 2008.)
Du Groenland à la Sibérie, en 31 expéditions, presque toujours solitaires
avec les Inuit, je me suis appliqué à leur faire prendre conscience qu’ils
ne seraient qu’apparemment gagnants en adoptant nos moeurs et nos
techniques. Qu’en adoptant aveuglément tout ce que la civilisation blanche
leur apportait, ils risquaient de perdre entièrement les valeurs capitales
de leurs connaissances millénaires. Ainsi, par exemple, le sens profond de
leur volonté de se refuser, et, entre autres, leur extraordinaire
prescience. Dans certains groupes ethniques inuit, comme ceux de Back
River (Arctique central canadien), qui ne comptait que cinq familles, à
mon passage en avril 1963, on refusait de se chauffer pour ne pas perdre
la capacité à survivre dans des conditions de froid plus dures encore,
lesquelles ne pouvaient manquer de se reproduire.
Les Inuit n’ont, durant des millénaires, reconnu qu’un seul maître
absolu : la Nature. Sagesse suprême et qui est celle professée par tous
les mythes grecs. Ils ont toujours respecté ses lois, aussi dures
soient-elles. Leur intuition profonde était que se comporter autrement
revenait à prendre des risques considérables. L’idée de s’évertuer à
comprendre le sens profond de la création, pour déceler son mystère, leur
semble totalement inconcevable. Et plut au ciel en effet qu’un jour, notre
curiosité jamais assouvie, notre soif de découvrir les pensées et les
mobiles de ce que certains d’entre nous nomment « le Dieu caché » et, bien
plus encore, notre prétention de croire que nous sommes capables de
découvrir les tenants et les aboutissants de ses actes, en allant jusqu’à
prétendre avoir reçu de sa part des révélations. Plut au ciel surtout que
ne se retourne pas contre nous cette volonté orgueilleuse d’être dans le
secret des raisons pour lesquelles nous devons vivre et mourir, ne nous
rende coupables d’un crime de lèse-majesté et nous condamne tous à
disparaître.

© Jean Malaurie (tous droits réservés)
LEXNEWS : "En 1951, vous avez assisté, Jean Malaurie, à un drame qui vous
a profondément marqué, parce qu’il a mis un point brutal et final à la
civilisation ancienne des Esquimaux Polaires ?"
Jean Malaurie :
Le 16 juin 1951, je suis en train de gravir un glacier avec trois
traîneaux et deux esquimaux. Je reviens de douze mois d’une vie solitaire
avec les Inuit qui a été littéralement « extra-ordinaire ». Geboren !
Oui, je suis né à nouveau. J’ai sur mon traîneau, dans des caisses, tous
mes fossiles, mes relevés de cartes topographiques et géologiques, mes
carnets ethnologiques, mon journal personnel, mes photos ; je pars prendre
le bateau annuel, avant que les glaces ne se referment, et il ne faut pas
que je le manque. Mes deux compagnons inuit, le chaman Sakaeunnguaq et Q’alasok
– le nombril - sont là avec moi. Ils sont en peaux de bêtes. Soudain
Sakaeunnguaq s’arrête, prend son couteau et le couvercle d’une boite
métallique et, en frappant avec rythme le bord de ce couvercle, il se met
à entonner un chant guttural agonistique. Il est désespéré et me dit :
-« Un grand malheur va nous frapper, nous, Inuit ». Je vous précise que je
n’ai pas de radio, je vous répète que je suis sans boussole car c’est
inutile dans ces régions à fort magnétisme, sans carte puisque je la
dresse et nous nous repérons donc au soleil, sans vivre, en pleine
autarcie, vivant de notre chasse. Nous sommes à 2000 mètres d’altitude,
nous ne sommes pas arrivés au sommet et nous ne voyons pas ce qui est
au-delà de la crête, c’est-à-dire au sud. Nous reprenons la route,
accablés par la peur, très inquiets et nous découvrons soudainement une
base militaire qui se construit à une dizaine de kilomètres, avec un avion
qui décolle toutes les dix minutes. Après avoir traversé avec difficulté
la banquise qui commence à se disloquer, nous arrivons sur cette base avec
nos chiens et nos traîneaux ; les camions militaires vont et viennent.
J’ai les cheveux longs, je sens très fort car je ne me lave plus depuis
des mois, comme mes compagnons inuit. Je suis conduit militairement devant
le général en chef de l’US Air Force de Thulé. Il est extrêmement
mécontent. Il me dit : -« Vous êtes français, d’où arrivez-vous ? Du Pôle
qui est inhabité ? Vous êtes suspect et vous vous trouvez sur une base
militaire très secrète et sans autorisation.» Je lui réponds derechef :
-« Mon Général, puis-je me permettre de vous demander qui vous autorise à
être sur un territoire inuit ? ». Il s’est éloigné silencieux et quelques
minutes plus tard un aide de camp est venu pour me dire que j’étais libre
– « You are released ! » -. Mais j’aurais pu tout aussi bien être arrêté !
C’était un moment dramatique de l’Histoire dont vous avez les tenants et
les aboutissants dans Hummocks, après mon examen attentif des
archives de la Présidence de la Fédération de Russie à Moscou qui m’ont
été exceptionnellement ouvertes, en tant que Président de l’Académie
Polaire d’État à Saint-Pétersbourg (école des cadres autochtones du nord
de la Russie) poste auquel j’ai été nommé par le Président Gorbatchev.
Nous sommes à un moment très difficile de l’après-guerre. C’est la guerre
de Corée et la situation des Nations Unies est périlleuse. Aussi le
Pentagone a-t-il décidé de construire une piste pour avion porteur de
bombes nucléaires, pour frapper Moscou ou Pékin, si nécessaire.
Ceci est l’histoire stratégique. Mais à aucun moment, ni l’US Air Force,
ni le gouvernement danois n’ont consulté le Conseil des chasseurs de Thulé
pour avoir leur autorisation de construire cette base au coeur même de
leur territoire. Ils sont au sommet du monde. Cette rencontre avec la base
américaine a bouleversé ma vie. Après cet entretien avec le général
américain, je me suis isolé dans un fjord avec mes chiens, à l’écart, pour
y réfléchir pendant huit jours. Dans cette solitude, j’ai pensé : si je ne
fais rien, je vais poursuivre ma carrière universitaire en faisant ma
thèse de doctorat d’État, et cette base totalement inconnue du monde, face
à ce peuple dont 1/5° du territoire va être annexé, me fait prendre
conscience que ce combat de ma vie doit être engagé : la défense des
minorités et l’apologie de la diversité culturelle. À la vérité, les
droits sacrés de l’homme à vivre libre chez lui. Il m’appartenait, en
Réfractaire et Résistant, de me mettre à combattre, non pas pour que ce
peuple n’évolue pas et ne subisse pas notre influence – ce qui est
impossible et n’est pas même pas souhaitable, toute histoire progressiste
appelant le contact –, mais que cette influence ne soit pas seulement
nocive, obstructive et, qu’à travers elle, les Inuit demeurent conscients
de leurs valeurs ; je ne veux évidemment pas dire par là qu’ils revivent
dans des iglous et mangent de la viande crue. Des valeurs culturelles et
immatérielles qui ont été à la base de leur survie et dont je suis
convaincu que, nous, les Blancs, avons aujourd’hui besoin et qui, si
impensables qu’elles puissent être, en se mêlant aux meilleures des
nôtres, contribuent à nous éviter le pire. Je crois profondément à ce que
j’appellerais : l’alliance des « meilleurs » ; soit qu’ils deviennent
complémentaires et se fassent valoir les uns les autres, soit aussi qu’ils
se confrontent dans une émulation bénéfique, soit même qu’ils se
métissent.
Le rapprochement chez l’homme des couleurs, des formes d’intelligence, des
pensées, des créativités, est une source de jouvence et sans nul doute
d’avenir. Encore faut-il que dans ce laboratoire de synchrèse, l’opérateur
ait le sens des réalités. Le tourisme entre les peuples n’est qu’un timide
préambule qui devra s’approfondir pour faire taire définitivement, grâce à
la connaissance de l’autre, cette peur délétère que nous en avons encore.
Il faut vivement nous convaincre que nous avons parfois plus d’affinités
intérieures, véritables avec des êtres venus d’ailleurs et même du bout du
monde – passées les barrières de la langue, des moeurs et des usages
locaux, qui nous leurrent trop souvent sur ce que nous sommes vraiment -.
La mondialisation est un malheur. J’ai décidé de témoigner et je suis
rentré à Paris en fondant la collection « Terre Humaine » aux éditions
Plon avec mon livre Les Derniers rois de Thulé, à laquelle s’est
joint aussitôt mon ami Claude Lévi-Strauss avec ce grand livre que je lui
ai demandé d’écrire dans cet esprit : Tristes Tropiques. La
collection qui peut s’inscrire sous le thème des droits de l’homme
poursuit son exploration des sociétés humaines à l’échelle du monde, avec
son prochain centième livre. En 2005, nous avons célébré, à la
Bibliothèque Nationale de France, avec une grande exposition et un
colloque international, et sous le patronage personnel du Chef de l’État
et de Jean-Noël Jeanneney, Directeur général de la BNF, le cinquantenaire
de ce que l’on veut bien appeler aujourd’hui une collection mythique.
LEXNEWS : "Ainsi donc, Jean Malaurie, la création de votre célèbre
collection Terre Humaine, à la suite de son livre fondateur : Les derniers
rois de Thulé, se voulait une plateforme à plusieurs facettes ?"
Jean Malaurie :
Sûrement, oui. Vous le savez, elle est née, avant tout, d’une – je dirais
– « sainte » colère : le mépris de notre civilisation blanche pour tout ce
qui n’est pas elle-même, la conviction intime de sa supériorité en raison
de sa suprématie technique, la manière insoutenable avec laquelle tout ce
qui ne « fonctionne » pas dans les autres civilisations, ne « progresse »
pas selon ses propres critères, est « inférieur ».
C’est pourquoi j’ai voulu donner à Terre Humaine une connotation
« métis » : mettre sur le même plan que les nôtres les témoignages de
sociétés aux évolutions fondamentalement différentes, les rapprocher, les
faire se comprendre et, si possible, s’admirer et s’influencer. Imposer,
par exemple, qu’il est possible de penser oralement sans savoir écrire
(voilà qui commence – et je dis bien commence – aujourd’hui à être admis,
au moins « officiellement »).
LEXNEWS : "Mais enfin, nous témoignons de notre admiration pour les
peuples premiers en présentant leurs oeuvres dans des musées qui suscitent
un intérêt mondial ?"
Jean Malaurie :
En effet, mais vous conviendrez que c’est encore très nouveau ! Seulement,
il y a tout de même un « hic » à cela, si je puis dire, c’est que nous
nous bornons à admirer les peuples premiers pour leur art du passé dont
nous nous déclarons « connaisseurs », nous leur décernons des médailles
« blanches », comme si l’Europe se livrait aujourd’hui à une générale
distribution de prix posthumes aux artistes primitifs ! Mais hélas, il se
passe parallèlement un phénomène stupéfiant, et que je trouve profondément
contradictoire et répréhensible : c’est notre mépris. Pire encore, notre
condamnation de ces peuples à n’avoir dorénavant plus aucun intérêt ni
valeur, maintenant que nous leur avons imposé de basculer dans notre
civilisation. Comme s’ils étaient, de ce fait, incapables d’avoir la
possibilité de nous égaler à l’avenir !
N’est-il pas impossible que nous nous comportions au XXIe
siècle comme les Romains jadis vis-à-vis des Gaulois qui, peut-être, ont
considéré aussi, du fait qu’ils avaient conquis et dominé un peuple
« premier », que celui-ci n’avait aucun espoir, en assimilant et en
associant ses valeurs dites primitives aux leurs, de donner naissance à
une grande nation, en l’occurrence la France ?
Je me suis convaincu, pour ma part, et pour avoir vécu avec les Inuit,
qu’ils ont des valeurs propres assez vives et profondes pour qu’elles
résistent à l’impact des nôtres, aussi totalitaires soient-elles. Le fait
qu’ils adoptent aujourd’hui notre façon de vivre et s’adaptent à elle ne
signifie pas qu’ils renoncent en eux-mêmes à la force créatrice qui leur
est spécifique, pour une renaissance qui influencera en profondeur notre
propre évolution.
Comment ne pas prendre conscience que notre civilisation est à bout de
souffle ? Que notre culture, à tous les niveaux, de plus en plus étendue,
de plus en plus pointue, se retrouve en quelque sorte contre nous, dans le
sens où nous courbons si intensément devant elle, que nous n’avons plus
assez de force, en raison de l’afflux grandissant de nos connaissances,
pour retrouver prestement notre souffle créateur originel ? Chacun déplore
les pertes de valeur, nos démocraties corrompues, des élections ciblées et
le copinage. C’est précisément là où l’apport des peuples premiers peut
être essentiel pour l’avenir de l’Occident. Nos bibliothèques bien
chauffées et, dorénavant, notre asservissement aux ordinateurs qui font de
nous des esclaves, voire des victimes sans mémoire, nous détournent de
plus en plus des forces naturelles, entre autres climatiques, - ce dont
nous commençons à peine à prendre conscience – qui se vengeront en
risquant de précipiter notre perte.
Le temps des réserves stériles où étaient enfermés les peuples premiers,
destinés à revivre indéfiniment leur passé, est définitivement – et fort
heureusement – révolu. Mais nous devons nous persuader aujourd’hui que ce
passé, lié entièrement aux lois de la nature, a une valeur essentielle
pour l’humanité et que les peuples ne doivent pas se laisser séduire sans
la moindre réticence par les mirages de l’Occident, mais qu’ils doivent
nous convaincre, au contraire, que leur présence spécifique parmi nous, en
raison de leur existence passée, est un apport essentiel pour retrouver
notre équilibre et assurer notre survie.
LEXNEWS : "Mais êtes-vous bien sûr que les Inuit vous entendent quand vous
leur parlez, à eux, de cette manière ?"
Jean Malaurie :
Je le crois en effet, et surtout depuis que j’ai découvert l’important
projet de jeunes élites inuit qui ont décidé de créer, au Groenland, dans
la ville d’Uummannaq, un Institut Polaire novateur (UPI), qu’elles m’ont
fait le plaisir de placer sous l’égide de mes convictions et de mes
espoirs en m’en nommant président d’honneur. Cet Institut se propose
justement, en valorisant leur passé, de démontrer notre intérêt à nous,
Occidentaux, à nous inspirer d’urgence de leur sagesse et surtout à nous
convaincre que ces hommes, qui l’ont vécue et respectée durant tant de
siècles, sont susceptibles, mieux que quiconque, de nous apporter un
soutien capital pour recouvrer notre équilibre mondial dévasté et assurer
notre avenir. C’est à Uummannaq que les Groenlandais reconnaissants de mon
oeuvre ont reconstitué, dans une modeste maison groenlandaise recouverte
de tourbe, ma base d’hivernage de 1950. Je vais inaugurer en avril 2009 un
musée de l’exploration exaltant la coopération fraternelle des Inuit avec
les grandes missions occidentales : l’amiral Peary dans la recherche du
Pôle Nord, l’allemand Alfred Wegener dans son étude tectonique des plaques
au Groenland, Knud Rasmussen dans sa grande expédition du Groenland au
Canada (1922-1925) et Jean Malaurie avec son compagnon Kutsikitsoq. La
couverture de mon livre, Les derniers rois de Thulé, est illustrée
de sa photographie, en hommage. Ce musée insistera sur le fait que, à
l’avenir, ces peuples du Nord doivent être nos éclaireurs, dans la
définition du développement durable de ces immenses espaces pétroliers et
gaziers.
Voilà pourquoi je me refuse si fortement à cautionner notre tendance à
réduire exclusivement les peuples premiers à n’être que des fantômes
culturels dans des musées qui me font penser aux Grands Cimetières sous
la Lune de Bernanos, destinés seulement à démontrer la suprématie de
ses jugements esthétiques, alors que nous devrions au contraire proclamer
que lier au nôtre l’avenir de ces peuples est une chance essentielle pour
notre survie.
(Fin 1ère Partie)
Propos
recueillis par Philippe-Emmanuel Krautter
© Interview exclusive Lexnews
Tous droits réservés
|
|
Interview Jean Malaurie
IIème
Partie

|
| |
LEXNEWS : « Vous êtes ainsi passé de la pierre à l’homme. Quels en ont été
les enseignements ? »
Jean Malaurie : J’ai
beaucoup appris et l’homme qui est devant vous continue à apprendre
d’eux ! Avec ces cinquante ans d’expérience auprès de ces peuples, j’ai
appris que c’est une société qui a un code mental différent du nôtre, qui
a la conscience d’avoir un passé hybride avec le monde animal. Comme ils
sont dans un monde extrêmement cruel, et je vous rappelle qu’ils évoluent
dans des températures de – 40 / - 50°, toute erreur est payée très cher.
La vie est très courte ; si certains peuvent atteindre 50-60 ans,
l’espérance moyenne de vie, compte tenu de la mortalité infantile à Thulé,
était de 22 ans pour les femmes, 27 ans pour les hommes. Donc, l’homme
mobilise dans sa vie une énergie extraordinaire, car il sait qu’elle est
courte. Ce sont des hommes qui sont des Inuits, qui ont conscience d’être
dans un groupe et qui ont la conscience d’un destin. Ils savent que cette
histoire doit être transmise. Ce patriotisme ethnique devait être
communicatif, car chaque matin je bénissais le ciel qui me faisait voir
cette glace, entendre le vent qui soufflait, voir mes chiens tirer mon
traîneau.
Ils ont inventé une métaphore de
contes, de légendes, de mythes, qui établissent que l’homme est au terme
de toute une évolution. Ils ont le sentiment de pouvoir décrire de façon
très précise les premiers temps de la Genèse ! Ils vous parlent de manière
détaillée de l’obscurité des premiers temps de l’histoire de la Terre, du
chaos… Ils affirment que tout à coup, les chiens sont apparus et seulement
après la lumière et la lune, ce qui est très curieux. Le chien va
engrosser une femme, et il sera père géniteur de quadrupèdes qui peu à
peu, siècle après siècle, deviendront des humains. Ils sont convaincus que
l’histoire des espèces est aussi celle d’une évolution des espèces, que
l’homme procède de l’animal et que c’est par un crâne plus volumineux avec
un front plus haut que l’homme s’affirme. Ils m’ont d’ailleurs fait
remarquer, pendant tout le temps que je vivais avec eux, près de 50 ans,
au cours de missions multiples, que leur taille par métissage augmentait,
que la couleur de leurs yeux changeait, leur morphologie également ; bref,
que leur évolution se poursuivait. Ils ont également conscience qu’ils
perdent des facultés perceptives par les techniques que l’homme occidental
leur apporte. Par exemple, le fusil permet de prendre un animal à 50
mètres, par contre il vous fait perdre en acuité d’approche. Le chasseur à
l’arc attrapait son animal à 20 mètres, il y avait donc toute une
technique d’approche qu’ils ont perdue. En d’autres termes, ils
m’apprennent qu’en gagnant, ils perdent ! Et peu à peu, ils m’ont fait
sentir que ce que nous leur apportions était très dangereux, non seulement
pour leur identité, mais aussi pour ce qu’ils considéraient être leur
puissance cognitive.

L’exemple des Inuit de Back River –
Utkuhikhalingmiut - est significatif. C’est la société sans doute la plus
primitive de tout l’Arctique. Des Esquimaux Caribous ne vivant que de la
chasse du caribou et de la pêche du poisson de rivière. Cette société est
composée de 25 personnes, cinq familles vivant dans des iglous de neige,
que j’ai étudiées en avril/mai 1965 dans l’Arctique central, à la demande
du gouvernement canadien. J’avais été seulement précédé par le célèbre
explorateur Knud Rasmussen en 1923 qui, en six jours, dans un rapport
remarquable, avait indiqué que c’était là pour lui la société inuit la
plus singulière. J’étais donc le second anthropologue parmi eux. Dans
Hummocks* Canada, cette extraordinaire rencontre pour moi est
racontée, en posant les questions anthropogéographiques, historiques et
philosophiques nécessaires. J’invite les lecteurs à s’y reporter. Le
chapitre V est certainement la partie la plus forte de ce livre. J’appelle
ces hommes les « Spartiates Inuits » ! Songez que ce sont des hommes qui
vivent dans des iglous de neige qu’ils ne chauffent pratiquement pas, ils
refusent de le faire ! Je leur ai demandé pour quelles raisons, ils m’ont
répondu qu’ils n’allaient pas chauffer l’air et qu’il valait mieux se
chauffer dedans ; ils mangeaient un poisson cru toutes les quatre heures
et je peux vous dire, pour l’avoir pratiqué, que j’ai très bien vécu parmi
eux et que j’ai même pris du poids. Ils mangent ce poisson entièrement :
la tête, les yeux et même les arêtes… Ils venaient de connaître une famine
qui avait touché près de 10 % du groupe. Ils m’ont expliqué en outre que
leur société ne pouvait pas ne pas connaître des hauts et des bas. Tout
comme les Netsilik, leurs voisins du nord mangeurs de caribous mais aussi
de phoque, qu’ils méprisaient. Et ils m’ont ajouté que s’ils s’attachaient
à vivre d’une façon plus aisée, cela pourrait être suivi d’une période de
disette et à ce moment-là, ils n’arriveraient pas à résister. Pour
survivre, il faut donc une façon de vivre continue ; ce qui est d’ailleurs
bien connu des services pénitenciers. Si vous voulez briser un homme, vous
le faites vivre durement puis, pendant huit jours vous le rendez très
heureux et après vous le remettez dans le régime sévère. Il ne peut plus
se réadapter avec un tel régime répété. Ce peuple a véritablement établi
une philosophie de la résistance. Et elle repose sur un tabou alimentaire
du phoque. C’est-à-dire qu’ils s’interdisent de manger tout ce qui vient
de la mer. Dans la période de famine, bien qu’ils fussent au bord de la
mer, ils se sont attachés à suivre régulièrement ce tabou, dont j’analyse
les causes psychanalytiques, historiques et religieuses.
Le troisième aspect marquant réside
dans le fait que ce sont des hommes affamés de sacré. Ils sont
littéralement concernés par les morts. En cela, je suis très éloigné de
l’approche marxiste dialectique, car pour moi c’est le mystique qui
commande le social. À l’image de Roger Bastide, un grand sociologue
méconnu, de la dimension d’un Lévi-Strauss – dont il ne partageait pas les
idées structuralistes -, je ne peux pas comprendre comment un homme athée
qui, avec ses pensées d’athée, regarde de tels hommes animistes. Le
matérialisme dialectique athée n’est pas la clé pour comprendre le sacré
et la dimension immatérielle de ces sociétés d’esprit religieux ; et c’est
même l’inverse. Ce n’est pas le contingent de la vie sur Terre qui les
concerne, c’est l’au-delà qui les habite. Cela est si vrai qu’avec le
Christianisme qui est maintenant installé, ils se posent beaucoup de
questions. C’est une des études que j’ai faite
lorsque j’étais dans cette société de Back River, dont je partageais la
vie avec des moyens d’investigations assez exceptionnels (interprètes,
très bonne intégration avec ces hommes et femmes...). Cette société, je le
répète, était en grand péril ; elle venait de connaître une famine et
était à 150 kilomètres d’un comptoir au Nord. Ma mission confidentielle
que m’avait confiée le Ministère fédéral à Ottawa était de les pousser
discrètement à se rapprocher de ce comptoir. Ils m’ont vite fait
comprendre qu’il valait mieux que je m’occupe de mes affaires ! À aucun
prix ils ne voulaient quitter leur mort dont les esprits les inspiraient.
Je poursuis mon enquête ; je le répète, j’ai un interprète qui pidgin avec
eux, car cette langue est difficile, et je commence moi-même à la
comprendre. C’est souvent les mêmes mots que ceux de la langue inuit que
je connaissais, mais la prononciation très gutturale m’empêchait de bien
saisir ce qu’ils me disaient, aussi enregistrais-je tous leurs propos.
Au bout de cinq jours, mon voisin de
couche dans l’igloo de neige – Aqritok – me dit : -« Petit blanc, tu viens
de si loin pour poser des questions si médiocres : ce que l’on mange, où
l’on va, tu viens de si loin pour ça ! Mais peut-être que l’on pense ! ».
Alors, je l’emmène dans le long couloir de neige, nous sommes en tête à
tête pour ne pas perdre la face devant ces deux familles rassemblées dans
une double iglou de neige. Il poursuit alors en me disant qu’ils avaient
bien compris que je souhaitais les faire déplacer dans cet endroit de
perdition du comptoir de la baie d’Hudson à 150 kilomètres, d’autant plus
mauvais qu’il est tenu par les Netsilik catholiques, c’est-à-dire
hérétiques ! Il me fit à nouveau remarquer que les morts, leurs ancêtres,
étaient là, que l’espace historique était là pour les inspirer depuis des
générations et des générations. Et on ne trahit jamais les Anciens. Et il
a ajouté qu’il était chrétien, qu’il venait d’être converti et que j’étais
mauvais. Je lui ai dit : -« Comment cela je suis mauvais ? » Il m’a
répondu : « Oui, tu es riche parce que tu es blanc ! Mercredi soir, l’un
d’entre nous, qui sait lire, va lire des textes. Tu écouteras. » C’étaient
les Béatitudes. Beati poperes ! Heureux
vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous ! Heureux vous
qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés !... Imaginez-les
parler avec des nuages de buée puisqu’il faisait -4° dans l’igloo. Il
poursuit en me disant : -« Oui, nous sommes chrétiens (un christianisme
anglican) ; nous croyons en Dieu le Père mais nous avons du mal à
comprendre sa toute-puissance parce qu’il y a le mal, il y a Satan ! »
Tous ces peuples sont en effet très marqués par l’Apocalypse, la fin du
monde qui doit arriver. -« Nous savons qu’il y aura un combat terrible
entre Dieu et Satan, c’est donc bien qu’il n’est pas tout puissant. Et
puis, il y a Jésus. Nous aimons Jésus car il est pour les pauvres, les
humiliés et il a dit que nous serions à ces côtés, mais pas vous les
Blancs, car vous êtes riches et vous êtes condamnés ! »
Une telle leçon sur les Béatitudes
donnée par de tels hôtes, dans une iglou de neige, c’est inoubliable. Et
je me suis lié avec Aqritok qui m’a dit : -« Quand je suis seul dans la
toundra pour chasser le caribou, j’invoque aussi le chaman et les
esprits ». En fait, dans tout l’Arctique est en train de naître un
néochristianisme, où Jésus est moins le Dieu salvateur que l’ami des
humiliés et le chamanisme reste la voie sacrée pour communiquer avec
l’immatériel et l’invisible. Un courant nouveau du christianisme est en
train de naître dans le Nord comme en Amérique centrale.

En 1965, et jusqu’en 1980, j’ai
poursuivi mon itinéraire dans l’Alaska chez d’autres populations plus
avancées. À Akitchak, sur le Yukon, j’ai
enquêté sur une population inuit yupik de tradition baptiste morave. Elle
avait, elle aussi, cette double inspiration, celle des Béatitudes et celle
d’une meilleure connaissance d’une philosophie chamanique. Les Inuit sont
devenus de bons théologiens ; l’un d’entre eux m’interroge sur les anges,
en me précisant qu’il a besoin de mon aide, car le pasteur n’est pas là.
« Les Anges ont des ailes et ils sont les soldats de Dieu, donc ils ont
été créés par Dieu ; mais Dieu est bon, or il y a des Anges qui sont
mauvais puisqu’ils se sont révoltés contre lui, comme l’archange des
archanges : Lucifer. C’est donc Dieu qui, avant Adam, a créé le mal et
dans ce cas nous ne comprenons plus le péché originel. Et bien s’il vous
plait, si vous avez la réponse, Monsieur le scientifique, je vous en serai
reconnaissant ! »
LEXNEWS : Ces aventures renvoient à ce principe d’anthropologie
d’immersion que vous avez évoqué. L’’observateur fait donc parti de
l’observé ?
Jean Malaurie : J’étais
et je suis dans un environnement universitaire habité par le positivisme
et par la volonté de la rigueur du fait. Le « moi » est haïssable.
Oublions ici ces querelles. Si je témoigne sur la place de l’homme dans le
Grand-Nord, se pose alors le problème de l’enquêteur et de la validité de
l’ethnologue dans son enquête. Dans mes missions avec les Inuit, j’ai
compris que la manière avec laquelle on témoignait rendait très difficile
l’étude des témoignages rapportés parce que l’ethnologue revient avec les
conclusions fondées sur une théorie, sans donner le détail de l’enquête et
le sous texte. Moi, ce qui m’intéresse, c’est comment l’ethnologue est
arrivé à ces conclusions. Il est absolument nécessaire d’inclure
l’observateur dans l’observation. Il est une partie de l’observé et il est
donc indispensable que le témoignage soit personnel. » C’est ce que
j’appelle l’anthropologie narrative et réflexive. Toute la collection
Terre Humaine est inspirée par cette volonté.

LEXNEWS : « Vous ne croyez donc pas à l’objectivité du témoignage ? »
Jean Malaurie :
« Impossible !
Je n’y ai jamais cru et avec des populations lointaines encore moins.
L’affaire Outreau devrait éclairer les sciences humaines sur la fragilité
d’une enquête. Et je continue à craindre que les conclusions n’en aient
pas été tirées dans nos cénacles. Rien n’est anodin. Le « je » n’est non
seulement pas haïssable, mais, bien au contraire, une nécessité
scientifique. Je dois avouer que j’ai eu assez de force pour le dire,
puisque j’ai réussi à décider Lévi-Strauss de l’écrire. Il m’a même écrit
cette étonnante et si élégante dédicace d’un des premiers exemplaires de
son Tristes tropiques en indiquant : « À Jean Malaurie à qui je
suis obligé de m’avoir obligé à écrire ce livre. ». Ce livre a fait
connaître sa pensée, sa grande sensibilité et ses commentaires désabusés
dans le monde entier. Avec le temps, Lévi-Strauss préfère que l’on
reconnaisse la valeur de son œuvre scientifique avec ses œuvres comme
Le cru et le cuit, Anthropologie structurale, etc. C’est le
temps qui décidera de la valeur du structuralisme dans sa dimension
universelle. Ce qui est certain, c’est que ce prince de l’esprit a apporté
un éclat exceptionnel à cette œuvre collective de Terre Humaine, que j’ai
réalisée avec cent auteurs.
LEXNEWS : « Comment avez-vous réalisé la narration de votre témoignage ? »
Jean
Malaurie :
« J’ai
eu recours à ce que j’appelle le « visuel » et à cette volonté d’une
anthropologie narrative et réflexive. Qui est-on ? Qui suis-je pour
l’Inuit ? Ne croyez pas que pour les Inuit, tout cela était facile et
qu’ils étaient mes amis. Ils avaient leur vie et leurs difficultés. Et
comme il s’agissait d’une société « anarchocommunaliste », où le groupe
dirige des individualités au caractère très marqué, ils ont essayé de
m’incorporer. J’ai appris la langue, même si je ne me fais pas
d’illusions, car mes fautes grammaticales devaient être extrêmement
grossières, mais comme ces hommes étaient très courtois et que cette
rencontre les intéressait, ils ont peu à peu parlé « ma » langue
c'est-à-dire en utilisant mes fautes et mon accent. J’ai eu un moment de
retard et ce n’est que six mois plus tard que mes progrès se sont
intensifiés. Cela étant dit, la vraie langue, ce n’est pas celle des mots,
c’est une langue que j’ai vécue mais que l’on ne peut pas mettre en
dictionnaire : les silences, les regards, les gestes, ce qui est sous les
mots, l’action... |

C’est une société qui est à un âge
prélinguistique, surtout en Arctique central canadien, dans les années
1960. J’avais un magnétophone et je leur ai fait entendre ce qu’ils
m’avaient dit. Ils m’ont répondu après le passage de la bande qu’ils
n’avaient jamais dit cela ! Ils m’ont fait comprendre que les mots qu’ils
avaient entendus réduisaient les éclairs de sensibilité qu’ils avaient au
même moment et qu’en prononçant le mot, ils avaient dans l’esprit trois ou
quatre significations. Pour eux, le mot est réducteur. C’est tout
simplement passionnant. Cela est d’autant plus vrai que certains mots
étaient très compliqués comme la terre, le gouvernement, l’au-delà, les
esprits… Tous les mots étaient doubles et avaient plusieurs connotations.
Il fallait alors inventer des mots spéciaux pour que cela soit précis. En
vérité, sans faire de jeu de mots, le verbe englaçait la sensibilité. Dans
le même esprit, ils ne voulaient pas d’autonomie ; mais un gouvernement
Inuit. Tous les mots étaient à repenser. Nous trouvons la même chose sur
le plan spirituel. La plupart du temps, nous n’utilisons pas, dans nos
rapports anthropologiques, les mots dans les traductions qui correspondent
à la pensée du peuple qui vit. Si vous prenez par exemple le mot Tartok,
qui signifie l’esprit, quand je lis les œuvres des plus grands
explorateurs comme celles de Knud Rasmussen par exemple, l’anglais utilise
le mot « soul » : âme ; mais cela n’a aucun sens, cela n’a jamais
été une âme et cela ajoute pour le lecteur une connotation chrétienne ! Et
l’anthropologie repose sur des traductions, principalement en anglais, en
russe et en allemand. Je vous laisse conclure quant au danger de théoriser
à partir d’un matériau aussi contaminé et impur. Nous avons une ardente
obligation, comme les historiens chartistes, de faire un travail de
déconstructionnisme et de critique interne des mots et de la phrase, tout
comme les talmudistes. Pour l’autochtone, ce qu’il a dit ne correspond pas
à ce qui a été traduit ; c’est un faux sens ou un contresens. Nous sommes
là en face d’un champ de rencontre extraordinairement difficile entre un
homme incertain, l’enquêteur, dans un cadre de vie difficile qui ne
correspond pas à son pays, avec un interprète plus ou moins informé dans
la langue occidentale, et l’interlocuteur qui reste masqué, qui ne sait
pas où l’on veut le conduire. Que fait-il donc ? Il manœuvre et brouille.
Finalement, lui aussi arrive à la conclusion que nous n’avons que des
bribes. C’est à l’image d’une instruction judiciaire. L’enquête, le
magistrat, le médico-légal : si vous avez du mal à vérifier a posteriori
tous les éléments de l’enquête, d’étape en étape et dans le détail, vous
imaginez ce que cela peut produire comme erreurs pour l’Histoire d’un
peuple ! Par expérience personnelle, j’ai pu voir des enquêtes de
collègues plutôt bizarres… Je renvoie à l’oeuvre ironique à cet égard sur
l’interprète d’un des grands compagnons de mon ami Théodore Monod, le
poète peul Amadou Hampâté Bâ.
Le lecteur sera le jury et pour qu’il
puisse décider correctement, il faut tout dire. Bien évidemment, on peut
nous rétorquer que cela va être illisible ; et bien non, et c’est là le
devoir de l’éditeur et vous savez que les oeuvres de mes collègues
anthropologues de la collection Terre Humaine ont connu des tirages
exceptionnels ; l’ensemble de la collection représente 13 millions de
volumes, qui témoignent de l’attente d’un public. Quelques exemples,
Dominique Sewane et Le souffle du mort. La tragédie de la mort chez les
Batãmmariba (Togo, Bénin), Philippe Descola et Les Lances du
crépuscule. Relations Jivaros, Haute-Amazonie, Josiane et Jean-Luc
Racine avec Viramma. Une vie de paria. Le rire
des asservis (pays tamoul, Inde du Sud),
Patrick Declerck et Les
naufragés. Avec les clochards de Paris, et Émile Zola avec les
Carnets d'enquêtes : Une ethnologie inédite de la France.

LEXNEWS : « Vous semblez avoir toujours désiré offrir un regard différent
sur l’homme. »
Jean
Malaurie :
« Oui,
c’est vrai. Je me suis toujours opposé à ceux que j’appelle les
missionnaires de la science. Voyez-vous ce que je ne supporte vraiment
pas, c’est cette science arrogante. C’est ce contre quoi je me suis
insurgé lorsque mes camarades des expéditions Paul-Émile Victor
souhaitaient étudier la glace au Groenland et les problèmes de sondages
séismiques en négligeant les plantes, les oiseaux, et les hommes… Il en
est un peu de même dans les sciences humaines. Au fil des temps, s’est
instauré un positivisme, héritier du marxisme, avec pour boussole le fait
objectif et les modèles théoriques que l’on peut en tirer. Cela dit, si
vous pouvez parvenir à m’établir ce qu’est le fait objectif…
Est ainsi posé un problème capital, celui
de la sensibilité. Et pour moi, pardonnez-moi, mais la sensibilité, c’est
la vie, le désir, l’angoisse, l’imaginaire de la matière et ce qui est la
hantise de l’homme : la mort ! On va me rétorquer : « Ah ! L’imaginaire,
l’imagination folle du logis ! Le mysticisme, cette bouillie venant des
temps anciens, de l’inconscient, de la peur, de l’ignorance... Tout ça,
c’est de la religion et non pas de la science. » Mais comment voulez-vous
étudier autrement une société primitive pour laquelle l’essentiel est
composé de sacré et de religion ?
Quand vous êtes un anthropologue, un
ethnologue, un historien et que vous vous revendiquez athée, donc
missionnaire de la science, et que vous voyez un Africain, qui lui est
profondément habité par le sacré et qui a le sentiment que celui qui
l’entoure prend pour billevesée ses croyances, cela ne peut pas
fonctionner. Naturellement, c’est l’objet de son étude puisqu’il en vit ;
n’oubliez jamais que la recherche n’est pas un sacerdoce, c’est un métier
souvent de fonctionnaire pour lequel on fait carrière avec tout ce que
cela sous-entend, hélas, de suivisme à l’égard des idéologies à la mode,
d’ambition, de manoeuvres et d’habileté afin de gravir l’échelle ; tout
comme les singes sur un rocher cherchant à déstabiliser les anciens pour
les faire tomber du sommet… Cela me fait penser à un des plus grands
esprits que j’ai rencontré dans le cadre d’un séminaire que j’animais à l’EHESS,
au Centre d’études arctiques. Il s’appelait Claude Asaba, un anthropologue
professeur à l’Université de Cotonou (Bénin), disciple de Roger Bastide
qui s’est toujours opposé résolument à la pensée de Durkheim, qui suivait
modestement mon séminaire de 2004 sans faire état de ses qualités, alors
qu’il avait une pensée fulgurante digne de celle de Lévi-Strauss. Il me
disait : -« Je suis las de cet enseignement anthropologique à Paris ; on
étudie notre société et nos rituels comme si tout était mort, comme si
nous étions des insectes… Mais c’est que nous avons un imaginaire, une
pensée, et pour nous c’est la vérité ! Les rites sont inspirés par une foi
animiste profonde. En les étudiant, il ne s’agit pas d’être désinvolte
comme si on analysait la théorie des jeux. Je suis chrétien, mais je suis
animiste également et je ne supporte pas que l’on vienne nous regarder en
pensant : tout cela est de la sensibilité, de l’imaginaire, de
l’irrationnel. Non ! C’est nous trahir. » Et c’est ce que d’autres
Africains et autochtones sibériens m’ont confié : une science froide et
dure, qui nie le chamanisme parce que la pensée occidentale, de culture
chrétienne ou rationaliste, ne veut adhérer à ces pratiques qu’elle juge
trop souvent une imposture et les étudie comme relevant de pratique
exotique. Et je reprends l’observation de Roger Bastide : « L’Occidental
veut comprendre tout, tout de suite, et c’est pour cela qu’il ne comprend
pas. [...] La pensée africaine est une pensée savante ».
Ce n’est qu’en 1988, que l’équipe
Gorbatchev m’a demandé de venir pour diriger une mission anthropologique
en Tchoukotka. C’était la première expédition internationale dans ces
régions depuis la révolution d’Octobre et la seconde depuis Catherine de
Russie. Celui qui a décidé les autorités soviétiques à me confier cette
formidable expédition est l’Académicien Dimitri Likatchev, conseiller
scientifique du Président Gorbatchev. Cette expédition avait pour but de
faire un rapport sur la justesse ou les erreurs de la politique de Moscou
à l’égard des minorités arctiques, notamment en Sibérie nord-orientale.
J’ai donc choisi mes huit camarades, tous membres du parti et tous des
amis, malgré mon éloignement pour cette doctrine. L’expédition a été
mouvementée et fraternelle, mon livre Hummocks en témoigne, et nous
faisons une découverte extraordinaire : c’est l’allée des baleines !
À l’échelle arctique, cette découverte,
d’abord identifiée par Sergei Arutiunov en 1977, se révèle être aussi
importante que celle des Pyramides. C’est Stonehenge. Je me reporte à mon
ami l’éminent archéologue russe, Sergei Arutiunov, directeur de l’Institut
d’ethnographie de l’Académie des Sciences de la Russie et qui dans la
préface de l’édition française de l’Allée des Baleines écrit : « [...]
Sans parler de ceux qui regardent et ne voient pas, comme ces dizaines de
marins expérimentés qui ne remarquèrent pas, pendant un siècle et demi,
l’Allée des baleines. C’est un peu comme si un voyageur parcourant
l’Égypte dans tous les sens décrivait le pays en détail sans noter la
présence des Pyramides. [...] Les ethnographes professionnels qui se
rendent dans le Nord pour voir, comprendre et raconter, sont souvent,
quant à eux, limités par leur école scientifique – matérialisme
historique, fonctionnalisme culturel, positivisme objectif, etc. Si
différentes que soient les écoles, elles inculquent toutes un certain
dédain à l’égard des voies d’accès à l’essence des phénomènes du monde
fondées sur l’intuition et l’émotion, et un principe d’approche absolument
inévitable, qui, quand il n’est pas matérialiste, est tout simplement
mécanique. Jean Malaurie se distingue nettement parmi eux. C’est un
véritable scientifique ; il sait se servir de ses instruments quand il
fait de l’ethnographie. Mais il ne se limite pas à cela et cherche à
pénétrer par l’intuition et l’émotion le mystère caché sous l’enveloppe
matérielle des pierres et des hommes. »
Jean Malaurie, L’Allée des baleines,
Paris, Mille et une nuits, 1ère édition, 2003 ; 2° édition
augmentée, 2008.
En fait, et ceci est intéressant pour
terminer notre entretien, lorsque la science n’est plus libre, qu’elle a
des filtres et des à priori, elle ne voit plus, n’entend plus.

LEXNEWS : « Quel regard portez-vous aujourd’hui sur ce vaste espace en
équilibre si fragile ? »
Jean
Malaurie :
« Il
est vrai qu’aujourd’hui, je suis préoccupé par l’avenir avec le
réchauffement climatique qui est une certitude. Ne nous perdons pas dans
des querelles entre glaciologues, climatologues. Le pourquoi reste à
établir. Mais il est une certitude, c’est que le réchauffement a des
effets négatifs et paradoxaux. Il est globalement favorable aux nations
arctiques, mais aussi avec des conséquences très néfastes sur le plan de
la pollution, de l’élévation des mers, de la fonte des glaces et de la
toundra, avec des dégagements de méthane. Mais il faut aussi observer que
le million d’autochtones est appelé à devenir millionnaire, comme les
Bédouins du roi Ibn Saoud en 1923, et que de grands territoires comme
Nunavut, Nunavik, le Groenland peuvent devenir ainsi de grandes puissances
pétrolières et financières. Qui eût accordé à Nanouk ce destin il y a 50
ans ? Outre les richesses pétrolières et gazières, deux nouvelles routes
maritimes majeures : le passage du nord-ouest canadien et la voie du Nord
sibérien reliant Londres, Hambourg à Shanghai et à Yokohama.
Et il se trouve que ces richesses
concernent les quatre plus grandes puissances financières du monde : les
États-Unis, le Canada, la Norvège et la Russie. Le Groenland, suite à son
autonomie renforcée, votée massivement par le référendum consultatif du 25
novembre 2008, commence à explorer ses grandes richesses pétrolières off
shore.
Mais il faut bien se convaincre que les
conquérants que nous sommes, nous, Occidentaux, avons l’esprit pervers. Et
sous couvert de développement durable et d’autonomie des peuples, nous
avons le génie, par la voie du néocolonialisme, de vider ces peuples de
l’intérieur, c’est-à-dire de leur faire perdre toute identité. Et ainsi de
pouvoir à leur place procéder à l’exploitation de ces grands déserts pour
notre bénéfice. Une immigration massive venant du Sud commence déjà à
peupler le Nord : 600 000 Alaskiens nord-américains, des millions de
Russes dans le Nord.
Nous assistons à un métissage physique et
culturel accéléré. Il y aura des laissés-pour-compte, mais c’est un
nouveau peuple du Nord qui est en train de naître. J’ai consacré toute ma
vie à la défense des minorités et je ne cesserai de plaider contre la
mondialisation. Pourquoi ? Parce que je me défends moi-même, j’ai été dans
l’histoire de ma vie une personne à part. Et quand je vois quels ont été
mes amis, tels Roland Barthes, Claude Lévi-Strauss, Fernand Braudel, Bruce
Jackson, ce sont tous des personnalités à part qui ont privilégié la
liberté de penser et le sens du transversal. Dans « Terre Humaine », je
privilégie les personnes ou les groupes à part tels les Juifs, les peuples
autochtones, les prêtres ouvriers, les personnalités engagées qui
dénoncent des scandales aussi vastes que le pillage de l’Amérique latine.
Qu'est-ce qui fait avancer l’Histoire sinon ceux qui ont cette capacité
d’avoir un génie créateur ? Et dans la masse, ils sont toujours à part.
C’est avec cette approche et cette volonté de lutter contre la
médiocrisation, la renonciation aux valeurs d’élite, et à cette
détestation de la mondialisation qui nous tire par le bas, que j’ai eu la
chance d’être désigné Ambassadeur de bonne volonté pour les régions
arctiques, domaines des sciences et de la culture, à l’UNESCO par le
Directeur général, Monsieur Koïchiro Matsuura. C’est à ma requête qu’il
d’ailleurs a décidé de faire organiser du 03 au 06 mars 2009, à Monaco, un
congrès de 40 experts réfléchissant sur les problèmes que pose le
développement durable dans l’Arctique et les intérêts patrimoniaux, des
peuples autochtones. C’est ainsi que l’on pourra, dans le tohu-bohu des
lamentations des grands organismes financiers de l’Occident, enfin
entendre les voix des peuples premiers auxquels si peu d’attention est
accordée. On ne fera rien de grand dans l’Arctique sans le respect de
cette nature aux lois mystérieuses. Il en va du sort même de notre planète
et de notre propre salut spirituel.

Pastel de
Jean Malaurie
(Fin IIème
Partie)
Propos
recueillis par Philippe-Emmanuel Krautter
© Interview exclusive Lexnews
Tous droits réservés
|
|
Un message de Jean
Malaurie à l'attention des lecteurs de Lexnews !

|
|
Interview Jacques
Attali
Paris, le 31/08/18 |
|

A l'occasion de la sortie de son livre Les Chemins de l'essentiel
aux éditions Fayard, Lexnews a eu le plaisir de rencontrer cette riche
personnalité pour qui la culture est une compagne de tous les jours
depuis sa jeunesse. il nous fait partager ses goûts, ses choix et ses
propositions pour encourager nos contemporains de prendre conscience de
l'urgence qu'il y a à sauvegarder ces chemins essentiels de notre
humanité.
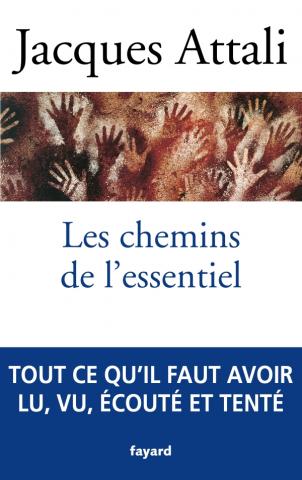
 omment
est née cette idée de réunir en un livre un choix de l’essentiel de la
culture ? omment
est née cette idée de réunir en un livre un choix de l’essentiel de la
culture ?
Jacques Attali :
"L’idée de cet ouvrage a pour origine les demandes
fréquentes qui m’ont été faites d’ouvrages que je lisais ou d’avis de
listes de lecture notamment par des jeunes. Il me semblait dès lors
intéressant d’établir une proposition de ce que chacun devrait savoir,
découvrir. Cette réflexion, que j’ai d’abord commencée avec la
littérature, m’a emmené à penser plus globalement ce que tout honnête
homme devrait connaître. C’est avec un tel questionnement que nous
réalisons l’importance de ces connaissances à acquérir, et j’ai essayé dès
lors de faire un certain nombre de propositions de la manière la plus
universelle possible. J’ai, en effet, pensé ce livre pour un public qui
dépasse le cadre uniquement et seulement français. J’estime en effet très
important de diffuser tout ce qui peut être utile pour d’autres afin
d’atteindre à une culture la plus universelle possible".
_______________
J’ai
retenu ce qui me semblait être les chefs-d’œuvre les plus incontestables
_______________
Le partage est fondamental pour vous,
souhaitez-vous partager votre propre regard sur la culture ou bien
proposer un choix raisonné que tout honnête femme & homme du XXIe siècle
devrait connaître ?
Jacques Attali :
"J’ai eu, en effet, un plaisir personnel en accomplissant ce livre. Je
propose bien entendu mon propre regard pour ces sélections. Je n’ai
nullement cherché à établir un hit-parade des livres les plus vendus, mais
j’ai retenu ce qui me semblait être les chefs-d’œuvre les plus
incontestables. J’aime beaucoup faire découvrir, et lorsque je recommande
un livre ou un film et que mon interlocuteur ne les connaît pas, je lui
réponds la plupart du temps « comme je t’envie ! ». Cette idée de
découverte enrichissant le lecteur ou le spectateur me semble
primordiale".
Hermann Hesse dans son livre « Une
bibliothèque idéale » évoque ces œuvres qui lui « parlaient »
comme critère de choix, Malraux quant à lui qualifie ces mêmes livres
comme faisant partie de « la famille », une proximité déjà rappelée par
Sénèque et Montaigne.
Jacques Attali :
"Je considère ces œuvres en effet comme un compagnonnage très intense. Il
m’arrive souvent de me demander ce que Victor Hugo, Dostoïevski ou Mozart
penseraient de telle ou telle situation".
______________
Le fait d’être en contact avec des
chefs-d’œuvre transforme effectivement la vie
_______________
Henry Miller retient dans « Les livres de ma
vie » les ouvrages qui ont « apporté à la vie ». Cette dimension
semble essentielle pour vous également avec ces chemins de l’essentiel
que vous associez à la vie ?
Jacques Attali :
"Le fait d’être en contact avec des chefs-d’œuvre transforme effectivement
la vie, et ce bien indépendamment du quotidien passé avec les choses plus
banales. Toute œuvre importante raconte une histoire, qu’il s’agisse d’un
roman bien sûr, mais aussi d’un tableau, et même de la musique,
contrairement à ce que l’on croit trop souvent. Qui dit récit implique le
fait de cheminer avec ces personnages, et connaître ainsi, de surcroît,
des vies multiples. C’est une manière de combattre notre condition de
mortel et de mieux affronter la vie réelle qui n’est, en fin de compte,
qu’une des minuscules formes de vie que nous avons.
J’estime, en effet, que certaines
existences évoquées dans une œuvre d’art peuvent apparaître bien plus
exaltantes que celles que l’on peut avoir dans la réalité, cela me paraît
manifeste notamment à la lecture de Guerre et Paix !
|

Les multiples existences dans Les chemins de l’essentiel peuvent
nous aider à faire face à la petite vie réelle dont nous disposons…
J’ai présent à l’esprit certaines de ces œuvres qui ont été très
importantes à des instants donnés de ma vie, je pense par exemple au
concerto n°.2 de Rachmaninov qui a beaucoup compté pour lutter contre le
découragement, les rhapsodies de Liszt et ces merveilleux moments de
découverte du prodige et d’extraordinaire virtuosité, Les Misérables,
véritable révélation quant à l’idéal républicain, l’altruisme et la
générosité, les Pensées de Pascal m’ont foudroyé par leur
simplicité et leur profondeur…"
_______________
Le temps passé en France sur les réseaux
sociaux équivaudrait en une année à la lecture de 200 livres !
_______________
Vous relevez ce constat édifiant que les œuvres
majeures sont de moins en moins visitées.
Jacques Attali : "Oui,
c’est en effet le cas, même s’il faut tempérer ce jugement en rappelant
que sur l’ensemble de la planète, il y a plus de personnes sachant lire et
lisant qu’autrefois. Si nous protégeons cette chance de la francophonie,
nous aurons même bientôt 700 millions de personnes pouvant lire le
Français. C’est un potentiel énorme ! Mais la question reste de savoir ce
que l’on lit. Et aujourd’hui, il est vrai que souvent le flux remplace le
stock. On s’intéresse à ce qui est nouveau en une certaine tyrannie, une
tendance qui existait déjà par le passé avec cette obsession du neuf,
synonyme du vivant, alors que le patrimoine est considéré comme mort.
C’est une erreur monumentale. Tout cela étant, bien entendu, accentué par
cet énorme flux de l’information. J’ai été frappé par ce chiffre
incroyable selon lequel le temps passé en France sur les réseaux sociaux
équivaudrait en une année à la lecture de 200 livres !"
Cette procrastination a selon vous un fondement
plus existentiel encore.
Jacques Attali :
"Oui, une procrastination parce que l’instant est synonyme de vivant,
alors que le patrimoine est considéré comme une série de vies accumulées
que l’on aura toujours le temps de découvrir. Nous sommes persuadés que
nous ne mourrons pas avant d’avoir lu tous les livres de sa bibliothèque,
ce qui est une grande illusion ! Pire, on en retarde la découverte de peur
même d’entamer le stock de vie qu’on est supposé disposer et qui est
symbolisée par tel livre, ce qui est encore plus absurde… Il est certain
qu’on mourra avant d’avoir découvert tous les chefs-d’œuvre de l’humanité.
Il faut donc avoir pleinement conscience de l’urgence que cela implique".
______________
Nous sommes persuadés que nous ne mourrons
pas avant d’avoir lu tous les livres de sa bibliothèque, ce qui est une
grande illusion !
_______________
Quel espoir nourrissez-vous avec cette initiative
?
Jacques Attali :
"Je reçois tous les jours des témoignages me remerciant de cette
réalisation ; certains soulignent tel oubli ou suggèrent telle ou telle
proposition. Dans tous les cas, j’avoue adorer l’émerveillement de mes
lecteurs vécu lors de découvertes offertes par cet ouvrage".
Quelles sont
les œuvres que vous avez (re)découvertes depuis la sortie de ce livre et
que vous auriez souhaité voir figurer ?
Jacques Attali :
"Je regrette d'avoir omis de faire figurer Lucrèce et Camoens dans la
première édition J'ai depuis découvert de nouvelles œuvres magnifiques par
mes lecteurs. Et, j'espère qu'il y en aura encore bien d'autres ! »
Propos
recueillis par Philippe-Emmanuel Krautter
© Interview exclusive Lexnews
Tous droits réservés
reproduction interdite sans autorisation
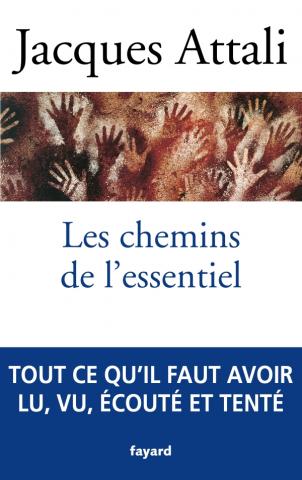 |
|
|
|
Interview Masuno Shunmyō
19/01/18 |
|

Lexnews a eu le privilège d'interviewer une
grande personnalité japonaise, Masuno Shunmyō, prêtre bouddhiste zen,
paysagiste et designer de jardins japonais, connu dans le monde entier pour
la beauté et la pureté de ses créations puisées aux sources du Zen.
Rencontre avec un esprit qui invite à explorer le tréfonds de notre
non-pensée en nos temps troublés...

© Minao Tabata

omment êtes-vous devenu prêtre bouddhiste ?
Masuno Shunmyō : "Mon
père était le supérieur du temple Zen Kenkohji, lieu où je suis né. Par
conséquent, il était tout naturel pour moi de devenir un prêtre zen et
d’hériter du temple. Bien sûr, pour réaliser cela, j’ai dû m’astreindre à
la pratique du Zen à Honzan (le temple principal de la secte Soto au
Japon) et surmonter bien d’autres étapes dans cette voie du Zen, mais qui
m’ont conduit finalement là où je suis aujourd’hui. Tout cela s’est fait
cependant très naturellement, avant même que je ne m’aperçoive que j’étais
devenu un prêtre zen !"
Vous n’êtes pas enfermé dans un
temple, vous êtes aussi connu pour être paysagiste et designer de jardins
japonais reconnu dans le monde entier, ainsi qu’un professeur
d’université. Votre vie est ainsi enracinée dans le monde moderne. Comment
gérez-vous toutes ces activités en tant que moine ?
Masuno Shunmyō : "Je
suis un prêtre bouddhiste et je ne conçois pas d’être un paysagiste sans
être, en même temps, un prêtre résident dans un Temple, et inversement.
L’école du bouddhisme Zen considère les tâches quotidiennes, les corvées
pour les moines, y compris la cuisine, le nettoyage et les services, comme
de bonnes opportunités pour la pratique du Zen, au même niveau que
zazen et la méditation assise pour apaiser l’âme.
Concevoir des jardins, selon moi, est un moyen de m’impliquer également
dans une tâche zen. Je considère mes œuvres d’art comme faisant partie de
ma formation spirituelle, j’exerce une pratique religieuse en concevant
des jardins. J’exprime ainsi les principes Zen dans ces espaces verts que
je conçois et aménage. C’est pourquoi je suis tout à la fois, de manière
indivisible, un prêtre zen et un paysagiste.

© Minao Tabata
Le Zen a pour but d’apprendre à vivre, et donc il n’y a pas par essence de
forme préétablie. Néanmoins, les prêtres bouddhistes zen de la période
Kamakura, (fin XIIe s.) jusqu’à la période Muromachi (fin XVIe s.),
cherchaient avant tout les moyens d’exprimer l’état d’esprit atteint lors
de leurs pratiques religieuses, lui donnant par- là même une certaine
forme. C’est cette forme que l’on a appelée l’art Zen. Ceux qui étaient
doués en littérature récitaient des poèmes, ceux excellant dans les arts
graphiques ont créé ces peintures au pinceau d’encre appelées sumi-e,
un art à deux dimensions, alors que ceux qui étaient en bonne forme
physique concevaient des jardins.
Dans ce contexte, des jardiniers zen ont construit des jardins reposant
sur leurs découvertes de par la discipline religieuse. Ce fut notamment le
cas pour le grand personnage historique Muso Soseki qui a joué un rôle
majeur dans la conception et la réalisation de jardins. Je conçois des
paysages qui décrivent le mieux l’état d’esprit atteint lors des pratiques
religieuses. Actuellement, je suis le seul prêtre bouddhiste qui conçoive
de tels jardins de style japonais".
Vos jardins reflètent votre
vision bouddhique. Pouvez-vous nous expliquer en quel sens le jardin
japonais traditionnel (et également contemporain) reflète l’esprit, ce qui
est bien différent de la conception occidentale d’un jardin.
Masuno Shunmyō : "Les
jardins japonais doivent exprimer l’esprit sous-jacent qui prévaut dans un
espace donné. Il ne s’agit pas de concevoir des concepts comme le wabi,
préconisant la jouissance d’une vie calme, libre de préoccupations
mondaines, ou sabi évoquant la solitude et la désolation à partir
de rien. Une attention particulière est plutôt accordée au paysage et aux
arbres existants. Ce que nous concevons lors de la création d’un jardin
doit donner forme aux expressions déjà présentes. Lors d’un projet de
création d’un jardin, nous devons également tirer le meilleur des
matériaux naturels utilisés pour former les paysages. Tous les matériaux
ont des expressions différentes et doivent être respectés autant que
possible.
En revanche, les jardins occidentaux sont conçus pour exprimer la beauté
des formes et des couleurs. Il y a ainsi une grande différence entre
l’approche occidentale et la nôtre.

© Minao Tabata
Les Japonais ont traditionnellement incorporé la nature dans leurs
maisons, autant qu’ils le pouvaient, comme un moyen d’ajouter de
l’agrément dans leur vie. Les rouleaux suspendus, les paravents pliants,
les plats de service et les meubles qui ornent les maisons sont changés
pour s’adapter au mieux des saisons. Dans le même esprit, les Japonais
portent également des kimonos différents chaque saison.
A l’ouest, c’est le contraire. On a pour habitude de concevoir des jardins
comme des lieux clos et intimes, à l’image de l’aménagement d’une chambre
ou d’un salon, les concepts d’espaces intérieurs sont ainsi transposés à
l’extérieur. Dès lors, c’est une perception élaborée à partir des
intérieurs qui est transposée en design pour les jardins".
Des architectes fameux comme
Tadao Ando, Rei Naito, Ryue Nishizawa, Arata Isozaki semblent eux aussi
préserver ce lien avec la nature à notre époque moderne. Comment
travaillez-vous avec eux dans le cadre de votre design paysagiste ?
Masuno Shunmyō : "Les
Japonais ont toujours eu à cœur de préserver ce sentiment de joie
qu’apporte une nature omniprésente, même lorsque nous vivons dans des
immeubles. Cette valeur est en effet encore bien vivante dans
l’architecture japonaise moderne. Notre conception du design
partage cette même valeur, et à partir de là, nous pouvons avec chacun
d’entre nous nous comprendre, peu importe que nous soyons dans un cadre
traditionnel ou moderne" (...) |

(...) Le Japon moderne oublie de plus en plus ce fondement
traditionnel, comment voyez-vous cette évolution de votre pays en relation
avec notre crise occidentale ?
Masuno Shunmyō : "Le
mode de vie, l’action, la façon de penser des Japonais modernes, ainsi que
l’espace de vie et les villes, ont complètement évolué selon la manière
occidentale. De par cette évolution, les valeurs traditionnelles et le
sens esthétique, bien qu’hérités depuis longtemps, ont été presque oubliés
de nos jours. En particulier, l’art Zen, visant à créer un espace avec une
haute spiritualité, et qui ne consiste pas à concevoir la forme des
choses, mais de percevoir l’espace formé par les choses, ce qui ne peut
être vu par les yeux. Donc, difficile à saisir. Cependant, cette valeur a
sommeillé dans le sang des Japonais depuis si longtemps, elle fait partie
de nos gènes. Tant que nous préserverons notre espace spirituel
traditionnel et tout ce qui en découle, je pense qu’il sera toujours
possible à nos contemporains de redécouvrir ces valeurs à l’occasion d’une
expérience de la beauté dans l’un de ces lieux spirituels, qu’ils peuvent
encore reprendre conscience de ces valeurs à un moment donné".

© Minao Tabata
Pouvez-vous indiquer à nos lecteurs la meilleure voie pour chercher la
paix au quotidien alors que l’urgence, l’efficacité, le culte du résultat
sont nos standards ?
Masuno Shunmyō : "Il
n’est pas facile aux citadins modernes de passer du temps au sein de la
nature dans la sérénité, car nous sommes toujours pressés par le temps et
nous oublions souvent qui nous sommes. Aussi ai-je donc aspiré à créer un
espace qui enrichirait nos esprits et nous permettrait d’être plus
flexibles. Dans le même esprit, nos contemporains urbains sont trop pris
dans l’agitation quotidienne pour trouver du temps pour s’asseoir et
regarder en eux-mêmes. J’ai ainsi conçu des jardins zen en zone urbaine,
de sorte que quand on entre et regarde ces jardins – des espaces d’art
avec des arbres et des rochers soigneusement sélectionnés – cela soit
aussi puissant que lorsque l’on se trouve dans de grands espaces, on peut
dès lors tranquillement réfléchir et méditer sur son existence".
Est-ce que le Bouddhisme peut être compris par la mentalité occidentale
?
Masuno Shunmyō : "Pour
vous répondre, j’aimerais prendre notre expérience de paysagiste hors du
Japon comme exemple. Il est extrêmement plus difficile de construire un
jardin japonais en dehors de notre pays. C’est deux fois, trois fois plus
complexe qu’on ne l’imagine, car il n’est pas facile de saisir notre sens
de l’esthétique ainsi que la valeur de l’espace, ni de trouver les bons
matériaux. Lorsque l’on est sur le point de construire réellement ces
espaces, les différences dans les méthodes de construction et de style de
pensée se révèlent être alors parfois des obstacles insurmontables. Ainsi,
en particulier, la recherche de bons rochers pour réaliser nos jardins
japonais, cela s’avère être un des plus grands défis ! Naturellement, nous
commençons toujours par informer les personnes concernées du genre de
roches que nous recherchons, nous savons ainsi au préalable la nature de
ces roches qui devront se trouver sur le lieu où nous interviendrons. Mais
il s’avère bien souvent qu’aucune de celles que nous trouvons à notre
arrivée ne soit satisfaisante. Nous devons alors nous mettre nous-mêmes à
la recherche de ces roches jusqu’à ce que nous trouvions ce qui exprime le
mieux ce que nous voulons transmettre. C’est un vrai défi!

© Minao Tabata
En même temps, surmonter ces obstacles et achever un jardin dans cet
esprit est gratifiant au-delà de toute comparaison. Certains propriétaires
pleurent en voyant le jardin terminé ! Ces personnes ne comprennent pas
nécessairement ce que nous voulons dire quand nous insistons sur le fait
que « cette branche est nécessaire, parce qu’elle se balancera dans le
vent d’une belle manière » ou qu’elle est « nécessaire parce
qu’elle projette une ombre magnifique sur le rocher ». Ils pensent
parfois que cette branche devrait être coupée parce qu’elle fait obstacle
à la vue. On ne peut reconnaître cette beauté seulement sur plan ou
dessin. Mais nous arrivons à surmonter ces obstacles qui tiennent aux
différences de culture et nous unissons nos efforts pour inscrire notre
travail dans le paysage.

© Minao Tabata
Lorsque tout est accompli, et que les propriétaires découvrent le résultat
final, ils prennent conscience de la beauté que nous poursuivions et sont
submergés par l’émotion qui les frappe. Ils surmontent l’émotion d’avoir
fait partie intégrante du projet et d’avoir pu achever cette
tâche difficile. Je crois vraiment que c’est un échange culturel dans le
vrai sens du terme. De nos jours, de nombreux Occidentaux se tournent de
plus en plus vers la culture orientale, notamment le Japon. La croyance en
la richesse matérielle qui a dominé le XXe siècle a provoqué, entre
autres, de graves problèmes environnementaux. Je pense que de nombreuses
personnes ont tiré les leçons de cette expérience, et manifestent de nos
jours un intérêt pour les voies orientales de développement spirituel
comme moyen d’enrichir nos vies".

© Minao Tabata
© Interview exclusive Lexnews
Tous droits réservés
reproduction interdite sans autorisation
|
|

 |
|
Interview Masuno Shunmyō
(English version) |
|

© Minao Tabata
How did you become a Buddhist priest?
Masuno Shunmyō : "My
father was the head priest of this Kenkohji Zen Temple, and I was born in
Kenkohji Temple. Therefore it is naturally for me to become a Zen priest
and inherit the temple. Of course to carry on the temple I have to make
efforts to pass the Zen practice in Honzan (the head temple of Soto sect
in Japan), and other difficult tests in Zen practice, and eventually now I
am. I feel very naturally, before I noticed that I have already become a
Zen priest".
You are not closed in a temple
but also well-known as a famous garden designer and university professor.
Your life is rooted in the modern living. How do you manage all these
activities as a monk?
Masuno Shunmyō : "I
am a Buddhist priest. I cannot be landscape designer without being a
resident priest at the same time, and vice versa. The Zen school of
Buddhism views daily tasks and chores for monks, including cooking,
cleaning and services, as good opportunities for Zen practice as zazen,
sitting meditation performed to calm the soul.
Designing gardens, to me, is a means of engaging in a Zen task. I regard
my art works as a part of my spiritual training. I am performing a
religious practice by designing gardens. I express Zen principles in the
garden spaces. This is why I am indivisibly a Zen priest and a landscape
designer.

© Minao Tabata
Zen aims to teach one how to live, so it has no form. Nonetheless, Zen
Buddhist priests in the Kamakura period, starting in the late 12th century
to the Muromachi period ending late 16th century, sought ways to express
their state of mind reached through religious disciplines. This is what
could be described as Zen art.
Those good in literature recited poems, those good in visual art painted
sumie ink brush paintings – a two dimensional art. Those good in form
created gardens.
Against this backdrop, Zen gardeners built gardens based on their findings
through religious discipline. This includes the historic Muso Soseki, who
played a major role in designing and producing gardens.
I design landscapes that best describe one’s state of mind achieved
through religious practices. Currently, I am the only Buddhist priest that
designs Japanese-style gardens".
Your gardens creations reflect
your Buddhism vision. Can you explain in what way the traditional (and
also modern) Japanese garden is a mirror of our soul, which is quite
different of the occidental conception of a garden?
Masuno Shunmyō : "Japanese
gardens must express the underlying spirit that prevails in the given
space. One does not design concepts like wabi, advocating the enjoyment of
a quite life, free from worldly concerns, or sabi, connoting loneliness
and desolation – out of nothing. Careful consideration is given to the
existing landscape and trees. Configurations we design gives form to
expressions that are already there.
The designs must also draw out the best of the natural materials used to
form the landscapes. All the materials have different expressions, and
they must be respected as much as possible.
On the other hand, western gardens are designed to express the beauty of
forms and colors. There is a big difference between the two.

© Minao Tabata
The Japanese have traditionally incorporated nature inside their homes, as
much as they could, as a means of adding enjoyment into their lives.
Hanging scrolls, folding screens, serving dishes and furniture that adorn
the houses, are changed to best suit each season. The Japanese also wear
different kimono for each season.
In the west it is the opposite. As one could tell from people that express
their gardens as being rooms, the concepts of interior spaces are taken
outdoors. Elaborate expressions of the indoors are turned into designs for
gardens".
Famous architects as Tadao Ando,
Rei Naito, Ryue Nishizawa, Arata Isozaki seem to keep this link with
nature in a modern time. How do you work with them (or others) in your
Environmental Design?
Masuno Shunmyō : "Japanese
have been historically thinking in this way that the most joyfulness is
feeling nature always surrounding us even when being in buildings. This
value is now still alive in modern Japanese architecture. As long as our
design sharing the same value, we can understand each other and no matter
it is traditional or modern". |
Japanese modern world forgets more and more
this traditional basis, how do you see this evolution in your country,
link with our occidental crisis?
Masuno Shunmyō : "Modern
Japanese people’s life style, action, the way of thinking, as well as the
living space and the cities, have been completely progressing in an
occidental way. Under this condition, the traditional value and esthetic
sense, although it has been inherited from long time ago, has been almost
forgotten in nowadays. Especially, Zen art, aiming at creating space with
high spirituality, is not to design the form of things, but to design the
space formed by things, which is cannot be seen by eyes. Therefore, it is
hard to understand. However, this value has been sleeping in the blood of
Japanese people from long time ago, like DNA. As long as we well keep the
traditional spiritual space and things like this with high spirituality,
once if people had a chance to experience the beauty of spiritual space,
they still can be aware of this value again sometimes".

© Minao Tabata
Can you give our readers
the main advises for searching peace in the daily life where urgency,
hurry, efficiency, results… are the standards?
Masuno Shunmyō : "It
is not easy for modern urbanites to spend time with nature in serenity, as
we are always pressed for time and we often forget who we are. So I
aspired to create a space that would enrich our minds and allow us to be
more flexible. Urban dwellers are too caught up in the hustle and bustle
to find some quiet time to sit down and look within themselves. I designed
Zen gardens in urban area, so that when one comes in and look at the
garden, an art space made with carefully selected trees and rocks are as
powerful as the great outdoors, one can quietly reflect within and feel
one’s living existence".
For you can the Buddhism be
understood by occidental mentality?
Masuno Shunmyō : "I
would like to take our garden work outside Japan as an example to this
question. It is doubly, triply more difficult to build a Japanese garden
outside of Japan. It is much more difficult than one imagines it to be. It
is by no means easy to win an understanding for our sense of aesthetics
and sense of value for space, and finding the right materials. When it’s
time to actually build the landscape, differences in construction methods
and style of thoughts also provide to be stumbling blocks. In particular,
finding the right rocks proves to be the biggest challenge. Naturally we
begin by conveying to the locals the kind of rocks we are looking for, and
we are informed beforehand what kind of rocks are there in the space. But
none of the rocks that the people recommend ever satisfy us. So we have to
continue our search until we find rocks that best express what we want to
convey.

© Minao Tabata
It really is quite a challenge. At the same time, having overcome the odds
and completing a landscape garden is gratifying beyond comparison. Some
locals cry viewing the completed garden. These people don’t necessarily
understand what we mean when we insist “this branch is necessary, because
it sways in the wind in a beautiful way”, or say “it’s necessary because
it casts a beautiful shadow on the rock beneath”. They say the branch
should be cut off because it stands in the way. They don’t recognize its
beauty just by being shown a plan or drawing. But we overcome the barriers
that stand due to differences in culture and such, and join hands to
complete the landscape. Finally, when we gaze at the final product, for
the first time, the locals realize the beauty that we had been pursuing,
and are overwhelmed by the emotion that strikes them.

© Minao Tabata
They are overcome by emotion about being a part of the project and having
completed this difficult task. I truly believe that this is cultural
exchange in the true sense of the word.
Nowadays, many westerners are increasingly turning their attention on
Eastern culture, including Japan. The belief in material wealth that
dominated the 20th century brought about environmental issues and such. I
think people have learnt from this experience and are now developing an
interest in the eastern ideals of pursuing spiritual affluence as a means
of enriching our lives".
© Interview exclusive Lexnews
Tous droits réservés
reproduction interdite sans autorisation
|
|

 |
|
http://www.kenkohji.jp/s/index.html
|
|
Interview Michael
Lonsdale
18 avril 2017,
Paris. |
|
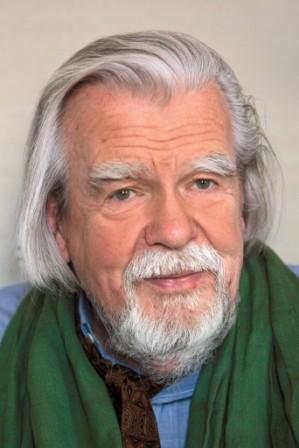
Lexnews a eu le privilège de rencontrer le grand acteur et comédien
Michael Lonsdale, internationalement reconnu, tant au cinéma qu’au
théâtre. Il vient de publier avec « Il n’est jamais trop tard pour le
plus grand Amour » (Ed. Philippe Rey) un ouvrage dans lequel il retrace
avec pudeur sa vie et son cheminement spirituel. Michael Lonsdale a bien
voulu revenir avec nous sur
les grands moments de cette vie, un retour sur ce qui l'a construit,
nourri et qu'il partage avec générosité.


otre parenté est marquée par de nombreuses
naissances hors mariage. Cette constellation familiale a-t-elle compté
dans vos premières années, et notamment dans le choix de cette vocation et
de vos rôles ?
Michael Lonsdale
: "J’ai en effet été l’enfant de la « honte »
aux yeux de mon grand-père lorsqu’il a appris que ma mère avait eu un
amour hors mariage et que j’étais le fruit de cette relation. Il était une
personne toute-puissante car toute la fortune de la famille était entre
ses mains et ma mère dépendait de son argent. Furieux, il souhaitait nous
exiler en Australie, et c’est grâce aux implorations de ma grand-mère que
le choix de l’île de Jersey a finalement été retenu, ce qui m’a valu
d’ailleurs pour ma carrière une maîtrise de l’anglais bien utile ! Il faut
savoir que ce grand-père était lui-même un enfant naturel et qu’il en
avait souffert de longues années, c’était ainsi tout son passé qui
ressurgissait avec moi… Qui plus est, il se trouve que lorsque l’on
remonte dans le temps, cela s’est répété à plusieurs reprises avec des
géniteurs prestigieux tels que le duc de Morny, demi-frère de Napoléon III
ou encore Talleyrand, mais tout cela bien sûr n’est pas officiel mais par
« la cuisse gauche » selon l’expression ! Ainsi, j’ai passé mes
premières années à Jersey, puis à partir de 1939 au Maroc à Casablanca où
en raison de la guerre je suis resté presque dix ans. Alors, oui !, avec
ce passé à l’esprit, il est possible que cela ait joué dans ma vocation et
dans ma vie d’acteur et de comédien, une manière de me révéler alors que
j’étais très timide…"
___________________
Tu sais, je crois que c’est Dieu que tu
cherches !
_______________
C’est un musulman mystique qui vous a donné
en premier la mesure de l’Être divin. Suivi en cela de plusieurs
personnalités que vous avez connues ou rencontrées comme le Père Régamey,
Maurice Zundel…
Michael Lonsdale
: "Oui,
toutes les personnes que vous citez ont joué un rôle important dans ma vie
et dans mon éveil à la foi qui s’est fait tout doucement avec le temps. Je
n’ai pas été baptisé enfant, mon père était protestant et ma mère
catholique tout en ayant pris ses distances. Je me souviens cependant
avoir été attiré très petit par Dieu, sans pouvoir placer sur cette
attraction bien sûr des mots. Les chants entendus lors d’une nuit de Noël,
l’odeur de l’encens et un livre que ma mère m’avait donné, The Life of
Jesus, ont compté pour ce cheminement. Gabsi, l’antiquaire de Fez a en
effet joué un rôle important dans cet éveil à la transcendance. C’était un
ami de ma tante Anne-Marie et nous nous retrouvions souvent le soir dans
une grande brasserie de la ville. Il nous parlait de la grandeur de Dieu,
c’était un musulman mystique, mais je me souviens encore du ton de sa voix
qui exprimait tant de choses qui m’ont marqué. La rencontre avec le Père
Régamey lors d’une conférence qu’il tenait dans l’atelier de Delacroix m’a
littéralement bouleversé. Après cette rencontre, moi, tout timide, j’ai
osé lui avouer que j’étais en quête de quelque chose de grand, d’unique…
Il m’a alors répondu directement : « Tu sais, je crois que c’est Dieu
que tu cherches ! » Cela a été l’appel pour mon baptême à l’âge de 22
ans, un souvenir inoubliable. Le père Régamey est un personnage
irremplaçable dans ma vie. Il dirigeait la revue Art sacré et c’est lui
qui m’a ouvert à l’art et à la culture. Je garde aussi un souvenir
impérissable des conférences du théologien Maurice Zundel ; ce prêtre
suisse m’a ouvert à de nouvelles dimensions spirituelles, notamment celle
d’un Dieu qui n’était pas ce Dieu vengeur et justicier que je croyais voir
dans l’Ancien Testament, mais bien un Dieu ouvert à l’amour dans toute sa
richesse, sa pauvreté la plus extrême dans la crèche comme sur la croix…
Son enseignement a été très précieux pour cette dimension de la foi dans
l’humilité et le dépouillement, ce qui correspond d’ailleurs à sa vie".
Pouvez-vous nous rappeler cette rencontre avec le Renouveau
charismatique, ce qu’il vous a apporté et en quoi il vous a conduit à vous
tourner toujours plus vers vos prochains.
Michael Lonsdale
: "Alors
que j’étais désespéré par la disparition d’êtres qui m’étaient chers,
c’est alors que j’ai fait la connaissance du Renouveau charismatique. Je
suis arrivé au cœur de cette assemblée qui chantait en langue et cela m’a
littéralement bouleversé. C’est un chant sans mots avec une musique
incroyable, j’avais l’impression d’être au paradis ! (rires). J’ai appris
relativement tard que j’étais né le jour de la Pentecôte, tout ce qui
relève du Saint-Esprit me touche infiniment…"
Vous évoquez également dans votre livre des expériences importantes
comme la prière du cœur et cette rencontre étonnante avec sainte Thérèse
de Lisieux.
Michael Lonsdale
: "Oui,
je dois beaucoup à Dominique Rey car c’est lui qui m’avait conseillé de
commenter les Récits d’un pèlerin Russe ; cette personne avait tout perdu,
sa femme, sa maison, il s’en va sur les routes et entre dans une église où
il entend un prêche l’invitant à prier. Il ne cessera dès lors de réciter
cette prière apprise, la fameuse prière du cœur, « Seigneur
Jésus-Christ, fils de Dieu, prends pitié de moi pécheur ». A Paray le
Monial, dans mon hôtel, je me suis retrouvé avec la châsse de sainte
Thérèse de Lisieux qui devait partir pour l’Italie et qui avait été
nettoyée avant son départ. En me penchant sur elle, j’ai ressenti alors
une forte odeur de roses. J’ai pris ce signe comme une proposition. Cela
m’a donné l’idée d’un spectacle dont j’ai donné le rôle à une jeune kabyle
qui a interprété la petite sainte de Lisieux. Avec Françoise Thuriès, une
autre comédienne avec qui je travaille beaucoup, elles ont fait toutes
deux une sélection de textes ayant l’amour pour thème et cela a donné
quelque chose de très bien".
___________________
Voilà je suis à ta disposition,
inspire-moi, je veux te servir au travers du théâtre
_______________
Vous ne cessez de rappeler qu’il est urgent d’aimer, de retrouver cette
candeur des petits enfants, être à l’écoute et effacer son Moi qui prend
tant de place…
Michael Lonsdale
: "J’aime
beaucoup Sœur Emmanuelle et le titre de mon dernier livre est un hommage à
sa mémoire. J’ai monté un spectacle avec Françoise Thuriès qui a joué son
rôle merveilleusement. Alors que j’étais au fond du gouffre, j’avais dit
dans mes prières au Seigneur : Voilà je suis à ta disposition,
inspire-moi, je veux te servir au travers du théâtre. Après, cela m’a
conduit à faire notamment un saint François d’Assise pour lequel
j’ai pris une quinzaine de Fioretti pour un spectacle ; de même pour
Madeleine Delbrêl, cette merveilleuse assistante sociale, qui a été une
grande mystique chrétienne. Plus récemment, à Lyon, nous avons monté
Haydn ou Les Sept Dernières Paroles du Christ en Croix avec un
orchestre complet d’une quarantaine de personnes. Tout cela a beaucoup
compté pour transmettre cet amour". |

©Jean-Claude
Gadmer
L’art a bien évidemment une place
essentielle dans votre vie. Quel regard portez-vous sur votre propre
perception de l’art aux différentes étapes de votre vie ?
Michael Lonsdale
: "Cela
fait très longtemps que je peins, depuis mon plus jeune âge. Selon moi,
c’est un lieu de contemplation. Je ne sais pas ce que je vais peindre, je
ne vous dirai pas que je ferme les yeux en peignant, mais c’est presque
cela ! J’ai découvert cette approche un jour en peignant alors que
j’écoutais la messe en si de Bach. Cela m’a tellement bouleversé, que j’ai
travaillé ainsi, sans faire attention, et lorsque tout a été fini, j’ai pu
constater qu’il y avait plein de personnages dont je n’avais pas idée à
l’origine. Pour moi, cela a été un petit signe ! La couleur également me
fascine… J’ai eu une grande chance d’avoir un oncle, Marcel Arland, qui
m’a sorti de mon ignorance ; c’est lui qui m’a fait lire, découvrir les
œuvres des peintres, les musées. J’étais touché très jeune par l’art et
par le cinéma. Les grands films ont été très importants notamment ceux de
Carl Dreyer avec sa Jeanne d’Arc et ensuite le merveilleux Ordet,
la seule fois où l’on voit quelqu’un ressuscité au cinéma !"
___________________
Pourquoi faites-vous toujours des rôles de
méchant ?
_______________
Avez-vous eu souvent à choisir entre des rôles qui vous poussaient vers
votre foi ou au contraire qui vous en éloignaient ?
Michael Lonsdale
: "J’ai
eu une période où je ne jouais que des rôles de personnes désagréables, ce
n’était pas un fait exprès, mais lorsqu’un chauffeur de taxi m’a posé la
question : « pourquoi faites-vous toujours des rôles de méchant ?
», J’ai alors arrêté ! (rires)".
Votre magnifique interprétation du frère Luc dans le film « Des
hommes et des dieux » est remarquable de sobriété et d’intensité.
Michael Lonsdale
: "Cela
a été en effet une expérience inoubliable. Le personnage de ce frère Luc
est une merveille. Songez qu’il a pratiqué pendant 45 ans des soins
intenses, tous les jours, de 7 heures du matin à minuit ! Il aimait
profondément les êtres humains, quelle que soit leur confession, il a même
sauvé des nazis pendant la guerre, ce qu’on lui a reproché d’ailleurs.
Cela a été un tournage très beau, le réalisateur Xavier Beauvois m’a même
demandé d’improviser cette fameuse scène avec la petite algérienne qui
m’interroge sur l’amour. J’ai spontanément répondu ce qui me venait du
cœur… Tous les acteurs se sont sentis concernés par la réalisation, et au
début, le réalisateur souhaitait qu’ils passent une semaine chez les
moines, ce qui n’enchantait guère certains d’entre eux, ayant peur des
cours de morale ! À l’issue, ils n’ont pas regretté cette expérience qui a
contribué à lever bien des préjugés qu’ils pouvaient avoir. Oui, je garde
un souvenir merveilleux de ce tournage dans ce pays que je connaissais,
certes, mais non cette partie montagneuse".
La compassion de Samuel Beckett vous a particulièrement ému.
Michael Lonsdale
: "Pendant
des siècles le théâtre a développé des thèmes sur les rois, les puissants,
et rarement sur les pauvres. En relisant l’œuvre de Samuel Beckett après
sa mort, j’ai réalisé combien il n’y avait que des pauvres, des fous, des
exclus dans les thèmes qu’il a développés. Dans sa vie, il était de même,
il a gagné une fortune colossale grâce notamment à son prix Nobel et il a
donné sans compter à un nombre incroyable de personnes, l’amitié était
sacrée pour lui. Il a aidé une multitude de gens désespérés. Il avait un
souci immense pour la détresse humaine".
C’est quelque chose que vous avez pu relever vous-même lorsque vous
avez travaillé avec lui ?
Michael Lonsdale
: "Absolument,
mais tout cela était associé à des rires car sinon cela aurait été
terrible à porter. Je lui dois beaucoup, cela a été également des moments
inoubliables. C’est lui qui nous avait mis en scène pour Comédie,
cette histoire avec les jarres avec Delphine Seyrig et Eléonore Hirt. Cela
avait déjà été créé en Allemagne, mais il n’avait pas aimé la mise en
scène car les jarres étaient trop grosses ; au Danemark, c’est une autre
version traitée sur le ton de la comédie qui ne l’avait pas plus
convaincu. Il a alors demandé à Jean-Marie Serreau de pouvoir intervenir
lui-même tel qu’il le souhaitait. C’est ce qu’il a fait pendant un mois
pour nous apprendre la vitesse de nos monologues pour nos trois
personnages, un homme et deux femmes, emprisonnés jusqu’au cou dans des
jarres… La scène commence dans la pénombre et dès que l’éclairage était
braqué, il fallait alors débiter à toute vitesse son texte comme une
mitrailleuse, sans psychologie ni affect !"
___________________
Pour moi, Marguerite Duras a eu une grâce
jusqu’à son dernier souffle
_______________
Vous dressez un beau portrait de Marguerite
Duras qui a eu également tant d’importance dans votre carrière d’acteur.
Michael Lonsdale
: "C’était
une femme qui a toujours cherché l’amour mais un amour qui n’est presque
plus de ce monde, sans oublier l’écriture qui, pour elle, était une chose
sacrée. Elle avait lu Isaïe, les Prophètes, et le fait qu’il était indiqué
dans ces sources bibliques que « c’était écrit » l’a littéralement
bouleversée. Elle avait une vénération pour l’écriture. Cela ne
l’empêchait pas d’être compliquée dans la vie, si je pense à son
féminisme, et ne parlons pas de la politique pour laquelle je m’éloignais
toujours lorsqu’elle l’abordait ! (rires). Nous avons eu des moments
délicieux avec elle dans le travail ; j’ai réalisé cinq choses avec elle
dont trois films. Je pense notamment à Indian Song, ce film dans
lequel je pousse des cris terribles, et pour lequel je me suis beaucoup
investi lors du tournage. J’étais amoureux de Delphine Seyrig, une femme à
mes yeux idéale, et ces cris ont été pour moi un psychodrame, une manière
d’exprimer ce qui ne pouvait s’accomplir. J’ai passé un après-midi à
crier, hurler, gémir pour le tournage, cela a duré tout de même trois
heures à la Maison de la radio… Les gens se demandaient ce qu’il se
passait et s’il fallait appeler une ambulance ! (rires). Je me suis
beaucoup investi, et me suis senti littéralement vidé a posteriori. Pour
moi, Marguerite Duras a eu une grâce jusqu’à son dernier souffle".
Vous réservez une part de votre vie à la peinture, comment
percevez-vous votre propre création et est-elle indissociable de votre foi
?
Michael Lonsdale
: "J’ai
commencé à peindre à l’âge de 17 ans bien avant d’être comédien. Par la
suite, je peignais l’après-midi et j’allais jouer le soir, ce qui faisait
des journées bien remplies ! J’ai passé deux ans sur la Côte d’Azur
pendant lesquelles j’ai beaucoup observé les fonds marins avec un masque
et un tuba. Ces paysages aquatiques m’ont beaucoup inspiré, de même que
les paysages de l’Esterel avec le soleil couchant qui ont nourri
profondément ma peinture. Pour moi, la peinture est un lieu de
contemplation, de prière. J’invente ce que j’appelle des paradis perdus,
des paradis trouvés".
Propos
recueillis par Philippe-Emmanuel Krautter
© Interview exclusive Lexnews
Tous droits réservés
reproduction interdite sans autorisation
Michael Lonsdale en 7 dates
24 mai 1931 Naissance à Paris.
1939 Installation familiale au Maroc.
1947 Retour en France.
1955 Première pièce de théâtre, Pour le meilleur ou le pire.
1956 Premier film, C’est arrivé à Aden.
1996 Nomination au césar du meilleur acteur dans un second rôle pour Nelly
et Monsieur Arnaud.
2011 César du meilleur acteur dans un second rôle pour Des hommes et des
dieux. |
|
Pier Paolo Pasolini
la
rage poétique

|
|

Pierre Adrian « La piste Pasolini »
Equateurs, 2015.
Pierre Adrian, né seize années après le meurtre de Pier Paolo Pasolini sur
une plage d’Ostie, un funeste 2 novembre 1975, a décidé de suivre « La piste
Pasolini » en un voyage initiatique en Italie sur les traces de l’écrivain,
poète et cinéaste. Le prologue débute justement par la fin tragique de celui
qui avait toute sa vie durant gêné les institutions, provoqué les règles
morales d’une Italie encore corsetée par les valeurs d’avant-guerre. Le
jeune Pierre Adrian n’a que 23 ans lorsqu’il découvre cet endroit sordide
par un matin de janvier où sable et mer n’ont rien d’un paysage de rêves, de
cette Italie absente des présentoirs de cartes postales. Que cherche ce
jeune homme dans ces grains de sable muets ? Les éléments taisent
obstinément le destin d’un homme qui a toujours cherché à exprimer
l’insondable profondeur de ses angoisses, de ses aspirations et passions.
C’est ailleurs qu’il faudra aller car « Ostie aujourd’hui, c’est Rome qui
vient cracher dans la mer », note amèrement Pierre Adrian. La quête est
plurielle chez cet étudiant dont c’est le premier livre et qui manifeste
déjà une belle maturité. Fuyant les voies convenues et privilégiant les
médianes, le livre trouve son inspiration dans ce mal de vivre évoqué par
Pasolini, et la critique qu’il fit d’une société consumériste, un jugement
d’une profonde actualité et que les décennies n’ont malheureusement pas
atténué. Antienne, élans mystiques, c’est presque une quête aux
accents mystiques à laquelle se livre l’auteur, partant à la découverte
d’une vie d’un saint des temps modernes et dont les témoignages sont à
rechercher dans les lieux vécus par Pasolini et qui recomposeront peut-être
les traits de son visage. Du Frioul natal à Rome, de la campagne identifiée
aux langues locales à la ville anonyme, il reste des zones où la vie ne peut
être définitivement muselée par la société de consommation, avec ces
témoignages laissés par Pasolini dans ses films tels Accatone ou
Mama Roma, même si ces espaces sont évanouis depuis. Malgré tout, les
traces seront toujours à rechercher et à retrouver en un beau jeu de piste
où les pas de Pasolini guident le narrateur et sollicitent avec sensibilité
le lecteur.
Philippe-Emmanuel Krautter
|

Laurent Lasne « Pier Paolo Pasolini,
le geste d’un rebelle » Editions Le Tiers Livre, 2015.
Laurent Lasne offre avec ce dernier essai un portrait sous un angle original
de Pier Paolo Pasolini dans son rapport avec le sport et notamment le
football qu’il pratiqua toute sa vie durant. Au-delà d’une simple passion
sportive, l’attrait de l’écrivain et poète pour ce jeu collectif si présent
dans la culture populaire italienne relève par de nombreux traits d’une
communion à un espace sacré où individualité et esprit de groupe cohabitent
selon des règles primordiales en de nouvelles mythologies comme les avait si
bien montrées Roland Barthes. C’est à Carsasa que le petit Pier Paolo
découvre le football, à l’âge de six ans. La virilité et l’attrait des corps
masculins sont intrinsèquement associés dans cette passion naissante, une
attirance longtemps effrayée mais qui avec le temps trouvera, sinon un
apaisement, tout au moins une culpabilité atténuée par l’assouvissement de
ses pulsions. L’auteur montre combien le corps de Pasolini s’affûte avec sa
pratique tout autant que son esprit fuse dans les méandres d’une culture
sans cesse élargie. La documentation réunie est impressionnante et témoigne
de la quête de Pasolini qui se tourne « vers le passé pour rendre la
réalité au sacré, manifester la présence du sacré au sein du réel ».
C’est notamment avec la poésie que ce joueur fait des feintes, fronde et
dénonce le « génocide culturel » perpétré par la société de consommation
tout en poursuivant comme une quête impossible cette jeunesse éternelle des
enfants innocents. Le lecteur réalise alors toute la justesse de ce
rapprochement entre Pasolini et le football qui de manière métaphorique,
tout autant que réelle, structure la vie de l’intellectuel. Individu à la
personnalité exacerbée, il sut se mouvoir dans un ensemble collectif où
amitiés et inimitiés évoluent en un espace restreint, poussant le jeu
jusqu’à ses limites, les dépassant même pour devenir hors-jeu, il en paiera
le prix de la manière que l’on sait, assassiné atrocement, ce 2 novembre
1975, sur la plage d’Ostie.
Philippe-Emmanuel Krautter
|

« Un printemps sans vie brûle » avec Pier Paolo
Pasolini, collection Haute Mémoire, éditions La passe du vent, 2015.
C’est un bel hommage que réserve la collection Haute Mémoire des éditions La
passe du vent à Pier Paolo Pasolini pour ce quarantième anniversaire de
l’assassinat du poète, écrivain, cinéaste, dramaturge et essayiste italien,
disparu dans les conditions dramatiques que l’on sait en 1975. Dix-neuf
auteurs contemporains ont accepté de livrer leur témoignage quant à la
mémoire de cette figure unique dans l’histoire du XX° siècle et dont le
message apparaît si actuel à sa relecture sur bien des aspects. Thierry
Renard et Michel Kneubühler pour évoquer Pasolini ont recours à cette belle
image d’insurrection poétique pour celui qui, dés le plus jeune âge, mit sa
plume et son inspiration dans cet art que ne le quitta jamais jusque dans
ses réalisations cinématographiques. Cette insurrection existentielle dont
les racines sont à rechercher dans une histoire familiale complexe et un
rapport au père conflictuel trouva certes un terreau fertile dans
l’internationalisme et les combats politiques où Pasolini prit fait et cause
pour la pensée marxiste, mais avec cette idéologie toujours propre à une
pensée libre qui lui fit critiquer très sévèrement les jeunes étudiants
bourgeois blessant les carabiniers du peuple lors des évènements de 1968
comme s’en souvient Erri de Luca proposant une belle évocation en fin de
volume. Le monde d’aujourd’hui n’est plus celui qu’a connu Pasolini et les
initiateurs de ce bel hommage se posent la question : que dirait-il de notre
époque, comment agirait-il ? Ces interrogations sont en effet celles que se
posent les familiers de la pensée protéiforme et en même temps d’une
redoutable cohérence du militant qu’était Pier Paolo Pasolini afin de
s’opposer aux forces sombres de la société comme en témoigne de manière
cryptée son dernier roman inachevé Pétrole. La poésie a une place d’honneur
dans ces hommages toujours discrets et humbles, le dernier mot revenant à
celui que l’on honore. Cet ensemble de poèmes, de proses, d’études et de
lettres permet ainsi d’approcher de plus près la personnalité de Pier Paolo
Pasolini, ce qui n’est pas le moindre de ses mérites.
(A noter dans ce volume l’article de Pier Paolo Pasolini sur la disparition
des lucioles paru au Corriere della Serra en 1975 quelques mois avant sa
mort).
La Revue Diérèse

Daniel Martinez est à l’origine, en 1998, de la création des
Éditions "Les Deux-Siciles" réunissant plus d’une quarantaine de recueils
aujourd’hui publiés, ainsi que de la revue trimestrielle de Poésie et
Littérature du nom de "Diérèse" avec ses soixante numéros parus. Chaque
numéro de cette revue s’attache à cette alchimie toujours délicate de réunir
des textes d’auteurs connus tels Michel Butor, Sandro Penna, Jean Rousselot,
Henri Meschonnic, Bernard Noël ou d’autres moins connus, mais dont la revue
a décidé de faire partager l’intérêt qu’elle leur porte. Plus livre que
revue, chaque livraison de Diérèse comporte ainsi près de 300 pages de
poésie et de littérature, et se permet même d’y inclure de nombreuses
illustrations, effort remarquable pour une revue autofinancée.
Des numéros spéciaux ponctuent également cette courageuse régularité tel
celui consacré à Pier Paolo Pasolini et à son Journal de 1948-1953 (numéro
Printemps-Eté 2010). Daniel Martinez souligne, dans son introduction,
combien l’intellectuel italien échappe à toute réduction de son œuvre à
l’une ou l’autre de ses expressions. Le lecteur entrera ainsi de plain-pied
dans la fulgurance aussi créatrice et passionnée que douloureuse et sombre
du poète, de l’écrivain ou encore du cinéaste. Ce précieux numéro a retenu,
en effet, une ouverture sur « l’envers du monde, qui nous est habituellement
caché ; y intégrer aussi bien l’affectif en tentant l’impossible pari d’une
absolue coïncidence de la pensée et de l’expression. » écrit en exergue
Daniel Martinez. Ce numéro spécial offre aussi des traductions inédites du
Journal depuis la récente arrivée de Pasolini à Rome en 1948 – il a tout
juste 26 ans – jusqu’en 1953. Ce journal en poésie est accompagné du texte
original en italien alors que la deuxième partie de la revue livre au
lecteur des entretiens de Pasolini tel celui pour la RAI 2 avec Enzo Biagi
en 1971 ou encore des traductions d’extraits de documentaires et films
permettant de mieux saisir et entrer encore dans l’incroyable atelier de la
création pasolinienne. Un numéro spécial de qualité et qui vient enrichir
les trop rares parutions en langue française consacrées à Pier Paolo
Pasolini.
Pier Paolo Pasolini, La longue route de
sable photographies de Philippe Séclier, Relié, 166 × 230 mm, 260 pages, 43
pages de tapuscrit, 61 photographies N&B, Editions Xavier Barral, 2014.

« J’arrive à Ostie sous un orage bleu comme la mort » écrit Pier Paolo
Pasolini dans La longue route de sable tout récemment rééditée aux
éditions Xavier Barral avec des photographies de Philippe Séclier, une
phrase qui sonnera de bien étrange manière pour tous les lecteurs de ce
récit datant de 1959. Le poète et écrivain eut souvent des prémonitions dans
ses écrits, prescience de son avenir à l’image de celui de la société qu’il
n’eut cesse d’interroger. Ce récit est un reportage écrit à la fin des
années 50 pour la revue Successo et qui subit à cette époque quelques
coupes pour la première publication. Avec cette très belle traduction d’Anne
Bourguignon qui parvient à rendre toute la richesse et la complexité de la
langue de Pasolini, c’est, enfin, toute l’intégralité de ce texte qui est
dorénavant accessible accompagné des facsimilés des tapuscrits de la 2° et
3° parties conservés précieusement par l’auteur. Philippe Séclier a souhaité
redonner vie à ces impressions de voyage sur les côtes italiennes que
Pasolini parcourut au volant de sa Fiat Millecento de Ventimiglia jusqu’à
Trieste. Suivant cette route ouverte cinquante ans plus tôt, le journaliste
et photographe capte des instantanés troublants d’identité avec l’univers
pasolinien, de nombreux signes démontreront d’ailleurs leur caractère non
fortuit tout au long du parcours. Les kilomètres défilent et les impressions
s’alignent dans leurs contrastes. Pasolini se voit misérable dans un casino
où il sait qu’il n’est pas à sa place, et en même temps cette expérience se
métamorphose en véritable laboratoire proustien en quelques lignes… Le
regard est sans concession et pourtant capable des émotions les plus fines,
dans des paradoxes qui ne sont qu’apparents. Ce regard porté par l’écrivain
rejoint celui du poète parfois, ou bien fait écho à celui du cinéaste
lorsque les plans et autres éclairages animent les plages avec leurs
modestes habitations ou leurs palais d’un luxe ostentatoire. Mais avant
toute chose, si Pasolini observe et scrute l’homme dans toute sa profondeur,
c’est également dans sa superficialité la plus confondante , car celle-ci
n’est jamais anodine ainsi que l’a révélé toute son œuvre. Le voyage
continue, ponctué de clichés dont les ombres ravivent le souvenir fugace du
passage du poète et la mémoire perpétuant le souvenir de cette longue route
de sable admirablement servie par cette édition.
Philippe-Emmanuel Krautter
Catalogue « Pasolini Roma » La Cinémathèque
française - Skira Flammarion, 2013.

Ce catalogue unique en son genre réunit l’ensemble des documents présentés
lors de l’exposition Pasolini Roma à la Cinémathèque française. Véritable
somme incontournable sur le poète, romancier et cinéaste italien, le livre
reprend le parcours chronologique de Pasolini à Rome avec un nombre
impressionnant de lettres, poésies, témoignages, tableaux et dessins,
photographies de celui dont le nom est définitivement associé à la ville
éternelle. La préface des commissaires de l’exposition - Gianni Borgna,
Alain Bergala et Jordi Ballô - souligne combien cette évocation de la vie
romaine de Pasolini est indissociable de la poésie, la politique, le sexe,
l’amitié et le cinéma, tout un programme donc. La personnification de la
ville n’est pas une image chez Pasolini et se place dans un rapport quasi
amoureux avec ses séductions, ses rencontres, ses peurs et des déceptions
avant le drame ultime. Rome n’est plus la même avec Pasolini et c’est
peut-être ce qu’il y a de plus extraordinaire lorsque l’on découvre les
pages de ce riche témoignage dans une mise en page que n’aurait
certainement pas renié l’écrivain. Plus qu’un catalogue, cette somme
restera un document de référence sur Pier Paolo Pasolini.
Pier Paolo Pasolini « Pétrole » traduction René
de Ceccatty, Gallimard, 2006.

Voici un livre qui se voulait inachevé, fragmentaire, et qui le fût –
fatalement – par l’assassinat de son auteur cette funeste nuit du 2
novembre 1975 ; étrange coïncidence. S’y mêlent les thèmes du double
(thème classique certes, mais ici, poussé à son paroxysme), de la
dissociation sur fond de politique, bien sûr, d’empire financier et de
sexe, mais surtout de mythes et de rites initiatiques ; ces thèmes
typiquement pasoliniens… (voir l’interview d’Emanuele Trevi)
Dans la collection Nrf, Poésie / Gallimard,
le lecteur français pourra découvrir trois recueils des poésies de Pier
Paolo Pasolini avec ses « Poèmes de jeunesse et
quelques autres » tout d’abord dans une édition bilingue
préparée par Nathalie Castagné et Dominique Fernandez qui signe quant à
lui une belle préface sur l’Italie Virgilienne de celui qui fut avant tout
un poète amoureux des dialectes locaux de l’Italie à commencer par celui
du Frioul maternel.

Toujours dans
une édition bilingue élaborée par José Guidi, les
Poésies couvrent la période 1953-1964 de
Pier Paolo Pasolini et forment le cœur de la pensée et de la voix de celui
qui développera ces thèmes par ailleurs dans le cinéma et le roman. Après
la poésie de jeunesse viennent les interrogations sur l’homme et la
société évoquées dans un lyrisme blessé avec une lucidité désespéré… A
noter également, toujours dans la collection
Poésie / Gallimard, Sonnets. Un recueil de poèmes magnifiques
que Pier Paolo Pasolini écrivit après sa rupture avec le jeune Ninetto
Davoli qu’il aimait tant pour sa gaieté et avec lequel il demeurera lié
néanmoins jusqu’à sa mort. Écrit en partie en Italie à l’automne-hiver
71-72 et quelques mois auparavant lors du tournage en Angleterre du film
Les Contes de Canterbury dans lequel Ninetto tient un des rôles
principaux, ce recueil « l’Hobby del Sonnetto », présenté ici en version
bilingue, est un petit chef-d'œuvre !


Poésie encore
avec le recueil de poèmes inédits en français, choisis et traduits par
René de Ceccatty « Adulte ? Jamais » Points Seuil
2013. Couvrant un période de 1941 à 1953, ce recueil – premier
volume portant sur la période de jeunesse du poète - montre la progression
d’une âme poétique à la fois fragile et déjà convaincue, sensible et
combative qui donne à la poésie la primeur de ses idées en germe et qui ne
cesseront de se développer par la suite dans le reste de son œuvre. Un
deuxième volume est prévu.

Voyager avec Pasolini est possible avec ce récit bien particulier qu’est
L’odeur de l’Inde traduit par René de Ceccatty,
Folio – Gallimard. Parti pour un voyage en Inde avec Alberto
Moravia et Elsa Morante, le livre est beaucoup plus qu’un journal tant la
sensibilité poétique de l’auteur y est exacerbée par les multiples
sollicitations du pays parcouru, cette odeur qui toucha tant d’écrivains
avant lui, mais dont le rendu est à nul autre pareil dans ces pages
inoubliables.

En 1969, Pier Paolo Pasolini effectue un second séjour à New York. A cette
occasion, il accorda un long entretien à Giuseppe Cardillo
« Inédit de New York » Arléa éditions,
dans lequel il retrace sa vie et s’exprime sur ses engagements tant
politiques, cinématographiques ou encore littéraires. Retrouvé dans les
archives de l’Institut Culturel Italien de New York – presque par hasard –
par Luigi Fontanella, cet entretien était inédit jusqu’alors, il faut donc
en saluer la publication et la présentation par Luigi Fontanella aux
éditions Arléa.

L’ouvrage « Les Anges distraits » aux éditions
Actes Sud regroupe une quinzaine de nouvelles et de récits
autobiographiques ainsi que deux courts romans qui ont pour cadre commun
le Frioul, région natale de la mère de Pasolini. Ces années de jeunesse
ont été déterminantes pour le poète, le romancier et le futur cinéaste
tant la sensibilité du jeune homme s’émerveille des paysages et lui permet
de dresser une topographie sentimentale de cette région. La sensibilité du
jeune homme se porte non seulement sur l’esthétique et le politique, mais
également sur de jeunes enfants et adolescents dont la beauté le
bouleverse, attirance qui sera d’ailleurs la cause de son départ définitif
pour la capitale italienne suite à un scandale qui le blessera gravement.
Dans « Douce et autres textes » de Pier Paolo
Pasolini toujours aux éditions Actes Sud, on y retrouve un
premier récit Douce issu de son journal intime – Cahiers rouges – et le
jeu subtil des séductions qu’affectionnait tant l’auteur, ici, pour un
jeune et beau Frioulan rencontré lors d’un bal ; puis, dans Romans, écrit
en 48-49, le thème également très pasolinien du double, mais ici mené avec
lui-même. Jeux donc, autobiographiques de masques et de doubles, entre vie
et sensibilité, poésie et littérature.
|
|
Interview Emanuele Trevi
pour son ouvrage
"Quelque chose d'écrit" -
Rome, 07 novembre 2013.
__________________________
Emanuele Trevi est né en
1964. Il est le fils d’un psychanalyste jungien de renom, avec lequel il a
cosigné un livre. Critique littéraire, il a déjà publié des essais et un
roman. Quelque chose d’écrit (Actes Sud, 2013) a été finaliste du prix
Strega 2012, et a reçu le prix du Livre européen 2012 et le prix Boccaccio.

Portrait © DR
Votre ouvrage « Quelque chose d’écrit
» est consacré à Pier Paolo Pasolini, mais Laura Betti y tient une
place également très importante…
Emanuele Trevi : "J’ai écrit le portrait
de Laura Betti comme un portait d’amour après être tombé dans une passion
désespérée pour cette femme. En Italie, on m’a dit - notamment certaines
personnes liées au monde du cinéma - « tu n’avais pas le droit ».
Certaines d’entre elles, il est vrai, étaient très liées avec elle, et
c’est un peu comme si je n’avais pas le droit de toucher à une icône. Il
peut être intéressant de savoir qu’un ouvrage de Cioran, ouvrage qui n’a
pas été jusqu’alors traduit en italien, intitulé « Anthologie du
portrait », a eu une grande influence sur moi. Lorsque j’étais jeune,
j’ai également fait des portraits sans concession pour des articles ou des
chroniques pour la presse – et j’aimais déjà cela–, ce qui ne signifie
nullement des médisances méchantes ou mauvaises. Il s’agit avant tout
chose et essentiellement d’écrire un portrait qui a vraiment du caractère,
et dans lequel on voit l’ombre du sujet. J’ai beaucoup réfléchi à cette
question, et pour moi, c’était l’unique voie par laquelle je pouvais
arriver à ce dernier livre. Je ne pouvais pas faire l’éloge de Laura Betti
parce que j’ai eu avec elle une relation beaucoup trop perverse, empreinte
de perversion."
Il ne semble pourtant pas que le portrait de
Laura Betti que vous avez fait soit négatif…
Emanuele Trevi : "C’est en effet ce qu’il me
semble et c’est en cela que j’apprécie les personnes comme Laura Betti ou
Pier Paolo Pasolini parce qu’ils n’ont pas peur, contrairement à beaucoup
d’autres, de dépasser les barrières, de rendre visible leurs propres
désirs. Dans la vie sociale, normalement, c’est le contraire, tout cela
est caché, mais eux sont eux-mêmes, ils suivent leurs désirs, leurs réels
désirs. En général, on ose rendre visible que des désirs tièdes qui ne
gênent ou ne dérangent pas. Or, eux osaient, ils étaient sublimes !
Pasolini osait en politique, il avait du plaisir à oser faire ou dire dans
ce domaine ce qui ne se faisait pas dans cette gauche italienne. Dans sa
vie privée aussi, il vivait continuellement dans une sorte de scandale
perpétuel. Laura était dans son genre aussi libre, jusqu’à la folie."
Pourtant, dans nombre de documents ou d’écrits,
Pasolini semble être très à l’écoute de l’autre, non ?
Emanuele Trevi : "Oui, il avait toujours une
conscience de l’interlocuteur, s’il était simple, Pasolini était simple.
Pasolini considérait l’interview comme une forme d’art, et pour que cela
se réalise, il faut accepter un mouvement paradoxal à savoir être
intéressé par la personne qui pose les questions. Les interviews de
Pasolini sont très belles, il les travaillait beaucoup. Là aussi c’était
le caractère vrai, authentique de Pasolini."
Qu’est-ce qui vous a conduit à entreprendre la
rédaction de cet ouvrage presque vingt ans après votre travail au fonds
Pasolini avec Laura Betti ?
Emanuele Trevi : "C’est très mystérieux… J’ai
toujours eu dans la vie une grande chance de rencontrer des personnes qui
méritaient d’être peintes ou que l’on fasse d’elles un portrait, et ma
mémoire retient quelque part ces personnalités. Mais, ma mémoire, et c’est
le propre de toute mémoire, garde tout autant qu’elle cache ses souvenirs.
J’avais, ainsi, pensé écrire quelque chose sur Laura lorsqu’elle est morte
en 2004. Elle avait été une personne très importante pour moi durant cette
période où j’avais commencé à écrire des livres. Elle m’avait dit des
choses très fortes et importantes, notamment qu’il me manquait de la rage.
Et puis, il y a eu en quelque sorte la « madeleine », lorsqu’un bel
après-midi d’été alors qu’il faisait horriblement chaud, j’ai décidé
d’aller au cinéma pour me rafraichir un peu parce qu’il y avait l’air
conditionné en cet endroit. On projetait dans un cinéma, ce jour-là, une
reprise du film L’Exorciste, film que j’ai toujours aimé, mais ce
jour-là avec des inédits, des bonus. Or, j’avais complètement oublié que
c’était Laura Betti qui dans la version italienne prêtait sa voix à la
petite fille possédée ; en entrant dans la salle, je voulais seulement
voir les inédits du film. Dans le monde entier a été choisi, selon les
langues, un acteur, une voix bien particulière pour cette voix du diable
qui possède cette petite fille…Or, en Italie, vous imaginez, c’est Laura,
Laura Betti ! Quelqu’un avait pensé à elle pour cette voix terrible. Laura
a alors fait pour cela un très bon travail. Elle a eu une intuition
incroyable. Elle était de Bologne, et elle est parvenue à faire de ce
diable, un diable bolonais, où le vice est bien présent, mais des vices
plus légers et moins diaboliques et non du registre sadien. Et ce fut un
chef d’œuvre ! Mais, elle attachait peu d’importance à tout cela, elle
était loin de cela et peu consciente de la grandeur du film. J’étais seul
dans ce cinéma ce jour de juillet, et c’était donc comme si le film avait
été projeté pour moi seul. C’était une relation vraiment personnelle, seul
avec cette voix, comme si elle était là juste pour moi, cette voix qui
avait l’ironie et les sarcasmes du diable de L’exorciste ! Je suis donc
sorti de ce cinéma avec la conviction que je devais écrire cette chose qui
m’avait été donnée comme une madeleine sonore. J’étais en train d’écrire
un autre livre que j’ai donc dû interrompre parce que ma mémoire était
remontée à la surface, à la conscience, comme une bulle d’oxygène. Il
fallait que j’écrive avant d’oublier de nouveau. J’ai donc commencé à
réunir des livres, et surtout à lire Pétrole, le dernier livre de
Pasolini, parce que Pétrole se devait d’être un personnage à part
entière de mon livre, et ce parce qu’il avait créé dans la tête de Laura
une véritable folie. Une folie dans la folie. La dernière fois que je l’ai
vue, longtemps après mon travail au fonds Pasolini et m’être brouillé avec
elle, je l’observais de loin, elle était en train de se quereller avec un
commerçant parce qu’elle était mal garée, et à la fin, elle n’a rien
trouvé de mieux que de le traiter de « populiste ». Elle me faisait rire,
elle avait en elle ce côté spectaculaire, elle était vraiment comme cela,
folle ! Pourtant, après ce travail au fonds, après m’être brouillé avec
elle, je pensais que c’était terminé. Mais, je repensais constamment à ce
qu’elle m’avait dit. Certes, elle me haïssait, c’était un rapport
totalement dissymétrique, elle m’appelait : « la poufiasse ». Non ! En
fait, la haine est même, peut-être, un sentiment plus noble que ce que je
veux dire ; elle me méprisait plutôt. Mais, s’il y a dans la communication
méprisante beaucoup de choses inutiles, il y avait cependant de ce qu’elle
me disait de manière méprisable beaucoup de choses également vraies. Parce
que je suis au fond tout le contraire du modèle anthropologique de Laura,
j’ai toujours été par mon caractère quelqu’un de non agressif."
Ce mépris a ainsi été fécond, même si vous ne
l’avez sûrement pas vécu, à l’époque, ainsi…
Emanuele Trevi : "Oui, je tentais toujours de
manifester mon amour pour elle, mais cela faisait empirer la situation !
Elle n’en voulait pas. Laura était impossible, elle rendait le travail au
fonds Pasolini impossible, elle ne laissait personne tranquille, elle nous
tyrannisait. On ne pouvait pas travailler en paix, avoir la concentration
nécessaire, et c’était cela pour tout le monde que ce soit nous, des
étudiants ou des chercheurs du monde entier. Ainsi, l’écrivain et éditeur
italien des œuvres complètes de Pasolini, Walter Siti, était si terrorisé
par Laura que nous lui avions donné en secret la clef de la bibliothèque
et qu’il a effectué tous ses travaux et recherches la nuit ! Sinon, dès
qu’elle était là, elle tourmentait sans cesse son entourage ; elle
arrivait dans la salle de lecture, et elle commençait, devant tous les
autres, à vous asséner que vous ne connaissiez pas Pasolini. Et pour
confirmer ses dires, elle entrait souvent après dans des détails intimes
de la vie privée de Pasolini. J’avais pour mission officieuse de
réconforter et de remonter le moral des personnes extérieures, étudiants,
chercheurs étrangers, qui venaient au fonds pour travailler. Elle était
vraiment incroyable, elle faisait des choses incroyables ! Elle tenait,
par exemple encore, à ce que les fenêtres restent toujours fermées alors
même qu’elle fumait, et elle fumait tant – portant, je suis moi-même
fumeur – que l’on finissait tous avec des larmes aux yeux ; elle voulait
conserver la fumée de la cigarette parce qu’elle disait que c’était la
chose la plus belle ! On ne sait pourquoi, et à quoi elle pensait, mais
c’était réellement ainsi. J’allais fumer dehors. Je crois que j’étais bien
l’un des seuls à en apprécier le côté comique. D’ailleurs, je crois que je
suis la seule personne à avoir travaillé avec elle au fonds aussi
longtemps. La personne qui me précédait a fait deux heures ; elle a dit,
Laura, « je vais acheter des cigarettes », et elle n’est jamais revenue…
Laura Betti a-t-elle néanmoins apprécié certaines personnes en dehors
de Pier Paolo Pasolini ?
Emanuele Trevi : "La seule personne qu’elle
aimait, à cette période, était le directeur des Cahiers du cinéma. Il
était une exception et avait droit à une salle à part. Elle n’aimait
l’autre que lorsqu’elle se reconnaissait en lui. Mais, elle avait un
réseau de relations très impressionnant, vous savez. Il le fallait
d’ailleurs pour se permettre d’être aussi désagréable ! Moi,
malheureusement, j’étais tout le contraire ! D’ailleurs, la première fois
où nous nous sommes rencontrés pour ce travail – c’était je m’en souviens
un 1er janvier à 8h du matin, j’avais renoncé à dormir…- elle m’a tout de
suite dit : « tu ne me plais pas ! ». Mais, je suis cependant sorti de cet
entretien avec la conviction qu’elle disait néanmoins de moi, sur moi, des
choses exactes. Elle touchait les points faibles. Elle avait cette
intuition, cette prescience de frapper là où c’est douloureux, là où cela
fait mal. Il y avait aussi une autre personne, une exception, un
archiviste, un homme incroyable qui ne parlait jamais et qu’elle
appréciait, j’ai parlé de lui dans mon livre. Il m’a écrit une lettre
lorsque le livre est sorti : « j’ai lu le livre ; » Point. C’est tout,
mais c’est beaucoup ! Parfois, il y avait cependant des récompenses, des
extras, notamment de partir en voyage avec Laura…"
Vous faites référence dans votre ouvrage à Mircea
Eliade, il y a effectivement dans tout cela quelque chose de hiérophanique,
c’est manifeste, non ?
Emanuele Trevi : "Oui, tout à fait, et on ne
peut expliquer au moins une dizaine – pas seulement une ou deux – mais
bien une dizaine de phrases de la dernière œuvre de Pasolini, Pétrole,
sans recourir aux ouvrages de Mircea Eliade, notamment ces références aux
rites initiatiques qui se trouvent dans le livre Méphistophélès et
l’androgyne de Mircea Eliade ou encore dans Naissances mystiques
qui correspond à un cycle de conférences qu’il avait fait à Chicago. La
chose la plus surprenante, ce sont ces phrases que l’on trouve dans le
manuscrit de Pétrole, celui de Pasolini, et qui sont soulignées en rouge.
Certes, je ne suis pas philologue, mais cela est surprenant. Il y a là un
véritable travail à faire comme cela a été fait pour Proust par exemple ou
Pascal. Dans le cas de Pasolini, ce qui peut être relevé, ce sont ces mots
propres ou liés à certains rites initiatiques, notamment des rites de
l’ancienne Athènes. Mais, je pense qu’on n’a pas compris cela, qu’on a
pris cela le plus souvent pour un point secondaire de la pensée de
Pasolini. Il me semble qu’il y a entre Mircea Eliade et Pasolini une
proximité ésotérique quant à l’histoire des religions. Je ne pouvais, ni
ne souhaitais, alourdir mon livre avec des références, mais je pense que
Pasolini, du moins dans le cas de Pétrole, a vraiment pris des
livres, des passages de Mircea Eliade qu’il a repris pour son ouvrage ;
cela va plus loin qu’une simple source d’inspiration."
Le thème du double, thème de cette dernière œuvre
– Pétrole – de Pasolini est un thème qui a toujours été central
chez Mircea Eliade.
Emanuele Trevi : "Oui, Pasolini a toujours
dit que le double était la chose la plus importante et constituait le
sommet de l’art littéraire comme en témoigne Don Quichotte ou Dostoïevski,
et ce, parce qu’il pensait que le double était le moyen le plus puissant
de connaître la nature humaine. Si la littérature est bien sûr elle-même
un moyen de connaître la nature humaine, le double est un moyen encore
plus fort. Pasolini lisait ce livre d’Eliade alors qu’il était sur le
point de commencer Pétrole, ce qui explique qu’il ait commencé avec le
double. Pasolini lisait également un autre ouvrage d’Eliade consacré aux
rites initiatiques des aborigènes australiens et cet essai va s’entrelacer
avec l’écriture de Pétrole avec cette idée de double. Eliade
développe dans ce texte l’aspect initiatique de l’Hermaphrodite et de
certaines pratiques violentes, scarification, etc. L’Hermaphrodite est,
dans les civilisations traditionnelles, la condition de certaines
divinités. Et, là, Pasolini va changer complètement son projet en
n’introduisant pas seulement un double – sommet littéraire pour lui – mais
un autre prodige, un autre double c’est-à-dire les deux Carlo vont
eux-mêmes se transformer en femme. Le double masculin engendre un autre
prodige féminin. Or, dans cette condition de femme, le double rejoint
toute l’humanité, il devient l’autre. Et c’est vrai que si, demain, je
devenais une femme, la première chose que je ferais, ce serait de chercher
un homme pour voir, pour savoir si c’est vrai que les femmes ont plus de
plaisir, si ce que l’on dit est vrai ! Dans cette transformation, qui est
dans Pétrole transitoire, et donc par son côté éphémère une
occasion, opportunité extrêmement importante, la femme est l’inversion de
la puissance masculine. Or, elles ont été des hommes, des mâles et donc
ont possédé le monde intellectuellement et physiquement, sexuellement. Ils
ont possédé l’autre, mais la sagesse réelle, et donc la compréhension du
monde, exigent de renoncer à un moment à la possession, à la pénétration
pour se transformer dans le nouveau monde, et d’accepter l’autre,
d’accepter d’être possédée, d’où surgit cette énergie. Dans la condition
du mâle, il n’y a pas la possibilité de se sauver parce que la
connaissance n’est pas liée à une addiction d’information sur le monde –
genre marxiste, historiciste – mais, il lui faut trouver, non pas une
méthode, mais substituer à la méthode l’irruption du réel, soudainement...
Cette irruption soudaine du réel ne peut être le fruit d’une méthode.
Parce qu’une méthode se poursuit dans le temps et fonctionne avec des
processus, de manière rationnelle, alors que l’irruption peut ne partir de
rien et arriver à tout. Lorsqu’ils sont femmes, ils participent à des
mécanismes d’initiation, et donc rentrent dans une connaissance
irréversible de la nature humaine. Le prodige est réversible – c’est
d’ailleurs, ce qui va se passer – mais pas la connaissance. La
connaissance, vérité, ce n’est pas une affirmation littérale."
Cela nous conduit alors aux fameux mystères
d’Eleusis…
Emanuele Trevi : "Pasolini aimait en effet
beaucoup les mystères d’Eleusis. Il a choisi ces mystères, et non pas les
aborigènes, parce qu’il y voyait une dimension ou composante démocratique
parce que les esclaves, mais aussi les étrangers pouvaient y participer.
Hercule, lui, qui n’était pas d’Athènes, a pu être initié parce que Thésée
a sacrifié un petit porc. Pour Pasolini, c’était un modèle idéal."
Peut-on dire qu’avec Pétrole, Pasolini
expérimente un genre littéraire ?
Emanuele Trevi : "Complètement, parce que la
littérature conte toujours des prodiges, mais la plupart du temps il n’y a
qu’une seule personne qui est capable ou un double. Mais, ici, avec
Pétrole, chaque double va lui-même se transformer en un autre sexe, et
chacun va, de plus, revenir ensuite à sa condition initiale. Je pense que
Pasolini, avec son dernier livre, est allé de l’autre côté. Il a abandonné
la méthode, et a préféré l’aventure, la possibilité de l’irruption. Comme
le disent les Maîtres zen : « La réalité n’est jamais la conséquence de
l’exercice. » On tombe dans la réalité sans aucune forme d’anticipation ou
de prévoyance. On est expulsé de la vérité. Aucun mysticisme n’est une
stupidité, parce que si on tombe dans la réalité, on est chassé de la
vérité aussi soudainement. Lorsque les personnages de Pétrole font
à rebours le parcours du prodige, les doubles prodiges de la fin du livre
sont probablement comme des blessures qui se referment. Tout commence là,
et peut-être que la condition de l’acquisition de la vérité des
personnages ne nous regarde pas, qu’elle ne regarde qu’eux parce que nous
ne participons pas. Pasolini n’allait donc pas raconter quelque chose qui
ne concernait pas le lecteur."
Pasolini n’a pas souhaité faire un livre à thèse…
Emanuele Trevi : "En effet. Vous savez, il
existe à Florence une boite dans laquelle Pasolini rangeait des articles
de presse assez brûlants, or ces articles sont bien plus périlleux parce
qu’eux, contrairement à Pétrole, mentionnent des noms. Cela écarte
la thèse politique ou du complot. Ce livre révèle plutôt un problème de
fatalité dans la mesure où Pasolini souhaitait écrire un livre inachevé
qui n’aurait pas été fini par son auteur avec notamment cette idée de
fragments ; Il avait d’ailleurs pris conseil pour cela auprès d’un
professeur de philologie. Or, il est mort, il a été assassiné lorsqu’il se
consacrait à ce livre même, et des pans, des fragments qui se voulaient
inachevés sont réellement demeurés inachevés. Une sorte de fatalité… Par
exemple, on sait de source sûre que Pasolini, sur les conseils de ce
professeur de philologie, avait dans un chapitre volontairement renvoyé à
un chapitre précédent qui n’existait pas, un effet de style en quelque
sorte pour asseoir l’inachevé, mais aujourd’hui, s’il manque un chapitre
auquel renvoie un autre, comment savoir si cela a été voulu par Pasolini,
s’il a réellement disparu ou a été subtilisé….C’est extrêmement difficile
de faire la part des choses et de savoir ce qui a été réellement voulu
inachevé lors de l’homicide, de trancher ces fatalités successives en
quelque sorte…"
Propos
recueillis par Philippe-Emmanuel Krautter
© Interview exclusive Lexnews
Tous droits réservés
reproduction interdite sans autorisation

|


MAMMA ROMA Un film de Pier Paolo PASOLINI | Drame
| Italie | 1962 | 110mn, CARLOTTA FILMS.
A Rome, Mamma Roma, prostituée vieillissante, abandonne son
métier lorsque son proxénète entreprend de se marier. Elle décide alors de
récupérer Ettore, son fils, laissé aux bons soins d’un pensionnat depuis
près de seize ans et de commencer une nouvelle vie, plus honnête et
respectable.
CARNET DE NOTES POUR UNE ORESTIE
AFRICAINE (Appunti per un’Orestiade africana), CARLOTTA FILMS.
Un film de Pier Paolo PASOLINI | Comedie-Dramatique |
Italie | 1970 | 71mn | 1.33
Pier Paolo Pasolini débarque dans un pays d’Afrique. Il prend des notes,
avec sa caméra, pour préparer son prochain film, une transposition de L’Orestie,
la tragédie d’Eschyle, dans l’Afrique d’aujourd’hui. De retour en Italie,
il montre ses premières images à un groupe d’étudiants africains de
l’université de Rome. Il leur demande leur avis…
NOUVEAUX MASTERS RESTAURÉS
Versions Originales Sous-Titres Français
Format 1.85 respecté – 16/9 compatible 4/3 – N&B |
|
|
 COFFRET
DVD Durée : 491 mn COFFRET
DVD Durée : 491 mn
Réalisation : Pier Paolo Pasolini
Contient :
- Accatone : Dans la banlieue romaine,
Vittorio "Accatone" Cataldi, un petit souteneur, perd son gagne-pain quand
Maddalena est arrêtée par la police. Il entreprend alors de séduire la
pure et naïve Stella avant de l'envoyer sur le trottoir. Mais cette
rencontre va bouleverser sa vie au-delà de tout ce qu'il imaginait...
- Oedipe roi : Dans l'Italie des
années 1920, un garçon naît, vite jalousé par son père. À la scène
suivante, Laïos, roi de Thèbes, est averti par un oracle qu'il sera tué
par son fils Oedipe, qui ensuite épousera sa mère Jacoste. Laïos abandonne
alors l'enfant dans le désert. Sauvé par des bergers, l'enfant est
recueilli par le roi Corinthe. Devenue adulte, Oedipe consulte l'oracle
sur le mystère de ses origines. Horrifié par la réponse, il prend alors la
fuite...
- Comizi d'amore : Pasolini se
transforme ici, comme il le dit lui-même, en "commis voyageur parcourant
l'Italie pour sonder les italiens sur leurs goûts sexuels". En utilisant
le sexe comme révélateur, le cinéaste parvient à mettre à jour une culture
répressive dans le Nord (débris d'une idéologie "clérico-fasciste") et
réprimée dans le Sud (où elle révèle "sa propre nature archaïque,
incongrue et névrotique")...
- Les oiseaux petits et grands : Un
père et son fils errent dans les interstices de l'Italie Moderne. Les deux
pèlerins rencontrent un corbeau doté de la parole et fort inspiré par
Marx, Freud et Gandhi. L'insouciance des deux hommes se retrouve alors
confrontée à la raison et la parole...
- Médée : Le récit est fidèle à la
légende : Jason, qui est à la recherche de la Toison d'Or dans le but de
récupérer son royaume, rencontre Médée sur l'île de Colchide. Il
s'emparent de la Toison puis s'exilent à Corinthe où règne Créon... |
|
|

Bologne peut
s'enorgueillir de posséder les archives de Pier Paolo Pasolini, natif de
la ville. Un fonds couvrant l'ensemble de la production du grand
écrivain, poète et cinéaste italien.
|
 |
|
|
|
La marquise Luisa Casati
23-01-1881 / 01-06-1957

Interview
Scot D. Ryersson et Michael Orlando Yaccarino
|
|
Née à la fin du XIXe siècle, il y a 134 ans, Luisa Amann, épouse du
marquis Casati Stampa di Soncino, ne cessa sa vie durant, et même au-delà,
de surprendre, d'étonner, voire de choquer. La marquise Casati fut l'amie
de Robert de Montesquiou, la
muse de Gabriele d'Annunzio, et l'égérie d'un grand nombre d'artistes.
Bien connue pour ses excentricités - réelles ou nées de l'imagination de
certains - elle sut dépasser très rapidement le statut de femme du monde
blasée par le luxe et les mondanités pour créer une image d'elle entre art
et littérature, une œuvre d'art vivante selon ses souhaits. Lexnews a interviewé à Londres Scot D. Ryersson et Michael
Orlando Yaccarino, les meilleurs spécialistes de La Casati à qui ils ont
consacré deux ouvrages majeurs ainsi qu'un site Internet exhaustif...
 
Scot D. Ryersson et Michael Orlando
Yaccarino
Comment a débuté cette passion pour la marquise
Casati?
Scot D. Ryersson et Michael
Orlando Yaccarino : "Lors de nos
recherches sur l’art et la culture de l’Europe au temps de la Belle
Époque, nous avons régulièrement rencontré des références concernant la
marquise Casati, références à son incroyable style de vie, ses fêtes
inoubliables ainsi que ses nombreuses contributions à l’art en tant que
muse et mécène. Or, nous avons été étonnés de remarquer qu’il n’y avait,
cependant, jamais eu de biographies dignes de ce nom consacrées à cette
vie étonnante. Au fil du temps, nous avons donc réuni de nombreux
documents venant de sources du monde entier. Parmi ces informations
figuraient des documents rares, mais aussi, et surtout, des témoignages de
première main des derniers survivants qui avaient connu la marquise, ces
derniers étant cependant pour la plupart morts depuis. Ainsi est née
l’idée d’écrire la première biographie complète exclusivement consacrée à
cette femme incroyable. Par chance, nous avons également gagné la
confiance et l’aide des membres de sa famille encore en vie en Italie, en
Angleterre et aux États-Unis. Naturellement, notre passion n’a fait que
croître et a conduit à la rédaction de deux ouvrages distincts, ainsi qu’à
la création des Archives Casati consacrées, aujourd’hui, à préserver
l’héritage artistique et culturel de la marquise."
Cette jeune femme est née dans une famille aristocratique italienne.
Comment expliquez-vous cette transformation de Luisa Adele Rosa Maria
Amman en l’icône légendaire de la marquise Casati ?
S.D.R. & M.O.Y.
: "Luisa Casati possédait l’âme d’une véritable artiste - et d’une vraie
rebelle – remettant toujours en question les perspectives et les
perceptions s’imposant dans la vie quotidienne comme dans les arts. Sa vie
a toujours été très agitée et seul un engagement artistique poussé à
l’extrême pouvait la satisfaire."

Luisa Casati photographiée par Man Ray en
1924
« Je veux être une œuvre d’art vivante » a dit un jour Luisa Casati.
A-t-elle rejoint ainsi l’art de vie des dandys de son temps ?
S.D.R. & M.O.Y.
: "La Casati a, en effet, été surnommée à juste titre la première femme
dandy, mais en même temps elle a remis en cause cette dénomination, car
elle n’a jamais souhaité suivre une tendance. Ainsi, créait-elle toujours
des tendances pour mieux par la suite s’en distinguer, voire même les
démolir."
 
Gabriele d'Annunzio et Robert de
Montesquiou, deux personnalités proches de Casati.
La marquise Casati n’était pas qu’une femme riche et raffolant de
présentations excentriques. Elle a aussi été la muse et mécène de nombreux
artistes du début du XXe siècle.
S.D.R. & M.O.Y.
: "La marquise a très certainement été fascinée par sa propre image.
Pourtant, il nous semble plus juste d’appréhender cette fascination
incessante pour sa personne non par le seul filtre d’un exhibitionnisme
narcissique, mais bien plus comme une méthode d’exploration artistique.
Casati a eu cette capacité rare de pouvoir se regarder de manière
décentrée, à la troisième personne pourrait-on dire. De cette manière,
elle sut céder son ego aux mains des artistes, ce qui a permis à son image
chargée de sens de devenir un objet puissant à des fins révolutionnaires."
Près de 60 ans après sa mort (le 1er juin 1957), la marquise Casati est
toujours une source d’inspiration pour la mode et les arts.
S.D.R. & M.O.Y.
: "Absolument ! Et il est particulièrement encourageant de constater
combien de nombreux artistes et de créateurs de mode de toute sorte ont
trouvé et trouvent encore une source d’inspiration vivifiante en la
personne de Casati."
Scot D. Ryersson, auteur d’essais
et critiques sur le cinéma et la littérature, est également un artiste
graphique et un illustrateur récompensé par de nombreux prix. Ayant vécu à
Londres, Toronto, Sydney et New York, son travail pour la réalisation
d’affiches de films prestigieux a été salué par la critique
internationale. Il est également l’auteur de romans Poisoned Ivy, The
Arsenic Flower and Mad, Bad, and Dangerous to Know. Ryerson est aussi
créateur d’objets d’art originaux à découvrir sur le site :
http://arcanifacts.blogspot.fr
Michael Orlando Yaccarino est critique de cinéma, notamment de
films de genre et interviewe régulièrement leurs auteurs. Il rédige
également des chroniques sur la mode, la musique et des personnages
historiques sortant des conventions. |

Photographie prise par Meyer, 1912
How started this passion for the
Marchesa Casati ?
Scot D. Ryersson et
Michael Orlando Yaccarino : "Throughout
our research into the art and culture of the European Belle Époque and
into the early 20th century, we continually encountered references to the
Marchesa Casati—her extraordinary lifestyle, unforgettable parties and
important artistic contributions as muse and patron. Yet, no substantial
and well-documented biographical work existed on her amazing life. Over
time, we began to gather materials on Casati from worldwide sources. This
included rare documents and, perhaps more importantly, many firsthand
accounts and interviews from those few remaining individuals who had known
the Marchesa—many of whom have since died. Thus was born the idea of
writing the first full-length biography of this incredible woman. Happily,
we gained the trust and assistance of her surviving family in Italy,
England and the United States. Naturally, our passion for the subject has
only grown which has led to two separate biographies and our establishing
The Casati Archives devoted to preserving the Marchesa’s significant
artistic and cultural legacy."

Luisa Casati dans une création de Paul
Poiret, années 1910
This young lady was born in an Italian aristocratic family. How do you
explain the transformation of Luisa Adele Rosa Maria Amman into the
legendary icon Marchesa Casati ?
S.D.R. & M.O.Y.
: "Luisa Casati possessed the
soul of a true artist and a genuine rebel—always questioning perspectives
and perceptions whether on canvas or in everyday life. She seems to have
been filled with a restlessness only satisfied through extreme artistic
endeavor."
"I want to be a living work of art" told one time Luisa
Casati. Can you tell us in which way, and did she rejoin in a certain way,
the dandy way of life of her time?
S.D.R. & M.O.Y.
: "While La Casati has
rightfully been dubbed the first female dandy, she defied categorization
as she never followed a trend. Indeed, she would establish and then break
them herself."

La marquise Casati en habit d'Arlequin
blanc
dessiné par Guiglio de Blaas, 1913.
She was not only a rich woman, caring of herself and fond of eccentric
exhibitions, she was also a muse and patroness for artists of the
beginning of the XX th century.
S.D.R. & M.O.Y.
: "Most certainly, the
Marchesa was fascinated by her own image. Yet perhaps it would be more
accurate to understand this lifelong concern less through a lens of
narcissistic exhibitionism and more as a method of artistic exploration.
Uniquely, Casati had the rare capacity to view herself in the third person.
In this way, she could surrender her ego into the hands of artists,
allowing her meaning-loaded image to become a potent object for
revolutionary purposes."
Nearly 60 years after her death (1 June 1957), the Marchesa is still a
source of inspiration for fashion and other arts.
S.D.R. & M.O.Y.
: "Absolutely! What is
especially encouraging to see is how new artists and fashion designers of
all kinds have found fresh inspiration in Casati".
Propos
recueillis par Philippe-Emmanuel Krautter
© Interview exclusive Lexnews
Tous droits réservés
reproduction interdite sans autorisation

Le Palais Rose, propriété du Vésinet vendue
par Robert de Montesquiou à Luisa Casati
|
|
Luisa Casati en livres...


The Marchesa Casati : Portraits of a
Muse, The Luxury Edition, ISBN: 978-0-8109-4815-0 • Hardcover • 240 Pages,
80 Full-Colour and 120 Black & White Illustrations (photographs & artwork
reproductions), Abrams Editions, 2009.
Infinite Variety : LIFE & LEGEND OF MARCHESA CASATI University of
Minnesota Press (édition française La Casati aux éditions Assouline
(épuisé).
|
 La
divina marchesa. Arte e vita di Luisa Casati dalla Belle Époque agli anni
folli, Casa editrice: 24 Ore Cultura, 2014. La
divina marchesa. Arte e vita di Luisa Casati dalla Belle Époque agli anni
folli, Casa editrice: 24 Ore Cultura, 2014.
Catalogue exceptionnel de l'exposition La Divina Marchesa à Venise au
Palazzo Fortuny (4 octobre 2014 - 8 mars 2015) |
|
Pour plus d’informations sur la marquise Casati
le site officiel :
www.marchesacasati.com |
|
Interview
Ryuichi Sakamoto
坂本 龍一 |
|

©
Ryuichi Sakamoto
LEXNEWS a eu le privilège de rencontrer
Ryuichi Sakamoto, ce grand compositeur apparu
historiquement sur la scène internationale avec son rôle dans le film
Furyo / Merry Christmas Mr. Lawrence de Nagisa Oshima, et la célèbre
musique qu'il a composée pour ce film. Il renouvellera avec la musique du
film Le dernier Empereur avant de se consacrer à la composition et à
l'interprétation de sa musique sur les scènes internationales. Rencontre
avec un artiste au carrefour de toutes les influences pour une créativité
des plus originales !
LEXNEWS : “Jeune adolescent, vous avez été
fortement intéressé par différents aspects de la culture, et notamment par
la musique impressionniste française avec les compositions de Debussy et
de Ravel. D’où vous venait cet attrait ? »
Ryuichi Sakamoto : « J’avais dans les treize ans la première fois
que j’ai écouté le quatuor à cordes en sol mineur de Debussy. J’ai été
littéralement sidéré par cette harmonie, si évoluée et inconnue de moi à
cette époque. Cela a été une expérience très forte pour moi… »
LEXNEWS : “Etait-ce votre premier contact avec la musique classique
européenne ?”
Ryuichi Sakamoto : “ Oh non ! J’ai débuté l’étude du piano à l’âge de
trois ans, je connaissais déjà bien entendu les musiques de Bach, Mozart,
Beethoven… mais c’était la première rencontre avec la musique de Debussy,
tout cela était totalement différent de ce que je connaissais jusqu’alors.
Ce fut un réel choc… J’ai voulu connaître le secret de ce mystère ; je ne
savais même pas quelle était cette harmonie, je ne l’ai apprise que deux
ou trois ans plus tard, après avoir étudié de plus près cette musique. »
LEXNEWS : “Vous savez bien que Debussy avait été lui-même influencé par la
culture japonaise et vous-même avez été influencé par ce musicien, un bel
entrecroisement ! »
Ryuichi Sakamoto : “ Oui, naturellement, cela est arrivé à toutes les
époques en musique, pensez à tous ces échanges entre le Portugal et le
Brésil, et de nombreux autres pays. Pour moi, la culture n’est faite que
de cela. Je crois intimement qu’il n’existe pas de culture « pure » sur
cette planète. C’est toujours le produit d’intégrations et d’influences
réciproques, du nord avec le sud, de l’est avec l’ouest. Il n’y a pas de
barrières, pas de séparations strictes… »
LEXNEWS : “Vos créations ne rejettent cependant pas votre culture
traditionnelle japonaise qui reste toujours au cœur de votre musique. »
Ryuichi Sakamoto : “Vous pouvez aisément imaginer qu’après la seconde
guerre mondiale, au Japon, la société s’est retrouvée totalement
américanisée. Je suis né en 1952 et, comme tous les enfants japonais de
mon âge, je n’avais quasiment jamais entendu de musique traditionnelle
japonaise à cette époque. C’est peut-être quelque chose qui va revenir de
nos jours avec les jeunes japonais branchés ! (Rires…) Mais à cette
époque, quand j’étais moi-même jeune, tout était marqué par l’Occident.
Vous savez, avec le choc de la guerre et de la défaite, l’identité
japonaise a été littéralement renversée. Pouvez-vous imaginer
qu’auparavant l’Empereur japonais était considéré comme un dieu, et qu’à
partir du jour même de la défaite, les Américains devinrent eux-mêmes un
nouveau dieu ! Les adultes haïssaient tout ce qui était japonais et ne
retenaient que ce qui avait trait à la société et à la culture
américaines. J’ai grandi dans cet environnement. Puis, la nouvelle
génération est arrivée, après les années 70, plus établie et plus
influencée par cette évolution. Ma connaissance est donc essentiellement
occidentale même si bien entendu je reste toujours marqué par l’esprit
japonais en termes de silence et de timbre. Le silence entre les notes est
quelque chose de très important pour moi, à l’image de la musique de John
Cage. Ce compositeur a eu un très fort impact sur moi après mon expérience
avec la musique de Debussy. Steve Reich a également été une source
d’inspiration. Tous ces compositeurs faisaient partie de la nouvelle
génération pour un jeune garçon comme moi et ils connaissaient intimement
la culture japonaise. D’une certaine manière, j’ai pu en effet retrouver
mes racines japonaises par le truchement de leur musique ! »
LEXNEWS : “Vous êtes connu, surtout ici en France, pour votre premier rôle
et votre composition de la musique du film Furyo de Nagisa Oshima avec
David Bowie. Comment jugez-vous l’importance de ce film, vingt-huit ans
après ? »
Ryuichi Sakamoto : “Je n’étais pas naïf et aussi candide que cela à cette
époque ! J’avais bien conscience que ce film pouvait être un outil
puissant pour diffuser ma musique aux quatre coins de la planète. Le
cinéma a une telle force et lorsqu’une histoire est en accord avec la
musique, tout est alors réuni pour avoir une diffusion mondiale. Je savais
cela ! C’est en partie pour ces raisons que j’ai accepté cette proposition
qui m’a été faite de tourner dans ce film. Bien entendu, la raison majeure
venait du fait de mon enthousiasme de jouer aux côtés de David Bowie et de
Takeshi Kitano. J’étais alors un grand fan des films d’Oshima, et ce
depuis mes plus jeunes années alors que j’avais 16 ans. Je n’aurais jamais
pensé que je travaillerai un jour avec M. Oshima, ce fut une grande
expérience parallèlement à ma passion pour la musique. Vous savez le
tournage a été réalisé en premier et j’ai écrit la musique du film dans un
second temps. Le tournage a duré deux mois et chaque jour j’essayais de
tirer mon inspiration directement des scènes que nous venions de jouer :
le paysage, les acteurs… J’ai même essayé de regarder par la caméra pour
trouver quelque chose, mais sans résultats ! (Rires…)
Le souvenir le plus amusant du tournage fut lorsque nous avons fait une
improvisation avec David Bowie, lui jouant de la guitare et moi des
tambours !
Tout ce qui a eu trait à la musique du film a donc été fait après le
tournage, mais il est évident que cette période où nous avons tourné sur
cette toute petite île du Pacifique Sud avec David Bowie et les autres
acteurs a été déterminante sur la composition de ma musique. Cela m’a pris
trois mois pour écrire cette musique de film. »
LEXNEWS : “Votre dernier album s’intitule out of noise. Une fois de plus,
vous associez d’une manière subtile la musique ancienne, votre riche
expérience de la musique électronique, ainsi que des préoccupations
écologiques.”
Ryuichi Sakamoto : “Je n’ai pas de réponses rationnelles pour expliquer
toutes ces influences, mais ce que je peux vous dire c’est que ces
éléments sont très importants pour moi aujourd’hui. La musique ancienne,
qu’elle soit médiévale, renaissance ou baroque, est une musique nouvelle
pour moi parce que, comme je vous le disais tout à l’heure, j’ai grandi
avec une connaissance à partir de la musique de Bach. Il n’y avait
pratiquement pas d’enregistrements de musique ancienne à l’époque.”
LEXNEWS : “Nous avons même reconnu des instruments de musique ancienne
dans cet enregistrement tel ce Consort de violes de gambe”.
Ryuichi Sakamoto : “Oui en effet, j’ai directement été marqué par cette
musique et ces instruments. J’ai même pour cela enregistré avec l’English
consort, introduisant ces instruments anciens. Il s’avère que je suis un
grand fan de ce que fait Jordi Savall ! De nos jours, nous avons un grand
nombre d’enregistrements de musique ancienne et j’apprécie encore
maintenant de trouver de nouveaux titres. J’aime réellement la résonance
de ces instruments. Il y a par ailleurs certainement des liens profonds à
l’intérieur de moi entre la musique ancienne et l’écologie, mais il m’est
très difficile de savoir lesquels et de les expliquer. Au fur et à mesure
que je vieillis, il me semble naturel de me préoccuper plus de la terre,
de la vie et tout cela a un lien avec la musique. Tout est lié pour moi et
comme la musique est mon moyen d’expression, j’essaye de développer mes
centres d’intérêt actuels dans mes compositions. »
LEXNEWS : “Votre musique pour piano offre souvent une alchimie étrange de
nostalgie, tristesse et en même temps exprime un profond espoir de vie.
Est-ce que cet instrument symbolise votre sens de la vie ? »
Ryuichi Sakamoto : “C’est trop de compliments pour moi ! Merci beaucoup
pour cette remarque… Il y a dix ans, j’ai commencé à m’intéresser aux
problèmes écologiques et j’ai réfléchi à notre futur et au futur de mes
enfants. Je suis très préoccupé par l’environnement que nous laisserons
aux futures générations. Je suis très désespéré par notre civilisation, et
en même temps, je ne veux pas laisser tomber, j’estime que je dois avoir
encore de l’espoir en l’humanité. En fait, je ne fais pas confiance en
l’intelligence des hommes tout simplement parce que nous ne sommes pas des
êtres parfaits. Nous avons fait tant d’erreurs, mais en même temps, j’ai
l’espoir que cette humanité trouvera un moyen de survivre quoi qu'il en
soit. La musique peut être une donnée importante pour cela. Je pense
profondément que sans la musique et la culture, il n’y aura pas de futur
pour nous. Ainsi, j’ai de l’espoir, mais je ne suis pas optimiste ! »
LEXNEWS : “Votre musique souhaite exprimer un message écologique.
Etes-vous influencé par le Shintoïsme ? »
Ryuichi Sakamoto : “Tout d’abord, il faut savoir que le Shintoïsme a été
la religion officielle de l’empire japonais. En ce sens, je n’adhère pas à
cela. Mais bien entendu, le Shintoïsme est lui-même fondé sur des
croyances très anciennes selon lesquelles toute chose, même la plus
petite, a un esprit. »
LEXNEWS : “C’est ce qu’on nomme les kamis ?”
Ryuichi Sakamoto : “Oui, absolument ! L’air, un arbre, une pierre, tous
ces éléments ont un esprit. Je crois que c’est une croyance naturelle de
l’Homo Sapiens que vous retrouvez partout en Afrique, dans les cultures
celtes… Dans ce sens, cette manière de penser a eu un écho sur ma musique,
mais je suis toujours prudent à l’égard du Shintoïsme pour les raisons
politiques que vous connaissez. J’ai toujours un sens profond du silence,
ainsi que d’autres sentiments profonds qui marquent en effet ma musique. »
LEXNEWS : “Quelles sont vos passions dans la culture dans les domaines
autres que la musique ?”
Ryuichi Sakamoto : “Malheureusement, je n’ai aucun talent pour d’autres
arts ! J’adore le cinéma, la danse, lire… Vous savez, mon père était un
éditeur de livres et il a travaillé notamment avec Mishima. Mon
environnement familial lorsque j’étais un enfant était rempli de livres !
»
LEXNEWS : "Ryuichi Sakamoto, Dômo arigatô
gozaimasu !" |

©
Ryuichi Sakamoto
LEXNEWS was privileged to meet with Ryuichi
Sakamoto, the great composer who has appeared historically in the
international scene with its role in the film Furyo / Merry Christmas Mr.
Lawrence by Nagisa Oshima and the famous music he composed for this film.
He will renew with the music of the film The Last Emperor before devoting
himself to composition and interpretation of his music on the
international scene. Meeting with an artist at the crossroads of all the
influences for creativity of the most original!
LEXNEWS : “As a young kid, You have been
interested by different aspect of culture, and specially French
impressionist music such as Debussy or Ravel compositions. Where does this
interest come from?”
Ryuichi Sakamoto : « the first time I’ve heard Debussy’s String Quartet, I
was about thirteen and I was shocked by the harmony, so sophisticated and
unknown for me at that time. It was a very strong experience at that
time.”
LEXNEWS : “Was it for your first contact at that time with classical
European music ?”
Ryuichi Sakamoto : “ Oh no ! I started playing piano when I was 3 years
old so of course I knew Bach, Mozart, Beethoven… but that was the first
encounter of Debussy’s music, it was totally different from what I knew
before. It was a real big shock for me… I wanted to know the secret of
this mystery; I didn’t even know what this harmony was called until 2 or 3
years later, I learned more about this music.”
LEXNEWS : “You perfectly know that Debussy was influenced by Japan Culture
and you ‘ve been yourself influenced by this musician, nice cross over !”
Ryuichi Sakamoto : “Yes, naturally, that happens all the times in music if
you think with Portugal and Brazil and a lot of other countries. For me
culture is all about that. That’s my belief that there is no pure culture
in this planet. It’s always integrated and influencing each other, north
and south, east and west. There is no barriers, no strict lines…”
LEXNEWS : “Your creations doesn’t reject your traditional Japanese culture
which is always in the background of your music”
Ryuichi Sakamoto : “Maybe you can imagine that after the war, in Japan,
the society was really americanized. I was born in 52, so just same as all
the Japanese boys of my age I didn’t hear almost any of traditional
Japanese music at that time. Maybe it’s coming back know, with the trendy
Japanese kids ! (Laughs) But at that time, when I was young, everything
was very westernized. With the shock of the war, and the defeat, the
Japanism was upside down you know. Can you imagine that the Japanese
Emperor was the god and after that day of the defeat, the Americans began
to be another god! Adults hated everything Japanese and choose everything
with American society and culture. I grew up in that kind of atmosphere.
Then, the new generation came, after the 70’s, more established and were
more influenced by this. My knowledge is primarily western but I still
have of course a sense of Japaneseness in terms of silence and timber. The
silence between the notes is very important for me like John Cage music.
This composer strongly influenced me after my meeting with Debussy music.
Steve Reich inspired me too, they were all new generation of composers for
a young boy like me and they deeply knew the Japanese culture and in a
certain way I found this Japanese ground with their music! ”
LEXNEWS : “People know you, specially here in France, for your first film
and music composition for the cinema with Merry Christmas Mr. Lawrence /
Furyo of Nagisa Oshima. How do you judge the importance of this film, 28
years after?”
Ryuichi Sakamoto : “I wasn’t so naïve and pure at that time ! I thought
this film would be a very strong tool to convey my music to every corner
of the world. Cinema is so powerful and it contains a story with the
music, everything was gathered to be broad of the world. I knew that! It
was part of the reasons I accepted this offer of acting in this film. But
of course, the major reason was the excitement to act with David Bowie and
Takeshi Kitano. I was a big fan of Oshima films from my earlier years
since I was 16. I never thought I would work with Mr Oshima, it was a
great experience beside my personal interest about music. You know
shooting was done first and then I started writing music. It took us two
months of shooting and every day I tried to get direct inspiration from
the shooting: the landscape, the actors… I even tried to look through the
camera to find something but without result! (Laughs…) The most fun memory
of the shooting was when I jammed with David Bowie playing guitar and I,
drums! Everything concerning music was done after the shooting but it’s
obvious that the shooting period on this little island in south Pacific
with David Bowie and the other actors was a strong experience for the
composition of my music. It took me three months to write the music.”
LEXNEWS : “Your last album is called out of noise. One more time, you
associate in a subtle manner ancient music, your rich experience of
electronic music and ecological interests.”
Ryuichi Sakamoto : “I don’t have any rational answer to link all of these
influences but what I can say to you is that those elements are very
important for me now. Early music, like Medieval, Renaissance and early
Baroque music are very new to me because I grew up with the knowledge from
Bach. There were almost no recordings of early music.”
LEXNEWS : “We even recognize ancient instruments in some of your music
like Consort Viola di Gamba”
Ryuichi Sakamoto : “Yes, I was directly influenced with those music and
instruments and I even recorded with the English consort, introducing some
ancient instruments. I am a big fan of Jordi Savall music ! Nowadays,
there are a lot of early music recordings but I still enjoy finding new
recordings of it. I really love the resonance of these instruments. There
must be some links deep inside me about ancient music and ecology, but
it’s very hard to explain it. Certainly as I get older, it’s a natural
process of living, to think more about the earth, the life and all these
linked with music. Everything is related for me and as music is my way of
expression, I tried to develop my actual interests in my compositions.”
LEXNEWS : “Your music for piano often offers a strange alchemy of
nostalgia, sadness and in the same times expresses a deep hope about of
life. Does this instrument symbolise your feeling about life”
Ryuichi Sakamoto : “That’s too much compliment for me ! Thank you so much
for that… Ten years ago, I began related with ecological problems and I
looked forward about our future and my children’s future. I’m very worried
about the environment for the future generations. I’m very despair about
our civilisation but I don’t want to give up, I have to have some hope
about humans. I don’t trust mankind intellectuality because we are not
perfect. We made so many mistakes and in the same time my hope is that
mankind will find a way to survive anyway and music is a strong element to
help this. I really think that without music and culture, there will be no
future for us. So I do have hope but I’m not optimistic!”
LEXNEWS : “Your music wishes to express an ecological message. are you
influenced by shintoism ?”
Ryuichi Sakamoto : “First of all Shintoism is the official religion of the
imperial Japan. In that sense I don’t follow this. But of course Shintoism
is based in very ancient beliefs: every little thing has anima”
LEXNEWS : “Is that what the term kami refers to ?”
Ryuichi Sakamoto : “Yes, absolutely! the air, a tree, a rock, all those
elements have anima. I think it’s a very Homo sapiens tendency that you
find in Africa, in Celtic cultures… In that way, this way of thinking has
an influenced on my music but I’m always careful with Shintoism for the
political reasons you know. I still have a deep sense of silence and other
deep feelings that influenced my music.”
LEXNEWS : “What are your passions in culture aside music ?”
Ryuichi Sakamoto : “Unfortunately, I have no talent for other arts. I
enjoyed seeing cinema, dance, reading books… You know my father was a book
editor and he worked with Mishima. The environment in my home when I was a
kid was a full of books!”
LEXNEWS : "Ryuichi Sakamoto, Dômo
arigatô gozaimasu !"
Propos
recueillis par Philippe-Emmanuel Krautter
© Interview exclusive Lexnews
Tous droits réservés
Un petit message de Ryuichi pour nos
lecteurs
( a small message for our readers written
by Ryuichi !)

www.sitesakamoto.com
© Lexnews - septembre
2011 |
|
"Playing the piano" Deluxe Edition Feat.'Out
Of Noise', Ryuichi Sakamoto, Decca Records/Universal.

|
 |
|
Interview Jean-François Colosimo
4 décembre 2010, Paris. |
|
Né en 1960, Jean-François Colosimo a fait des études de philosophie, de
théologie, d'histoire et de science des religions. Chrétien orthodoxe, il
enseigne l'histoire de la philosophie et de la théologie byzantine à
l'Institut Saint-Serge. Éditeur depuis 1988, Jean-François Colosimo a été
conseiller littéraire pour les éditions Stock, directeur littéraire chez
JC Lattes, chez Odile Jacob et aux éditions de la Table ronde. En 2006, il
a été nommé directeur général de CNRS Editions. Jean-François Colosimo est
par ailleurs l'auteur de films documentaires, dont Washington, la
frontière du protestantisme (Artline France 3, 2000) et comme co-auteur a
collaboré aux œuvres du cinéaste Olivier Mille, Les Cités de Dieu et Le
silence des anges (Arte). Il est également chroniqueur sur France Culture
et pour Le Monde des Religions. Depuis le 12 mai 2010, il est président du
Centre national du Livre.
Bibliographie :
Vingt siècles
d'art, la Bible de Jérusalem illustrée, Le Cerf/Réunion des Musées
nationaux (direction), 2009.
Le Paradoxe Persan, essai, Fayard, 2009.
L’Apocalypse russe, essai, Fayard, 2008.
Dieu est américain, essai, Fayard, 2006.
Le Silence des Anges, récit, Desclée de Brouwer, 2002.
Le Jour de la Colère, roman, JC Lattès, 2000.




 |

©DR
Lexnews a eu le plaisir de rencontrer Jean-François Colosimo pour
évoquer son parcours riche en expériences et ouvert sur de nombreuses
disciplines. Jean-François Colosimo est en effet enseignant en histoire de
la philosophie et en théologie, éditeur, romancier, journaliste et depuis
2010, président du Centre national du Livre. Rencontre avec une
personnalité profonde et complexe qui aborde les questions fondamentales de l'homme
avec acuité et sans prosélytisme !"

LEXNEWS : « Pouvez-vous nous parler de votre
parcours original et de votre foi en l’orthodoxie ? »
Jean-François Colosimo : « Je vous
répondrai tout d'abord sur la deuxième partie de votre question. À vrai
dire, je ne sais pas ce qu’est la foi. Et, par ailleurs, dans l'orthodoxie
on a quelque réticence à employer le « je » : l'existence s’y veut d’abord
corporative. Votre question m'embarrasse en ce que je ne saurais lui
apporter de réponse. Je ne me définirais pas comme un croyant.
Contrairement à ce que l'on dit, l'expérience de la foi ne passe pas par
le doute ou je ne sais trop quelle psychologisation. Elle découle plutôt
de deux déterminations « apophatiques », négatives. La première tient dans
la formule de Pascal : « Nous sommes plus inconcevables sans ces
mystères que ces mystères ne nous sont inconcevables. » - à mon sens,
c'est là tout le christianisme ; et, lorsqu’on y ajoute d’autres
considérations, débute la sécularisation. La seconde, c'est qu'à tout
prendre, ce qu’il y a d'irrémédiables rencontres dans l'Évangile, l'Eglise
des apôtres, des martyrs, des Docteurs, des conciles, des moines, dans la
tradition initiale du christianisme donc, je le retrouve vivant dans ce
qu'on appelle l'orthodoxie. Il ne va pas là d’une adhésion à une identité
de civilisation, mais d’une idée simple, selon laquelle l'orthodoxie est
dépositaire de la vérité de cet événement, non pas sous la forme d'une
vérité dogmatique ou juridique, mais d'une réception existentielle,
personnelle. C'est ce sur quoi Kierkegaard s'interroge et nous interroge :
que peut signifier le fait d'être contemporain du Christ ? C'est une
question qui ne peut être résolue en dehors de la transmission de
l'expérience originelle telle qu'elle s'est déroulée dans l'histoire à
travers les trois grandes matrices culturelles qu’ont été Jérusalem,
Athènes et Rome. C'est dans ce sens-là que je peux souscrire à votre
question et vous dire que je suis orthodoxe. Ce n'est là pas une
définition limitative, c'est au contraire l’indice d’une quête et d’une
enquête forcément ouvertes, à rebours d’un quelconque système de croyance
clos.
Quant à la première partie de votre question, je ne vois dans mon parcours
rien de très original pour quelqu’un de ma génération. En quelques repères
biographiques, je suis né en 1960 à Avignon dans un milieu catholique,
élève des jésuites. À l'adolescence, je me suis tourné vers l’Orient, ce
qui m'a lentement amené à l’orthodoxie que j'ai rencontrée notamment au
Mont Athos et au Mont Sinaï. Les années 1980 ont été marquées par des
études de philosophie et d’histoire des religions à la Sorbonne ; de
théologie en Grèce et aux Etats-Unis. De retour à Paris, j'ai travaillé
dans l'édition et me suis consacré à ce métier, pour lui- même, assez loin
de mes préoccupations plus anciennes. J'ai également mené une carrière
universitaire à l'institut Saint Serge en enseignant la Patrologie, et j’y
donne désormais un séminaire de métaphysique.
___________________________
nous n’assistons pas à un retour du religieux, mais à un achèvement de la
modernité dans la forme de néo-religion qui correspond à la divinisation
du corps social
J’ai consacré une large part de mes recherches sur les mutations de Dieu
en politique dans le monde moderne et contemporain. En témoigne la série
entamée chez Fayard et dont les trois premiers volumes parus examinent,
chaque fois, un lieu éminent de ces métamorphoses : le fondamentalisme
américain aux Etats-Unis, le slavophilisme en Russie, l'intégrisme en
Iran. Le tout pour essayer de démontrer in vivo la formule de Carl
Schmitt : les grands concepts politiques du monde moderne ne sont jamais
que des principes théologiques laïcisés. Selon moi, au contraire de ce que
l'on estime habituellement, nous n’assistons pas à un retour du religieux,
mais à un achèvement de la modernité dans la forme de néo-religion qui
correspond à la divinisation du corps social. Notre temps pose avec une
certaine acuité, parfois paradoxale, souvent convulsive, cette question
essentielle. »
LEXNEWS : « L’image a une grande importance dans
la confession orthodoxe, cela a-t-il eu une importance dans le travail que
vous avez dirigé pour l’édition de La Bible de Jérusalem, 20 siècles
d’art ? »
Jean-François Colosimo : « En stricte orthodoxie, on appelle
icône une forme d'art sacré qui est extrêmement codifiée. Tout l'art
occidental à partir de la Renaissance et des Primitifs italiens s'invente
en refusant cette codification ou, plutôt, en la naturalisant. L'icône
repose sur une représentation non humaniste, non figurative. Elle se veut
une transparence sur le royaume, un type du monde transfiguré. Elle est
une forme de sémantique eschatologique. Tout cela peut sembler obscur,
certes. Mais contempler une icône se révélera certainement une meilleure
leçon : l’icône se veut une trace de l’immatériel, une présence de
l’invisible. C’est de ce point de départ qu’est aussi parti notre travail
sans pour autant nier les développements ultérieurs et en tâchant au
contraire de les expliciter»
|
LEXNEWS : « Cela rejoint-il ce que Jean Damascène
développe dans ses réflexions sur l’icône ? »
Jean-François Colosimo : «Absolument. Il la conçoit comme une
théologie en couleurs. Le travail que nous avons réalisé pour La Bible
de Jérusalem, 20 siècles d’art, que vous évoquez et qui justifie cet
entretien, cherche à montrer comment le sens de l'image est passé de
l’Orient à l'Occident : avec l'invention du cadre, de la perspective, de
l’homothétie visuelle, l'Occident se rend maître du monde par, entre
autres savoirs, celui de la technique picturale. Non seulement il
représente le monde, mais il se représente également lui-même ainsi que
les autres. Dans cet espace que dessine la picturalité occidentale
apparaît la figure centrale de l'homme qui vient remplacer le
théocentrisme de l'icône.
___________________________
Dans l’art occidental, advient un renversement, l'homme apparaît au centre
de l'image avant, pour suivre l’analyse de Foucault, de dissoudre sa
propre figure dans l’abstraction
Pour quelle raison ? L'icône repose sur la perspective inversée,
c'est-à-dire que ce n'est pas vous qui regardez le motif de l'icône, c'est
le sujet de l'icône qui vous regarde et ce, de quelque angle que vous
cherchiez à la contempler : elle ouvre sur un infini qui suppose
l'abolition de la limite, des conditions a priori de la sensibilité. Dans
l’art occidental, advient un renversement, l'homme apparaît au centre de
l'image avant, pour suivre l’analyse de Foucault, de dissoudre sa propre
figure dans l’abstraction.
Cependant, il ne faut pas trop durcir cette opposition. Il y a
articulation entre les deux versants. Cette articulation tient dans la
constatation que, quel que soit le système de référence, l'humanité n'a
pas pu traverser l'histoire sans se donner effectivement un référent
symbolique qui la passe et la dépasse. Ce que fait le christianisme en
imposant le primat de l'incarnation, le verbe fait chair. Soit l’assurance
d'une signification de l'homme à travers son visage, ses circonstances,
son lieu, son topos. Le temps devient significatif de l'éternité :
il est un sens du sens, une permanence de l’être et une authenticité de
l'humanité. Et quelles qu’aient été les atteintes à cette humanité, et
aussi graves qu’elles aient pu être, au cours du XXe siècle, perdure cette
notion d'irréductibilité de chaque personne et de sa capacité d'éternité.
C'est cela l’histoire de l’image issue du christianisme, en Orient
d’abord, puis en Occident. Si Dieu s’est incarné, alors la représentation
est désormais possible. Cette levée de l'interdit de représenter le divin
a permis une représentation infinie de l'humain. »
LEXNEWS : « Cette image a été longtemps
essentielle dans l’histoire du christianisme afin de véhiculer un message
pour toux ceux qui n’avaient pas toujours accès à la lecture. Comment
jugez-vous le rôle de l’image et de la représentation du sacré,
aujourd’hui, au XXI° siècle ? »
Jean-François Colosimo : « Il y a tout d'abord un échec
esthétique des Eglises extrêmement profond qui accompagne leur échec
culturel. Dans le monde occidental, on a fait parfois appel à de grands
artistes profanes qui, pour ajouter à leur catalogue, ont réalisé des
fresques, des objets liturgiques… Mais aujourd'hui, cette longue tradition
est passée en Occident et en Orient, domine une espèce de néo-
byzantinisme qui a perdu le sens même de l'icône. Les Eglises sont hors de
la culture pour une simple et bonne raison : la culture contemporaine est
une culture post chrétienne qui vit à la fois dans l’oubli de ses sources
et de la sécularisation de ces mêmes sources. Les Eglises s’en trouvent
marginalisées et en porte-à-faux, d’où leur nouvelle propension à dénoncer
le blasphème là où le rappel des sources dit cette contradiction.
Ainsi, le christianisme va mal d'avoir trop réussi. Pour Chesterton, le
monde est plein d'idées chrétiennes, mais d’idées chrétiennes devenues
folles. C'est pour cela que nous assistons trop souvent à un art de la
répétition. Aujourd’hui, la sacralité est partout et, à travers la
désacralisation, n’en reste pas moins le référent absolu. Or, l'image
chrétienne raconte une autre histoire. Elle n'a pas opposé le profane au
sacré, elle a nourri l'image de tout ce qui était profane pour montrer que
ce profane n'était pas dissocié du sacré, antérieur au sacré, mais qu'il y
avait bien une sorte de sacramentalité du monde, de baptême des cultures,
et ainsi une sorte de signification d'éternité qui pouvait être apportée à
tout ce qui advient dans le temps. La dimension eschatologique n’est pas
la promesse d’un autre monde à venir, une projection messianique ou
millénariste, mais l’épiphanie de cet impalpable qui est déjà là et
toujours à venir. C'est une leçon qui vient de bien plus loin, c’est une
forme d'assomption que le christianisme opère également de la leçon
grecque ancienne. On la trouve déjà dans la statuaire antique, sur les
stèles. Cela vient vraisemblablement de cette forme de dépassement de la
mort que suppose le premier grand art funéraire. Quelle image gardons-nous
de celui ou de celle qui n'est plus ? Ces disparus n'existent-t-ils
d'ailleurs plus ? Y a-t-il un lieu des substances secrètes ? Y a-t-il une
capacité d'immortalité ? L'art prétend à cette capacité d'immortalité.
___________________________
Dans l’art contemporain, la matière est désacralisée au profit d’une
confusion entre l'art et l'artefact où chacun est censé être l'artiste
d'une vie qui elle-même est conçue comme une thérapie.
Dans l’art contemporain, la matière est désacralisée au profit d’une
confusion entre l'art et l'artefact où chacun est censé être l'artiste
d'une vie qui elle-même est conçue comme une thérapie. On constate souvent
alors une « médiocratisation » des choses et l'art contemporain met en
scène cette banalisation. Souvent, mais pas toujours. Andy Warhol est
incompréhensible si l'on ne sait pas qu'il était orthodoxe et tout l'art
dont il parle est un art qui puise dans cette idée de l'éternité à l’œuvre
dans le temps. Ce n'est pas pour rien qu'il nomme icônes ses portraits de
Marilyn. Il y a évidemment loin des icônes d'Andy Warhol à celles d’Andreï
Roublev. Il n'empêche qu'il faut être plus attentif aux traits d’union
qu’aux oppositions. Car, que représente Warhol ? Si ce n’est le retour du
figuratif diffusable à l'infini et participable par tous. Je n'en tire pas
pour autant un argument apologétique, mais je note tout de même que
l'artiste contemporain supposément le plus frivole a ramené le visage au
cœur des représentations contemporaines.»
LEXNEWS : "Jean-François
Colosimo, merci pour ce témoignage sur votre propre parcours et sur
l'importance de l'art et du sacré dans votre vie !"
Propos
recueillis par Philippe-Emmanuel Krautter
© Interview exclusive Lexnews
Tous droits réservés
|
|
Disparition de
CLAUDE LEVI-STRAUSS
Nous apprenons la mort de Claude
Lévi-Strauss survenue le samedi 31 octobre 2009 dans sa 101ème année. C'est
une des plus grandes figures non seulement de l'anthropologie mais également
de la culture internationale qui disparaît.
Celui qui avait fait connaître l'univers
des horizons lointains au grand public avec le fameux "Tristes tropiques"
était un homme de sciences bien connu pour le structuralisme.
Le site de la
revue Sciences Humaines vient d'avoir l'heureuse initiative de rendre librement
accessible le dossier spécial qui avait été consacré au centenaire de Claude Lévi-Strauss :
http://www.scienceshumaines.com/edito--pour-une-archeologie-de-l-esprit-humain_fr_22923.html
Le numéro spécial de la revue en version
papier est toujours disponible et peut être commandé :

sommaire :
* Claude Lévi-Strauss : Du Brésil au fauteuil
de l'académie française
* Claude Lévi-Strauss, le tourneur de pages
Nicolas Journet
* Trois moments d'un oeuvre
Nicolas Journet
* Lévi-Strauss en dix mots-clés
Nicolas Journet
* Les mythologiques, monument inachevé
Entretien avec Emmanuel Désveaux
* Parenté et mythes
* Les limites d'une grande idée
Entretien avec Laurent Barry
* Les mathématiques de l'homme
Claude Lévi-Strauss
* Offrir, c'est souhaiter
Claude Lévi-Strauss
* Le voyageur nostalgique
* Les mutiples lectures de Tristes tropiques
Vincent Debaene
* À la recherche du monde perdu
* La pensée sauvage
* Tous les hommes sont modernes
Frédéric Keck
* Sorciers et psychanalyse
Claude Lévi-Strauss
* La diversité culturelle
* Controverse sur la diversité humaine
Wiktor Stoczkowski
* La renaissance indigène au Brésil
Jean-Patrick Razon
* 1961 : La crise moderne de l'anthropologie
Claude Lévi-Strauss
* Masques et symboles
* Claude Lévi-Strauss contre l'art magique
Carlo Severi
* Anthropologie de l'art : le renouveau
Entretien avec Anne-Christine Taylor
* L'art de donner du goût
Claude Lévi-Strauss
* L'héritage
* Vers les sciences cognitives
Maurice Bloch
* Pourquoi je suis structuraliste
Entretien avec Françoise Héritier
* Actualité d'une oeuvre
Entretien avec Philippe Descola
* Les sciences sociales sont un humanisme
Claude Lévi-Strauss
* Bibliographie
Né à Bruxelles (de parents français), le 28
novembre 1908. Études secondaires à Paris (lycée Janson de Sailly), études
supérieures à la faculté de droit de Paris (licence) et à la Sorbonne
(agrégation de philosophie, 1931, doctorat ès lettres, 1948).
Après deux ans d’enseignement aux lycées de Mont-de-Marsan et de Laon, est
nommé membre de la mission universitaire au Brésil, professeur à
l’université de São Paulo (1935-1938). De 1935 à 1939, organise et dirige
plusieurs missions ethnographiques dans le Mato Grosso et en Amazonie.
De retour en France à la veille de la guerre, mobilisé en 1939-1940. Quitte
la France après l’armistice pour les États-Unis où il enseigne à la New
School for Social Research de New York. Engagé volontaire dans les Forces
françaises libres, affecté à la mission scientifique française aux
États-Unis. Fonde avec Henri Focillon, Jacques Maritain, J. Perrin et
d’autres l’École libre des hautes études de New York, dont il devient le
secrétaire général.
Rappelé en France, en 1944, par le ministère des Affaires étrangères,
retourne aux États-Unis en 1945 pour y occuper les fonctions de conseiller
culturel près l’ambassade. Il démissionne en 1948 pour se consacrer à son
travail scientifique, devient sous-directeur du musée de l’Homme en 1949,
puis directeur d’études à l’École pratique des hautes études, chaire des
religions comparées des peuples sans écriture. Il est nommé professeur au
Collège de France, chaire d’anthropologie sociale, qu’il occupe de 1959 à sa
mise à la retraite en 1982. Claude Lévi-Strauss est membre étranger de
l’Académie nationale des sciences des États-Unis d’Amérique, de l’American
Academy and Institute of Arts and Letters, de l’Académie britannique, de
l’Académie royale des Pays-Bas, de l’Académie norvégienne des lettres et des
sciences. Il est docteur honoris causa des universités de Bruxelles,
d’Oxford, de Chicago, de Stirling, d’Upsal, de Montréal, de São Paulo, de
l’université nationale autonome du Mexique, de l’université Laval à Québec,
de l’université nationale du Zaïre, de l’université Visva Bharati (Inde), et
des universités Yale, Harvard, Johns Hopkins et Columbia. Il a reçu, en
1966, la médaille d’or et le prix du Viking Fund, décerné par un vote
international de la profession ethnologique ; en 1967, la médaille d’or du
C.N.R.S. ; en 1973, le prix Erasme ; en 1986, le prix de la fondation Nonino
; en 1996, le prix Aby M Warburg ; en 2002, le prix Meister Eckhart ; en
2005, le prix international Catalunya.
Il a été élu à l'Académie française, le 24 mai 1973, en remplacement de
Henry de Montherlant (29e fauteuil).
Oeuvres
1948 La Vie familiale et sociale des Indiens
Nambikwara
1949 Les Structures élémentaires de la parenté
1952 Race et Histoire
1955 Tristes Tropiques
1958 Anthropologie structurale (Plon)
1961 Entretiens avec Claude Lévi-Strauss (Georges Charbonnier)
1962 Le Totémisme aujourd’hui (PUF)
1962 La Pensée sauvage (Plon)
1964 Le Cru et le Cuit
1967 Du miel aux cendres
1968 L’Origine des manières de table
1971 L’Homme nu
1973 Anthropologie structurale, II
1975 La Voie des masques (édition augmentée) (Plon)
1983 Le Regard éloigné (Plon)
1984 Paroles données (Plon)
1985 La Potière jalouse (Plon)
1988 De près et de loin (Odile Jacob)
1991 Histoire de Lynx (Plon)
1993 Regarder, écouter, lire (Plon)
1994 Saudades do Brasil
1995 Saudades de São Paulo
(source : Académie française)
|
|
POUR LE CENTENAIRE DE CLAUDE LEVI-STRAUSS
28 novembre 2008
 |
|
MUSEE DU QUAI
BRANLY
journée
spéciale : Claude Lévi-Strauss a 100 ans

journée spéciale le vendredi 28 novembre 2008
musée en accès libre de 11 heures à 21 heures
Le musée du quai Branly rend hommage à Claude Lévi-Strauss en lui consacrant
une journée exceptionnelle, à l’occasion du centenaire de sa naissance.
lire la biographie de Claude Lévi-Strauss...
une programmation en continu, un moment inédit et unique, est proposée aux
visiteurs du musée
des lectures des plus grands textes de Claude Lévi-Strauss par une centaine
de personnalités réunies pour l’occasion
Devant les visiteurs, à tour de rôle, les voix de cent penseurs et artistes
vont faire entendre ses plus grands écrits, en cinq points du plateau des
collections, au milieu des objets qu'il a collectionnés et étudiés :
De 13 heures à 21 heures, plus d’une centaine de personnalités des arts et
de la science, mêlant toutes les générations, de 18 à 85 ans, se succèdent
pour une lecture des textes de Claude Lévi-Strauss, tirés de l’ensemble de
ses ouvrages, Tristes tropiques (Plon, 1955) en particulier, mais aussi Les
structures élémentaires de la parenté (PUF, 1949), La pensée sauvage (Plon,
1962), les 4 volumes des Mythologiques (Plon, 1964, 1966, 1968, 1971),
Anthropologie structurale 1 et 2 (Plon, 1958 et 1973), Le regard éloigné
(Plon, 1983), La potière jalouse (Plon, 1985), Histoire de Lynx (Plon,
1991), Regarder, écouter, lire (Plon, 1993), Saudades do Brasil (Plon,
1994)…
Les extraits choisis sont regroupés selon cinq thématiques : Voyages,
Famille et parenté, L’efficacité symbolique : shamans, comédiens, mythes et
musique, Humanisme et humanité et Penser sur le terrain.
des projections de ses photographies prises lors de ses missions en Amérique
du Sud dans les années trente, mais aussi dans la région du Chittagong en
1950, sont projetées en continu dans le hall du musée
La collection de photographies réalisées par Claude Lévi-Strauss et
conservée au musée du quai Branly provient des ensembles déposés par leur
auteur au musée de l’Homme au retour de ses missions. La partie la plus
importante concerne la première mission de terrain au Brésil de l’ethnologue
et sa femme Dina, entre novembre 1935 et mars 1936. Ces images, en partie
publiées dans Tristes tropiques, montrent différents aspects de la vie des
indiens Bororo, Caduveo, Guarani et Kaingang. Un autre ensemble moins connu
de 14 tirages provient de l’enquête que Claude Lévi-Strauss réalisa pour
l’Unesco, en 1950, dans l’actuel Bangladesh (région de Chittagong). En 2007,
Claude Lévi-Strauss a officialisé le don de l’ensemble de ces tirages au
musée du quai Branly.
une programmation de documentaires en salle de cinéma
De 12h à 21h, le musée propose des projections de films documentaires et
d’archives audiovisuelles sur Claude Lévi-Strauss, venus en particulier des
fonds de l’INA, avec l’émission Apostrophes réalisée par Bernard Pivot chez
Claude Lévi-Strauss en 1984, l’émission Caractères de Bernard Rapp en 1991,
et le dernier documentaire réalisé par Pierre-André Boutang et Annie
Chevalley Claude Lévi-Strauss par lui-même.
des visites guidées et thématiques du plateau des collections, à la
découverte des lieux et des populations rencontrés par l’ethnologue
Proposées par les conservateurs du musée, chaque visite invite à suivre un
itinéraire, en lien avec les objets rapportés par Claude Lévi-Strauss, et
conduit les visiteurs sur les traces des populations que l’ethnologue a
rencontrées lors de ses différentes missions.
Durée : 1 heure, visites gratuites
la présentation des photographies de terrain et des éditions originales de
ses œuvres écrites, dans le salon de lecture Jacques Kerchache
Entre le 28 novembre et le 28 décembre, le salon de lecture Jacques
Kerchache expose les photographies de terrain réalisées par Claude
Lévi-Strauss et dont il a fait don au musée en 2007. Tous les titres de
Claude Lévi-Strauss dans leurs éditions originales seront également
présentés, dont les plus célèbres, Tristes Tropiques ou Les structures
élémentaires de la parenté, mais aussi des tirés-à-part que le jeune Claude
Lévi-Strauss avait dédicacés à ses maîtres comme Paul Rivet, alors directeur
du musée du Trocadéro. Plusieurs objets ayant appartenu à Claude
Lévi-Strauss, complètent cette exposition.
Enfin, cette présentation est également l’occasion de présenter le nouveau
volume de la Pléiade consacré à l’ethnologue, vendredi 28 novembre à 19h,
avec plusieurs spécialistes de Lévi-Strauss dont Marie Mauzé et Philippe
Descola.
le dévoilement d’une plaque lui rendant hommage, à l’entrée du théâtre du
musée du quai Branly qui porte son nom
Biographie de Claude Lévi-Strauss
Claude Lévi-Strauss, anthropologue, est le dernier des maîtres du
structuralisme français.
Né en 1908 à Bruxelles de parents français, il fait des études de droit et
de philosophie. Reçu à l’agrégation de philosophie en 1931, il enseigne deux
ans aux lycées de Mont-de-Marsan et de Laon. Puis, il s’expatrie au Brésil
où il est nommé professeur de sociologie à l'Université de São Paulo. De
1935 à 1939, il organise et dirige plusieurs missions ethnographiques dans
le Mato Grosso et en Amazonie, à la rencontre des populations kaingang,
caduveo, bororo, nambikwara et tupi-kawahib.
De retour en France à la veille de la guerre, il est révoqué à cause des
lois anti-juives du gouvernement français collaborationniste et réussit à se
rendre aux Etats-Unis en 1941, en s’échappant sur un paquebot où il voyage
avec André Breton et Victor Serge. Il enseigne alors à la New School for
Social Research de New-York et participe à la fondation de l'École libre des
hautes études de New-York, dont il devient le secrétaire général. De 1945
jusqu'à la fin de 1947, il est conseiller culturel à New-York auprès de
l'ambassade de France aux Etats-Unis. En 1948, il publie la Vie familiale et
sociale des Indiens Nambikwara et soutient sa thèse sur Les Structures
élémentaires de la parenté, publiée en 1949.
Rentré en France en 1949, il est d'abord maître de recherches au CNRS puis
sous-directeur du musée de l'Homme. Il est ensuite nommé directeur d'études
à l'Ecole pratique des hautes études, à l'ancienne chaire de Marcel Mauss,
rebaptisée chaire des religions comparées des peuples sans écriture. En
1955, il publie Tristes tropiques, livre écrit en quelques mois sur commande
et qui, au delà du récit de voyages, bouleverse la pensée occidentale ; les
jurés du prix Goncourt regrettent de ne pouvoir le couronner, car c’est un
essai et non pas un roman. En 1959, il est élu à la chaire d'anthropologie
sociale du Collège de France qu’il occupe jusqu’en 1982. Il y fonde le
laboratoire d'anthropologie sociale et la revue L'Homme.
Ses travaux sont alors marqués par une double réflexion :
* d'une part, l'élaboration théorique de l'anthropologie, avec Le Totémisme
aujourd'hui (1962), les deux tomes de l'Anthropologie structurale (1958 et
1973) et La Pensée sauvage (1962) ;
* d'autre part, de 1964 à 1971, l'application de ces principes dans la
tétralogie des Mythologiques (Le Cru et le Cuit, Du miel aux cendres,
L'Origine des manières de table, et L'Homme nu).
Elu à l'Académie française en 1973, il continuera à publier après sa
retraite en 1982 : Le Regard éloigné (1983), Des symboles et leurs doubles
(1989), puis Regarder Ecouter Lire (1993), et poursuit la quête des
mythologies avec les "petites mythologiques" - La voie des masques, La
potière jalouse, Histoire de Lynx.
Anthropologue méfiant envers les philosophes, excepté Michel de Montaigne et
Jean-Jacques Rousseau dont il se réclame constamment, Claude Lévi-Strauss
est, avec Emile Benveniste et Georges Dumézil, le fondateur du
structuralisme français dont l'influence rayonne durablement dans les
sciences humaines, en littérature et en psychanalyse. Poursuivant dans les
interdits de parenté le point de jonction entre Nature et Culture, qu’il
appelle en 1949 « l’Intervention », il élabore ensuite une théorie globale
des interactions entre le symbolique, le corps et le groupe avant d’étudier
la pensée sauvage, à l’œuvre dans les systèmes logiques et classificatoires
des peuples autochtones et des sociétés occidentales, et dans le vaste
ensemble des mythes indiens des deux Amériques, du Sud et du Nord. Par deux
fois, il répond à l’appel de l’Unesco et prononce deux célèbres conférences,
Race et histoire en 1952, et Race et Culture en 1971.
Dans ses derniers livres, il se concentre sur les logiques esthétiques
amérindiennes et occidentales ; il y poursuit aussi une œuvre morale
commencée dès le début de son œuvre, attachée à la protection des
différences, des espèces naturelles et de la diversité du monde.
(source : Site du musée du Quai Branly)
LES PARUTIONS VIDEO ET SONORES

"Claude
Lévi-Strauss par lui-même", un film de Pierre-André Boutang et Annie
Chevallay
2 DVD, Arte
Vidéo, 2008.
Pierre-André Boutang et Annie Chevallay retracent en archives l'itinéraire
intellectuel d'un homme curieux de tous les hommes. Un portrait lumineux,
polyphonique et musical, à l'image de l'oeuvre qui l'a inspiré.
S'ouvrant sur la dénonciation précoce des dérives de la société consumériste
par Claude Lévi-Strauss, ce film retrace l'itinéraire intellectuel qui le
mena de la philosophie à l'anthropologie, de l'amour de la musique au
structuralisme. Il nous emmène avec fluidité de son enfance à sa maturité de
chercheur, des sommets des Cévennes aux rives de l'Amazone, d'une partition
d'orchestre à la structure des mythes, de la Grèce antique aux Bororo. Ce
récit à la fois chronologique et thématique donne à voir la vitalité et la
beauté de l'oeuvre pour communiquer l'envie de s'y plonger. L'anthropologue
écrivain en est le narrateur principal, avec son verbe lumineux, précis,
affable ou malicieux - comme dans cette délectable séquence d'essayage chez
le tailleur où, futur académicien engoncé dans sa redingote, il évoque son
attachement aux "derniers rituels" qui restent à la France.
Pierre-André Boutang et Annie Chevallay ont puisé dans une série
d'entretiens accordés par Claude Lévi-Strauss à la télévision avant 1984
(Archives du XXe siècle de Jean-José Marchand, le documentaire Yanomami de
Jean-Pierre Marchand, Une approche de Claude Lévi-Strauss de Jean-Claude
Bringuier, les émissions de Michel Treguer, Apostrophes de Bernard Pivot),
mais aussi dans les archives personnelles du penseur (photos de famille,
manuscrits, clichés ou films de terrain). De son portrait enfant peint par
son père aux lignes fines de son écriture, elles renforcent le sentiment de
cheminer au plus près de l'homme et de sa pensée. Et deux compagnons de
route pleins de fraîcheur, Frédéric Keck et Vincent Debaene, qui ont
travaillé à l'édition de ses oeuvres parue cette année dans La Pléiade, en
livrent quelques-unes des clés.

Le siècle de
Claude Lévi-Strauss par Jean-Claude Bringuier et Marcelo Fortaleza Flores,
Collection Regards, 2 DVD, Editions Montparnasse, 2008.
Avant la seconde guerre, en 1938, Claude Lévi-Strauss décide
de partir pour une
expédition vers la région la moins connue de l'Amazonie brésilienne. Ce sera
la célèbre rencontre avec les Nambikwara, ce peuple qui marquera pour
toujours sa vie de chercheur et d'anthropologue. Avec le recul de l'âge et
à la veille de son centenaire, il revient sur cette expédition si
audacieuse à l'époque et qui sera déterminante pour
sa pensée. Le DVD permet également de découvrir que le souvenir de
l'anthropologue est resté longtemps ancré dans les mémoires des Nambikwara,
offrant ainsi le parallèle passionnant de toute recherche anthropologique :
le regardé et le regardant.
Avant sa réception à l'Académie Française, en 1974, Claude
Lévi-Strauss s'est confié, dans un entretien exceptionnel, au réalisateur
Jean-Claude Bringuier. Constitué de deux grands chapitres (La Pensée
oubliée, Lumière et brume des voyages), cette approche de Claude Lévi-Strauss
est un remarquable portrait intellectuel et une archive irremplaçable.
DVD 1 : Auprès de l'Amazonie : le parcours de Claude Lévi-Strauss
Un film de Marcelo Fortaleza Flores (2008 - 52 min)
DVD 2 : Une approche de Claude Lévi-Strauss
Un film de Jean-Claude Bringuier (1974 - 135 min)
Ce programme contient un extrait du documentaire "Les Indiens Yanomami"
réalisé par Jean-Pierre Marchand.

Claude Lévi-Strauss, entretiens France Inter avec Jacques Chancel, Direction
artistique : Jacques Chancel, Label : RADIO FRANCE / INA / FREMEAUX &
ASSOCIES.
"La diversité des cultures humaines est, en fait dans le
présent, en fait et aussi en droit dans le passé, beaucoup plus grande et
plus riche que tout ce que nous sommes destinés à en connaître jamais"
Claude Lévi-Strauss © UNESCO
Les célèbres émissions "Radioscopie" de Jacques Chancel
comptent parmi elles un entretien avec le célèbre anthropologue Claude
Lévi-Strauss en 1988. C'est l'intégralité de cet enregistrement qui est ici
proposé par les Editions Frémeaux sur un CD avec un témoignage d'un homme
qui n'aimait pas se livrer aux confessions personnelles. Cette réticence fut
d'ailleurs renforcée et nourrie par des expériences personnelles de Lévi-Strauss qui
rencontra le célèbre compositeur Stravinsky qu'il avait toujours admiré, et
qui lui sembla bien préoccupé par ses petites affaires personnelles...
L'homme se lit plutôt au travers de son oeuvre et de ses recherches ce qu'a
bien compris Jacques Chancel dans cette fameuse radioscopie qui prend valeur
de documents d'archive.

Lévi-Strauss "Nature, culture et société, les strucutres
élémentaires de la parenté, chapitres I et II" présentation, notes dossier
et chronologie par Alice Lamy, GF, Flammarion, 2008.
Le livre "Les structures élémentaires de la parenté" paru en
1949 est un des premiers livres de celui qui allait bientôt associer son nom
à l'anthropologie structurale. En partant des problèmes posés par les règles
du mariage, cette réflexion conduit son auteur à des interrogations
philosophiques bien plus générales : qu'est ce qui relève de la nature ? à
partir de quel moment doit-on parler de culture ? les frontières sont-elles
bien définies en l'homme ? ces différences permettent-elles de distinguer
l'homme de l'animal ? Face à toutes ces interrogations essentielles, ce qui
fut initialement la thèse de Claude Lévi-Strauss apporte non seulement des
éclairages essentiels pour l'avenir de la discipline, mais également une
méthode mise en oeuvre à l'occasion qui dépassera la discipline première,
l'ethnologie, pour atteindre une dimension philosophique et lancer les
prémisses du structuralisme. L'introduction et l'appareil critique préparés
par Alice Lamy permettent de mieux saisir l'importance d'un des premiers
textes majeurs de Claude Lévi-Strauss rarement présenté.

"Claude Levi-Strauss, le passeur de sens" de Marcel Hénaff
inédit, coll Tempus, Perrin, 2008.
Marcel Hénaff, philosophe et anthropologue, enseigne à
l'université de Californie, San Diego. Il débute sa réflexion par une
interrogation, celle du sens du titre choisi pour ce dernier ouvrage.
Lévi-Strauss peut-il, en effet, être présenté comme un passeur de sens ? Si
la formule peut séduire, rappelle l'auteur, est-elle cependant appropriée
pour un esprit qui n'a jamais exclu le doute, le pessimisme... L'analyse
structurale observe à partir de l'expérience. Le sens provient de ce qui
résulte de cette expérience c'est à dire ce qui devient intelligible, "fait
sens", et dont les modèles permettent une certaine lisibilité. C'est en ce
sens que Lévi-Strauss est un passeur de sens en nous aidant à comprendre la
formation des dispositifs symboliques, des transformations des mythes,...
|
HOMMAGE DU
COLLEGE DE FRANCE
du 25 au
27novembre.

Organisé par
le Collège de France, l’École des Hautes Études en Sciences Sociales,
l’École Pratique des Hautes Études
Amphithéâtre Marguerite de Navarre
11 place Marcelin-Berthelot - 75005 Paris
Entrée libre, sans inscription
dans la limite des places disponibles
Depuis la première publication de Claude Lévi-Strauss en 1926 jusqu’à la
plus récente en 2008, son oeuvre a traversé le long XXe siècle en le
marquant profondément. On trouve bien sûr des traces de cette influence dans
l’anthropologie, une discipline que Lévi-Strauss a refondée en France au
sortir de la guerre et dont il a orienté le cours dans des voies nouvelles
partout ailleurs, mais aussi dans un champ beaucoup plus vaste allant de
l’esthétique à la philosophie de la connaissance en passant par la réflexion
sur le racisme, sur le langage ou sur la responsabilité des humains
vis-à-vis des non-humains. Ce sont quelques-uns de ces domaines que le
colloque a pour but d’explorer grâce à certains de ceux sur qui l’influence
de Lévi-Strauss s’est exercée à divers moments au cours des cinq dernières
décennies. C’est aussi une manière de ressaisir dans le vif, au moment du
centième anniversaire de sa naissance, ce que le grand anthropologue a
contribué à faire advenir dans la pensée.
PROGRAMME
Mardi 25 novembre, Colloque international - Claude
Lévi-Strauss, un parcours dans le siècle
programme du colloque et des conférences
9h30 Introduction
Ouverture par Pierre Corvol, Administrateur du Collège de France
Danièle Hervieu-Léger, Présidente de l’EHESS
Jean-Claude Waquet, Président de l’EPHE
Présentation du colloque
par Philippe Descola, Professeur au Collège de France
Terrains et thèmes
Président de séance : Alfred Adler, EPHE
10h00 D’un opérateur structural : La côte Nord-Ouest de l’Amérique du Nord
Marie Mauzé, CNRS, Paris
10h30 Art et pensée sauvage
Carlo Séveri, CNRS et EHESS, Paris
11h00 discussion
11h15 pause
11h30 Lévi-Strauss et l'interface
Manuela Carneiro da Cunha, Universités de Chicago (USA) et de São
Paulo (Brésil)
12 h00 L’Amérique dans le structuralisme
Anne-Christine Taylor, CNRS et Musée du quai Branly
12h30 discussion
Domaines et problèmes
Président de séance : Philippe Descola, Collège de France
14h30 L'Aigle et le Corbeau structurent aussi la forêt sibérienne
Roberte Hamayon, EPHE
15h00 Si on en revenait à la parenté et à l’alliance ?
Françoise Héritier, Collège de France
15h30 Peut-on "donner un sens plus pur aux mots de la tribu" (Stéphane
Mallarmé) : Lévi-Strauss et la dynamique des mythes
Pierre Maranda, Université Laval (Québec)
16h00 discussion
16h15 pause
16h30 Regards sur la parenté et la royauté sacrée africaine
Luc de Heusch, Université libre de Bruxelles (Belgique)
17h00 Infrastructuralism, and a few other things I learned from Lévi-Strauss
Marshall Sahlins, Université de Chicago
17h30 Un moment épistémologique : "la contemplation de quelques fleurs
sauvages, quelque part du côté de la frontière luxembourgeoise au début de
mai 1940"
Claude Imbert, École normale supérieure, Paris
18h00 discussion finale
Conférences des 26 et 27 novembre
Et la nature humaine ?
Dan Sperber
26 novembre 2008, de 18h00 à 20h00
au Collège de France
Amphithéâtre Marguerite de Navarre
11 place Marcelin-Berthelot - 75005 Paris
D’Isaac Strauss à Claude Lévi-Strauss : le judaïsme comme culture
Daniel Fabre
27 novembre 2008, de 18h00 à 20h00
à l’EHESS
Amphithéâtre
105 boulevard Raspail - 75006 Paris

La Lettre du Collège de France, numéro Hors série : Claude
Lévi-Strauss, centième anniversaire. 80 pages
En vente au Collège de France Auteurs : collectif Editeur : Collège de
France
Sommaire :
- Claude Lévi-Strauss, une présentation par Philippe Descola
- Entretien avec Françoise Héritier
- Réflexions sur la réception de deux ouvrages de Claude Lévi-Strauss par
Maurice Bloch
- Le ciel étoilé de Claude Lévi-Strauss par Jean-Claude Pecker
- Bricoler à la bonne distance par Michel Zink
- Entretien avec Philippe Descola
- Entretien avec Eduardo Viveiros de Castro
Textes de Claude Lévi-Strauss
- Dis-moi quels champignons... (1958)
- L’humanité, c’est quoi ? (1960)
- La leçon de sagesse des vaches folles (1996)
Claude Lévi-Strauss et le Collège de France
- Rapport pour la création d’une chaire d’Anthropologie sociale
(1958),Maurice Merleau-Ponty
- Présentation de la candidature de Claude Lévi-Strauss à la chaire
d’Anthropologie sociale (1959), Maurice Merleau-Ponty
- Leçon inaugurale au Collège de France, Claude Lévi-Strauss (1960, extrait)
- Comment Claude Lévi-Strauss préserva l’un des rites de la leçon inaugurale
par Yves Laporte
- Au Collège de France, Extrait de De près et de loin
- Le Laboratoire d’anthropologie sociale par Nicole Belmont
- Le fichier des Human Relations Area Files par Marion Abélès
- Lévi-Strauss et la Côte nord-ouest par Marie Mauzé
- Le regard de l’anthropologue par Salvatore D’Onofrio
- Le moment Lévi-Strauss de la Pléiade par Marie Mauzé
- La chaire Lévi-Strauss à l’Université de São Paulo par Olivier Guillaume
- Claude Lévi-Strauss, un parcours dans le siècle, Colloque au Collège de
France
- Publications liées au centenaire de Claude Lévi-Strauss
LES PARUTIONS RECENTES

Claude Lévi-Strauss "Saudades do Brasil" PLON, 2008.
Lévi-Strauss commençait son livre "Tristes tropiques" par un
jugement qui allait rendre son récit si célèbre. Comment un anthropologue
pouvait-il en effet affirmer dès la première ligne qu'il haïssait les
voyages et les explorateurs ? Au-delà du paradoxe apparent, se cachait une
sensibilité extrême qui a également inspiré les photographies réunies dans
ce magnifique livre publié par les éditions PLON. Ces clichés pris entre
1935 et 1939 avec son fameux Leica offrent à nos yeux un monde à jamais
disparu. Cet univers fut si important pour l'anthropologue qu'il a choisi de
nous en livrer quelques bribes. Nous plongeons ainsi dans le Brésil
d'avant-guerre, autant dire un Brésil plus proche des temps anciens que de
notre époque. Lévi-Strauss hait les voyages, mais ce malaise n'affecte pas
son regard. Nulle emphase ni illusion, mais ce paradis perdu a beaucoup
appris au jeune anthropologue sorti de ses humanités et d'une solide
formation universitaire. Cette école de la vie a certainement plus compté
que les nombreuses heures dans les bibliothèques. Les photographies prises
très spontanément font revivre ces femmes, ces hommes, ces enfants même si
Claude Lévi-Strauss avertit que ces images ne sont que des indices, des
traces et non des témoins fidèles. Cette expérience, Lévi-Strauss cherche à
nous la faire partager avec un commentaire à la fois sobre et en même temps
passionné. L'auteur nous rappelle que cette époque est révolue. Ainsi son
témoignage prend-il valeur non seulement de document affectif, mais
également de document historique. Certains habitants des contrées visitées
par Lévi-Strauss se souviennent encore de l'anthropologue, à son tour
l'homme qui atteint un âge si vénérable dans les sociétés traditionnelles
leur rend cet hommage grâce à ce superbe recueil constitué en leur honneur !

Claude Lévi-Strauss "Les structures élémentaires de la
Parenté" Editions Mouton de Gruyter, 2002.
Dans Les Structures élémentaires de la parenté, chef-d’œuvre
précurseur du structuralisme français, Claude Lévi-Strauss tente d’expliquer
les systèmes de parenté et d’union, dans toute l’étendue de leur diversité
et de l’étrangeté de leurs institutions, au moyen d’un principe unique :
l’échange. Il considère l’échange comme la manifestation des constantes
structurelles fondamentales de l’esprit humain, qui peuvent être également
perçues dans d’autres sous-systèmes de culture et, de façon plus manifeste,
dans le langage. Cet ouvrage constitue le premier résultat, majeur, des
longues recherches de l’auteur qui l’ont également conduit vers les champs
de systèmes de classification du langage et vers la mythologie.

"Claude Lévi-Strauss : L'homme derrière l'oeuvre" de
Emilie Joulia, Editions JC Lattès, 2008.
Emilie Joulia, journaliste à Canal Académie, a cherché à
mieux connaître l'homme derrière l'oeuvre, une tâche ambitieuse et délicate
lorsque l'on connaît la réserve du principal 'intéressé face à l'exercice.
Peu importe, grâce à cinq témoignages de personnes ayant côtoyé l'un des
derniers grands géants du XX° siècle, l'ombre se dissipe et l'homme apparaît
peu à peu.
Philippe Descola est le dernier thésard du célèbre professeur au Collège de
France ; Françoise Héritier a succédé à Lévi-Strauss à la direction du
Laboratoire d'anthropologie sociale du même Collège de France ; Vincent
Debaene préfacier de l'édition Oeuvres dans la Pléiade ; Claudine Hermann
une amie depuis 1941 et Jean José Marchand qui a sauvegardé pour la
télévision la voix et l'image des grands penseurs du XX° siècle, tous ces
témoins ouvrent leur mémoire afin d'offrir au lecteur leurs souvenirs de
l'homme dans son contexte professionnel ou privé. Nous découvrons un homme
qui a essayé l'écriture automatique à l'époque du surréalisme, et qui
apprécie le théâtre chinois, un amoureux de Balzac et de Conrad sans pour
autant dépasser en influence l'écriture de Proust... Le volume se termine
par le discours de réception à l'Académie française prononcé le 27 juin 1974,
ainsi que la réponse peu usuelle de Roger Caillois dans ce genre d'exercice,
un beau voyage pour mieux connaître l'homme avant de retourner à ses oeuvres
!

"Au-delà du structuralisme : Six méditations sur Claude
Lévi-Strauss" de Emmanuel Désveaux, Editions Complexe, 2008.
L'auteur, directeur d'études à l'EHESS, est un grand
spécialiste de la pensée de Lévi-Strauss. Lui-même ethnologue de
terrain dans le Grand Nord canadien, il a une connaissance particulièrement
fine des écrits de Lévi-Strauss et cherche ainsi, au-delà du structuralisme
comme l'indique le titre de ce dernier livre, à percevoir les faisceaux qui
sous-tendent l'oeuvre du grand anthropologue. Ces lignes de force peuvent
ne pas apparaître de prime abord surtout lorsqu'elles se cachent sous
le dénicheur d'oiseaux, la poésie ou la représentation visuelle chez Poussin...
mais tout le travail exégétique d'Emmanuel Désveaux réside justement dans
cette démarche de la quête du sens afin de dégager, tel l'ethnologue de
terrain, des notions comme celles de l'échange matrimonial, le mythe ou
encore la musique.

"Le Siècle de Lévi-Strauss" Avant-propos de Jean Daniel,
CNRS Editions, 2008.
Cet ouvrage présenté par le Nouvel Observateur et publié avec
les éditions Saint-Simon regroupe les contributions qu'avait consacré
l'hebdomadaire au célèbre anthropologue et académicien. Jean Daniel, dans
son avant-propos, souligne que le livre "La Pensée sauvage" paru en 1962
a servi de fil conducteur à cet hommage. Que son anthropologie structurale
soit remise en question par certains disciples n'enlève rien à la dette que
tous lui doivent pour avoir renouveler la discipline et ouvert des horizons
fermés jusqu'alors. Cette pensée sauvage dont le symbolisme de la fameuse
fleur qui ornait la première édition n'avait pas été perçu par les
universitaires américains de l'époque est une plante beaucoup plus délicate
à l'état sauvage que dans sa version "cultivée". "Tristes Tropiques"
évoquent les difficultés de l'anthropologue pour mieux comprendre l'autre.
Ce collectif d'auteurs devrait nous aider tout au moins à mieux comprendre
celui qui posait une telle interrogation et qui n'a cessé de sa vie d'y
apporter des éléments de réponse.

"Anthropologies rédemptrices : La race et le monde selon
Lévi-Strauss" de Wiktor Stoczowski Editions Hermann, 2008.
Même si la mode du « structuralisme » appartient désormais au
passé, l’œuvre de Claude Lévi-Strauss garde toute sa vigueur et continue
d’être rééditée, lue, commentée, parfois critiquée, souvent admirée.
Beaucoup d’énigmes y demeurent cependant, qui défient le lecteur. L’enquête
présentée dans cet ouvrage prend comme point de départ l’une d’entre elles :
la contradiction surprenante entre « Race et histoire » (1952), devenu un
classique de la littérature antiraciste, et « Race et culture » (1971),
considéré comme scandaleusement proche des positions racistes, cependant que
Lévi-Strauss clame imperturbablement que l’un et l’autre textes expriment
les mêmes convictions.
Afin d’expliquer ce paradoxe, l’analyse s’élargit progressivement à
l’ensemble de l’œuvre lévi-straussienne. L’auteur écarte les lieux communs
qui abondent dans la littérature exégétique déjà consacrée à cette œuvre,
pour s’appuyer sur des données nouvelles : il s’est entretenu avec Claude
Lévi-Strauss à plusieurs reprises et a retrouvé de nombreux matériaux
d’archives qui jettent une lumière inattendue sur le parcours intellectuel
de l’anthropologue français, depuis ses premières publications dans les
années 1920.
L’auteur fait ici le pari d’élucider les idées de Claude Lévi-Strauss non
seulement comme celles de l’inventeur d’une théorie anthropologique, mais
surtout comme celles d’un penseur qui propose, en deçà d’un système
théorique, une vision du monde. Réfractant la plupart des drames devenus
emblématiques du siècle passé, l’œuvre de Lévi-Strauss est irriguée par la
réflexion sur le problème des imperfections du monde humain. Pour la
comprendre, il est nécessaire de démêler l’écheveau de plusieurs conceptions
qui, au XXe siècle, relevèrent le défi de ces deux questions parmi les plus
obsédantes auxquelles les hommes eurent à faire face dans notre tradition
culturelle : celle de la présence du mal et celle des remèdes à y apporter.
Wiktor Stoczkowski enseigne l’anthropologie à l’École des Hautes Études en
Sciences Sociales. |
|
La collection Lévi-Strauss du musée du
quai Branly est composée de 1 478 pièces.
Elle est à diviser en deux grands ensembles : les collections du Brésil, qui
proviennent des missions effectuées dans les années 1930, relatées notamment
dans Tristes tropiques ; les collections d’Amérique du Nord, soit 5 pièces
exceptionnelles ayant appartenu à Claude Lévi-Strauss, et provenant de la
Côte Nord-Ouest de l’Amérique du Nord (Colombie britannique et Alaska)
|
|
LE CHE AU XXI° siècle à l'épreuve du relativisme
Le témoignage du philosophe Miguel Benasayag |
   |
|
Faut-il encore présenter Miguel Benasayag ?
Argentin, guévariste, emprisonné et torturé sous la dictature argentine à la
fin des années 70, il est également psychiatre, psychanalyste. Il est
surtout philosophe et militant-chercheur. Parce que ce philosophe ne milite
pas seulement, il cherche surtout les bonnes questions, celles qui remettent
en cause nos certitudes et souvent conduisent à déranger nos positions
tranquilles. Ennemi du sens commun, alliant une réflexion globale et les
paradoxes, ce qui l'intéresse, c'est avant tout la réalité, la complexité du
réel avec ses conflits, ses contradictions et sa multitude.
Auteur d'un ouvrage sur le Che aux
Éditions La Découverte,
Il a accepté aujourd'hui pour LEXNEWS de nous
parler du Che à l'heure où ce dernier se retrouve à la date anniversaire de
sa mort dans la tourmente du relativisme...

Relativisme et relativisme…
La question du relativisme est un des
événements fondamentaux de ces trente dernières années dans notre société,
dans la mesure où, elle correspond effectivement à l’irruption dans nos
sociétés, dans nos modes de penser et d’agir, de la complexité du réel. Que
cela soit du côté bourgeois, capitaliste, libéral ou du côté contestataire,
de gauche, il y a effectivement des analyses linéaires, des analyses
cause/effet qui ne fonctionnent plus. Or, l’irruption de la complexité a
comme corollaire inévitable une certaine dose de relativisme parce que on
commence à se dire soudainement que les choses ne sont pas si simples ou si
vraies que cela. Si quelqu’un est opprimé et se révolte, on peut estimer
qu’il a absolument raison d’agir ainsi, mais on peut également se dire que
s’il a raison de se révolter, ce n’est pas pour autant qu’il a raison dans
ce qu’il propose…Le capitalisme ne peut pas être mis ainsi tout entier dans
un sac comme si cela était une dictature militaire et être attaqué dans son
ensemble. Cette irruption de la complexité agit comme un retour du refoulé
après que l’on ait cru que l’on pourrait maîtriser le monde, la pensée avec
des analyses claires et linéaires. Il est donc tout à fait normal que nos
petites sociétés marquent ainsi un coup d’arrêt par rapport à certaines
positions ou certaines convictions trop profondes et qu’elles les mettent à
l’index parce que les choses ne sont plus effectivement aussi évidentes que
cela ou comme le dit un slogan idéologique « pas si simple que cela ».
Mais, à partir de ce moment là, on va se
rendre compte dans les sciences, dans la médecine, dans le domaine politique
etc. qu’une des hypothèses les plus lourdes, celle du progrès - plus ou
moins rectiligne ou linéaire mais néanmoins progrès vers un but –, a montré
ses limites. On rencontre alors beaucoup de difficultés à penser ce qu’est
une injustice ? Ce qu’est la justice ? Où va-t-on ? Il est donc tout à fait
normal qu’il y ait eu à un moment un certain relativisme en réponse aux
manques de convictions.
Cependant, le problème dans cette société
est que les injustices n’ont fait que s’accroître ; les droites et
l’impérialisme américain n’ont pas fait autre chose que de se lancer dans
une période de restauration comme jadis en France après Napoléon. Ils ont
cru qu’ils pouvaient dire : « Bon, maintenant, c’est fini ! ».
L’impérialisme américain, qui avait eu peur de tomber après avoir perdu le
Vietnam, une partie de l’Afrique, etc., a eu peur dans les années
soixante-dix que ce soit la fin du capitalisme. Dans ces années, beaucoup de
politologues, de sociologues pensaient en effet que la décennie se
terminerait par le socialisme d’une façon ou d’une autre. Or, les années
soixante-dix ont fini par la restauration impérialiste et capitaliste
mondiale. Cette restauration a été rendue possible surtout par le fait que
les partisans de l’émancipation ne savaient plus où ils en étaient !
Effectivement, ce retour des choses était d’autant plus possible que - mis à
part quelques fanatiques ou tendances illuminées - les gens qui pensaient,
désiraient la justice, ont continué à désirer cette justice mais sans savoir
comment. On avait perdu la question centrale : le sens de l’histoire ; tous
les lieux où on avait gagné avaient engendré le contraire de ce que l’on
voulait, la confusion était totale ! Pour ces raisons, ce relativisme ne
doit pas être diabolisé.
"Nous
n’avons pas besoin d’un avenir radieux, ici et maintenant, en situation,
pour résister aux injustices."
Cependant, si ce relativisme, cette
complexité du réel, repose sur un processus logique, honnête – que seuls
certains fanatiques avaient écarté – il comporte également une partie
malhonnête. C’est en effet le cas lorsque on estime que parce que l’on n’a
pas vaincu la maladie, on va se soumettre à elle. Ici, il y a alors un
passage « canaille », malhonnête du relativisme qui consiste à dire puisque
nous n’avons pas vaincu l’horreur – parce que nous étions totalement dans
l’erreur ou presque dans nos hypothèses – on va se plier à l’horreur. Ce
passage, je ne l’ai pas fait, beaucoup de gens ne l’ont pas fait en étant
anti-relativistes. Nous n’avons pas besoin d’un avenir radieux, ici et
maintenant, en situation, pour résister aux injustices. Le relativisme,
anthropologiquement et sociologiquement, est une réalité mais la position
existentielle de chacun de nous face à ce relativisme n’est cependant pas
sur-déterminée mais répond à un désir. Si nous prenons l’exemple des
injustices, va-t-on rester inerte parce nous n’avons pas la solution, voire
pire encore va-t-on se plier face à l’ennemi ou bien est-il possible de
s’engager en mettant entre parenthèses la question générale d’injustice.
Aujourd’hui, il me semple que la fonction espoir, la fonction promesse dans
le dispositif d’engagement – que ce soit en tant que chercheur en biologie
ou en tant que chercheur en justice ; c’est pour ces raisons que je préfère
le terme militant-chercheur – peut être mise à l’écart, laissée de côté,
dégagée parce qu’elle est une fonction métaphysique. Mais, notre problème
cependant est que la fonction promesse ou espoir était vraiment le moteur
de la lutte, de l’engagement. Il est dès lors très difficile de savoir ce
qui peut remplacer un tel moteur si puissant sans nous faire retomber dans
l’espoir. Cela est un problème terrible !
Son dernier livre...

|
Le Che
dans la tourmente de l’idéologie ambiante.
Cependant, au delà de ce constat, il y a
aujourd’hui un très fort désir de légitimer ce que je nomme la pensée
« canaille » parce qu’elle donne une cohérence et dès lors rassure.
Aujourd’hui, beaucoup de personnes ont envie de lâcher prise sur certains
principes, sur certains désirs, certaines possessions…mais elles ne font
rien ; pourquoi ? Parce qu’elles pensent que personne ne fait rien ; et pire
encore, elles ne font rien parce qu’elles se disent : « ce sont tous des
canailles ». Cela rassure parce que, en revanche, si le Che existe, si le
Mahatma Gandhi existe, si le Christ existe, si de telles personnes
existent…à ce moment là, il va falloir admettre que ces personnes existent
et me disent qu’il est en fait possible dans certaines situations de ne pas
être ni une « canaille », ni égoïste.
"il y alors une idéologie de la « canaillerie », de la collaboration qui se
met en place. Celle-ci est aujourd’hui très forte."
Mais, si on me dit : « Non, finalement ce
sont tous des « canailles », qu’en fin de compte cela n’était pas vrai, il y
alors une idéologie de la « canaillerie », de la collaboration qui se met en
place. Celle-ci est aujourd’hui très forte. On veut aujourd’hui nous prouver
que l’on ne peut être que des collabos et cela va très bien avec le
sarkozysme qui nous dit : « Allons, vous voyez bien tout le monde vient à la
soupe, il n’y a pas de principes, il n’y a pas de droite-gauche… », C’est
l’idéologie ambiante. On nous dit que si personne ne tient sur des positions
éthiques ou de principes, ce n’est pas parce que personne ne tient, mais
bien parce que de telles personnes n’existent pas ! Et si quelqu’un tient,
et bien on s’empresse de nous dire : « Mais non, vous voyez ce n’était pas
vrai ! ». Aujourd’hui, les personnes adorent savoir, apprendre la face
sombre de quelqu’un. Ils adorent savoir qu’à chaque fois qu’ils enjambent un
SDF dans la rue, à chaque fois qu’ils sont « canailles », qu’en fait tout le
monde est comme cela et qu’il n’est pas vrai qu’un pauvre médecin argentin
ait pu être différent ! Nous assistons à une véritable obsession qui
consiste à montrer que tout cela n’est pas vrai, que personne n’a jamais
tenu le coup. C’est l’idée même qu’il n’existe pas d’icône, pas de mythe
dans le sens anthropologique, c’est-à-dire que tout est égal à tout, que
tout est possible. Il n’y a plus de ligne divisoire. Or, quand on pense en
termes de complexité, on rechigne bien sûr à se surévaluer, à avoir une
image de soi trop haute, à se dire que l’on est le «bien » ; Mais, il est
alors facile d’écouter l’autre vous dire : « Mais non, enfin, tu n’es pas le
« bien » ; on se dit « Bien sûr !, je sais bien que je ne suis pas le «
bien ! »… Le problème dès lors est de faire la différence entre des
identités narcissiques stupides et une idéologie du « tout est pareil au
même ». Le problème se situe là. Il y a une base toujours réelle de
complexité qui nous dit : « tu ne vas pas te prendre pour le « bien » contre
le « mal », mais cette base réelle de complexité est cependant également
utilisée pour mettre en place une « guimauve » de proximité idéologique qui
estime que tout homme a son prix. C’est une véritable entreprise de
démolition de tout mythe, de toute icône, de tout principe.
"...lorsqu’on croit en soi il y a un énorme danger : le volontarisme."
La
vérité du Che…
Il m’est arrivé un jour de participer à
une émission de télévision sur une chaîne publique où Ismael Kadaré et
moi-même étions invités pour parler de la dictature. Selon cette
émission l’un devait défendre Pinochet, en l’espèce Kadaré, et moi-même
Cuba. Or ni Kadaré ni moi-même n’avions en fait l’intention de soutenir
cette logique contre toute attente de l’émission. Comme nous avions tous les
deux vécus sous une dictature, nous n’avions bien sûr absolument aucune
envie ni lui ni moi de soutenir ce principe même de la dictature mais bien
au contraire de développer notre opposition à ce principe de dictature. J’ai
même insisté sur quelque chose que je connais bien à savoir : le désastre
qui va survenir à la mort de Castro. Il ne s’agit pas de dire ce sera pire
ou non, l’après Castro sera tout de même du Castro. Les désastres de la
dictature seront du tout au même. J’expliquais ainsi que la dictature est
une horreur et que toute dictature à venir sera également une horreur. Il ne
peut y avoir une apologie de la dictature.
De même l’erreur fondamentale est de
laisser aujourd’hui à des petits « filous » le soin de dénoncer les crimes
du Che, j’insiste sur le mot crime car ce ne sont pas des erreurs : 300
morts ne peuvent être le résultat d’une erreur. Or, je pense que les crimes
qui sont commis au nom de la liberté doivent être au contraire une
préoccupation permanente de ceux qui luttent justement pour la liberté. Non
seulement, il ne faut pas contester ces crimes mais bien au contraire être
les premiers à les dénoncer et être le procureur le plus féroce ou le plus
minutieux. Il ne faut pas attendre que quelqu’un de droite vienne dénoncer
ces crimes mais bien, à la moindre alerte, faire très attention et chercher
soi même à y apporter une réponse. La réponse ne peut pas être : « il ne
faut pas dire » ; La réponse au contraire est de dire : « oui, il y a eu un
crime » ; il ne faut surtout pas le nommer en erreur. C’est un crime, et ce,
aussi « salopards » que pouvaient être ces 300 personnes.

Dans le cas du Che, il est certain que
c’était quelqu’un avec des convictions très fortes, qui croyait en ses
convictions, qui croyait en lui – et cela était indispensable pour faire le
parcours qu’il a fait – mais lorsqu’on croit en soi il y a un énorme
danger : le volontarisme. Or, je me suis rendu compte personnellement que la
position de chercheur qui consiste à être capable de démolir ses propres
présupposés est antagonique avec la position de leader, pour être leader il
faut croire très fort en soi et évidemment cela créer un danger. Quelles
sont les erreurs, dérapages qu’a commis le Che pour le conduire à de tels
crimes ? Il n’a pas réalisé la différence entre ce que l’on nomme
aujourd’hui puissance et pouvoir, gestion et politique. Ainsi, et je prends
un exemple personnel lors de notre lutte contre la dictature en Argentine,
c’était une chose d’attaquer à nos risques et périls un commissariat ou une
caserne en éliminant des officiers tout en faisant attention à ne pas
toucher les appelés ou bien de supprimer un tortionnaire que l’on avait
repéré, alors qu’il en est tout autrement lorsque l’on est du coté du
pouvoir et que l’on utilise ce même pouvoir pour éliminer des personnes qui
objectivement ne représentent plus un danger. Du moins si elles représentent
encore un danger, ce danger ne justifie plus leur élimination physique. Il
me semble que le Che n’a pas fait cette différence.
|
Or, cette différence a condamné à peu près
toutes les révolutions. Il y a une hypothèse qu’il faut abandonner : celle
selon laquelle le pouvoir pourrait avoir les mêmes modes de légitimité que
la résistance. Ce n’est pas la même chose parce que le pouvoir doit assumer
le coté conflictuel contradictoire. Le pouvoir n’est pas polarisable
contrairement à la résistance qui elle, en revanche -et c’est le propre de
la résistance - est polarisable. Le problème est que lorsqu’on est dans le
pouvoir on est immédiatement pris dans un faisceau contradictoire et
multiple de forces qui impose à celui qui est au pouvoir de vouloir vraiment
tout faire pour ne pas agir en sens unique, de façon polarisée. Et cela, le
Che mais aussi Mao, Lénine ou Robespierre ne l’ont
pas compris.
" Résister,
c’est créer "
Les crimes commis
par le Che constituent-ils la vérité du Che ? Non ! Parce que la vérité d’un
être humain n’est nulle part. La vérité d’un être humain, c’est au contraire
justement la multiplicité de la situation. Pourquoi dès lors la vérité du
Che serait plus celle-ci que lorsqu’il se bat pour la libération contre les
Soviétiques ? La vérité du Che n’est ni lorsqu’il est au Congo ni lorsqu’il
est un héros. La vérité du Che ne se situe pas là, pas plus qu’elle n’est
dans les crimes. L’épuration ne peut condamner à elle seule la résistance.
Ça, c’est ce que tente – au-delà des crimes – de faire croire une idéologie
réactionnaire pour démolir la résistance et la possibilité de lutter pour la
résistance. On nomme les crimes pour noircir le reste. Là, il y a un travail
à faire pour dire : « Oui, Il y a eu des crimes impardonnables, mais
attention de ne pas condamner par là même la résistance ». Les personnes qui
critiquent les exécutions, les crimes, l’épuration, et en fin de compte sans
nuances la résistance, se fichent en fait des victimes, ce qui les
intéressent c’est de démolir la possibilité que des gens résistent et se
révoltent en imposant ce qu’est pour eux la vérité. L’entreprise est ici
très réactionnaire et vise une démolition de l’idée même de résistance et de
révolte. Je suis convaincu que c’est comme une sorte de déploiement du
programme de Fukuyama : il n’y aura plus de passion, plus de lutte pour la
liberté, plus d’amour, plus d’art, il n’y aura plus que gestion de la vie.
Aujourd’hui, lorsqu’on parle de révolte, on a l’air d’être une personne
totalement tarée et dangereuse ! Il y a ainsi une délégitimation de la
révolte. Alors que dans toute société, la révolte signifie : éprouver les
marges, les frontières, créer des nouveaux possibles, reculer… Or, on nous
dit aujourd’hui : « Tu n’es pas d’accord, mais ce n’est pas la peine de se
révolter parce que toute révolte n’est pas sérieuse ». Cette délégitimation
peut être relevée également en recherche fondamentale qui est aujourd’hui
quadrillée par des faux-sérieux ; Nous sommes aujourd’hui dans un monde
soft, de discipline et de quadrillage qui avance et ce sans aucun Big
Brother. Cependant, il ne faut pas franchir le pas du volontarisme. Toute
tentative de forcer la main à l’Histoire se retourne contre la personne qui
agit ainsi. Si on a une opposition très forte, ce qui est mon cas, à un
moment donné il faut se retirer pour éviter de se placer dans des positions
trop forcées, quitte à revenir d’une autre manière… La lutte contre les
tyrans, la lutte contre le racisme, la lutte contre le machisme est
acceptable mais le pas qui consiste à faire de cette lutte un pouvoir ne
peut être franchi. La lutte contre la réalité, contre l’histoire, contre la
complexité ne peut être envisagée. Il faut apprendre dans la vie que ce
n’est pas parce que nous résistons et que la justice fait partie de notre
résistance que nous devons penser en termes de « comment l’imposer ? » .
C’est pour cela que j’avais écris avec Florence Aubenas : « Résister, c’est
créer ». Il ne s’agit pas de rejeter l’action directe mais l’action directe
est toujours dans le contre pouvoir. Toute action directe exercée depuis le
pouvoir est une dictature.

« Ma
vie, ce n’est pas moi… »
Le Che a repris une idée essentielle de
l’héritage pré-colombien et qui a donné corps à sa radicalité, « nous
sommes déjà morts », une idée que les indiens avaient en eux et que Marcos
reprendra également. Cela ne signifie nullement mépriser la vie mais plutôt
ne rien désirer de ce que possède mon maître. C’est cela l’idée de l’homme
nouveau du Che. Ne rien désirer de ce qui est dans ton pouvoir ; donc tu
peux me donner la mort et bien je ne désire pas vivre ! C’est l’idée d’une
radicalité totale dans laquelle, en situation, rien n’est négociable. Rien
n’est négociable car ce que nous défendons, en situation, est quelque chose
qui de façon quelque peu mystique nous traverse. Tu ne peux pas m’acheter
parce que ce n’est pas de moi dont il s’agit. C’est rendre compte que l’on
est porteur de quelque chose qui ne nous appartient pas et cela ne peut être
ravi. Ce dont il s’agit dans cette situation dépasse la personne sans
dimension nécessairement religieuse. Ce qui ordonne les situations ne
s’épuise pas dans la situation. Il est possible de voir cela d’une façon
mystique mais ce n’est pas une obligation. L’important pour la culture
pré-colombienne est de ne pas se laisser prendre dans la situation comme un
interlocuteur, refuser toute symétrie parce que le révolté ne se révolte pas
pour quelque chose que le maître puisse lui concéder. C’est justement cette
idée : « Je ne demande rien de ce que tu as ». L’esprit de la révolte que le
Che a incarné est l’esprit d’une révolte qui justement n’est plus dans le
calcul terrible géopolitique soviétique, ni dans les calculs politiciens du
parti communiste argentin. Ce dont il s’agit est un ineffable, quelque chose
qui n’est pas nommable.
"La vie ne commence pas avec soi et ne finit pas avec soi..."
Le Che représentait la possibilité de se
révolter contre la dictature d’une façon qui n’était pas prise dans un
calcul minable. Le guévarisme signifie cela. Se rendre compte que là où nous
sommes il n’est pas question de moi en tant que « moi ». Je ne peux
qu’assumer le mieux possible cette place qui tout en étant la mienne ne
m’est pas très personnelle. La vie ne commence pas avec soi et ne finit pas
avec soi. C’est une vision allocentrée de soi, du monde et non pas
égocentrée. Les indiens ont une culture, une cosmogonie, une façon de vivre
allocentrée. Ce qui ne signifie nullement ne pas tenir compte de sa vie, de
ses désirs, mais ils conçoivent toutes leurs passions humaines comme
imbriquées, articulées dans un tout qu’ils perçoivent de côté. Le Che était
l’articulation de cela et de la modernité. Il a été très tenté par le
communisme moderne et à la fois par ce quelque chose d’autre contre l’Union
soviétique, contre le réalisme socialiste. Le Che a toujours représenté
cette autre possibilité. Il avait absorbé cette sensibilité comme une éponge
et son fameux voyage en motocyclette a été un voyage initiatique qui lui a
permis de trouver l’objet de son amour comme un romantique allemand. Ce
voyage là beaucoup de jeunes l’ont fait en Amérique Latine mais le Che était
comme un amoureux à la Novalis qui attend, et celle qu’il aimait -
l’Amérique Latine - il l’a trouvée dans son voyage !
Merci Miguel Benasayag pour ce très beau
témoignage qui n'est ni une apologie aveugle et encore moins une tentative
de subversion de l'Histoire mais bien un regard sur la complexité du réel
pour une invite à repenser les risques du relativisme !
Propos
recueillis par Philippe-Emmanuel Krautter
© Interview exclusive Lexnews
Tous droits réservés
|

"Che Guevara" de Miguel Benasayag, BAYARD,
2003

Ernesto Che Guevara Le socialisme et l'homme"
Editions ADEN 2007.

"Che plus que jamais" sous la direction de
Jean Ortiz, ATLANTICA, 2007.

"Les routes du Che" de Patrick Bark, Seuil,
2007.

"Che" de Pierre Kalfon, Seuil.
|
|
 ien
vers notre Interview
de Miguel BENASAYAG ien
vers notre Interview
de Miguel BENASAYAG
|
|
 |

|